Quelques Remarques Sur La Libération De Nice
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Pr Ovence Mont Ventoux
Pr ovence Mont Ventoux BikePlusTour s Join us for some fabulous cycling in the in Nice and ride the training roads of the pros, Provence and Maritime Alps region of the including Col de la Madone, Eze and Braus. south of France. Late September is a great time to visit this Our itinerary will take you on a spectacular region as the weather is still warm and pleasant journey including the rugged Gorges du Verdon for riding but most of the tourists have left so canyon and the heights of the mighty Mont the roads are quieter. Ventoux. We will stay in ancient towns and We'll be staying for consecutive nights in each experience the typical Provençal food and wine. hotel to give you the chance to have a real At the end of our tour we will spend three nights vacation and relax after our rides. Gorges du Verdon Mazan Old Tow n Mont Vent oux Trip dates: September 19-27, 2020 Cycling distance / vertical: up to 382 miles / 42,000 ft Small group: maximum 15 guests Supported rides with guide on bike and vehicle support Hotel accommodation, with breakfasts and dinners included Price: $2,995 per person, single room surcharge: $695 Luberon Villages: Ansouis Itinerary and Elevation Profiles Friday 18 September: Evening departure from the US on an overnight flight to Nice. Saturday 19 September: Arrival in Nice and group transfer to Moustiers Sainte Marie, a beautifully located town above the massive Lake Sainte Croix reservoir. The town has been known for centuries for its artisanal pottery and is a busy tourist hub as a gateway to the Gorges du Verdon. -

Maritime Alps Summer 2013 Wildlife Tour Report Botanical Birdwatching
Maritime Alps Satyrs and the Ancient King A Greentours Tour Report 16th to 23rd July 2013 Led by Paul Cardy and Stefano Doglio Daily Accounts and Systematic Lists written by Paul Cardy The third of the Greentours summer Alpine trilogy, following on from The Dolomites and Slovenia, was an excellent week in the western Alps, on both the French and Italian sides of the glorious Maritime Alps. Even after more than a decade of leading tours here, and living just to the north in the Cottian Alps, the area still holds some surprises. Plant highlights this year included Lilium pomponium, Allium narcissiflorum, and Saxifraga callosa all in fine flower, the latter locally abundant cascading from cliffs and walls. Special were the endemic Micromeria marginata, the beautiful endemic Viola valderia, and many of the local speciality Nigritella corneliana. New for the tour this year were Orobanche salviae, Phyteuma globulariifolium, Knautia mollis, Achillea tomentosa, Gentiana brachyphylla, and Leuzea conifera. It was also a very good season for butterflies, not quite reaching the lofty heights of 2012’s 124 species, but we recorded approaching 100 species, many in large numbers. The first five nights were spent at a small pleasant family run hotel in the Valdeblore hamlet of La Bolline, a fine location, well situated for all excursions, and with a small grocery and a bakery just along the street where I could do the daily picnic shopping whilst Stefano looked after the group at breakfast. For the last two nights of the tour we moved to the other side of Mercantour National Park, and the hamlet of Casterino, which allowed easy access into the Italian Alpi Maritime, a superbly productive area. -

The Route Des Grandes Alpes (M-ID: 2349)
+49 (0)40 468 992 48 Mo-Fr. 10:00h to 19.00h The Route des Grandes Alpes (M-ID: 2349) https://www.motourismo.com/en/listings/2349-the-route-des-grandes-alpes from €1,799.00 Dates and duration (days) On request 10 days 08/15/2022 - 08/24/2022 10 days The "Route des Grandes Alpes", the supreme discipline among motorbike tours and probably the most famous route through the French Alps, offers us unforgettable riding experiences, framed by breathtaking mountain scenery and distant views that only the French Alps can offer. The tourist high alpine road begins in Thonon-les-Bains, on Arrival at the hotel by 18.00 hrs. the southern shore of Lake Geneva and leads us to Menton on the Côte d'Azur. In between are almost 700 motorcycle During dinner we get to know each other and get in the right kilometres, which will inspire us with 18 Alpine passes and mood for the tour through the French Alps that lies ahead what feels like 10,000 bends and hairpin bends every day. of us. Included in the program is a motorcycle tour to the Verdon Gorge, one of the largest canyons on the continent and will If you arrive by car, parking spaces are available at the hotel inspire you with its breathtaking rock massif and its up to for the duration of the motorcycle tour. 700 m deep gorges. Overnight stay: Near Freiburg (Western Switzerland) Our return journey is no less spectacular, passing Lac de Sainte-Croix and the fortified town of Briancon and Alpine Day 2: Fribourg - Bourg-Saint-Maurice approx. -

Le Tour De France Dans La Métropole Nice Côte D'azur
29 > 31 AOÛT LE TOUR DE FRANCE DANS LA MÉTROPOLE NICE CÔTE D’AZUR VIVEZ L’ÉPREUVE ÉTAPE PAR ÉTAPE LEVENS Fermeture M14-M719 (vers Tourrette-Levens) 12h30 - 19h SAMEDI 29 AOÛT Fermeture Carrefour M19-M20 12h30 - 19h10 Fermeture M20 (vers La Roquette-sur-Var) 13h - 19h10 ÉTAPE 1 Caravane 15h09 Tour de France (3e passage) 16h56 LA ROQUETTE-SUR-VAR Fermeture M20 (vers Levens) 13h - 19h10 Caravane 15h22 Tour de France (3e passage) 17h05 SAINT-MARTIN-DU-VAR Fermeture M6202 (jusqu’au giratoire Saint-Blaise) 13h - 19h10 Fermeture M6202 (du giratoire Saint-Blaise au pont de la Manda) 8h - 19h10 Caravane 15h30 Tour de France (3e passage) 17h10 TOURRETTE-LEVENS CASTAGNIERS Fermeture M14-M719 (vers Aspremont et Levens) 12h30 - 19h Fermeture M614-M6202 et giratoire de Castagniers 8h - 19h10 Caravane 14h52 Course féminine « By le Tour » (1e passage) 10h40 Tour de France (3e passage) 16h44 Course féminine « By le Tour » (2e passage) 11h51 Caravane 16h Tour de France (1e passage) 14h37 Tour de France (2e passage) 15h43 Tour de France (3e passage) 17h17 ASPREMONT Fermeture M14-M614 (vers Castagniers) 8h - 19h Fermeture M14-M114 (vers Falicon/Nice) 8h - 18h45 Fermeture M14-M719 (vers Tourrette-Levens) 12h30 - 19h10 Course féminine « By le Tour » (1e passage) 10h28 CARROS Course féminine « By le Tour » (2e passage) 11h39 Fermeture giratoire / pont de la Manda 8h - 19h Caravane 14h43 e Fermeture M6202bis (de la 8 rue au giratoire Du 28/08 à 21h Tour de France (1e passage) 14h26 des baraques de Nice) au 31/08 à 15h Tour de France (2e passage) 15h32 e Course -

Download Detailed Description
From the French-Italian border down to the Mediterranean Departure Nice » Arrival Monaco - Hike from Limone Piemonte to Monaco 7 Days | 6 nights | Difficulty | Max. difficulty In this one-week hike, you will leave Nice on board a picturesque train to plunge into the eastern Maritime Alps and cross into Italy. You will walk back to the very end of the Via Alpina in Monaco, alternating between the Red and Blue trails in the Mercantour National Park and also taking in the famous Vallée des Merveilles with its breathtaking rock engravings. Period recommended : mid-June to mid-October Public transport at departure "Train des Merveilles" to Tende then change: Nice-Ville 9h24, Tende 11h05/13h05, Limone (Italia) 13h25 (route 5, Nice-Cuneo). http://www.ter-sncf.com/Regions/paca/Fr/Se_deplacer_en_TER/Avant_mon_voyage/Fiches_horaires/Default.aspx Public transport at arrival Trains every half hour to Nice and Ventimiglia (25 min. each) www.bahn.de Lodgings at departure Gablonzer Hütte ~ +43 6136 8465 (offi[email protected]) Hotel Berghof ~ +43 4285 8271-0 ([email protected]) Rifugio E.Questa ~ +39 351 5835607 ([email protected]) Foresteria di Carnino ~ (+39) 0174 390194 ([email protected] ) Auberge de jeunesse Les Camélias ~ +33 4 93 62 15 54 ([email protected]) Auberge de jeunesse du Mont Boron ~ +33 4 93 89 23 64 ([email protected]) Bed & Breakfast 'L Mai ( [email protected]) Useful topographic maps Ref. / Name Publisher Scale TOP25 3741OT IGN 1:25.000 Alpes Sans Frontières n°4 - Vallée des Merveilles / Val Vermenagna IGN-IGM 1:25.000 TOP25 3741ET IGN 1:25.000 Day 1 : Nice - Limonetto Difficulty | Walking time 1h30 min | 200 m | 0 m Starting from Nice-Ville train station, you travel on board the Train des Merveilles tourist railway to discover the Paillon and Roya-Bévéra valleys. -
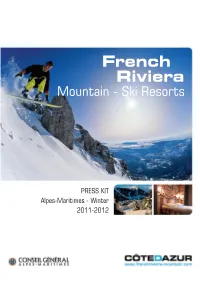
Mise En Page 1
French Riviera Mountain - Ski Resorts PRESS KIT Alpes-Maritimes - Winter 2011-2012 ABBREVIATIONS Motorway Dual carriageway Major roads Minor roads Tourist itinerary Borders Railway Station Tourist resort Ski resort Alpine skiing Cross-country skiing Snowpark MAP p. 4 Ski resorts in the Alpes-Maritimes, key figures, trends, investment, the challenges… p. 6 Key figures p. 7 Trends p. 8 Major investments p. 9 Challenges in the development of the ski resorts in Alpes-Maritimes p. 10 The press: we like what the journalists have written p. 11 A wealth of young champions p. 13 Events - winter 2011-2012 SUMMARY p. 16 Ski resorts in the Alpes-Maritimes, every one different! p. 18 Good holidays start with good ideas p. 18 Internet, gateway to the resorts p. 19 Isola 2000 p. 22 Auron p. 24 Saint-Dalmas-Le-Selvage p. 25 Valberg p. 27 Beuil-Les-Launes p. 27 Val Pelens - Saint-Martin-d’Entraunes p. 27 Estenc-Entraunes p. 28 La Colmiane-Valdeblore p. 29 Le Boréon (Saint-Martin-Vésubie) p. 31 Roubion-Les-Buisses p. 33 Turini-Camp d’Argent p. 33 Peïra-Cava p. 34 Castérino - Tende p. 35 Gréolières-Les-Neiges p. 36 L’Audibergue-La Moulière p. 38 Handiski p. 39 Practical Information SUMMARY 2 3 SKI RESORTS IN THE ALPES-MARITIMES KEY FIGURES – TRENDS – INVESTMENT... THE CHALLENGES 4 5 The Alpes-Maritimes ski resorts will be open from the beginning of December 2011 to mid-April 2012. This Department (c.f. English county), with its 15 resorts including 3 international ones (Isola 2000 – Auron and Valberg), pays special attention to the development of its mountain areas so as to ensure rapid access, top-quality skiing and the provision of other activities for non- skiing snow lovers. -

Le Bulletin De L'
Association généalogique des Alpes-Maritimes Le bulletin de l’ Trimestriel . N° 28 Décembre 2014 Chers amis généalogistes, Je crois que cette année nous avons dépassé tous les records en nombre de manifestations et d’événements que nous avons organisés ou auxquels nous avons participé. Nous avons eu énormément de journées généalogiques, non seulement dans le département, mais aussi à l’extérieur pour des événements généalogiques auxquels nous avons été invités comme Mauguio, Saint-Raphaël où se sont tenues les journées régionales de généalogie, Péronnas en Rhône-Alpes ou La Côte-Saint-André en Isère. Le projet Bleuets, quant à lui, a été présent partout, d’abord sur le terrain, puis dans la presse et sur les ondes. Le point d’orgue de son activité ayant été les premières rencontres généalogiques sur la Grande Guerre au palais des rois sardes à Nice. Son initiative d’exposition itinérante sur les chasseurs alpins a également remporté un grand succès, non seulement auprès du public, mais aussi auprès de nos élus qui la redemandent. Tout cela est un travail d’équipe qui a parfois des hauts et des bas ; il ne faut pas perdre de vue que la potion magique de la réussite se trouve avant tout dans le dialogue et la mise en valeur des qualités de chacun. Je tiens à ce propos à remercier l’ensemble des bénévoles qui sont la clef de voûte de nos activités et de nos manifestations, car sans eux il n’y aurait pas l’AGAM. Je profite de ces quelques lignes pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année avec vos proches et j’espère vous retrouver très nombreux pour notre assemblée générale fin janvier. -

SPORTS CALENDAR 2021 #Cotedazurfrance
SPORTS CALENDAR 2021 #CotedAzurFrance 28 : Marathon of St Tropez A unique running race combining vineyards, hills and seaside. marathondugolfedesainttropez.com SPORT EVENTS CALENDAR #CotedAzurFrance - 2021 APRIL 10-18 : ROLEX MONTE-CARLO MASTERS - Monaco JANUARY The first of three ATP Masters 1000 tournaments played on clay. Until 19 : HORSE RIDING- WINTER MEETING - Cagnes-sur-Mer The tournament is a player and fan favorite due to its magnificent location, The winter meeting is an international meeting from mid december to mid march at the Monte-Carlo Country Club, and long tradition of champions. the hippodrome of Cagnes sur Mer. montecarlotennismasters.com hippodrome-cotedazur.com. 23-25 : CANNES INTERNATIONAL TRIATHLON - Cannes 08 & 09 : ANDROS TROPHY - Isola 2000 8th Edition of Cannes international triathlon ! Exceed your limits in a magnificent one stage of the French national Ice racing Championship with famous pilots setting ! tropheeandros.com cannes-international-triathlon.com 18 -24 : 89th MONTE-CARLO RALLY – Monaco Famous car rallye, over 85% of the route has been changed, compared to the NEW 30 April – 02 May : OUTDOOR FESTIVAL 06 previous edition, and the 2021 program is a brand new mix of difficulties, 1st Outdoor Festival of the Alpes Maritimes to discover and experience the sport alternating classic stages and new portions and outdoor activities on ground, in air or in the sea. acm.mc The Exhibition hall will be located in Cannes. departement06.fr/terre-de-sports/outdoor-festival-06-29302.html 30-04 February HISTORIC RALLYE OF MONTE CARLO - Monaco The Historic version of the world’s most ancient road rally is reserved to cars that MAY have entered at least one Rallye Automobile Monte-Carlo between 1911, the year 01-02 : ONE & 1 RUN TO CAMP – Tourrettes sur Loup when it was created, and 1983, so that a greater number of models are allowed to 2 days of racing per stage and by team of 2 with a breathtaking itinerary in the enter the 2021 edition. -

L'étape DU TOUR DE FRANCE 2020: a Major First Un Nice for the 30Th
Nice, October 3rd 2020 L’ÉTAPE DU TOUR DE FRANCE 2020: A major first un Nice for the 30th Key points: ➢ The date for the 30th edition of the Étape du Tour de France has been reserved for 5th July 2020. One week after the professionals, the amateur riders will follow the roads of the 2nd stage on the Tour de France, over a distance of 177 km, starting and finishing in Nice. ➢ In the history of the Étape du Tour de France, it is both the first loop stage and the first to be ridden along the coast. However, during their trek, the 16,000 amateur cyclists expected will twice climb to more than 1,500 metres above sea level on the Col de la Colmiane and Col de Turini. ➢ Bernard Thévenet will be ambassador of the Étape du Tour de France and the Grand Départ of the Tour de France 2020 in Nice. ➢ Registration opens on 21st October at 16.00 on the time to web site. When the Tour de France takes on a southern accent, mountainous stages can be found on the route right from the start. This will indeed be the case in 2020 with the Grand Départ in Nice taking advantage of the Southern Alps from as early as the second stage. The loop-shaped route will be taken several days after the elite riders by the amateur cyclists who sign up for the Étape du Tour de France. Naturally, it is a challenge made for the climbers among the 16,000 participants expected, because over 177 kilometres of racing the expedition will gobble up a total upward gradient of 3,570 metres. -

DP Neige 2012-2013 GB.Indd
PRESS KIT Côte d'Azur The Mountains Winter 2012-2013 MONTAGNE.com FRENCH RIVIERA THE MOUNTAINS SKIING WITH A SEA VIEW! The easiest access to the Alpes-Maritimes ski resorts is from the coast. This is an important point in favour of the destination French Riviera! Stylish clients will fi nd the most prestigious ski equipment brand (Moncler) in Cannes. Moncler opened its new shop last spring at 14, La Croise e. Transfers are arranged to allow clients to be on the snow-covered slopes of the Alpes-Maritimes ski resorts in less than 30 minutes. In the evening, everyone can be back in the most prestigious hotels on the coast – hotels that make the French Riviera famous. Adult beginners can take advantage of free initiation off ers at Auron and Isola 2000 to learn about snow sports without charge thanks to the collaboration of the resorts and the ESF (French Ski School). They can then use around 100 blue and green runs to explore the resorts and their amazing scenery! Family clients will fi nd options where classes and activities are organized especially for children in 15 ski resorts and Nordic areas. "Adventurers" can experience the most extreme activities in the heart of the “Parc National du Mercantour” or the “Parc Naturel Régional des Pré-Alpes d’Azur”: constructing igloos, ice falls, paragliding... Sea view! Finally, the feature that sets the Alpes- Maritimes ski resorts apart is the fact that, on a fi ne day, skiers can see the sea from three of our resorts: Valberg – Isola 2000 and Gréolières-Les-Neiges! Find out all about the Destination -

2019 MEDIA GUIDE Rallye Monte-Carlo January 24 - 27, 2019
2019 MEDIA GUIDE Rallye Monte-Carlo January 24 - 27, 2019 ROUND 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Rallye Monte-Carlo January 24 - 27, 2019 HYUNDAI’S HELLO A very warm welcome from all at Hyundai Motorsport to Rallye Monte-Carlo and to the start of our sixth season in the FIA World Rally Championship. Having fought so hard for both the Drivers’ and Manufacturers’ titles in 2018, the winter break not only provided an opportunity to recharge our batteries, it was also a great chance to assess how we could be stronger during the season ahead. We therefore begin 2019 rejuvenated and with a firm battle plan in place. Being appointed Team Director of Hyundai Motorsport is a completely new challenge for me and a step forward from what I’ve done so far, which gives me even more motivation to work together with the team to reach our goals. Our objectives for WRC remain the same as they have always been, namely to fight for the Manufacturers’ and Drivers’ titles. This is important for Hyundai and our N brand. The WRC is incredibly competitive and the other teams will want to approach the new season with the same winning mind-set. We have to make sure we’re delivering and performing at our best at all times. In my new role, it is a real privilege to welcome Sébastien Loeb and Daniel Elena to the Hyundai Motorsport family. Nine-time world champions, they will contest six rounds with our team, starting on Rallye Monte-Carlo, an event they have won a record seven times. -

Carte Des Boucles Cyclosportives Et Grands
LES ALPES-MARITIMES CARTE DES BOUCLES CYCLOSPORTIVES ET GRANDS TOURS ITINÉRANTS MAP OF SPORTS CIRCUITS AND LONG-DISTANCE “GRAND TOURS” MAPPA DEI CIRCUITI CICLOSPORTIVI E DEI GRANDI GIRI ITINERANTI DES PARCOURS D’EXCEPTION Reliefs sinueux, cols mythiques, richesse des paysages, douceur du climat : dans les Alpes-Maritimes, tous les atouts sont réunis pour conjuguer performance sportive et découverte du patrimoine au gré d’une randonnée à vélo. Vous pourrez les apprécier pleinement, sur un ou plusieurs jours, en suivant les itinéraires spécialement conçus à votre intention. Dans chacun de ces parcours, aussi exigeants qu’épanouissants, les cyclistes aguerris relèveront des défis à la mesure de leur passion, tout en contemplant les mille et un joyaux qui bordent nos routes. À vos vélos pour éprouver des sensations fortes en plein air et glaner, au fil des ascensions, des souvenirs inoubliables. Eric CIOTTI Député, Président du Département des Alpes-Maritimes EXCEPTIONAL TRAILS Winding hills, famous mountain passes, sheer diversity of landscapes and a balmy climate: the Alpes-Maritimes has it all when it comes to combine sports and sightseeing, with visitors invited to discover the local heritage over a cycling trail. By following itineraries specifically designed to meet your interests and needs, trully enjoy your visit during one or several days. As challenging as they are fascinating, all of these routes give seasoned cyclists the opportunity to align performance with passion, while taking in the thousands of gems that line our roads. Hit the road and prepare to live a thrilling open-air experience, collecting unforgettable memories with every twist and turn along the way.