L'aventure De La Médecine
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Encuentro Internacional Sobre La Historia Del Seguro
Instituto de Ciencias del Seguro Encuentro Internacional sobre la Historia del Seguro © FUNDACIÓN MAPFRE Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra sin el permiso escrito del autor o de FUNDACIÓN MAPFRE FUNDACIÓN MAPFRE no se hace responsable del contenido de esta obra, ni el hecho de publicarla implica conformidad o identificación con la opinión de los autores. Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra sin el permiso escrito del autor o del editor. © 2010, FUNDACIÓN MAPFRE Paseo de Recoletos 23 28004 Madrid (España) www.fundacionmapfre.com/cienciasdelseguro [email protected] ISBN: 978-84-9844-210-6 Depósito Legal: SE-6825-2010 © FUNDACIÓN MAPFRE Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra sin el permiso escrito del autor o de FUNDACIÓN MAPFRE PRESENTACIÓN En el marco de los actos conmemorativos del 75 Aniversario de MAPFRE tuvo lugar en Madrid, los días 8 y 9 de mayo de 2008, el Encuentro Internacional sobre la Historia del Seguro en el que, con la participación de prestigiosos especialistas, se analizó la Historia del Seguro en Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, España y Suecia, así como en Estados Unidos, Japón y los países de América Latina. La idea de convocar este Encuentro Internacional surgió durante el proceso de elaboración del libro De Mutua a Multinacional. MAPFRE 1933 / 2008, por los historiadores Gabriel Tortella, Leonardo Caruana y José Luis García Ruiz. La organización del Encuentro Internacional estuvo a cargo de Andrés Jiménez, Presidente de MAPFRE RE y de la Comisión del 75 Aniversario de MAPFRE, y del profesor Leonardo Caruana. -

Fiches Thématiques Europresse
REGARDS ANGLOPHONES SUIVEZ CETTE ACTUALITÉ AVEC : • The Independent (Grande Bretagne) RESTEZ INFORMÉ • The Financial Times (Grande AVEC EUROPRESSE ! Bretagne) • The Trade (Royaume-Uni) • The Daily Star (Liban) • Daily Tribune (Bahreïn - site web réf.) Consultez toutes les • Gulf News (Emirats Arabes Unis – site sources pour les web) bibliothèques • The Observer (Australie) publiques et de • The Chronicle ( Australie) l’enseignement sur • Xinhua – News Agency (China) www.europresse.com. • The Korea Times (Corée du Sud) • The New-York Times (Etats-Unis) • Indian Currents (Inde) • Japon Economic Foundation (Japon) … Et bien d’autres titres ! L’ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE ET POLITIQUE FRANÇAISE SUIVEZ CETTE ACTUALITÉ AVEC : • Le Monde RESTEZ INFORMÉ • Le Figaro AVEC EUROPRESSE ! • Libération • Les Echos • L’Obs • La Tribune Consultez toutes les • La Croix sources pour les • L’Humanité bibliothèques • L’Express publiques et de • Le Point l’enseignement sur • Challenges www.europresse.com. • Le Parisien Economie • Bulletin Quotidien • Les Dossiers de l’actualité • Valeurs actuelles … Et bien d’autres titres ! REGARDS FRANCOPHONES SUIVEZ CETTE ACTUALITÉ AVEC : RESTEZ INFORMÉ • Le Temps (Suisse) AVEC EUROPRESSE ! • La Tribune de Genève (Suisse) • Le Soir (Belgique) • La Libre Belgique (Belgique) • L’Orient – Le Jour (Liban) Consultez toutes les • El Watan (Algérie) sources pour les • La Tribune Afrique (Maroc) bibliothèques • Le Matin (Maroc – site web réf) publiques et de • Le Temps Tunis (Tunisie) l’enseignement sur • Le Devoir (Canada) www.europresse.com. • L'Actualité (Canada) …. Et bien d’autres titres ! PRESSE GRAND PUBLIC SUIVEZ CETTE ACTUALITÉ AVEC : • L’Équipe RESTEZ INFORMÉ • Télérama AVEC EUROPRESSE ! • Science et Avenir • TéléObs • Auto Moto Consultez toutes les • Marie France sources pour les • Maison Côté Ouest bibliothèques • Historia publiques et de • Le Nouveau Magazine Littéraire l’enseignement sur • Maison et Travaux www.europresse.com. -
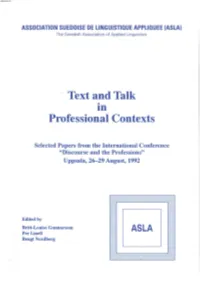
Text and Talk Professional Contexts
ASSOCIATIONSUEDOISE DE LINGUISTIQUE APPLIQUEE (ASLA) The Swedish Association of Applied Linguistics Text and Talk • ID Professional Contexts Selected Papers from the International Conference "Discourse and the Professions" Uppsala, 26-29 August, 1992 Edited by Britt-Louise Gunnarsson ASLA Per Linell Bengt Nordberg ASLA:s skriftserie 6 ASSOCIATION SUEDOISE DE LINGUISTIQUE APPLIQUEE (ASLA) The Swedish Association of Applied Linguistics Text and Talk in Prof essional Contexts Selected Papers from the lnternational Conference "Discourse and the Professions" Uppsala, 26-29 August, 1992 Edited by Britt-Louise Gunnarsson Per Linell Bengt Nordberg ASSOCIATION SUEDOISE DE LINGUISTIQUE APPLIQUEE (ASLA) The Swedish Association of Applied Linguistics ASLA is part of the international organisation AILA, which has members in more than thirty countries all over the world. The main aim of the association is to promote and disseminate information about linguistic research relating to practical language problems in society. ASLA's activities areas follows: - arranging conferences, symposia and seminars, - publishing a newsletter for its members, - publishing symposium proceedings and other material, - distributing information and published material from AILA, - taking part in AILA's scientific commissions, committees and conferences. The newsletter "ASLA Information" is sent out three times a year. It gives details of literature, conferences etc. One issue a year also contains a section presenting ongoing research and developments in applied linguistics. A yearly symposium is arranged, with a theme which is of interest to researchers and practitioners. The proceedings of these autumn symposia are published in ASLA's publication series. The books in this series are yearbooks and they are distributed free of charge to ASLA members. -

PRESSE MAGAZINE - Synthèse Observatoire 2011
PRESSE GRAND PUBLIC - synthèse Observatoire 2011 P E R F O R M A N C E S Total de la diffusion 2010 Total de la diffusion France 2010 Quotidiens + France Etranger France + Etranger Périodiques Total Presse GP 7ème Jour Diffusion payée 4 169 728 515 142 370 730 4 312 099 245 Diffusion Payée 2 266 102 510 1 903 626 005 4 169 728 515 Répartition 96,70% 3,30% Diffusion Non Payée 65 324 394 36 402 749 101 727 143 Diffusion non payée 101 727 143 9 617 381 111 344 524 Diffusion Totale 2 331 426 904 1 940 028 754 4 271 455 658 Diffusion Totale 4 271 455 658 151 988 111 4 423 443 769 Répartition de la diffusion France payée 2010 Répartition de la diffusion France payée 2010 Ventes 2 172 300 122 Ventes 1 129 083 563 1 043 216 559 2 172 300 122 Abonnements 919 312 098 Abonnements 277 046 419 642 265 679 919 312 098 Portage 1 064 975 526 Portage 859 971 620 205 003 906 1 064 975 526 Diffusion Différée Payée 13 140 769 Diffusion Différée Payée 908 13 139 861 13 140 769 R E P A R T I T I O N S 2 0 1 0 E V O L U T I O N S Répartition par canal de diffusion Répartition Diffusion Individuelle - Diffusion par Tiers et Différée Evolution des types de diffusion - Diffusion France Payée 0,32% Diffusion France Payée 5,24% Indice base 100 0,32% Diffusion France Payée 130 25,54% 120 Ventes Diffusion par Tiers 120 Ventes N° Diffusion Différée Individuelles 110 Abonnements Diffusion Individuelle Diffusion par tiers 101 et différée 100 Portage Abos Individuels + 52,09% 92 90 Portage Diffusion Différée Diffusion France 22,05% 80 Payée 79 Payée 94,44% 70 2005 2006 -

Associations Pour Le Contrôle De La Diffusion Des Médias
Associations pour le Contrôle de la Diffusion des Médias PRESSE GRAND PUBLIC - synthèse Observatoire 2010 P E R F O R M A N C E S Total de la diffusion 2009 Total de la diffusion France 2009 Quotidiens + France Etranger France + Etranger Périodiques Total Presse GP 7ème Jour Diffusion payée 4 260 849 836 145 542 539 4 406 392 375 Diffusion Payée 2 319 620 712 1 941 229 124 4 260 849 836 Répartition 96,70% 3,30% Diffusion Non Payée 69 287 509 39 362 253 108 649 762 Diffusion non payée 108 649 762 10 257 920 118 907 682 Diffusion Totale 2 388 908 221 1 980 591 377 4 369 499 598 Diffusion Totale 4 369 499 598 155 800 459 4 525 300 057 Répartition de la diffusion France payée 2009 Répartition de la diffusion France payée 2009 Ventes 2 266 667 452 Ventes 1 185 559 247 1 081 108 205 2 266 667 452 Abonnements 947 140 971 Abonnements 297 148 655 649 992 316 947 140 971 Portage 1 035 613 355 Portage 836 910 989 198 702 366 1 035 613 355 Diffusion Différée Payée 11 428 058 Diffusion Différée Payée 1 821 11 426 237 11 428 058 R E P A R T I T I O N S 2 0 0 9 E V O L U T I O N S Répartition par canal de diffusion Répartition Diffusion Individuelle - Diffusion par Tiers et DifféréeEvolution des types de diffusion - Diffusion France Payée Diffusion France Payée Indice base 100 0,27% 4,48% 0,27% Diffusion France Payée 120 24,30 Ventes Diffusion par Tiers Ventes N° 110 Diffusion Différée Individuelles Abonnements 105 Diffusion par tiers Diffusion Individuelle 101 et différée Portage 100 Abos Individuels + 53,20% Portage 92 22,23% Diffusion Différée 90 -

Le Mal Jaune: the Memory of the Indochina War in France, 1954-2006
Le Mal Jaune: The Memory of the Indochina War in France, 1954-2006 by Maura Kathryn Edwards A thesis submitted in conformity with the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Department of History University of Toronto © Copyright by M. Kathryn Edwards 2010 Le Mal Jaune: The Memory of the Indochina War in France, 1954-2006 Maura Kathryn Edwards Doctor of Philosophy Department of History University of Toronto 2010 Abstract National historical memory in France has often given rise to violent polemic. Controversial episodes of national history, such as the Second World War and Algerian conflict, have attracted considerable attention. Yet despite its obvious importance as a particularly violent war of decolonization and precursor to the Vietnam War, the First Indochina War (1946-54) has largely been ignored. In the context of decolonization and the beginning of the Cold War, however, Indochina offers a unique example of the complex relationship between event, commemoration, and memory. This dissertation examines state commemorations, official and unofficial sites of memory, film and other media representations of the war, and several “flashpoint” events that have elicited particularly heated debates over the legacies of the war. The thematic structure allows me to bring together various vehicles and artefacts of memory, from monuments to commemorative ceremonies to veterans‟ associations, along with less tangible expressions of memory expressed through public debates and film. I also analyze the tangible legacy of colonialism in the metropole: the „repatriate‟ camps that housed primarily French ii citizens of Vietnamese, Lao and Cambodian origin after 1956. This chapter makes an important contribution to the history of immigration to France, which is critical to understanding issues currently facing this multicultural society. -

Libby Magazine Titles As of January 2021
Libby Magazine Titles as of January 2021 $10 DINNERS (Or Less!) 3D World AD France (inside) interior design review 400 Calories or Less: Easy Italian AD Italia .net CSS Design Essentials 45 Years on the MR&T AD Russia ¡Hola! Cocina 47 Creative Photography & AD 安邸 ¡Hola! Especial Decoración Photoshop Projects Adega ¡Hola! Especial Viajes 4x4 magazine Adirondack Explorer ¡HOLA! FASHION 4x4 Magazine Australia Adirondack Life ¡Hola! Fashion: Especial Alta 50 Baby Knits ADMIN Network & Security Costura 50 Dream Rooms AdNews ¡Hola! Los Reyes Felipe VI y Letizia 50 Great British Locomotives Adobe Creative Cloud Book ¡Hola! Mexico 50 Greatest Mysteries in the Adobe Creative Suite Book ¡Hola! Prêt-À-Porter Universe Adobe Photoshop & Lightroom 0024 Horloges 50 Greatest SciFi Icons Workshops 3 01net 50 Photo Projects Vol 2 Adult Coloring Book: Birds of the 10 Minute Pilates 50 Things No Man Should Be World 10 Week Fat Burn: Lose a Stone Without Adult Coloring Book: Dragon 100 All-Time Greatest Comics 50+ Decorating Ideas World 100 Best Games to Play Right Now 500 Calorie Diet Complete Meal Adult Coloring Book: Ocean 100 Greatest Comedy Movies by Planner Animal Patterns Radio Times 52 Bracelets Adult Coloring Book: Stress 100 greatest moments from 100 5280 Magazine Relieving Animal Designs Volume years of the Tour De France 60 Days of Prayer 2 100 Greatest Sci-Fi Characters 60 Most Important Albums of Adult Coloring Book: Stress 100 Greatest Sci-Fi Characters Of NME's Lifetime Relieving Dolphin Patterns All Time 7 Jours Adult Coloring Book: Stress -

Calcul Reprise En Main
Calcul reprise en main Ensemble Hommes Femmes Foyers CSP+ Hebdomadaire 01net Micro Hebdo 4.6687 4.966 - - L’Argus - - - - Auto Plus 3.2122 3.4253 - 3.4267 Challenges - - - - Closer 2.668 1.893 2.9611 2.2737 Courrier International 3.8206 4.1213 - - Elle 2.6646 - 2.9974 3.2574 L’Equipe Magazine 2.5847 2.7435 - 2.953 L’Express 3.2205 3.2355 3.2036 3.417 Femme Actuelle 2.6198 2.0005 2.8062 2.1492 Le Figaro Magazine 3.2878 3.7598 2.8313 - France Dimanche 1.3287 - - - France Football 3.2621 3.587 - - Gala 1.4563 - 1.482 - Grazia 3.3354 - - - Ici Paris 1.7158 - - - Les Inrockuptibles - - - - M. le Magazine du Monde 3.4382 3.8237 2.9452 3.9173 Madame Figaro 2.3931 - 2.2618 - Marianne 4.3649 4.6595 3.9456 3.9999 Maxi 2.1236 - 2.3763 - Nous Deux 3.0068 - 3.2029 - Le Nouvel Observateur 4.8498 4.8817 4.8142 4.2894 L’Officiel des Spectacles - - - - Paris Match 2.3107 2.5583 2.167 2.1015 Pariscope - - - - Pèlerin 4.5143 - - - Le Point 3.8641 4.3247 3.3572 3.2518 Point de Vue - - - - Public 3.4385 - 3.7534 2.5565 Rustica 3.4001 - 3.7386 - Télé 7 Jours 8.7894 8.4457 9.0999 6.9289 Télé Loisirs 9.0367 8.7492 9.2871 8.3154 Télé Magazine 3.9731 3.5963 4.3253 - Télé Poche 8.0146 7.3465 8.5206 7.167 Télé Star 9.3585 8.9047 9.7155 8.3745 Télé Z 10.0885 9.2291 10.7869 9.2335 Télécâble Sat Hebdo 12.3941 13.5429 11.1132 10.1522 Calcul reprise en main Ensemble Hommes Femmes Foyers CSP+ Télérama 11.3051 10.8996 11.6513 10.741 TV Magazine 6.1157 6.4899 5.7934 5.1066 Version Femina 2.4471 2.4133 2.4645 2.7751 La Vie 5.1483 - - - Voici 1.6006 - 1.6069 - VSD - - - - -

This Is an Accepted Manuscript of an Article Published in Revue D'histoire De La Shoah
“This is an accepted manuscript of an article published in Revue d'histoire de la Shoah. It is not the copy of record.” After “Holocaust”. The Shoah in televised fiction in Italy and in France: a compared reading of public memory and representation (1979-2011) Emiliano Perra University of Winchester In the vast and ever expanding body of scholarly works exploring Holocaust memory and representation, television is a relatively late and largely overdue addition. This relatively small, but steadily growing body of work shows that if we want to understand the place of this event in popular memory culture, we need to look at television. Much of the existing literature in this field centres on the analysis of single countries such as the United States, Germany, Israel, Britain, or the two discussed in this article, France and Italy.1 However, only a handful of studies have developed a comparative approach,2 and most of this body of work is about documentaries, while works of fiction such as made-for-TV films, miniseries and series are still relatively understudied.3 And yet, TV fictions are important. As the then Fiction Manager for France Télévisions (and currently Project Manager for ARTE France) Vincent Meslet stated in 2010, ‘la fiction, c'est une 1 See at least Jeffrey SHANDLER, While America Watches: Televising the Holocaust, New York (NY), Oxford University Press, 1999 on the United States; Wulf KANSTEINER, In Pursuit of German Memory: History, Television, and Politics after Auschwitz, Athens (OH), Ohio University Press, 2006 on Germany; Oren MEYERS, Eyal ZANDBERG, and Motti NEIGER, «Prime Time Commemoration: An Analysis of Television Broadcasts on Israel’s Memorial Day for the Holocaust and the Heroism», in Journal of Communication, 59, 2009, p. -

Music, Youth and Moral Panics in France, 1960 to Present
HAOL, Núm. 11 (Otoño, 2006), 51-64 ISSN 1696-2060 MUSIC, YOUTH AND MORAL PANICS IN FRANCE, 1960 TO PRESENT Chris Warne University of Sussex, United Kingdom. E-mail: [email protected] Recibido: 18 Abril 2006 / Revisado: 12 Mayo 2006 / Aceptado: 17 Mayo 2006 / Publicación Online: 15 Octubre 2006 Abstract: French society since 1945 has been inequity of the distribution of wealth and characterised by a generally negative social opportunity across age groups, with those discourse on youth, frequently precipitated by following the baby-boomers inevitably falling specific anxieties that relate to the emergence of on the wrong side of the equation 1. apparently new groups onto the social scene. This article undertakes a comparative study of If the general tone of social representation of two such moments, when moral panics and an French youth has been marked by a certain accompanying discourse of control developed in caution, even a certain pessimism, then it is also relation to the apparence of new forms of true to say that the evolution of this social popular music in France: rock’n’roll in the early representation has been marked by a series of 1960s, and techno in the mid-1990s. On the ruptures and breaks, where new youth groups basis of this comparison, it draws some emerge spectacularly on to the social scene. conclusions about the relationship between France has passed through a succession of regulatory authority and the ordinary citizen in moments where interventions by specific groups France, and about the evolving role of the state. of young people have acted as a focus for Keywords : popular music, France, Fifth debate, discussion and questioning about the Republic, youth, techno, rock’n’roll. -

Economic and Financial...Qxd
June2 2001 Economic and Financial Press. From the Beginnings to the First Oil Crisis This publication is copyright. Apart from any fair dealing for the purpose of study, research, criticism, or review, as permitted under the Copyright Act in con- junction with international copy- right agreements, no part may be reproduced for any purpose with- out written permission of the publisher. La Fundación Diálogos ha colaborado en la edición de esta monografía. © 2001. Ángel Arrese Ediciones Universidad de Navarra, S.A. (EUNSA) Plaza de los Sauces, 1 y 2. 31010 Barañáin (Navarra) España Phone: (34) 948 25 68 50 – Fax: (34) 948 25 68 54 e-mail: [email protected] ISBN: 84-313-1893-7 Depósito legal: NA 1.839-2001 Design by: Angardi Consultores Creativos Printed by: Line Graphic, S.A. Hnos. Noáin, 11. Ansoáin (Navarra) Printed in Spain June2 2001 Economic and Financial Press. From the Beginnings to the First Oil Crisis Ángel Arrese EDICIONES UNIVERSIDAD DE NAVARRA, S.A. PAMPLONA CONTENTS INTRODUCTION 9 I ANTECEDENTS: INFORMATION FOR TRADE AND TRADE OF INFORMATION (FROM THE ORIGINS TO THE FIRST THIRD OF THE 19TH CENTURY) 1. COMMERCIAL INFORMATION SYSTEMS AND THE FIRST ECONOMIC CONTROVERSIES 19 1.1. Private information networks and current price sheets 19 Number Two 7 1.2. Information on the Amsterdam and London markets 23 1.3. First debates on free trade 28 June 2001 2. THE PUBLIC DISCUSSION ABOUT THE PRINCIPLES OF POLITICAL ECONOMY 33 2.1. Encyclopaedists and physiocrats 34 2.2. The first English economists and the reviews 40 2.3. Economic news in the general and political press 44 II BIRTH OF THE ECONOMIC PRESS: BETWEEN THE ECONOMIST AND BUSINESS MAGAZINES (FROM THE THIRTIES IN THE 19TH CENTURY TO THE 1929 CRISIS) 1. -

Press Coverage of the French Colonial Expositions of 1922 and 1931
University of Central Florida STARS Electronic Theses and Dissertations, 2004-2019 2015 Visions of Race and Gender: Press Coverage of the French Colonial Expositions of 1922 and 1931 Zachary Morgan University of Central Florida Part of the History Commons Find similar works at: https://stars.library.ucf.edu/etd University of Central Florida Libraries http://library.ucf.edu This Masters Thesis (Open Access) is brought to you for free and open access by STARS. It has been accepted for inclusion in Electronic Theses and Dissertations, 2004-2019 by an authorized administrator of STARS. For more information, please contact [email protected]. STARS Citation Morgan, Zachary, "Visions of Race and Gender: Press Coverage of the French Colonial Expositions of 1922 and 1931" (2015). Electronic Theses and Dissertations, 2004-2019. 1157. https://stars.library.ucf.edu/etd/1157 VISIONS OF RACE AND GENDER: PRESS COVERAGE OF THE FRENCH COLONIAL EXPOSITIONS OF 1922 AND 1931 by ZACHARY MICHAEL MORGAN B.A. University of Central Florida, 2011 A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts in the Department of History in the College of Arts and Humanities at the University of Central Florida Orlando, Florida Spring Term 2015 © 2015 Zachary Morgan ii ABSTRACT During the interwar period, France attempted to reinvigorate interest in the empire amongst the public via elaborate colonial expositions. The colonial expositions of Marseille (1922) and Paris (1931) served as a means to celebrate the empire and to educate the French about the benefits of living within Greater France, an entity that included the metropole and the colonies.