Le Commerce Équitable À L'épreuve De La Mode
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Quel Commerce Équitable Pour Quel Développement Durable ?
Manuscrit auteur, publié dans "Innovations, cahiers d'économie de l'innovation, 30 (2009) 99-113" A paraître dans : Innovations, cahiers d’économie de l’innovation, n° 30, 2nd semestre 2009 Quel commerce équitable pour quel développement durable ? Ronan Le Velly Maître de conférences en Sociologie Montpellier SupAgro, UMR Innovation 2 place Viala, 34060 Montpellier cedex 1, France [email protected] Résumé A travers l’exposé de quatre controverses, portant respectivement sur le travail avec des plantations dépendant d’une main d’œuvre salariée, le respect de l’authenticité culturelle des produits d’artisanat vendus, le degré de marginalité des producteurs visés et la possibilité d’un commerce équitable avec des producteurs locaux, l’auteur montre que la mise en œuvre du développement durable visé par le commerce équitable implique d’en délimiter les bénéficiaires et d’en hiérarchiser les objectifs. Mots-clés : commerce équitable, commerce équitable local, controverses, coopératives, halshs-00592598, version 1 - 13 May 2011 développement durable Références JEL : L31, Q01, Q17, Z13 Abstract Through the statement of four controversies, respectively dealing with the inclusion of companies working with hired labour, the respect of the cultural identity of handicrafts, the degree of marginality of producers’ groups and the eventuality of building a “local fair trade”, the author shows that the accomplishment of the sustainable development aimed by fair trade implies to frame the limits of its beneficiaries and to establish hierarchies among its purposes. Key-words: fair trade, local fair trade, controversies, cooperatives, sustainable development Quel commerce équitable pour quel développement durable ?1 Le commerce équitable est fréquemment identifié comme étant un outil au service du développement durable. -

Proquest Dissertations
Ill u Ottawa Canada^ university FACULTE DES ETUDES SUPERIEURES l==l FACULTY OF GRADUATE AND ET POSTOCTORALES U Ottawa POSDOCTORAL STUDIES L'Universit^ canadienne Canada's university Annie-Pier Marchand AUTEUR DE LA THESE / AUTHOR OF THESIS M.A. (Science Politique) GRADE/DEGREE Sciences sociales - Ecole d'etudes politiques TAWTOCOLTDTPARTE^ L'evolution historique du commerce equitable: d'une ethique religieuse-humaniste a utilitariste TITRE DE LA THESE / TITLE OF THESIS Professeure Jacqueline Best DIRECTEUR (DIRECTRICE) DE LA THESE / THESIS SUPERVISOR CO-DIRECTEUR (CO-DIRECTRICE) DE LA THESE / THESIS CO-SUPERVISOR EXAMINATEURS (EXAMINATRICES) DE LA THESE / THESIS EXAMINERS Professeure Marie-Josee Massicotte Professeur Matthew Paterson Gary W. Slater Le Doyen de la Faculte des etudes superieures et postdoctorales / Dean of the Faculty of Graduate and Postdoctoral Studies L'evolution historique du commerce equitable : d'une ethique religieuse-humaniste a utilitariste. Analyse de discours des partenaires du Nord Par Annie-Pier Marchand Travail presente a Madame Jacqueline Best Ecole d'etudes superieures et postdoctorales Universite d'Ottawa 12mai2008 © Annie-Pier Marchand, Ottawa, Canada, 2008 Library and Bibliotheque et 1*1 Archives Canada Archives Canada Published Heritage Direction du Branch Patrimoine de I'edition 395 Wellington Street 395, rue Wellington Ottawa ON K1A0N4 Ottawa ON K1A0N4 Canada Canada Your file Votre reference ISBN: 978-0-494-48479-1 Our file Notre reference ISBN: 978-0-494-48479-1 NOTICE: AVIS: The author has granted -

NUMBER 06 / AUGUST 2019 La Situation Économique Et Sociale Au Liban Ne Cesse De Se Détériorer
NUMBER 06 / AUGUST 2019 La situation économique et sociale au Liban ne cesse de se détériorer. Le chômage atteint des sommets, on parle de 35% des jeunes diplômés, et plus de 25% de la population active ! A publication by Il a donc fallu innover, créer de Fair Trade Lebanon nouvelles opportunités notamment avec un focus export : Chief Editor: Philippe Adaimé Ainsi donc Fair Trade Lebanon a Assistant Chief Editor: pu renforcer sa présence au Etats- Christy Massabni Unis avec un partenariat fort avec Sahadi's. De même, FTL a renforcé sa présence en Europe avec une Copywriters: entité en France qui lui distribue ses Maya Masri produits. Pour cela un large travail de Ghada Marine "rebranding" a été lancé pour rajeunir la marque Terroirs du Liban et la Contributors: rendre plus attirante. Alexandre Salha Et au Liban, FTL a œuvré pour créer Benoit Berger un marché de produits frais, Souk Christian Kamel Jana Loubnan. Avec le ministère de Joe Abi Harb l’agriculture, FTL organise donc ce BECAUSE TRADE CAN Lamia Karaki marché ambulant pour permettre aux BE FAIR, LEBANESE Lucie Venet producteurs d’écouler leurs produits frais. Cette action a été possible grâce Marie-Christine Nawfal SOCIETY CAN BE FAIR. au soutien du projet Ardi, financé par LET’S STRUGGLE TO Michel Yanni l’Union Européenne et implémenté Omar Chehaidi par Expertise France. BUILD A FAIR TRADE Ossama El Kaoukji Par ailleurs, FTL s’est largement COMMUNITY TO Patricia Kebbé investi dans le développement du CREATE HOPE AND Samir Abdelmalak concept Fair Trade au Liban et aussi à l’international. -

Is Large-Scale Fair Trade Possible? Ronan Le Velly
Is large-scale fair trade possible? Ronan Le Velly To cite this version: Ronan Le Velly. Is large-scale fair trade possible?. Edwin Zaccai. Sustainable consumption, ecology and fair trade, Routledge, pp.201-215, 2007. hal-00533326 HAL Id: hal-00533326 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00533326 Submitted on 8 Nov 2010 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Edwin Zaccai (éd.), Sustainable consumption, ecology and fair trade, Londres, Routledge, 2007 Is large-scale fair trade possible? Ronan Le Velly Abstract The article presents the changes in the nature of the market relationship that are induced by the expansion of fair trade. It shows that the increase in outlets leads to challenging working with “small producers”, the payment of a “fair price” that cannot be totally disconnected from market forces, and the rising impersonality of the producer-consumer relationship. Several types of fair trade on several scales are possible. The transition from a direct chain to an intermediated chain and then to a labelled chain increase the efficiency of trade but is accompanied by less opposition to the characteristics that fair trade activists attribute to the conventional market. -

WFTO-Europe Annual Report 2019-2020
2019 ANNUAL REPORT 2020 CONTENTS 2 Foreword 3 Home of the European Fair Trade Enterprises 4 Our objectives 5 Members of WFTO-Europe 7 Capacity 9 Learning 11 Voice 12 Looking ahead 13 Our governance 14 Financial results 1 FOREWORD Dear readers, Last year the global WFTO family voted to revise Principle 10 to strengthen our common endeavours in acting on the climate crisis and protecting our planet. This means that we will increase our focus on the environmental aspects in our daily work. In the same spirit we co-hosted a public event with the FTAO, at our Connect & Act members’ meeting last summer, to highlight the role of mission-led business models in pursuing global social and environmental justice and the clear utility of Fair Trade for climate action. We were pleased to join hands with many like-minded movements in this important work to protect planet as well as people. Thanks to the funding from the 3-year “Trade Fair Live Fair” project funded by the EC’s DEAR fund, we have had the capacity to further strengthen our collaboration and informal alliances with other organisations, for example on a research on EU policy options for ensuring fair and sustainable textiles supply chains. Similarly, we have been engaged in promoting WFTO Global and Traidcraft Exchange's report on business models that put people and planet above profit. We also had the opportunity to present this report to other European CSOs that are key allies in our advocacy work. In this connection, we are always proud to highlight our members as prime examples of the very business models that do good on all dimensions of sustainable development. -

What Future for Fair Trade in Scotland?
WHAT FUTURE FOR FAIR TRADE IN SCOTLAND? An Independent review of Fair Trade Sales and Promotion in Scotland For SCOTTISH GOVERNMENT FINAL REPORT FEBRUARY 2020 Radcliffe, Pauline and Justad, Tor With associate research and facilitation from: Meteyard, M; Valerio, G; Howie, A; Fenderl, N. EXECUTIVE SUMMARY ‘In November, the United Nations climate change summit in Glasgow will attract more than 30,000 people from around the world……. ‘And it will give Scotland a chance to show that we are leading by example – not just by reducing our greenhouse gas emissions but by doing so in a way that helps to build a fairer, healthier and happier society’. First Minister, Nicola Sturgeon, 2020 New Year message I. Introduction This independent Review of Fair Trade sales growth and promotion in Scotland, commissioned by the Scottish Government’s International Development (SGID) Team, is published at a time when there has never been a better opportunity for Fair Trade to re-state its relevancy to the climate change emergency through using fair and ethical trade to sustain the livelihoods and environments of the poorest communities across the globe. Figure 1.1: Graphic representation of Fair Trade, International Fair Trade Charter 2018. The International Fair Trade Charter (2018) describes Fair Trade as a movement which ‘works to transform trade in order to achieve justice, equity and sustainability for people and planet’. The ‘fairer society’ which the First Minister emphasises in her New Year message, is inextricably linked to our actions (or inaction) to tackle the climate crisis at an international level, our approach to fair and responsible trading arrangements and the way in which SG and business works with its international neighbours to tackle the injustice and human rights abuses in supply chains. -
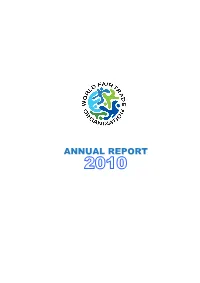
WFTO Annual Report 2010.Pdf
ANNUAL REPORT Table of Contents 1. VISION AND MISSION OF THE WFTO.............................................................................................. 3 2. PRESIDENT’S REPORT..................................................................................................................... 4 3. WFTO in 2010: BRIEF REVIEW ......................................................................................................... 5 4. CORE SERVICES ............................................................................................................................... 7 4.1. Membership and Monitoring: Coping with growth and harmonization through QMS ............... 7 4.2. COMMUNICATION: positioning a global network .................................................................... 8 4.3. MARKET ACCESS AND MARKET DEVELOPMENT .............................................................. 9 5. PROGRAMS AND PROJECTS: SFTMS and Geo Fair Tr.................................................................. 9 5.1. The Sustainable Fair Trade Management System (SFTMS): Developing a sustainable certification system for greater equity .............................................................................................. 9 5.2. Geo Fair Trade........................................................................................................................ 10 6. REGIONAL NETWORKS AND REGIONAL NETWORKING............................................................ 11 6.1. AFRICA: Cooperation for Fair Trade in Africa (COFTA) -

The Domestic Fair Trade Movement in France, a Bottom-Up Regulation?
Norwegian University of Life Sciences Departement of Plant Sciences Agroecology Master Program Master Thesis 2016 30 credits The domestic fair trade movement in France, a bottom-up regulation? Adèle Boissau The Domestic Fair Trade movement in France, a bottom-up regulation? MSc Agroecology – January 2016 Departement of Plant Science (IPV) Norwegian University of Life Sciences (NMBU) P.P box 5003 NO-1432 Ås, Norway Course Code: M30-IPV Agriculture Engineering School of ISARA-Lyon Agroecology department 23 rue Jean Baldassini 69364 Lyon Cedex 07, France Agriculture Engineering School of Purpan 75 voie du T.O.E.C. - BP57611 31076 Toulouse Cedex 3, France Author Adèle Boissau NMBU student number: 983112 [email protected] Supervisor prof. Geir Lieblein (NMBU, IPV) 2 Table of content Introduction _______________________________________________________________ 6 The fair trade movement _________________________________________________________ 6 Building domestic fair trade (DFT) initiatives within the global North ______________________ 7 The convergence between international fair trade and other alternative food networks ______ 8 Farmers from the global North and farmers from the global South: the same struggle? _______ 8 France and the US: the most advanced countries regarding DFT __________________________ 9 Regulation, private labels and third party certification _________________________________ 9 Methodology, materials and methods _________________________________________ 11 Step 1 - General framework question ______________________________________________ -

Annual Report 2009
WORLD FAIR TRADE ORGANIZATION Annual Report 2009 © WFTO Annual Report 2009. All Rights Reserved. Table of Contents I The mission and vision of the WFTO 3 II President’s Executive Summary 3 III WFTO 2009: Year in Review 5 IV Core Services: Growing Trust in Fair Trade Organizations 7 Membership and Monitoring: Towards a Quality Management System 7 Market Access and Market Development: From Local to Global Trade For Small Producers 7 Communications and Branding: Building an Innovative Brand 8 World Fair Trade Day: A Big Day for the Planet 9 Advocacy: engaging policy makers in Fair Trade 10 V WFTO Regionalization and the Regional Networks: Fair Trade Around the World 13 VI Financial Report 21 VII Acknowledgements 24 VIII List of the WFTO Members 25 © WFTO Annual Report 2009. All Rights Reserved. 1. THE MISSION AND VISION OF THE WFTO Vision WFTO, the World Fair Trade Organization, has a vision of a world in which trade structures and practices have been transformed to work in favour of the poor and promote sustainable development and justice. Mission WFTO’s mission is to enable producers to improve their livelihoods and communities through Fair Trade. WFTO will be the global network and advocate for Fair Trade, ensuring producer voices are heard. The interests of producers, especially small farmers and artisans, should be the main focus in all the policies, governance, structures and decision making within the WFTO. 2. PRESIDENT’S EXECUTIVE SUMMARY AN EVENTFUL YEAR - A DIFFICULT ENVIRONMENT The full force of the global economic downturn dramatically affected many of our members in both the North and in the South. -

International Guide to Fair Trade Labels
INTERNATIONAL GUIDE TO FAIR TRADE LABELS Edition 2020 The reference tool to better understand the guarantees of fair trade labels, their standards, monitoring measures and how they differ from sustainable development labels. ISBN: 979-10-94727-07-2 10€ / 11$ 2 INTERNATIONAL GUIDE TO FAIR TRADE LABELS For any operating license requests, please contact Commerce Équitable France: [email protected] 3 Authors of the guide Commerce Équitable France Commerce Équitable France is the national platform of the fair trade sector in France, bringing together companies, main fair trade labels on the French market, retailer networks, NGOs working on awareness raising or on support for small farmers’ organisations. Commerce Équitable France’s mission is to promote fair trade and trade justice towards public institutions, the private sector and consumers alike. www.commercequitable.org Fair World Project (FWP) Fair World Project is an independent campaign of the Organic Consumers Association which seeks to protect the use of the term "fair trade" in the marketplace, expand markets for authentic fair trade, educate consumers about key issues in trade and agriculture, advocate for policies leading to a just economy, and facilitate collaborative relationships to create true system change. www.fairworldproject.org FairNESS FairNESS (NESS: Network of Exchanges on Social Sciences) is a multidisciplinary network of researchers working on fair trade. FairNESS France, created in 2006 after the 2nd Fair Trade International Symposium (FTIS) in Montreal, brings together about 30 researchers from France, Belgium, Canada and Switzerland. www.fairnessfrancophone.wordpress.com FairNESS United Kingdom mirrors the continental Fairness Network and gathers UK academics. FairNESS UK primarily exists as an online platform for communication and information sharing. -

Fair Trade 2007: New Facts and Figures from an Ongoing Success Story a Report on Fair Trade in 33 Consumer Countries
Fair Trade 2007: new facts and figures from an ongoing success story A report on Fair Trade in 33 consumer countries. by Jean-Marie Krier A survey prepared on behalf of DAWS – Dutch Association of Worldshops, Netherlands Fair Trade 2007: New Facts and Figures from an ongoing Success Story A Report on Fair Trade in 33 consumer countries by Jean-Marie Krier A survey prepared on behalf of DAWS – Dutch Association of Worldshops, Netherlands This survey is published by the Dutch Association of Worldshops with support of the FINE advocacy office located in Brussels: Fairtrade Labelling Organisations International (FIO), International Fair Trade Organisation (IFAT), Network of European World Shops (NEWS!) and European Fair Trade Association (EFTA). The project was financed by the Dutch Ministry of Foreign Affairs. For information and copyright: The Dutch Association of Worldshops Randweg 8 4104 AC Culemborg The Netherlands Tel: (+31) 234 270 250 Fax: (+31) 234 479 272 [email protected] www.wereldwinkels.nl Reproduction of parts of the text is permitted, provided that the Dutch Association of Worldshops is cited as the source. © DAWS, August 2008 Author of the survey: Jean-Marie Krier Elisabethstr. 2 A - 5020 Salzburg Austria Tel: (+43) 662 840953 - 14 [email protected] www.fairfutures.at The author wishes to thank all those who have in some form or another contributed to this report and helped him gain as comprehensive a picture as possible. All remaining errors are the sole responsibility of the author. Final editing: Peter van Mersbergen, -

Rapport Annuel 2017
RAPPORT ANNUEL 2017 Oxfam-Magasins du monde se donne comme mission de construire la justice socio-économique en combattant les inégalités et les injustices de manière structurelle et globale. Pour cela, nous proposons une alternative de commerce équitable qui fédère et qui attire, nous dénonçons, nous interpellons, nous mobilisons et nous formons. EN COUVERTURE : Selvi est couturière chez notre partenaire indien Mila. D’abord assistante et aujourd’hui couturière, elle a beaucoup appris au sein de Mila, notamment grâce à l’expérience de ses collègues et à l’approche qualité adoptée par l’organisation. Aujourd’hui, elle est fière de gagner un peu plus que son mari. Ensemble, ils parviennent à économiser suffisamment pour envisager l’achat d’un terrain afin de construire leur propre maison. Photo : © Tineke d’Haese/oxfam OXFAM-MAGASINS DU MONDE - RAPPORT ANNUEL 2017 2 table des matières Avant-propos ................................................................................................4 partie 4- le commerce équitable et solidaire ........................... 44 L’artisanat équitable, un savant mélange entre tradition et modernité ......45 partie 1 - informer, sensibiliser, mobiliser .................................5 Quelques partenaires d’artisanat ...................................................................47 Campagnes : la recherche constante d’alternatives Beaucoup de changements dans le rayon épicerie ......................................49 pour une autre économie ...................................................................................6