Rives Méditerranéennes, 50
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Social Cleavages and National “Awakening” in Ottoman Macedonia 1 by Basil C
East European Quarterly 29 (1995), 409-426 Social cleavages and national “awakening” in Ottoman Macedonia 1 by Basil C. Gounaris In early summer 1992 a lavish monograph was published in Skopje entitled Macedonia on old Maps.2 In the first chapter of the book, which is called “A History without a Geography”, Ilija Petrushevski states that: “These maps present the undeniable historical and scientific facts about the distinctness of the Ìacedonian nation, which differs from its neighbours not only by its territory, which has always belonged to it, but also by its language, folklore, traditions and all the other elements of significance in ethnic differentiation”.3 Petrushevski’s attempt to support the existence of a nation by stressing its connection with an age-old ethnic core is not a new task in Balkan historiography, nor is it the first time that the testimony of old maps is being employed to serve such a cause.4 It has been stated that the advent of the European Enlightenment in the Ottoman Balkans involved a rather slow procedure. Describing, however, pre-independence nationalist feelings of the Balkan peoples, especially the situation in the hinterland of the peninsula (Macedonia included), is a demanding exercise, which far exceeds the purpose of this paper.5 In brief, modern Greek nationalism emerged in the 18th century and was affected by western ideas, but its actual roots lay in protonationalist phenomena noticed in the 13th century Byzantium.6 Under Ottoman rule these feelings were only partly preserved through the institutions of the millet system. The folk of the Ecumenical Patriarchate was the Rum-i-millet, with a population which, in addition to the Greek-speakers, included large numbers of Slav- Vlach and other non Greek- speaking Orthodox subjects of the Sultan. -

Old and New Islam in Greece Studies in International Minority and Group Rights
Old and New Islam in Greece Studies in International Minority and Group Rights Series Editors Gudmundur Alfredsson Kristin Henrard Advisory Board Han Entzinger, Professor of Migration and Integration Studies (Sociology), Erasmus University Rotterdam, the Netherlands; Baladas Ghoshal, Jawaharlal Nehru University (Peace and Confl ict Studies, South and Southeast Asian Studies), New Delhi, India; Michelo Hansungule, Professor of Human Rights Law, University of Pretoria, South Africa; Baogang He, Professor in International Studies (Politics and International Studies), Deakin University, Australia; Joost Herman, Director Network on Humani tarian Assistance the Netherlands, the Netherlands; Will Kymlicka, Professor of Political Philosophy, Queen’s University, Kingston, Canada; Ranabir Samaddar, Director, Mahanirban Calcutta Research Group Kolkata, India; Prakash Shah, Senior Lecturer in Law (Legal Pluralism), Queen Mary, University of London, the United Kingdom; Tove Skutnabb-Kangas, Guest Researcher at the Department of Languages and Culture, University of Roskilde, Denmark; Siep Stuurman, Professor of History, Erasmus University Rotterdam, the Netherlands; Stefan Wolfff, Professor in Security Studies, University of Birmingham, the United Kingdom. VOLUME 5 The titles published in this series are listed at brill.nl/imgr Old and New Islam in Greece From Historical Minorities to Immigrant Newcomers By Konstantinos Tsitselikis LEIDEN • BOSTON 2012 Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Tsitselikis, Konstantinos. Old and new Islam in Greece : from historical minorities to immigrant newcomers / by Konstantinos Tsitselikis. p. cm. -- (Studies in international minority and group rights ; v. 5) Includes bibliographical references and index. ISBN 978-90-04-22152-9 (hardback : alk. paper) 1. Muslims--Legal status, laws, etc.--Greece. 2. Minorities--Legal status, laws, etc.--Greece. 3. -

Greek Legislation Concerning the International Movement of Antiquities and Its Ideological and Political Dimensions
DAPHNE VOUDOURI Greek legislation concerning the international movement of antiquities and its ideological and political dimensions THHISIS PPAPERAPER EEXAMINESXAMINES the main lines of the Greek leg- Deterring the exportation of antiquities: a primary con- islation on antiquities with regard to their international cern of the fledgling Greek state movement, in the course of its history and in the context of the relevant international experience and reflection. The first promptings for the preservation of ‘the proofs At the same time, it attempts to shed light upon the of our ancestral glory’ and the founding of a ‘Greek Mu- ideological and political dimensions of this issue, which seum’ are attributed to Adamantios Korais, the leading is connected with the perception of ancient monuments representative of the Modern Greek Enlightenment, as national symbols and sacred heirlooms, has caused in- who wrote in 1807 that the nation’s accusers had to be tense disputes, and acquired added interest in the global convinced that ‘we neither give away, nor do we sell our environment. ancestral property any more’.4 Within the chronological confines established by the During the War of Independence, among other meas- title of the present volume, this analysis starts with Law ures, a decree was issued in 1825 by Papaflessas, Minister 2646/1899 ‘On antiquities’,1 and concludes with Law of the Interior of the revolutionary government, regarding 3028/2002 ‘On the protection of antiquities and cultural the collecting and safeguarding of antiquities in schools, heritage in general’,2 currently in force. However, the for- on the basis of the following arguments: ‘so that, with the mation and evolution of the status of the archaeological passage of time, every school will acquire its own Muse- heritage in Greece cannot be understood without, initially, um, something which is most necessary for history, for the some account of the first – and early – measures for its legal discovery of the ancient names of cities and places, for a protection. -
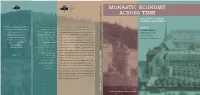
MONASTIC ECONOMY ACROSS TIME Wealth Management, Patterns, and Trends
CENTRE FOR ADVANCED STUDY MONASTIC ECONOMY SOFIA ACROSS TIME WEALTH MANAGEMENT, PATTERNS, AND TRENDS The Centre for Advanced Study So a (CAS) Roumen Avramov The book aims at a readership of both econo- EDITED BY is an independent non-pro t institution Aleksandar Fotić mists and historians. Beyond the well-known ROUMEN AVRAMOV with strong international and Elias Kolovos Weberian thesis concerning the role of Protes- ALEKSANDAR FOTIĆ multidisciplinary pro le set up Phokion P. Kotzageorgis tantism in the development of capitalism, mo- ELIAS KOLOVOS for the promotion of freedom Dimitrios Kalpakis nastic economies are studied to assess their PHOKION P. KOTZAGEORGIS of research, scholarly excellence Styliani N. Lepida impact on the religious patterns of economic be- and academic cooperation Preston Perluss havior. Those issues are discussed in the frame in the Humanities Gheorghe Lazăr of key economic concepts such as rationality, and Social Sciences. Konstantinos Giakoumis state intervention, networking, agency, and gov- Wealth Management, Patterns, and Trends Patterns, Management, Wealth Lidia Cotovanu ernance. The book includes essays concerning Andreas Bouroutis Byzantine, Ottoman and modern South-Eastern www.cas.bg Brian Heffernan Europe, and early modern and modern Western Antoine Roullet Europe. Survival and continuity of the monastic Michalis N. Michael wealth is considered as an example of success- Daniela Kalkandjieva ful handling of real estate transactions, ows of Isabelle Depret funds, and contacts with nancial institutions. Isabelle Jonveaux Moreover, the book focuses on the economic im- pact of the privileged relations of monasticism with the secular powers. Finally, the question is raised how the monastic economy (still) matters in the contemporary world. -

State Prizes for Literature 2017
State Prizes for Literature 2017 MINISTRY OF CULTURE AND SPORTS Ministry of Culture and Sports State Prize for Literature Committee he State Prizes for Literature constitute a diachronic and developing President: Mariliza Mitsou tradition, but also a bond between the sphere of books and the General Directorate of Contemporary Culture Vice President: Mary Leontsini T Director: Marios Kostakis Members: State. They are not simply state rewards for writers, but a celebration Michalis Chryssanthopoulos for the entire community related to books. Directorate of Letters, Books and Reading Policy Klairi Mitsotaki Director: Sissy Papathanassiou Kallia Papadaki This year, the state prizes constituted the occasion for the creation Pavlina Pampoudi - Department of Literature and Book of a dialogue on issues relevant to the world of books. During the Elena Maroutsou Director: Giorgos Perrakis Anna Afentoulidou meetings that we held prior to the formal award ceremony, we had the - Department of Reading and Digital Content Kostas Karavidas opportunity to discuss around the subject of the relationship between Director: Haris Pappis - Committee Secretaries books and the reading public and to reflect on the future of such a State Prize for Literature Sofia Mara, Evgenia Balaska, Penny Kambosou in Translation Committee relationship. Furthermore, to discuss the meaning of state prizes and President: Jacques Bouchard their institutional evolution. What role are literature writers, translators, Vice President: Pavlos Kalligas publishers and critics called upon -

State, Society and the Religious “Other” in Nineteenth-Century Greece
KAMPOS: CAMBRIDGE PAPERS IN MODERN GREEK No. 18, 2011 State, society and the religious “other” in nineteenth-century Greece Philip Carabott King’s College London Introduction As with other nineteenth-century successor states in the Balkans, from its inception Greek polity was grounded on the principle of nation-building through the homogenization of the realm. In a generic sense, homogenization comprised a series of inter- connected processes aiming at reconfiguring political and civil authority along “national” lines in the name of the Eastern Orthodox Church of Christ and the genos/ethnos. Unsurprisingly, in the early days of the 1820s War of Independence, the exclusion of the religious “other” from the polity and society that the warring factions of the rebels envisaged went hand-in-hand with the victimization and discrimination of the indigenous Muslim and Jewish element and an innate suspicion and mistrust of the adherents of the Western Church. As Great Power intervention became pivotal in securing a successful conclusion to the agonas, the practices associated with the exclusion of the religious “other” came to a halt. In their com- munication to Kapodistrias of the London Protocol of 3 February 1830, which provided for the establishment of an independent monarchical state and offered the crown to Prince Leopold of Saxe-Coburg, the powers demanded that his government accept, immediately and unconditionally, that henceforth Greek Catholics would worship in full freedom, that their religious and educational establishments would remain -

Regatul Romaniei
RegatulRomaniei file:///C:/Programele%20Mele/IstorieRomania1/RegatulRomaniei/Regat... Regatul României Visul unirii tuturor românilor sub un singur steag a frământat mințile conducătorilor încă din cele mai vechi timpuri, dar alianțele militare și interesele de ordin comercial nu au fost în favoarea simplificării relațiilor dintre diferitele formațiuni statale. În vechime, țările românești au negociat protecția celor două mari imperii ale romanilor, apoi începând cu secolul al XIII-lea au întreținut legături de prietenie și ajutor mutual cu Polonia și Lituania. Din secolul al XV-lea, ca state vasale Imperiului Otoman dar sub protecția directă a Hanatului Crimeei, s-a pus problema formării unui eyalat turcesc comun. Proiectul a fost însă refuzat cu dârzenie, ca urmare a divergențelor de ordin religios. Ca o soluție de compromis, sultanii au permis independența religioasă a celor trei principate, în schimbul dependenței economice. Situația de criză a intervenit o dată cu revoluția și apoi războiul de independență purtat de greci și sârbi. Sub aripa ocrotitoare a Bisericii Ortodoxe Răsăritene, creștinii din toate țările Balcanice au ridicat la început glasul, apoi armele, cerând vehement ieșirea din situația de compromis religios. Ca rezultat, boierii și dragomanii greci au fost maziliți, iar mănăstirile filiale ale celor de la Muntele Athos au fost secularizate. În urma grecilor au rămas nenumăratele lor rude născute din alianțe cu casele boierești autohtone, practic aproape toată crema boierimii. Pentru a umple vidul administrativ rămas s-a hotărât instituirea unei locotenențe domnești, ajutată de o Adunare Constituantă a fruntașilor celor două țări. În ambele principate, toate sufragiile au fost întrunite în anul 1859 de Colonelul Alexandru Ioan Cuza, cu funcția de Ministru de Război, fost deputat de Galați și fost șef al Miliției de la Dunărea de Jos. -

Vol. II, National Romanticism, the Formation Of
DISCOURSES OF COLLECTIVE IDENTITY IN CENTRAL AND SOUTHEAST EUROPE (1770–1945) TEXTS AND COMMENTARIES VOLUME II NATIONAL ROMANTICISM – THE FORMATION OF NATIONAL MOVEMENTS DISCOURSES OF COLLECTIVE IDENTITY IN CENTRAL AND SOUTHEAST EUROPE (1770–1945) TEXTS AND COMMENTARIES EDITORIAL COMMITTEE AHMET ERSOY, MACIEJ GÓRNY, VANGELIS KECHRIOTIS, MICHAL KOPEČEK, BOYAN MANCHEV, BALÁZS TRENCSÉNYI, MARIUS TURDA DISCOURSES OF COLLECTIVE IDENTITY IN CENTRAL AND SOUTHEAST EUROPE (1770–1945) TEXTS AND COMMENTARIES VOLUME II NATIONAL ROMANTICISM – THE FORMATION OF NATIONAL MOVEMENTS Edited by Balázs Trencsényi and Michal Kopeček CENTRAL EUROPEAN UNIVERSITY PRESS Budapest • New York ©2007 by Ahmet Ersoy, Maciej Górny, Vangelis Kechriotis, Michal Kopeček, Boyan Manchev, Balázs Trencsényi, Marius Turda Published in 2007 by Central European University Press An imprint of the Central European University Share Company Nádor utca 11, H-1051 Budapest, Hungary Tel: +36-1-327-3138 or 327-3000 Fax: +36-1-327-3183 E-mail: [email protected] Website: www.ceupress.com 400 West 59th Street, New York NY 10019, USA Tel: +1-212-547-6932 Fax: +1-646-557-2416 E-mail: [email protected] All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, without the permission of the Publisher. ISBN 963 7326 60 X cloth 978-963-7326-60-8 Series ISBN 963 7326 51 0 Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Discourses of collective identity in Central and Southeast Europe (1770–1945) : texts and commentaries / edited by Balázs Trencsényi and Michal Kopecek. p. cm. Includes bibliographical references and index. ISBN-10: 9637326529 (v. -

Greece: from Ottoman to the European Union Professor: Tassos Anastassiadis Fall 2012, MW 8:35-9:55, RPHYS 114
HIST349: Greece: From Ottoman to the European Union Professor: Tassos Anastassiadis Fall 2012, MW 8:35-9:55, RPHYS 114 The first flag of the Kolokotronis band during the Greek war of Independence, 1820s, Benaki Museum, Athens. Office Hours (Leacock 827): Monday & Wednesday 10:15-11:45, or by appointment E-mail: [email protected] Office phone: 514-398-4400 x-094283 1 Course description: Why has a tiny 10 million people state been capturing the world’s headlines during the last two years within the context of one of the most severe economic crisis of our times? Trying to tackle this question, this course has a two-fold objective. First of all, it examines the main aspects and events in political, economic, social and cultural history, which shaped the formation of Modern Greece and Greeks. Adopting a longue durée perspective, it will kick off during the 18th c. We will explore life in the Ottoman Empire and the subsequent emergence and development of a new national state from the status of a component of a multiethnic, albeit Islamic empire, to its present position of a full-fledged member of the world’s wealthiest association of states, i.e. the European Union. Topics to be addressed include: the position of non-Muslims under Ottoman rule; the role of language and religion in the formation of ethnic and national identities; the usage of the past and culture in the debates about the identity of the Greeks; the War of Independence and the role of foreign Powers; anthropological readings of violence and corruption; political, social, cultural and economic developments during the 19th-20th c.; emigration and the Greek diaspora; the impact of the Balkan wars and WWI on state formation; the interwar period and the impact of refugees on food, music and culture in general; Questions of Gender and Women’s history; WWII: occupation, resistance and the subsequent Civil War; Greece and the Balkans during the Cold War and after. -

UNIVERSITY of CALIFORNIA SAN DIEGO Transnational Piracy in the Eastern Mediterranean, 1821-1897 a Dissertation Submitted in Part
UNIVERSITY OF CALIFORNIA SAN DIEGO Transnational Piracy in the Eastern Mediterranean, 1821-1897 A dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in History by Leonidas Mylonakis Committee in charge: Professor Thomas W. Gallant, Chair Professor Gary Fields Professor Mark Hanna Professor Hasan Kayalı Professor Michael Provence 2018 Copyright Leonidas Mylonakis, 2018 All rights reserved. The dissertation of Leonidas Mylonakis is approved, and it is acceptable in quality and form for publication on microfilm and electronically: _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ Chair University of California San Diego 2018 iii DEDICATION To Anna iv TABLE OF CONTENTS Signature Page …………………………………………………………………………………... iii Dedication ...................................................................................................................................... iv Table of Contents ............................................................................................................................ v List of Abbreviations …………………………………………………………………………… vii List of Figures .............................................................................................................................. viii Acknowledgements ....................................................................................................................... -

REFERENCES and BIBLIOGRAPHY Archives Case-Law and Legislation
REFERENCES AND BIBLIOGRAPHY Archives Alexandros Pallis archive, National Hellenic Research Foundation, Athens. Archive on the Bulgarian occupation and propaganda in Macedonia (1941–1944), ELIA Thessaloniki. Archive of the High Commissariat of Smyrna, General Archives of the State, Athens. Aggelos Anninos archive, ELIA Thessaloniki. Archive of Athanasios Souliotis, Gennadius Library, American School of Classical Studies, Athens. Archive of Konstantinos Karamanlis, Athens. Archive of Pavlos Kalligas, Museum of the Macedonian Struggle, Thessaloniki. Directorate of Cults, Technical, Foreign and Minority Schools Archive, Governorate General of Macedonia, General Archives of the State, Kavala. Eleftherios Venizelos archive, Historical Archives of Benakis Museum, Athens. Eleftherios Venizelos archive, Greek Literary and Historical Archives (ELIA), Athens. General Archives of Macedonia, Archives of the Governorate General of Macedonia, Thessaloniki. General Archives of the State, Athens. General Archives of the State, Drama. General Archives of the State, Ioannina. General Archives of the State, Komotini. General Archives of the State, Kozani. General Archives of the State, Mytilini. Harisis Vamvakas archive, ELIA Thessaloniki. Historical Archive, Ministry for Foreign Afffairs, Athens. Historical Archive, Library of the Greek Parliament, Athens. Ioannis Politis Archive, Historical Archives of Benakis Museum, Athens. Istanbul District Administration Archives, General Directorate of Foundations, Istanbul [moved by 2008 to Ankara]. Moufti Offfijice of Komotini archives. Moufti Offfijice of Didymoteiho archives. Moufti Offfijice of Xanthi archives. Offfijicial Gazette of the Governorate General of Epirus, Archive of the Society of Epirus Studies (EHM), Ioannina. Philippos Dragoumis archive, Gennadius Library, American School of Classical Studies, Athens. Library of the Greek Parliament, Archive of Provisional Government of Thessaloniki [1916–1917]. Library of the Greek Parliament, Collection of Law Reports. -

Michail Sotiropoulos European Jurisprudence And
Queen Mary, University of London Michail Sotiropoulos European jurisprudence and the intellectual origins of the Greek state: the Greek jurists and liberal reforms (ca 1830‐1880) PhD thesis submitted for the partial fulfillment of the requirements of the Degree of Doctor of Philosophy 2 Statement of originality I, Michail Sotiropoulos, confirm that the research included within this thesis is my own work or that where it has been carried out in collaboration with, or supported by others, that this is duly acknowledged below and my contribution indicated. Previously published material is also acknowledged below. I attest that I have exercised reasonable care to ensure that the work is original, and does not to the best of my knowledge break any UK law, infringe any third party’s copyright or other Intellectual Property Right, or contain any confidential material. I accept that the College has the right to use plagiarism detection software to check the electronic version of the thesis. I confirm that this thesis has not been previously submitted for the award of a degree by this or any other university. The copyright of this thesis rests with the author and no quotation from it or information derived from it may be published without the prior written consent of the author. Signature: Date: 3 Abstract This thesis builds on, and contributes to recent scholarship on the history of nineteenth‐century liberalism by exploring Greek legal thought and its political implications during the first decades after independence from the Ottomans (ca.1830‐1880). Protagonists of this work of intellectual history are the Greek jurists—a small group of very influential legal scholars—most of whom flocked to the Greek kingdom right after its establishment.