Web04-Rhd 2020-2
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

1 the African Dimension to the Anti-Federation Struggle, C.1950-53
‘It has united us far more closely than any other question would have accomplished’.1 The African Dimension to the Anti-Federation Struggle, c.1950-53 The documentary record of African opposition to the C[entral] A[frican] F[ederation] has been the subject renewed historiographical interest in recent years.2 This paper seeks to contribute to the existing debate in three principle ways. Firstly, it will be shown that opposition to the scheme was fatally undermined by the pursuit of two very distinct strands of N[yasaland] A[frican] C[ongress] and A[frican] N[ational] C[ongress] political activism. This dissimilar political discourse produced contradictions that resulted in the bypassing African objections. In the third instance, the paper will go a step further, suggesting that the two respective anti-Federation campaigns not only undermined Congress efforts to stop federation, but laid the path for future discord in the national dispensation then materialising. In 1988, John Darwin wrote that ‘with its telescope clapped firmly to its ear, London declared that [African] opposition [to Federation] could be neither seen nor heard’.3 The well-worn historiographical path points to the fact that African opposition was effectively ignored on the basis that ‘partnership’ between white settlers and black Africans in Northern and Southern Rhodesia and Nyasaland offered a strong rationale for the CAF. The requisite benefits arising would see the promotion of African economic opportunities, the placation of settler politicians seeking to reduce the influence of the Colonial Office and the preservation of British influence in the region.4 The utility of ‘partnership’ was in its ambiguity. -

Africa: Background, May 1977, Part 3
, , . STATE~iENT OF PRINCIPLES OF U. S. FIRNS WITH AFFILIATES IN THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA . 1. Non-segregation of the races in all eating, comfort, and ,,,ork facili ties. 2. Eoual, and fair .employment practices for all employees. 3. Equal pay for all employees doing equal or comparable work for the same period of t~me. 4 • Initiation of and development of training program~ that will prepare, in substan~ial numbers, blacks and,other non-whites for supervisory, administrative, clerlcal, and t echnical jobs. ~ . 5 . Incr~asing the number of blacks and other non-~lites in manag~ment and supervisory positions. 6. Improving the qualitY ' of employees' lives outside the work cnvi rO])Hl en t in such are as as hOl.S ing, tl'?nsporta U 0] )" school i ng, recreation and health facilities. We :lg 'r- Ct:: to fU 'rther implement these principles . Wh<;!te,J j~P l. (;':.:J:: : 1J~ E . ~.... iol1 requires a modification of existjng' South African . '\mrkir.q . con(iit:Lc:-;s . I we will seek s uch modification throug]l appropriate' ch ~ nnels. , . We be 1 i eve that the implementation of the foregoing pri n::.5.ples . Is t. consistent with respect for human dignity and will con t ribute grea t ly I to the general e~o;)omic vlelfare of all the people of the Republic. of South Afl"ica ~ . ; .' • • . r • •• t ... •..... h • • • • _ .... .t ... ;" ~ . " . , .t· - .- MEMORANDUM OFFICE OF THE VICE PRESIDENT WASHINGTON UNCLASSIFIED INFORMATION Memo No. 861-77 April 20, 1977 MEMORANDUM FOR THE VICE PRESIDENT THRU: Denis Clift ~ FROM: Jay Katzen ~ SUBJECT: Anatomy of a Rebel, by Peter Joyce Attached, at Tab A, is a synopsis of the subject book, as you requested. -

The Rhodesian Crisis in British and International Politics, 1964
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by University of Birmingham Research Archive, E-theses Repository THE RHODESIAN CRISIS IN BRITISH AND INTERNATIONAL POLITICS, 1964-1965 by CARL PETER WATTS A thesis submitted to the University of Birmingham For the degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY School of Historical Studies The University of Birmingham April 2006 University of Birmingham Research Archive e-theses repository This unpublished thesis/dissertation is copyright of the author and/or third parties. The intellectual property rights of the author or third parties in respect of this work are as defined by The Copyright Designs and Patents Act 1988 or as modified by any successor legislation. Any use made of information contained in this thesis/dissertation must be in accordance with that legislation and must be properly acknowledged. Further distribution or reproduction in any format is prohibited without the permission of the copyright holder. Abstract This thesis uses evidence from British and international archives to examine the events leading up to Rhodesia’s Unilateral Declaration of Independence (UDI) on 11 November 1965 from the perspectives of Britain, the Old Commonwealth (Canada, Australia, and New Zealand), and the United States. Two underlying themes run throughout the thesis. First, it argues that although the problem of Rhodesian independence was highly complex, a UDI was by no means inevitable. There were courses of action that were dismissed or remained under explored (especially in Britain, but also in the Old Commonwealth, and the United States), which could have been pursued further and may have prevented a UDI. -

April 2013 Rhodesian Services Association Incorporated
April 2013 A monthly publication for the Rhodesian Services Association Incorporated Registered under the 2005 Charities Act in New Zealand number CC25203 Registered as an Incorporated Society in New Zealand number 2055431 PO Box 13003, Tauranga 3141, New Zealand. Web: www.rhodesianservices.org Secretary’s e-mail [email protected] Editor’s e-mail [email protected] Phone +64 7 576 9500 Fax +64 7 576 9501 To view all previous publications go to our Archives Greetings, The increase in applications to subscribe to this publication is overwhelming – every day we are getting new people on board. Welcome to you all. At the same time there are a number of email addresses which have gone dead. I have had a big purge of these dead addresses and removed them from our address book. It is far too labour intensive to go around chasing people who have changed their addresses. If you know anyone not receiving this publication, please direct them to our web page http://www.rhodesianservices.org/Newsletters.php where they can fill in the online form and get on our mailing list. Please note, this form is for people wanting to register or change address – it is not designed to be used for messages to me. If you want to send me a message, please do it by email. Thank you. Lastly – we require the services of a suitably equipped and capable person who can make up some bracelets from coins that we have. We need to have lugs and fasteners welded onto the coins and then we will arrange electro plating. -

Flag of Defiance – the International Use of the Rhodesian Flag Following Udi
FLAG OF DEFIANCE – THE INTERNATIONAL USE OF THE RHODESIAN FLAG FOLLOWING UDI BRUCE BERRY University of Pretoria ([email protected] ; +27 82 909 5829) Abstract The international response to Rhodesia’s Unilateral Declaration of Independence (UDI) was to proclaim the colony to be in a state of rebellion, the government in Salisbury to be illegal, and to request the United Nations to apply sanctions against the ‘rebel regime’. The ensuing political impasse resulted in the need to promote a more distinctive national identity and the symbols to reflect this newfound independence. The first, and most obvious, change came with the adoption of a new national flag on the third anniversary of UDI on 11 November 1968. As the most visible symbol of post-UDI Rhodesia, the international use and display of the new flag became the subject of demonstration and controversy. This paper shows how the green and white Rhodesian flag came to highlight Rhodesia’s contested statehood when flown outside the country during the UDI period. Rhodesia’s new flag became a symbol of the country’s defiance, and the emotion it evoked, and continues to evoke, causes controversy even to this day. Keywords: Rhodesia, symbols, flags 1 1. INTRODUCTION After years of fruitless negotiations on the issue of independence, at 11 a.m. on 11 November 1965 (the 11th hour of the 11th day of the 11th month) Rhodesian Prime Minister Ian Smith and his Cabinet signed a Proclamation of Independence from the British Parliament, whilst retaining loyalty to the person of the Monarch as the Queen of Rhodesia.1 The immediate response by the British Government to this Unilateral Declaration of Independence (UDI) was to proclaim Rhodesia to be in a state of rebellion, the Government in Salisbury to be illegal and to request the United Nations to apply sanctions against the ‘rebel regime’. -

Collapse of Rhodesia: Society in Nigeria Population Demographics and the Usmana.Tar Politics of Race 978 1 84511 656 9 Josiah Brownell 978 1 84885 475 8 23
Josiah Brownell received his Ph.D. from the School of Oriental and African Studies in 2009, and has a J.D. from the University of Virginia School of Law. His research focuses on African history, comparative settler colonialism, and the end of the British Empire. P1: PHB Trim: 138mm × 216mm Top: 1in Gutter: 1in IBBK042-01 IBBK042-Serieslist-Demis ISBN: 978 1 84885 217 4 August 13, 2010 17:24 INTERNATIONAL LIBRARY OF AFRICAN STUDIES Series ISBN: 978 1 84885 217 4 See www.ibtauris.com/ILAS for a full list of titles 18. Mineworkers in Zambia: Labour 25. African Women and Apartheid: and Political Change in Post-Colonial Migration and Settlement in Urban Africa South Africa Miles Larmer Rebekah Lee 978 1 84511 299 8 978 1 84511 819 8 19. Reconstructing the Nation in 26. Islam’s Perfect Stranger: The Life Africa: The Politics of Nationalism in of Mahmud Muhammad Taha, Ghana Muslim Reformer of Sudan Michael Amoah Edward Thomas 978 1 84511 259 2 978 1 84885 004 0 20. Revolt and Protest: Student 27. The Governance of Water and Politics and Activism in Sub-Saharan Sanitation in Africa: Achieving Africa Sustainable Development through Leo Zeilig Partnerships 978 1 84511 476 3 Tim Gray and Amy Stewart 978 1 84885 027 9 22. The Politics of Neoliberal Democracy in Africa: State and Civil 28. The Collapse of Rhodesia: Society in Nigeria Population Demographics and the UsmanA.Tar Politics of Race 978 1 84511 656 9 Josiah Brownell 978 1 84885 475 8 23. Afrikaners in the New South Africa: Identity Politics in a 29. -

Sir Roy Welensky, Prime Ninister of the Crumbling Federation of the Rhodesias and Nyasaland, Went Fishing Together
NOT FOR PUBLICATION INSTITUTE OF CURRENT WORLD AFFAIRS CB-21 $r Roy Welensky July i, 1963 3 Richmond Close Highlands Salisbury, Southern Rhodesia Mr. Richard Nolte Institute of Current World Affairs 366 Nadison Avenue New York 17, New York Dear Mr. Nolte While Ileads of State in the rest of Africa were meeting .t the summit at Addis Abbaba, a small Southern Summ..i Conference was held at Betty's Bay, South Africa, when Dr. Ver- woerd and Sir Roy Welensky, Prime Ninister of the crumbling Federation of the Rhodesias and Nyasaland, went fishing together. Sir Roy could not represent the Sou+/-hem Rhodesian government in any off.cial way, His Federation _is breaking up and he will soon be a man without a job. But in spite of this he is still considered a power in politics here and his actions receive careful scrutiny. During the last 25 years he has worked his way through the "tough school of politics".. He ente*ed political life first as a union organizer and then head of the European Railwaymen's Union in Northern Rhodesia's cooprbel%. Over ten years ago he and sir Godfrey Huggins, Prime Ninister of Southern Rhodesia (later Lord Nalvern), together sold Britain on the idea of a federation of the three central African territories, Northern Rhodesia, Southern Rhodesia and Nyasaland. tle succeeded Lord hlalvern as Prime linister of the Federation in 1956. From the beei.ning Africans in Northern Rhodesia and Nyasaland, qhere there are very few Europeans, distrusted federation. ey saw Europeans in the three territories uniting to control their rising aspira- tions. -

NEW/LETTER African Studies Center, Michigan State University, East Lansing,MI 48823
GS ASSOCIATION OF CONCERNED AFRICA SCHOLARS NEW/LETTER African Studies Center, Michigan State University, East Lansing,MI 48823 Fall 1986 Number 19 CONTENTS .. 1. Letter from the Interim Editor •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2 RESOURCES & CONFERENCES 2. Inside Africa News ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3 3. Lutherans Plan Conference on Namibia ••••••••••••••••••••••••••••••• 5 4. New Films on Southern Africa ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 6 NEWS & EVENTS 5. NElI Disowns "The Africans" • •..••••.•..•••• ·• • • • • . • . • . • • • . • • . • • • • • • • • 7 6. Congress Overrides Reagan's Veto of Sanctions •••••••••••••••••••••• 8 7. ACAS Panels at ASA 1986•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 9 8. Divestment Update •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 11 9. The Great African Cook-In •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 13 10. TIAA-CREF Campaign Wins Partial Victory •••••••••••••••••••••••••••• 14 , 11. Item Received from University of Dar es Salaam ••••••••••••••••••••• 18 ARTICLES 12. "Law and The State in Tanzania" by Ed Ferguson.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••19 13. New Publications From Nigeria •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 20 14. "Southern Africa: Who is the 'Dependent' One?" by Carol Thompson •••••••••••••• .•••••••••••••.••.••••••••••••••••••• 22 15. "Sanctions Worked in Rhodesia, White Businessmen Say" by Elizabeth Schmidt ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 24 16. "Zimbabwean Independence - Not For Sale" by Warren "Bud" Day •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• -

100 Questions November 2017
CLATapult Current Affairs Questions – November 2017 1.Who has won coveted “Miss World 2017” crown in China? (a)Alma Andrea Meza (b)Stephanie Hill (c)James Herrell (d)Manushi Chillar 2.Which country crowned the champions of women’s asia 2017 Kabaddi championship after defeating South Korea in Iran ? A. Pakistan B. Japan C. India D. China 3.Who is the president of world bank ? (a) Jim Yong Kim (b) Joaquim Levy (c) Kristalina Georgieva (d) Shaolin Yang 4.Who is the richest person of Asia according to Forbes? (a) Hui Ka Yan (b) Mukesh ambani (c) Ratan Tata (d) Azim Premji 5.Who has been named as india G20 sherpa for the development track of the grouping? (a)Arvind subramanium (b)Neeraj kumar gupta (c)Shaktikanta das (d)Ajay narayan jha 6.Who has been awarded Isarel’s 2018 Genesis prize commonly known as “Jewish Nobel Prize” (a)Angelina jolie (b)Elizebeth taylor (c)Natalie portman (d)Jenifer lowerence 7.Maximum Age of Joining NPS (National Pension Scheme ) is- (a) 60 (b) 65 (c) 67 (d) 62 8.Which place been awarded for UNESCO Asia-Pacific award for cultural heritage conservation? (a)president house (b)The royal opera house (c)Red fort (d)Hotel taj palace 9.Rank of India in WEF Global Gender Gap index – (a) 103 (b) 106 (c) 108 (d) 87 10.Which country is on the top of WEF Global Gender Gap list 2017 ? (a) Finland (b) Iceland (c) Norway (d) China 11.Walmart India launched its first fulfilment centre in which city? (a) Mumbai (b) Bangalore (c) Hyderabad (d) Chandigarh 12.Who has been crowned as “Miss International 2017” in Tokyo? (a)Kevin Lilliana -

Enactment of New Constitution Bill and Related Legislation. - British Government's Reaffirmation of Sanctions Policy
Keesing's Record of World Events (formerly Keesing's Contemporary Archives), Volume XVII, February, 1970 Rhodesia, Page 23810 © 1931-2006 Keesing's Worldwide, LLC - All Rights Reserved. Enactment of New Constitution Bill and Related Legislation. - British Government's Reaffirmation of Sanctions Policy. - Rhodesian Espionage Trials. - Other Developments. Following the result of the referendum of June 20, 1969, on the Smith regime's proposals for a Republic and a new Constitution [see 23474 A], the Rhodesian Legislative Assembly passed in November 1969 four Bills, including the Constitution Bill proper. Mr. Smith had told the Legislative Assembly on Sept. 3 that there would be no formal declaration of a Republic and that in any case the new status could not come into effect until the electorate had accepted the proposed Constitution at a general election, which would probably be held early in 1970. The regime, he added, had considered proclaiming Nov. 11, the anniversary of U.D.I., as Republic Day, but this had been rejected because that day was already an Independence Day holiday. However, from 1970 Republic Day would be observed as a holiday on the second last Monday in October. The Constitution Bill, published on Sept. 11, while incorporating the basic White Paper proposals of May 21 [see 23474 A], provided in addition that the Head of State and Commander-in-Chief of the armed forces would be a President appointed by the Cabinet for not more than two five-year terms with limited constitutional powers. Mr. Lardner-Burke (Minister of Justice and Law and Order), moving the Bill's second reading on Oct. -
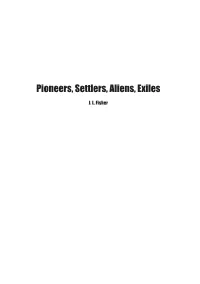
Pioneers, Settlers, Aliens, Exiles: the Decolonisation of White Identity In
Pioneers, Settlers, Aliens, Exiles J. L. Fisher Pioneers, Settlers, Aliens, Exiles The decolonisation of white identity in Zimbabwe J. L. Fisher THE AUSTRALIAN NATIONAL UNIVERSITY E P R E S S E P R E S S Published by ANU E Press The Australian National University Canberra ACT 0200, Australia Email: [email protected] This title is also available online at: http://epress.anu.edu.au/pioneers_citation.html National Library of Australia Cataloguing-in-Publication entry Author: Fisher, J. L. (Josephine Lucy) Title: Pioneers, settlers, aliens, exiles : the decolonisation of white identity in Zimbabwe / J. L. Fisher. ISBN: 9781921666148 (pbk.) 9781921666155 (pdf) Notes: Bibliography. Subjects: Decolonization--Zimbabwe. Whites--Zimbabwe. Zimbabwe--Politics and government--1980- Zimbabwe--Race relations. Dewey Number: 320.96891 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying or otherwise, without the prior permission of the publisher. Cover design and layout by ANU E Press Printed by University Printing Services, ANU This edition © 2010 ANU E Press Contents Abbreviations. ix Preface . xi 1 ..Introduction. 1 2 ..Zimbabwe’s.discourse.of.national.reconciliation . 27 3 ..Re-inscribing.the.national.landscape. 55 4 ..Zimbabwe’s.narrative.of.national.rebirth. 79 5 ..Decolonising.settler.citizenship. 103 6 ..The.mobilisation.of.indigeneity. 131 7 ..The.loss.of.certainty. 173 8 ..Zimbabwe’s.governance.and.land.reform.crises—a.postscript.201 -

ED 112 453 AUTHOR TITLE INSTITUTION PUB DATE AVAILABLE from DOCUMENT RESUME EA 007 422 Atkinson, Norman Educational Co-Operation
DOCUMENT RESUME ED 112 453 EA 007 422 AUTHOR Atkinson, Norman TITLE Educational Co-Operation in the Commonwealth: An Historical Study. Series in Education, Occasional Paper No. 1. INSTITUTION Rhodesia Univ., Salisbury. PUB DATE 74 NOTE 274p. AVAILABLE FROM The Library, University of Rhodesia, E.O. Box MP.45, Mount Pleasant, Salisbury, Rodesia ($5.10 Rhodesian) EDRS PRICE MF-$0.76 Plus Postage. HC Not Available from EDRS. DESCRIPTORS Adult Education; *Educational Coordination; *Educational History; *Educational Planning; *Educational Policy; Higher Education; Instructional Media; International Education; *International Organizations; International Programs IDENTIFIERS *British Commonwealth ABSTRACT This book provides an historical assessment of educational cooperation within the British Commonwealth, during both the imperial and postimperial periods. However, the author makes no attempt to examine the educational policies or institutions of the individual territories or countries, except as they have affected the development of international cooperation. Individual chapters examine the nature of the modern Commonwealth, educational policy during the imperial period, educational cooperation in the Commonwealth since 1945, adult education in the Commonwealth, higher education in the Commonwealth, the use of instructional media in the Commonwealth, and international relations between the Commonwealth and other nations. (Author/JG) *********************************************************************** Documents acquired by ERIC include many informal unpublished * materials not available from other sources. ERIC makes every effort * * to obtain the best copy available. Nevertheless, items of marginal * * reproducibility are often encountered and this affects the quality * * of the microfiche and hatdcopy reproductions ERIC makes available * * via the ERIC Document Reproduction Service (EDRS). ErBs is not * responsible for the quality of the original document. Reproductions * * supplied by EDRS are the best that can be made from the original.