P.L.U. De CUQUERON (64)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

La Fibre Écolo, Ça Se Cultive ! P
Il étaIt une foI Zoé accueille ses cousins qui viennent de loin, ils vont passer le dimanche ensemble. Elle est toute P. 4-5 joyeuse : « Heureusement qu’il y a le dimanche pour se retrouver avec la famille, les amis. Ça fait du bien ! » La Chaîne De Saint-Vincent-des-Baïses le n° 2 € •Avril 2014 • n° 77 iSSn 1161 7896 ecoresponsables la fibre écolo, ça se cultive ! p. 3 saint-vincent-des-Baïses aBos lucq-de-Béarn P 2 P 7 P 8 Marie se consacre à l'huManitaire Balade dans les pyrénées au service de la communauté chrétienne 2 ■ Avril 2014 La Chaîne TAXIS saint-vincent-des-Baïses Joël HARICHOURY TRAnspORTs mAlAdes AssIs Aline Roze COnvenTIOnné CAIsses mAteRiel de mAintien à domicile 06 77 13 96 03 diététique Rencontre 05 59 21 48 19 Produits biologiques et naturels Quartier marquemale 64360 mOneIn 5, pl. H. lacabanne monein Taxi n° 5 mOneIn tél. 05 59 21 37 23 Marie se consacre à l'humanitaire SARL PANDELES Plombier - Chauffagiste Au mois de février, Marie a rencontré l’équipe de 6e de l’aumônerie du collège, au monastère sarl paillous & fils 4, rue Charles Lacoste 64150 PARDIES ENERGIE de Sarrance. Elle a participé, il y a quelques années, aux activités de l’aumônerie et elle a fait 8h /20h - Dimanche 9h /13h RENOUVELABLE 05 59 60 50 76 sa communion, sa profession de foi et sa confirmation dans notre paroisse. 34, rue du commerce Monein 06 08 74 38 29 SOLAIRE Tél. 05 59 21 20 20 [email protected] Domaine BRU-BACHÉ Domaine Gaillot Vins du Jurançon Vins de Jurançon sec et mœlleux Claude Loustalot MONEIN 64360 64360 Monein Tél. -

Pyrenees Atlantiques
Observatoire national des taxes foncières sur les propriétés bâties 13 ème édition (2019) : période 2008 – 2013 - 2018 L’observatoire UNPI des taxes foncières réalise ses estimations à partir de données issues du portail internet de la Direction générale des finances publiques (https://www.impots.gouv.fr) ou de celui de la Direction générale des Collectivités locales (https://www.collectivites-locales.gouv.fr). En cas d’erreur due à une information erronée ou à un problème dans l’interprétation des données, l’UNPI s’engage à diffuser sur son site internet les données corrigées. IMPORTANT ! : les valeurs locatives des locaux à usage professionnel ayant été réévaluées pour le calcul de l’impôt foncier en 2017, nos chiffres d’augmentation ne sont valables tels quels que pour les immeubles à usage d’habitation. Précautions de lecture : Nos calculs d’évolution tiennent compte : - de la majoration légale des valeurs locatives , assiette de la taxe foncière (même sans augmentation de taux, les propriétaires subissent une augmentation de 4,5 % entre 22013 et 2018, et 14,6 % entre 2008 et 2018) ; - des taxes annexes à la taxe foncière (taxe spéciale d’équipement, TASA, et taxe GEMAPI), à l’exception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM). Précisions concernant les taux départementaux 2008 : En 2011 la part régionale de taxe foncière a été transférée au département. Pour comparer avec 2008, nous additionnons donc le taux départemental et le taux régional de 2008. Par ailleurs, nos calculs d’évolution tiennent compte du fait que, dans le cadre de cette réforme, les frais de gestion de l’Etat sont passés de 8 % à 3 % du montant de la taxe foncière, le produit des 5 % restants ayant été transféré aux départements sous la forme d’une augmentation de taux. -

Liste Des Services D'aide À Domicile
14/04/2015 LISTE DES SERVICES D'AIDE À DOMICILE pouvant intervenir auprès des personnes âgées bénéficiaires de l'Allocation Personnalisée d'Autonomie (A.P.A.), des adultes handicapées bénéficiaires de la Prestation de Compensation du Handicap (P.C.H.) et pour certains, auprès des bénéficiaires de l'aide ménagère au titre de l'aide sociale légale départementale A Habilitation à l'aide sociale départementale www.cg64.fr TI = Type d'interventions réalisables u AS = Service prestataire d'aide à domicile pouvant intervenir auprès des P = Prestataire -- M = Mandataire t bénéficiaires de l'aide sociale départementale Pour plus d'information, voir : Choisir un mode d'intervention . C Code AS Nom du service Adresse Ville Téléphone TI Territoire d'intervention G Postal CCAS Hôtel de ville P Ville d’ANGLET A AS 64600 ANGLET 05 59 58 35 23 Centre Communal d'Action Sociale Place Charles de Gaulle M Département des Pyrénées-Atlantiques Uniquement en garde de nuit itinérante Association 12, rue Jean Hausseguy A AS 64600 ANGLET 05 59 03 63 30 P Communauté d’agglomération du BAB (BIARRITZ, Les Lucioles BP 441 BAYONNE, ANGLET) et périphérie proche Association P 95, avenue de Biarritz 64600 ANGLET 05 59 41 22 98 Département des Pyrénées-Atlantiques Côte Basque Interservices (ACBI) M Association P 3, rue du pont de l'aveugle 64600 ANGLET 05 59 03 53 31 Département des Pyrénées-Atlantiques Services aux Particuliers (ASAP) M Association 12, rue Jean Hausseguy P 64600 ANGLET 05 59 03 63 30 Département des Pyrénées-Atlantiques Garde à Domicile BP 441 M Centre -

Liste Des SAAD
15/09/2020 LISTE DES SERVICES D'AIDE À DOMICILE pouvant intervenir auprès des personnes âgées bénéficiaires de l'Allocation Personnalisée d'Autonomie (A.P.A.) et/ou des adultes handicapées bénéficiaires de la Prestation de Compensation du Handicap (P.C.H.) et pour certains, auprès des bénéficiaires de l'aide ménagère au titre de l'aide sociale légale départementale Habilitation à l'aide sociale départementale www.le64.fr TI = Type d'interventions réalisables AS = Service prestataire d'aide à domicile pouvant intervenir auprès des bénéficiaires P = Prestataire -- M = Mandataire de l'aide sociale départementale Code AS Nom du service Adresse Ville Téléphone TI Territoire d'intervention Postal Centre Mercure P AS A.D.M.R. ADOUR ET NIVE 64600 ANGLET 05 59 59 44 75 Département des Pyrénées-Atlantiques 25 avenue Jean Léon Laporte M CCAS 2 avenue Belle Marion AS 64600 ANGLET 05 59 58 35 23 P Ville d’ANGLET Centre Communal d'Action Sociale Pôle Solidarité Association Uniquement en garde de nuit itinérante AS Les Lucioles 95, avenue de Biarritz 64600 ANGLET 05 59 03 63 30 P Communauté d’agglomération du BAB (BIARRITZ, BAYONNE, ANGLET) et périphérie GARDE DE NUIT ITINERANTE proche Association P 3, rue du pont de l'aveugle 64600 ANGLET 05 59 03 53 31 Département des Pyrénées-Atlantiques Services aux Particuliers (ASAP) M Association P 95, avenue de Biarritz 64600 ANGLET 05 59 03 63 30 Département des Pyrénées-Atlantiques Garde à Domicile M Bâtiment l’alliance - 3 rue du pont de AZAE COTE BASQUE 64600 ANGLET 05 59 58 29 50 P Département des Pyrénées-Atlantiques -

A 65 Km Av Copernic
Av Copernic - Rp Total - Rte de Sendets - Andoins - Limendous - Soumoulou - Gomer - A 65 km Lucgarier - Lagos - Bénéjacq - Nay - Pardies-Piétat - Côte de Piétat - D209 - Crêtes de 02-janv Sam 13h30 Rontignon - Gelos - Pau Av Copernic - Rp Total - Rte de Sendets - Andoins - Limendous - Soumoulou - Gomer - B 40 km Lucgarier - Angaïs - Ousse - Sendets - Idron – Pau Hippodrome - Perlic - Poey-de-Lescar - Bas de Beyrie - Bougarber - Viellenave - X A 60 km D945 - D201 - Bas de Momas - D32 - D206 - Lonçon - Bournos - X D834 - Navailles- 07-janv Jeu 13h30 Angos - St Castin - Maucor - Bas de Buros - Pau Hippodrome - Perlic - Poey-de-Lescar - Bas de Beyrie - Bougarber - D945 - D201 - Bas B 40 km de Momas - D216 - Caubios - Sauvagnon - D289 - ZI Serres-Castet - Pau Jardiland - Trespoey - Bizanos - Assat - Baliros - Nay - Bénéjacq - Lagos - Espoey - Haut A 65 km d'Espoey - Lourenties - Limendous - Andoins - Sendets - Haut d'Idron - Pau 09-janv Sam 13h30 Jardiland - Trespoey - Bizanos - Assat - Baliros - Nay -Mirepeix - Angaïs - Ousse - Idron - B 40 km Pau Avenue et bas de Buros - Morlaàs - St Jammes - Souye - Escoubes - St Laurent- A 60 km Bretagne - Sedzère - Arrien - Lourenties - Limendous - Nousty - Ousse - Pau 14-janv Jeu 13h30 Hippodrome - Rocade nord - D289 - Uzein - Caubios - Ste Quitterie - D40 - D206 - B 40 km Navailles-Angos - Maucor - Bas de Buros - Pau Av Copernic - Rp Total - Rte de Sendets - Ousse - Hameau de Ousse - Assat - Baliros - A 65 km Nay - Asson - D35/CV - Lestelle-Bétharram - Montaut - Coarraze - Bénéjacq - Angaïs - 16-janv -

(EU) 2021/335 of 23 February 2021 Amending the Annex To
25.2.2021 EN Offi cial Jour nal of the European Uni on L 66/5 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2021/335 of 23 February 2021 amending the Annex to Implementing Decision (EU) 2020/1809 concerning certain protective measures in relation to outbreaks of highly pathogenic avian influenza in certain Member States (notified under document C(2021) 1386) (Text with EEA relevance) THE EUROPEAN COMMISSION, Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, Having regard to Council Directive 89/662/EEC of 11 December 1989 concerning veterinary checks in intra-Community trade with a view to the completion of the internal market (1), and in particular Article 9(4) thereof, Having regard to Council Directive 90/425/EEC of 26 June 1990 concerning veterinary checks applicable in intra-Union trade in certain live animals and products with a view to the completion of the internal market (2), and in particular Article 10(4) thereof, Having regard to Council Directive 2005/94/EC of 20 December 2005 on Community measures for the control of avian influenza and repealing Directive 92/40/EEC (3), and in particular Article 63(4) thereof, Whereas: (1) Commission Implementing Decision (EU) 2020/1809 (4) was adopted following outbreaks of highly pathogenic avian influenza (HPAI) in holdings where poultry or other captive birds were kept in certain Member States and the establishment of protection and surveillance zones by those Member States in accordance with Council Directive 2005/94/EC. (2) Implementing Decision (EU) 2020/1809 provides that the protection and surveillance zones established by the Member States listed in the Annex to that Implementing Decision, in accordance with Directive 2005/94/EC, are to comprise at least the areas listed as protection and surveillance zones in that Annex. -

LO BLUES DE CUQUERON Que'vs Vau Cantar Ua Cançon, E La Dondèna,La Dondon. Qu'ei La Cançon De Micolau, E Atau Qu'ei E Qu'ei At
LO BLUES DE CUQUERON LE BLUES DE CUQUERON Que'vs vau cantar ua cançon, Je vais vous chanter une chanson E la dondèna,la dondon. Et la dondaine la dondon. Qu'ei la cançon de Micolau, C'est la chanson de Micouleau, E atau qu'ei e qu'ei atau. Et c'est comme çà, et c'est comme çà. E quan avetz lo mau d'amor Quand vous avez le mal d'amour, Cantatz lo blues de Cuqueron. Chantez le blues de Cuqueron. Que soi passat a Visanòs, Je suis passé à Bizanos, Minja la carn deisha los òs. Mange la viande et laisse les os. Visanòs n'ei pas com a Morlaàs, Bizanos, c'est pas comme à Morlàas, A Morlaàs que t'envítan quan te'n vas. A Morlàas on t'invite quand tu t'en vas. E d'Ortès dinca Somolon, Et d'Orthez jusqu'à Soumoulou, Cantatz lo blues de Cuqueron. Chantez le Blues de Cuqueron. Que soi entrat dehens un bar, Je suis entré dans un bar, Que'n soi sortit a mieitat hart. J'en suis sorti à moitié saoul, Sus lo camin qu'èi espleishat, Sur le chemin j'ai fait les bordures, Que'm soi fotut dens lo varat. Je me suis foutu dans le fossé. Si avètz forçat sus lo pinton, Si vous avez forcé sur la bouteille, Cantatz lo blues de Cuqueron. Chantez le blues de Cuqueron. A mieja nueit que soi tornat, A minuit je suis rentré, La mia hemna qu'avè clavat, Ma femme avait fermé à clé, Qu'ei partida dab lo vesin, Elle est parti avec le voisin, Se'n tornaran doman matin Ils reviendront demain matin. -

Ma Maison En Bois P
Des euros, mais pour quoi faire ?... P. 3 Sensibiliser l’adolescent à la valeur de l’argent, à gérer un budget, relève surtout de l’éducation reçue en famille. L’argent de poche peut être un moyen d’apprentissage, une étape vers l’autonomie pourvu qu’il soit soumis à des conditions bien précises. La Chaîne De Saint-Vincent-des-Baïses le n° 2 � • novembre 2013 • n° 75 ISSn 1161 7896 Société Ma maison en bois p. 5 saint-Vincent-des-baïses cardesse lUcq-de-béarn P 2 P 7 P 8 Un accUeil inoUbliable Heste dé noUsté dame, l’atelier de danses traditionnelles fête de notre-dame 2 ■ Novembre 2013 La Chaîne saint-Vincent-des-baïses TAXIS Joël HARICHOURY TRAnspORTs mAlAdes AssIs Aline Roze COnvenTIOnné CAIsses mAteRiel de mAintien à domicile Être prisonnière 06 77 13 96 03 diététique 05 59 21 48 19 Produits biologiques et naturels Quartier marquemale 64360 mOneIn 5, pl. H. lacabanne monein Taxi n° 5 mOneIn tél. 05 59 21 37 23 Une journée très particulière SARL PANDELES Plombier - Chauffagiste L’été dans les prisons est une période où les inoubliable : avons pu mesurer, à voir 4, rue Charles Lacoste ENERGIE journées paraissent plus longues et ennuyeuses - « Nous n’étions plus des leur enthousiasme, com- sarl paillous & fils 64150 PARDIES RENOUVELABLE AlimentAtion - QuincAillerie 05 59 60 50 76 car les activités sont suspendues. numéros mais des stars. » bien cette démarche leur 34, rue du commerce Monein 06 08 74 38 29 SOLAIRE - « Je me suis sentie à nou- avait fait du bien. Tél. 05 59 21 20 20 [email protected] veau femme, j’étais belle. -

Dossier De Presse
Dossier de presse Nouvelle signalisation bilingue en français-béarnais aux entrées des communes de la CCLO 6 juillet 2020 SOMMAIRE 1. Le déploiement de la nouvelle signalisation bilingue .... P. 3 Une mise en œuvre en interne par les services de la CCLO Un co-financement CCLO / département des Pyrénées-Atlantiques Liste des communes en version bilingue 2. L’engagement partenarial de la CCLO pour valoriser la langue régionale .................................................................. P. 5 3. Contacts ........................................................................... P. 6 2 1. LA NOUVELLE SIGNALISATION 95 nouveaux panneaux de signalisation bilingue français-béarnais aux entrées des communes de la CCLO Engagée dans la promotion de la langue béarnaise, gasconne et occitane, la communauté de communes de Lacq-Orthez (CCLO) vient d’achever la pose de panneaux de signalisation bilingue aux entrées des communes du territoire. Inscrite dans le schéma d’aménagement linguistique Iniciativa porté par le département des Pyrénées-Atlantiques, cette valorisation visible et concrète de la langue régionale, encore peu fréquente en Béarn, s’accompagne d’actions d’animation et de communication visant à partager les richesses de ce patrimoine vivant. Le déploiement de la nouvelle signalisation franco-béarnaise En 2019, la CCLO a invité les 61 municipalités du territoire à se prononcer sur l’installation d’une signalisation bilingue aux entrées de leurs communes respectives. 51 ont répondu favorablement, dont 6 qui en étaient déjà équipées. 10 ont donné une réponse négative. Conformément à ces avis, la CCLO a installé des panneaux avec le nom des communes en béarnais aux principales entrées d’agglomération de 45 villes et villages, ce qui représente un total de 95 panneaux. -

COMMUNES HAD OLORON À Compter Du 01/02/2016
REPARTITION DES COMMUNES/HAD AQUITAINE COMMUNES HAD ORTHEZ COMMUNES HAD OLORON COMMUNES HAD PAU COMMUNES HAD BAYONNE à compter du 01/02/2016 à compter du 18/12/2015 AAST ABIDOS ACCOUS AHAXE-ALCIETTE-BASCASSAN ABERE ABITAIN AGNOS AHETZE ANDOINS ABOS AINHARP AICIRITS-CAMOU-SUHAST ANOS ANDREIN ALCAY-ALCABEHETY-SUNHARETTE AINCILLE ARBUS ANOYE ALOS-SIBAS-ABENSE AINHICE-MONGELOS ARESSY ARGAGNON ANCE AINHOA ARRIEN ARGELOS ANGAIS ALDUDES ARTIGUELOUTAN ARGET ANGOUS AMENDEUIX-ONEIX ARTIGUELOUVE ARNOS ARAMITS AMOROTS-SUCCOS ASSAT ARRICAU-BORDES ARAUJUZON ANGLET AUSSEVIELLE ARROSES ARAUX ANHAUX BALEIX ARTHEZ-DE-BEARN AREN ARANCOU BARINQUE ARTIX ARETTE ARBERATS-SILLEGUE BEDEILLE ARZACQ-ARRAZIGUET ARRAST-LARREBIEU ARBONNE BENTAYOU-SEREE ASTIS ARROS-DE-NAY ARBOUET-SUSSAUTE BERNADETS ATHOS-ASPIS ARTHEZ-D'ASSON ARCANGUES BILLERE AUBIN ARUDY ARHANSUS BIZANOS AUBOUS ASASP-ARROS ARMENDARITS BUROS AUDAUX ASSON ARNEGUY CASTEIDE-DOAT AUGA ASTE-BEON AROUE-ITHOROTS-OLHAIBY CASTERA-LOUBIX AURIAC AUBERTIN ARRAUTE-CHARRITTE ESCOUBES AURIONS-IDERNES AUSSURUCQ ASCAIN ESLOURENTIES-DABAN AUTERRIVE AYDIUS ASCARAT ESPECHEDE AUTEVIELLE-SAINT-MARTIN-BIDEREN BALIROS AYHERRE GABASTON AYDIE BARCUS BANCA GELOS BAIGTS-DE-BEARN BARZUN BARDOS HIGUERES-SOUYE BALANSUN BAUDREIX BASSUSSARRY IDRON BALIRACQ-MAUMUSSON BEDOUS BAYONNE LABATUT BARRAUTE-CAMU BENEJACQ BEGUIOS LAMAYOU BASSILLON-VAUZE BEOST BEHASQUE-LAPISTE LAROIN BASTANES BERROGAIN-LARUNS BEHORLEGUY LEE BELLOCQ BESCAT BERGOUEY-VIELLENAVE LESCAR BERENX BEUSTE BEYRIE-SUR-JOYEUSE LESPOURCY BESINGRAND BIDOS BIARRITZ LOMBIA BETRACQ -
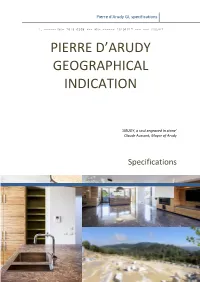
Hier Des Charges IG Pierre D'arudy
Pierre d'Arudy GI, specifications hier des charges IG Pierre d’Arudy 1. ------IND- 2019 0568 F-- EN- ------ 20191217 --- --- PROJET PIERRE D’ARUDY GEOGRAPHICAL INDICATION ‘ARUDY, a soul engraved in stone’ Claude Aussant, Mayor of Arudy Specifications p. 1 Pierre d'Arudy GI, specifications hier des charges IG Pierre d’Arudy Table of contents INTRODUCTION ....................................................................................................................................... 4 I. Name .................................................................................................................................................... 6 II. Product concerned .............................................................................................................................. 6 A. Product description ..................................................................................................................... 6 B. Products covered ......................................................................................................................... 8 III. Demarcation of the geographical area or associated specific place .................................................. 8 IV. The quality, reputation, traditional knowledge or other characteristics possessed by the product in question is essentially attributable to its geographical area or specific place ...................................... 15 A. Specificity of the geographical area ......................................................................................... -

Bayonne Canton : ANGLET Arrondissement : Pau BOUILLO
Département des Pyrénées-Atlantiques Liste des cantons Arrondissement : Bayonne Canton : ANGLET ANGLET (Bureaux de vote de 1 à 15) Arrondissement : Pau Canton : ARTIX ET PAYS DE SOUBESTRE ARGAGNON ARGET ARNOS ARTHEZ DE BEARN ARTIX ARZACQ-ARRAZIGUET AUSSEVIELLE BALANSUN BEYRIE EN BEARN BONNUT BOUGARBER BOUILLON BOUMOURT CABIDOS CASTEIDE-CAMI CASTEIDE-CANDAU CASTETIS CASTILLON D'ARTHEZ CESCAU COUBLUCQ DENGUIN DOAZON FICHOUS-RIUMAYOU GAROS GEUS-D'ARZACQ HAGETAUBIN LABASTIDE-CEZERACQ LABASTIDE-MONREJEAU LABEYRIE LACADEE LACQ LARREULE LONCON LOUVIGNY MALAUSSANNE MAZEROLLES MERACQ MESPLEDE MIALOS MOMAS MONT MONTAGUT MORLANNE PIETS-PLASENCE-MOUSTROU POMPS POURSIUGUES-BOUCOUE SAINT-MEDARD SALLESPISSE SAULT-DE-NAVAILLES SEBY SERRES-SAINTE-MARIE URDES UZAN VIELLENAVE-D'ARTHEZ VIGNES Arrondissement : Bayonne Canton : BAIGURA ET MONDARRAIN CAMBO-LES-BAINS ESPELETTE HALSOU HASPARREN ITXASSOU JATXOU LARRESSORE LOUHOSSOA MACAYE SOURAIDE Arrondissement : Bayonne Canton : BAYONNE 1 ANGLET (Bureaux de vote de 16 à 27) BAYONNE (Bureaux de vote de 17 à 20) Arrondissement : Bayonne Canton : BAYONNE 2 BAYONNE (Bureaux de vote de 21 à 30) BOUCAU Arrondissement : Bayonne Canton : BAYONNE 3 BAYONNE (Bureaux de vote de 1 à 16) Arrondissement : Bayonne Canton : BIARRITZ BIARRITZ Arrondissements : Oloron et Pau Canton : BILLERE ET COTEAUX DE JURANCON AUBERTIN BILLERE JURANCON LAROIN SAINT-FAUST Arrondissement : Pau Canton : LE COEUR DE BEARN ABIDOS ABOS ANGOUS ARAUJUZON ARAUX AUDAUX BASTANES BESINGRAND BIRON BUGNEIN CARDESSE CASTETNAU-CAMBLONG CASTETNER CHARRE CUQUERON