Semaine Du Film Ethnographique De Caen
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
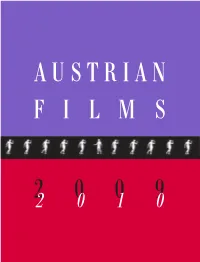
2 0 0 9 a U S T R I a N F I L
A U S T R I A N F I L M S 22 00 01 90 AFC-Katalog10_fin_MaB:AFC-Kat.5/6Kern 29.10.09 13:56 Seite 1 AUSTRIAN FILMS 20 09 2010 Published by the Austrian Film Commission AFC-Katalog10_fin_MaB:AFC-Kat.5/6Kern 29.10.09 13:56 Seite 2 Austrian Films 2009 /10 – Catalogue Owned by: Austrian Film Commission A-1070 Vienna, Stiftgasse 6 tel: +43 1 526 33 23 fax: +43 1 526 68 01 e-mail: [email protected] website: www .AustrianFilm.Com, www.afc.at © 2009 Austrian Film Commission, Vienna Publisher: Martin Schweighofer Editors: Charlotte Rühm, Karin Schiefer Translations: Steve Wilder Graphic design: Catherine Rollier Printed by: REMAprint Printed in: Vienna AFC-Katalog10_fin_MaB:AFC-Kat.5/6Kern 29.10.09 13:56 Seite 3 CONTENTS Introduction ........................................................ 4 Feature Films ....................................................... 7 Documentary Films .............................................. 35 Video Features .................................................... 61 Coproductions .................................................... 73 Short Films ........................................................ 87 TV Features ....................................................... 97 Coming Soon ..................................................... 125 List of Directors ................................................ 167 List of Films ..................................................... 171 Production Companies ........................................ 175 World Sales ...................................................... 182 -

A Film by Tizza Covi and Rainer Frimmel with Patrizia Gerardi, Walter Saabel, Tairo Caroli, Asia Crippa Cannes 2009
LP_poster_OK1 04.05.2009 19:17 Uhr Seite 1 LaPivellina A FILM BY TIZZA COVI AND RAINER FRIMMEL WITH PATRIZIA GERARDI, WALTER SAABEL, TAIRO CAROLI, ASIA CRIPPA CANNES 2009 La Pivellina A FILM BY TIZZA COVI AND RAINER FRIMMEL WITH PATRIZIA GERARDI, WALTER SAABEL, TAIRO COROLI, ASIA CRIPPA Austria-Italy / 2009 / 100 min / 35mm (S-16mm/Blow up) / 1.66 / colour / Dolby SRD PRESS WORLD SALES RENDEZ-VOUS FILMS DISTRIBUTION Viviana Andriani 34, rue du Louvre | 75001 PARIS Tel/fax: +33 1 42 66 36 35 Tel : +33 1 53 10 33 99 Fax : +33 1 53 10 33 98 In Cannes :+33 (0) 6 80 16 81 39 www.filmsdistribution.com | [email protected] [email protected] In Cannes BOOTH E5/F8 (RIVIERA) Production Vento FILM Tel : +33 4 92 99 32 09 Leitermayergasse 33/20 A-1180 Vienna Tel : +43 1 40 60 392 Fax : +43 1 25 33 03 37 999 www.ventofilm.com | [email protected] www.lapivellina.com Download Photos www.filmsdistribution.com/download/lapivellina SYNOPSIS Asia, an abandoned two-year old girl, is found by Patty, a circus woman living with her husband Walter in a trailer park on the outskirts of Rome, in San Basilio. With the help of Tairo, a 13 year-old boy who lives with his grandmother in an adjacent container, Patty starts to search for the girl’s mother. LA PIVELLINA is a film about a cosmos of outcasts in present day Italy: A tale of courage and discrimination, of loss and sharing together, a look behind the corrugated iron fence of a gated community. -

Broschüre Innovative Film Austria
Published by Federal Chancellery of Austria Arts Division 2014 Vienna — Austria innovative film austria ——— Imprint Federal Chancellery of Austria Arts Division / Film Department Barbara Fränzen – Director Concordiaplatz 2 1014 Vienna/Austria +43 1 531 15—206 880 [email protected] www.bka.gv.at Publisher and Concept Carlo Hufnagl – Film Department Editor Brigitte Mayr Translations Christine Wagner John Rayner (p. 20—35) Photographs © Maria Kracíková (p. 21) © Jürgen Keiper (p. 25) © Judith Wieser-Huber (p. 32/33) Editorial Deadline October 2014 Graphic Design up designers berlin-wien Walter Lendl Print Remaprint Litteradruck Contents INTRODUCTION 11 Dubito ergo sum by Federal Minister Josef Ostermayer FACTS + FIGURES 12 Budget 13 Most Frequent Festival Screenings 2011–2014 14 Most Frequent Rentals 1995–2014 15 Most International Awards Received 1998–2014 16 Outstanding Artist Awards 16 Austrian Art Awards 17 Thomas Pluch Screenplay Awards OUTSTANDING ARTIST 20 Johannes Hammel AWARDS 24 Ivette Löcker AUSTRIAN ART AWARD 30 Florian Flicker FILMS 39 Fiction 43 Documentary 63 Avant-garde 67 Fiction Short 71 Documentary Short 75 Avant-garde Short FILMS COMING SOON 89 Fiction Coming Soon 99 Documentary Coming Soon 129 Avant-garde Coming Soon 133 Fiction Short Coming Soon 137 Documentary Short Coming Soon 143 Avant-garde Short Coming Soon SCHOLARSHIPS FOR YOUNG TALENTS 159 Start-up Grants for Young Film Artists CONTACT ADDRESSES 167 Production Companies 169 Sales 169 Directors INDEX 172 Films 174 Directors introduction facts + figures ———— 10>11 Introduction Dubito ergo sum At the start of the 20th century, Rainer Maria Rilke wrote: “Wishes are the memories coming from our future.” Anyone thinking along well-trodden paths and perspectives is unlikely to grasp what these words mean. -

Download Detailseite
Berlinale 2010 Tizza Covi, Rainer Frimmel Generation LA PIVELLINA Kplus LA PIVELLINA LA PIVELLINA Österreich/Italien 2009 Darsteller Patty Patrizia Gerardi Länge 100 Min. Asia Asia Crippa Format 35 mm, 1:1.78 Tairo Tairo Caroli Walter Walter Saabel Farbe Stabliste Regie Tizza Covi Rainer Frimmel Buch Tizza Covi Kamera Rainer Frimmel Schnitt Tizza Covi Produzent Rainer Frimmel Patrizia Gerardi, Asia Crippa LA PIVELLINA Patty und Walter sind Artisten, die in ihrem Zirkuswagen wohnen, der im Winter in einem römischen Vorort aufgestellt ist. Bei Patty lebt Asia, ein zweijähriges Mädchen, das von ihrer Mutter ausgesetzt wurde. Gemeinsam mit Tairo, einem 13-Jährigen aus dem Nachbarwagen, begibt Patty sich auf die Suche nach Asias Mutter. LA PIVELLINA ist ein Film über die Menschen am Rande der italienischen Gesellschaft. Tizza Covi: „Am Anfang der Geschichte zeigen wir quasi-dokumentarisch, wie unsere Protagonisten leben. Dazu sollte ich erwähnen, dass in Italien nicht wenige Kinder in diesem Alter ausgesetzt werden, also nicht nur Neu - ge borene. Beim Filmemachen interessiert uns der dokumentarische Zu - gang. Was man in der Realität findet, lässt sich nicht inszenieren. Ande rer - seits sind wir beim Dokumentarfilm an den Punkt gelangt, an dem wir auf das Geschehen keinen Einfluss mehr nehmen konnten, und das hat uns gestört. In LA PIVELLINA arbeiteten wir mit Menschen zusammen, die vor der Kamera wunderbar natürlich waren und kein Problem damit hatten, dass sie zugegen war. Patty kennen wir schon seit langem, mit ihrer Stimme und ihrem ganzen Verhalten erinnert sie uns sehr an Anna Magnani, die wir beide verehren. Sie ist ein explosiver Charakter, obwohl sie sich bei den Aufnahmen sehr zurückgenommen hat. -

About Anthology FILM Archives
ANTHOLOGY FILM ARCHIVES July - September 2012 Anthology Film Archives Film Program, Volume 42 No. 3, July–September 2012 Anthology Film Archives Film Program is published quarterly by Anthology Film Archives, 32 Second Avenue, NY, NY 10003 Subscription is free with Membership to Anthology Film Archives, or $15/year for non-members. Cover artwork by Matt Mullican, 2012, all rights reserved. Staff Board of Directors Jonas Mekas, Artistic Director Jonas Mekas, President John Mhiripiri, Director Oona Mekas, Treasurer Stephanie Gray, Director of Development & Publicity John Mhiripiri, Secretary Wendy Dorsett, Director of Membership & Publications Barney Oldfield, Chair Jed Rapfogel, Film Programmer, Theater Manager Matthew Press Ava Tews, Administrative Assistant Arturas Zuokas René Smith, Special Events Coordinator Honorary Board Collections Staff agnès b., Brigitte Cornand, Robert Gardner, Robert A. Haller, Library Annette Michelson. In memoriam: Louise Bourgeois Andrew Lampert, Curator of Collections (1911-2010), Nam June Paik (1932-2006). , Archivist John Klacsmann Board of Advisors Erik Piil, Digital Archivist Richard Barone, Deborah Bell, Rachel Chodorov, Ben Theater Staff Foster, Roselee Goldberg, Timothy Greenfield-Sanders, Tim Keane, Print Traffic Coordinator & Head Manager Ali Hossaini, Akiko Iimura, Susan McGuirk, Sebastian Bradley Eros, Theater Manager, Researcher Mekas, Sara L. Meyerson, Benn Northover, Izhar Rachelle Rahme, Theater Manager Patkin, Ted Perry, Ikkan Sanada, Lola Schnabel, Stella Schnabel, Ingrid Scheib-Rothbart, P. Adams Sitney, Projectionists Hedda Szmulewicz, Marvin Soloway. Ted Fendt, Carolyn Funk, Sarah Halpern, Genevieve Havemeyer-King, Daren Ho, Jose Ramos, Moira Tierney, Composer in Residence Eva von Schweinitz, Tim White, Jacob Wiener. John Zorn Box Office Cait Carvalho, Phillip Gerson, Rachael Guma, Nellie Killian, Lisa Kletjian, Marcine Miller, Feliz Solomon. -

A Film by Tizza Covi and Rainer Frimmel
Mister Universo A Film by Tizza Covi and Rainer Frimmel with Tairo Caroli Wendy Weber Arthur Robin THE NEW FILM BY TIZZA COVI & RAINER FRIMMEL ENTERS THE FORCE FIELD BETWEEN A LION TAMER AND A FORMER MR UNIVERSE. MISTER UNIVERSO IS A FILMIC JOURNEY GUIDED BY IRON MUSCLES AND LUCKY CHARMS. SYNOPSIS The young lion tamer Tairo is unhappy with his life. He uses the loss of his good luck charm as an excuse to travel across Italy looking for Arthur Robin, a former Mr Universe, who gave it to him a long time ago. A movie about rational and irrational forces. DIRECTORS’ BIO production company Vento Film to produce their films independently. They won several awards for their documentaries, including the Wolfgang Staudte Award at the Berlinale for Babooska. La Pivellina, their first feature, was awarded the Tizza Covi was born in Bolzano, Europa Cinemas Label at the Italy, in 1971. She lived in Paris Quinzaine des Réalisateurs and Berlin before studying in Cannes and was Austria`s photography in Vienna. Rainer offical entry for the Oscars Frimmel was born in Vienna, 2011. Their second feature film Austria, in 1971. He studied The Shine of Day premiered in photography in Vienna. Since the international competition 1996 Tizza Covi and Rainer in Locarno 2012 and won the Frimmel are working together Silver Leopard for Best Actor. in photography, theatre, movie projects. In 2002 they founded their own film INTERVIEW We have encountered Tairo Caroli suddenly bursts into the life of An animal trainer and a before, in La Pivellina (2009). -

Innovative Film Austria 09/10
IF_2010_091129:ok 29.11.2009 18:23 Uhr Seite 1 Published by Federal Ministry for Education, the Arts and Culture 2009 Vienna — Austria IF_2010_091129:ok 29.11.2009 18:23 Uhr Seite 2 IF_2010_091129:ok 29.11.2009 18:23 Uhr Seite 3 IF_2010_091129:ok 29.11.2009 18:23 Uhr Seite 4 Imprint Federal Ministry for Education, the Arts and Culture – Film Division Barbara Fränzen – Director Concordiaplatz 2 1014 Vienna/Austria +43 1 531 20–68 80 [email protected] www.bmukk.gv.at Publisher and Concept Carlo Hufnagl — Film Division Editors Irmgard Hannemann-Klinger Brigitte Mayr Carlo Hufnagl Translation Eve Heller Photographs Directors © Joerg Burger Graphic Design up designers berlin-wien Walter Lendl Print REMAprint IF_2010_091129:ok 29.11.2009 18:23 Uhr Seite 5 Contents INTRODUCTION 7 Foreword by Federal Minister Claudia Schmied 9 Foreword by Nicole Brenez FACTS + FIGURES 14 Budget 15 Most Frequent Festival Screenings 2006–2009 15 Most Frequent Festival Screenings 1995–2009 16 Most Frequently Rented 1995–2009 17 Most International Awards Received 1995–2009 18 Promotional Awards 18 Recognition Awards 19 Thomas Pluch Screenplay Award RECENT SUCCESSES 22 Most Wanted FILMS 45 Fiction 53 Documentary 73 Avant-garde 77 Fiction Short 83 Documentary Short 89 Avant-garde Short FILMS COMING SOON 101 Fiction Coming Soon 107 Documentary Coming Soon 141 Avant-garde Coming Soon 145 Fiction Short Coming Soon 153 Documentary Short Coming Soon 161 Avant-garde Short Coming Soon CONTACT ADDRESSES 183 Production Companies & Sales 185 Directors INDEX 188 Directors 190 Films IF_2010_091129:ok 29.11.2009 18:23 Uhr Seite 6 6>7 Introduction IF_2010_091129:ok 29.11.2009 18:23 Uhr Seite 7 Yes, We Cannes! Austrian avant-garde film has long been recognized as an international trademark. -

La Pivellina
Après "LA PIVELLINA" l’éclat du jour SÉLEcTIOn MEILLEuR FILM SÉLEcTIOn PRIx dE La cRITIquE OFFIcIELLE FESTIVaL dE OFFIcIELLE nEw YORk SaRREbRuck PREMIERS PLanS FESTIVaL TaRkOVSkI angERS d’IVanOVO L’écLat du jour Un film de TIZZA COVI et RAINER FRIMMEL Autriche – 2012 – 1h31 – couleur – 1.85 – Dolby SRD SORTIE LE 12 FÉVRIER 2014 DISTRIBUTION PRESSE ZOOTROPE FILMS RENDEZ-VOUS 8 rue Lemercier 2 rue Turgot 75009 Paris 75017 Paris Viviana Andriani / Aurélie Dard Marie Pascaud Tél : 01 42 66 36 35 Tél : 01 53 20 48 63 [email protected] [email protected] [email protected] Dossier de presse et photos téléchargeables sur le site www.zootropefilms.fr SYnOPSIS Philipp, acteur de théâtre reconnu, se produit sur les plus prestigieuses scènes de Vienne et Hambourg. Son quotidien est rythmé par l’apprentissage des textes, les répétitions et les représentations. L’irruption dans sa vie de son oncle Walter, ancien artiste de cirque, va le pousser à ouvrir les yeux sur le monde qui l'entoure et réaliser que la vie n’est pas qu’un spectacle. EnTRETIEn aVEc TIZZa cOVI ET RaInER FRIMMEL Vous vous attachez de film en film à montrer l’envers du décor ? Qu’est-ce qui vous fascine tant dans cette idée ? Au théâtre, il y a la scène et les coulisses. Et c’est un peu la même chose dans la vie. Nous prétendons être ce que nous ne sommes pas. Dans nos films, nous dépeignons des personnages qui sont au centre d’une scène, que soit un cirque ou un théâtre, et nous les confrontons ensuite au monde réel. -

La Pivellina”)
(“La Pivellina”) A film by Tizza Covi and Rainer Frimmel 100 min / color / Austria-Italy / 2009 / HDCAM (S-16mm transfer) / 1.66 / stereo Italian w/ English subtitles FIRST RUN FEATURES The Film Center Building, 630 Ninth Ave. #1213 New York, NY 10036 (212) 243-0600 Fax (212) 989-7649 Website: www.firstrunfeatures.com Email: [email protected] http://www.lapivellina.com SELECTED PRESS "Humane and quietly moving." – Variety "A gem...most impressive. Asia Crippa's riveting presence melts not only the characters' but viewers' hearts as well." – Hollywood Reporter "[five stars] Bittersweet yet often joyful. If you can imagine a movie that takes a Dardennes-like approach to a milieu more familiar from Fellini's La Strada, you're halfway ready for the rough-hewn kind of magic at hand. One of the year's most delightful finds." – Toronto Eye Weekly "Remarkable...Affecting...Graceful...Astonishing authenticity. Asia Crippa is a delight." – Screen Daily "Charms in the neo-realist tradition. The child is utterly delightful." – Now (Toronto) "An emotionally potent chronicle of love and kinship...with the perfect cast." – Cinema Scope AWARDS AND ACCOLADES OFFICIAL AUSTRIAN ENTRY ~ Academy Awards ~ Best Foreign Language Film WINNER ~ Best European Film, Director’s Fortnight ~ 2009 Cannes Film Festival OFFICIAL SELECTION ~ 2010 Berlin Film Festival WINNER ~ Audience Award, 2011 Libertas Film Festival Dubrovnik SYNOPSIS Bathed in the neorealist tradition of Roberto Rossellini and Vittorio De Sica, La Pivellina is a captivating tale of people at the margins of society who open their hearts to a stranger. In a run-down park on the outskirts of Rome, a two year-old girl is discovered and taken in by a family of hard-luck circus performers. -

Der Glanz Des Tages the Shine Of
Der The Glanz shine Des of TaGes Day (original title) (international title) a film by Tizza Covi and Rainer Frimmel with Philipp Hochmair and Walter Saabel Austria / 2012 / 90 min / DCP / 1:1,85 Shooting format: Super 16 mm Production: Contact: Vento Film Austrian Film Commission Leitermayergasse 33/20 Stiftgasse 6 A-1180 Vienna A-1070 Wien Tel: +43 1 40 60 392 T: +43 1 526 33 23 Fax: +43 1 25 33 03 37 999 F: +43 1 526 68 01 [email protected] [email protected] www.ventofilm.com [email protected] www.afc.at SYNOPSIS Phillip Hochmair is a young, successful actor with engagements at big theatres in Vienna and Hamburg. His life is marked by learning new texts by heart, rehearsals, and performances, thus gradually losing contact with the reality of everyday life. Only when he meets wandering Walter, with whom he establishes an ambiguous friendship, and also faces his neighbour Victor’s destiny, he remembers that life is not just a stage. INTERVIEW WITH THE DIRECTORS TIZZA COVI AND RAINER FRIMMEL When we look at your films we could attention in Philipp was that he was say that in a certain way one story is a out of touch with reality, forced into segue of the previous one. that state as a very busy actor. You If there is a common theme, then it would live in intellectual texts, you are always have to be the fascination for performing someone else, and you are admired for in its most varied forms. Do you agree? something which is not you – i.e. -

Innovative Film Austria 12/13
Published by Federal Ministry for Education, the Arts and Culture 2012 Vienna — Austria Imprint Federal Ministry for Education, the Arts and Culture – Film Division Barbara Fränzen – Director Concordiaplatz 2 1014 Vienna/Austria +43 1 531 20–68 80 [email protected] www.bmukk.gv.at Publisher and Concept Carlo Hufnagl – Film Division Editor Brigitte Mayr Translation Christine Wagner Photographs Directors © Joerg Burger Graphic Design up designers berlin-wien Walter Lendl Print REMAprint Contents INTRODUCTION 9 Paradise, Love, Auteur Film by Federal Minister Claudia Schmied 10 Hybrid by Christa Blümlinger FACTS + FIGURES 14 Budget 15 Most Frequent Festival Screenings 2009–2012 16 Most Frequent Rentals 1995–2012 17 Most International Awards Received 1995–2012 18 Outstanding Artist Awards 18 Austrian Art Award 19 Thomas Pluch Screenplay Award RECENT SUCCESSES 21 Most Wanted FILMS 45 Fiction 51 Documentary 69 Avant-garde 73 Fiction Short 77 Documentary Short 83 Avant-garde Short FILMS COMING SOON 101 Fiction Coming Soon 111 Documentary Coming Soon 145 Fiction Short Coming Soon 151 Documentary Short Coming Soon 159 Avant-garde Short Coming Soon SCHOLARSHIPS FOR YOUNG TALENTS 2011 173 Start-Up Grants for Young Film Artists CONTACT ADDRESSES 181 Production Companies 184 Sales 185 Directors INDEX 188 Films 190 Directors introduction facts + figures > 8>9 Introduction Paradise, Love, Auteur Film The world’s oldest and most renowned film festival in Venice, which celebrated its 80th anniversary in 2012, presented the second part of Ulrich Seidl’s trilogy, Paradies: Glaube, this year. Following on from his 2009 success with Das weiße Band, Michael Haneke won another Palme d’Or in Cannes in 2012 for Amour. -

Babooska Regie: Tizza Covi, Rainer Frimmel
Babooska Regie: Tizza Covi, Rainer Frimmel Land: Österreich, Italien 2005. Produktion: Vento Film, Wien. Buch, Regie: Tizza Covi, Rainer Frimmel. Kamera, Produzent: Rainer Frimmel. Ton, Schnitt: Tizza Covi. Mitwirkende: Babooska Gerardi, Michele Pellegrini, Azzurra Gerardi, Marina de Vincentis, Ciccio Gerardi, Patrizia Gerardi, Walter Saabel. Format: 35mm (gedreht auf Super16mm), Farbe, 1:1.66. Länge: 100 Minuten, 25 Bilder/Sekunde. Originalsprache: Italienisch. Urauf- führung: 21. Oktober 2005, Viennale, Wien. Weltvertrieb: Vento Film, Leitermauergasse 33/20, A-1180 Wien, Österreich. Tel. + Fax: (43-1) 406 0392, email: contact@ventofi lm.com Gefördert vom Bundeskanzleramt Kunst (Wien) und der Südtiroler Landesregierung Inhalt Synopsis Der Film erzählt in Episoden vom alltäglichen Existenzkampf moderner BABOOSKA is an episodic fi lm that describes the daily Nomaden in Italien. Ein Jahr lang wird die junge Artistin Babooska, struggle for survival of modern nomads in Italy. Over the die mit ihrer Familie einen Wanderzirkus betreibt, auf ihrer Odyssee period of one year it follows the young artist Babooska, durch abgelegene mittelitalienische Ortschaften begleitet. who runs a traveling circus with her family, on her odyssey Ein ungeschminkter Blick hinter die Kulissen eines Mikrokosmos am through remote areas of the country. Rande der Gesellschaft, abseits gängiger Klischees, ohne Kommentar, An unvarnished look behind the scenes of a microcosm ohne Interviews. on the fringes of society – beyond the usual stereotypes, without commentary, without interviews. 27 Interview mit den Regisseuren Interview with the directors Frage: Wie seid ihr auf das Thema Zirkus gestoßen? Question: What got you interested in the theme of the Rainer Frimmel: Ich war schon immer von diesem Milieu fasziniert.