RASAMIMANANA, Ny Mahefa Telina
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more
Recommended publications
-

Répartition De La Caisse-École 2020 Des Collèges D'enseignement
Repartition de la caisse-école 2020 des Collèges d'Enseignement Général DREN ALAOTRA-MANGORO CISCO AMBATONDRAZAKA Prestataire OTIV ALMA Commune Code Etablissement Montant AMBANDRIKA 503010005 CEG AMBANDRIKA 1 598 669 AMBATONDRAZAKA 503020018 C.E.G. ANOSINDRAFILO 1 427 133 AMBATONDRAZAKA 503020016 CEG RAZAKA 3 779 515 AMBATONDRAZAKA SUBURBAINE 503030002 C.E.G. ANDINGADINGANA 1 142 422 AMBATOSORATRA 503040001 CEG AMBATOSORATRA 1 372 802 AMBOHIBOROMANGA 503070012 CEG ANNEXE AMBOHIBOROMANGA 878 417 AMBOHIBOROMANGA 503150018 CEG ANNEXE MARIANINA 775 871 AMBOHIBOROMANGA 503150016 CEGFERAMANGA SUD 710 931 AMBOHIDAVA 503040017 CEG AMBOHIDAVA 1 203 171 AMBOHITSILAOZANA 503050001 CEG AMBOHITSILAOZANA 1 671 044 AMBOHITSILAOZANA CEG TANAMBAO JIAPASIKA 622 687 AMPARIHINTSOKATRA 503060013 CEG AMPARIHINTSOKATRA 1 080 499 AMPITATSIMO 503070001 CEG AMPITATSIMO 1 530 936 AMPITATSIMO 503070015 CEG ANNEXE AMBOHITANIBE 860 667 ANDILANATOBY 503080025 CEG ANDRANOKOBAKA 760 039 ANDILANATOBY 503080001 CEG ANDILANATOBY 1 196 620 ANDILANATOBY 503080026 CEG ANNEXE SAHANIDINGANA 709 718 ANDILANATOBY 503080027 CEG COMMUNAUTAIRE AMBODINONOKA 817 973 ANDILANATOBY 503080031 CEG COMMUNAUTAIRE MANGATANY 723 676 ANDILANATOBY 503080036 CEG COMMUNAUTAIRE RANOFOTSY 668 769 ANDROMBA 503090005 CEG ANDROMBA 1 008 043 ANTANANDAVA 503100020 CEG ANTANANDAVA 1 056 579 ANTSANGASANGA 503110004 CEG ANTSANGASANGA 757 763 BEJOFO 503120016 C.E.G. -

Table Des Matieres La Region…………………………………………………….…………………..……………….1 1 Milieu Physique
TABLE DES MATIERES LA REGION…………………………………………………….…………………..……………….1 1 MILIEU PHYSIQUE ........................................................................................................................13 1.1 RELIEF .......................................................................................................................................13 1.2 GEOLOGIE .................................................................................................................................13 1.3 CLIMAT ......................................................................................................................................14 1.3.1 Le réseau de stations météorologiques ................................................................................15 1.3.2 Température ........................................................................................................................16 1.3.3 Pluviométrie ........................................................................................................................17 1.3.4 Diagrammes ombrothermiques ...........................................................................................18 1.3.5 Cyclones ..............................................................................................................................19 1.4 HYDROLOGIE ...........................................................................................................................19 1.5 SOLS ET VEGETATIONS .........................................................................................................20 -

Résultats Détaillés Antananarivo
RESULTATS SENATORIALES DU 29/12/2015 FARITANY: 1 ANTANANARIVO BV reçus: 313 sur 313 GASIKA MARINA HVM MAPAR MMM NY AREMA ASSOCI TIM RA MANGA ATION MAINTS RANO MALAG N°BV Emplacement AP AT Inscrits Votants B N S E O MALAZA ASY SAMBA REGION 11 ANALAMANGA BV reçus 140 sur 140 DISTRICT: 1101 AMBOHIDRATRIMO BV reçus24 sur 24 01 AMBATO 0 0 8 7 0 7 0 3 4 0 0 0 0 0 0 02 AMBATOLAMPY 0 0 8 8 0 8 0 1 4 1 0 0 0 0 2 03 AMBOHIDRATRIMO 0 0 10 10 0 10 0 1 8 0 0 0 0 0 1 04 AMBOHIMANJAKA 0 0 6 6 0 6 0 3 3 0 0 0 0 0 0 05 AMBOHIMPIHAONANA 0 0 6 6 0 6 0 0 3 0 0 0 0 1 2 06 AMBOHITRIMANJAKA 0 0 8 8 0 8 0 0 6 0 0 0 0 0 2 07 AMPANGABE 0 0 8 7 0 7 0 1 6 0 0 0 0 0 0 08 AMPANOTOKANA 0 0 8 8 0 8 0 4 2 0 1 0 0 0 1 09 ANJANADORIA 0 0 6 6 0 6 0 0 5 0 0 0 0 0 1 10 ANOSIALA 0 0 8 8 0 8 0 2 2 1 0 0 0 0 3 11 ANTANETIBE MAHAZA 0 0 8 8 0 8 0 0 6 0 0 0 0 0 2 12 ANTEHIROKA 0 0 8 6 0 6 0 0 5 0 0 0 0 0 1 13 ANTSAHAFILO 0 0 6 6 0 6 0 3 2 0 0 0 0 0 1 14 AVARATSENA 0 0 6 5 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 15 FIADANANA 0 0 6 6 0 6 0 0 3 0 0 0 0 0 3 16 IARINARIVO 0 0 6 6 0 6 0 2 3 0 0 0 0 0 1 17 IVATO 0 0 8 8 0 8 0 1 4 2 0 0 0 0 1 18 MAHABO 0 0 6 6 0 6 0 0 4 0 0 0 0 0 2 19 MAHEREZA 0 0 6 5 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 20 MAHITSY 0 0 8 8 0 8 0 4 3 0 0 0 0 0 1 21 MANANJARA 0 0 6 5 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 22 MANJAKAVARADRAN 0 0 6 6 0 6 0 1 2 1 0 0 0 1 1 23 MERIMANDROSO 0 0 8 8 0 8 0 2 5 0 1 0 0 0 0 24 TALATAMATY 0 0 8 8 0 8 0 0 3 2 0 0 0 0 3 TOTAL DISTRICT 0 0 172 165 0 165 0 28 98 7 2 0 0 2 28 DISTRICT: 1102 ANDRAMASINA BV reçus14 sur 14 01 ALAROBIA VATOSOLA 0 0 8 8 0 8 0 2 6 0 0 0 0 0 0 02 ALATSINAINY -

ASSEMBLEE NATIONALE Antenimieram-Pirenena
ASSEMBLEE NATIONALE REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Antenimieram-pirenena Tanindrazana-Fahafahana-Fahamarinana LOI n° 97- 032 modifiant certaines dispositions de l'Annexe de la Loi n° 94-001 du 26 avril 1995 fixant le nombre, la délimitation, la dénomination et les Chefs-lieux des Collectivités Territoriales Décentralisées L'Assemblée Nationale a adopté en sa séance du 10 Octobre 1997, la loi dont la teneur suit : Article premier .- Les listes des Communes et les Fokontany composants, celles des Départements, des régions de Betsiboka, du Sofia, de l'Est, du Mangoro, du Sud-Ouest, du Vonizongo-Marovatana, du Horombe, de la Haute Matsiatra, du Nord, d'Analamanga, du Vatovavy, de l'Androy, du Bongolava, du Fitovinany, d'Ivon'Imerina, du Boeni, de l'Itasy, du Vakinankaratra, du Melaky, de l'Anosy, d'Atsinanana, d'Ambatosoa, de l'Alaotra sont respectivement modifiées par le tableau annexé à la présente loi. Article 2 .- Toutes dispositions antérieures et contraires à la présente loi sont et demeurent abrogées notamment celles prévues par l'annexe de la Loi n° 94-001 du 26 avril 1995 fixant le nombre, la délimitation, la dénomination et les chefs lieux des Collectivités Territoriales Décentralisées. Article 3 .- La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République. Elle sera exécutée comme loi de l'Etat. Antananarivo, le 10 octobre 1997 LE PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE NATIONALE, LE SECRETAIRE, ANDRIAMANJATO Richard Mahitsison 2 ANNEXE DE LA LOI. n° 97-032 modifiant certaines dispositions de l'Annexe de la Loi n° 94-001 du 26 avril 1995 fixant -
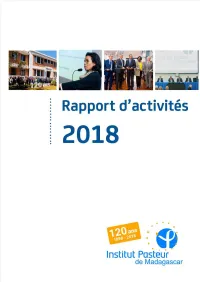
20190705-RAPDAC-Final-Compressé.Pdf
Rapport d’activités 2018 Rapport d’activités 2018 2 sur 358 Rapport d’activités 2018 3 sur 358 Sommaire Sommaire .............................................................................................................................................. 3 Mot du Directeur ................................................................................................................................... 7 Célébration du 120ème anniversaire de l’Institut Pasteur de Madagascar. 1898-2018 .............................. 12 Evènements marquants de l’année 2018 ............................................................................................... 26 Organigramme ..................................................................................................................................... 28 1. Présentation des entités ................................................................................................................... 29 Direction scientifique .................................................................................................................................. 30 Direction Administrative et Financière ........................................................................................................ 33 Unité de Bactériologie expérimentale ......................................................................................................... 39 Unité d’Entomologie Médicale .................................................................................................................... 44 Unité -
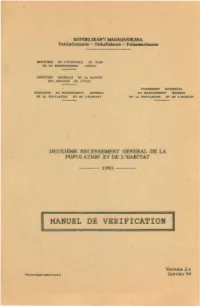
[ Manuel De Verification'i
~POBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana - Fahafahanâ - Fahamarinana YIN1ST~RB DE L' ECONOMIE, DU PLAN ET DU REDRBSSBMENT SOCIAL DIRBCTION' GBNERALE DE LA BANQUE DES DON NEES DE L'BTAT COMMISSION N'ATIONALE DIRECTION DV RECENSEMBNT GENERAL- DU iECBNSENENT ~ENERAL DE LA POPULATION ET DE L'HABITAT DB LA 1'OPULATION ST J)E L'HABITAT ,. DEUXIEME RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION ET DE L'HABITAT 1993 --- 1 / [ MANUEL DE VERIFICATION ' I Version 2.s . fO\<l.ocrsph\lIIanveT2.8 Janvier 94 REPOBLlKAN'I MADAGASlKARA 'farundrazalla - Fahafahana - Fahamarinana UINISTERE DE L'ECONOMIE, DU PLAN ET DU REDRESSEMENT SOCIAL DIRECTIO:-: GENERALE DE LA BANQUE DES DONNEES DE L'ETAT COMMISSION NATIONALE DIREC1ION Dl! RECENSEMENT GENERAL DU RECENSEMENT GENERAL DE LA POP U LATIO:i ET DE l' HABITAT DE LA POPULATION ET DE L'HABITAT DEUXIEME RECENSEMEl\rrr GEN]~RAL DE LA POPULATION Err DE L ~HA,BI'TAT 1993 MANUEL DE VERIFICATION 1 Il Version 2.s fb\docrBPh\manver2.s Janvier 94 SOI\.iMA1RE INTRODUCTIO~~ . 2 l - GENERALITES SUR LA VERIFICATION 1.1 - LA SECTION V"ERIFICATION ..•.........' , . ,........... 2 1.2 - LE TR~ VAIL DU \lt:RlFICATEUR ..................... 2 1.3 - L'IDEN1IFICATION DES QUESTIONNAIRES .. ,.... ~, ...... 3 1.4- LES QUESTIOl'.~.AIRES-SUITE ...................... 5 ,2 '- METIIODE DE'VERIFICATION o - MILIEU ..............................••........ 5 l - 'FARITA.N1" 2 - F IVONDRONA1\fPOK0l'41 Al"\""l , 3 - FIRAISM1POKONTMry· ..............•...•..........• 5 4 -. N°DE LA ZONE 5 - N e DU S EGME?\l . ~ . .. .... 6 6 "- FOKONTAl~l'· 7 - LOCALITE .... ' .....•..............•..... la ••' • • • • • • 8 8 - N ~ 'DU B.ATIMEr1T .•..-. _ .....•.. ~ ..••.•' .•••.•..•• · • 8 . 9 - TI'1>E' D'UTILISATION . '........................ · . 8 , <> DU ,..,.-c.... TAGE .. 9 ,~ 10. ~ _N Ir}...!::..l'" .• • . -

1104 Ankazobe
RESULTAT LEGISLATIVES 27 MAI 2019 District: ANKAZOBE Commune: AMBOHITROMBY Code Bureau: 110401010101 AMBOHITROMBY EPP AMBOHITROMBY SALLE 1 INSCRITS: 562 VOTANTS: 320 BLANCS ET NULS: 4 SUFFRAGE EXPRIMES: 316 N° Partie Voix Poucentage 1 INDEPENDANT RABENJA 10 3,16% 2 IRD 162 51,27% 3 TIM 144 45,57% Total des voix 316 RESULTAT LEGISLATIVES 27 MAI 2019 District: ANKAZOBE Commune: AMBOHITROMBY Code Bureau: 110401010102 AMBOHITROMBY EPP AMBOHITROMBY SALLE 2 INSCRITS: 486 VOTANTS: 315 BLANCS ET NULS: 2 SUFFRAGE EXPRIMES: 313 N° Partie Voix Poucentage 1 INDEPENDANT RABENJA 18 5,75% 2 IRD 173 55,27% 3 TIM 122 38,98% Total des voix 313 RESULTAT LEGISLATIVES 27 MAI 2019 District: ANKAZOBE Commune: AMBOHITROMBY Code Bureau: 110401020101 AMBOHIMORA CENTRE DE NIVAQUINISATION AMBO INSCRITS: 190 VOTANTS: 96 BLANCS ET NULS: 4 SUFFRAGE EXPRIMES: 92 N° Partie Voix Poucentage 1 INDEPENDANT RABENJA 6 6,52% 2 IRD 46 50,00% 3 TIM 40 43,48% Total des voix 92 RESULTAT LEGISLATIVES 27 MAI 2019 District: ANKAZOBE Commune: AMBOHITROMBY Code Bureau: 110401030101 AVARABATO-VOAJANAHARY EPP ANDRAINARIVO INSCRITS: 216 VOTANTS: 90 BLANCS ET NULS: 2 SUFFRAGE EXPRIMES: 88 N° Partie Voix Poucentage 1 INDEPENDANT RABENJA 5 5,68% 2 IRD 59 67,05% 3 TIM 24 27,27% Total des voix 88 RESULTAT LEGISLATIVES 27 MAI 2019 District: ANKAZOBE Commune: AMBOHITROMBY Code Bureau: 110401040101 FIRAISANTSOA EPP MANDROSOA INSCRITS: 205 VOTANTS: 64 BLANCS ET NULS: 0 SUFFRAGE EXPRIMES: 64 N° Partie Voix Poucentage 1 INDEPENDANT RABENJA 6 9,38% 2 IRD 44 68,75% 3 TIM 14 21,88% Total des voix 64 -

Citizen Involvement in Municipal Service Improvement (Cimsi) : Etude De Reference (Baseline)
EVALUATION DES EFFETS ET IMPACTS DU PROJET CITIZEN INVOLVEMENT IN MUNICIPAL SERVICE IMPROVEMENT (CIMSI) : ETUDE DE REFERENCE (BASELINE) RAPPORT FINAL Etude de référence du projet « Citizen Involvement in Municipal Service Improvement (CIMSI) » Version finale GROUPEMENT A2DM Association d’Appui au Développement de Madagascar Siège sociale : Lot III O 50 Mananjara BP 8336 - Antananarivo 101 Téléphone : +261 33 15 00 495 / +261 34 20 104 95 Email : [email protected] CONFORME Conseil Formation Etudes Lot II M 45 DF Andrianalefy Androhibe 101 Antananarivo Téléphone : +261 33 72 596 13 Email : [email protected] Juillet 2018 p. 1 EVALUATION DES EFFETS ET IMPACTS DU PROJET CITIZEN INVOLVEMENT IN MUNICIPAL SERVICE IMPROVEMENT (CIMSI) : ETUDE DE REFERENCE (BASELINE) Table des matières Table des matières..........................................................................................................................2 Résumé exécutif ..............................................................................................................................6 1. Introduction générale ........................................................................................................... 11 1.1. Contexte du projet .......................................................................................................... 11 1.2. Le projet CIMSI ................................................................................................................ 11 1.3. Localisation des zones d’intervention du projet ............................................................ -

Rapport D'activités 2019
Rapport d’activités 2019 1 sur 355 Rapport d’activités 2019 Rapport d’activités 2019 2 sur 355 Sommaire Sommaire .............................................................................................................................................. 2 Mot du Directeur ................................................................................................................................... 6 Direction scientifique ........................................................................................................................... 11 Direction Administrative et Financière .................................................................................................. 16 Evènements marquants de l’année 2019 ............................................................................................... 24 Organigramme ..................................................................................................................................... 26 1. Présentation des entités ................................................................................................................... 27 Unité de Bactériologie expérimentale ......................................................................................................... 28 Unité d’Entomologie Médicale .................................................................................................................... 33 Unité d’Epidémiologie et de Recherche Clinique ....................................................................................... -
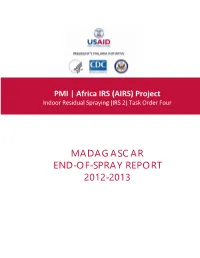
IRS Technical Report Template
PMI | Africa IRS (AIRS) Project Indoor Residual Spraying (IRS 2) Task Order Four MADAGASCAR END-OF-SPRAY REPORT 2012-2013 Recommended Citation: PMI|Africa IRS (AIRS) Project Indoor Residual Spraying (IRS 2) Task Order Four. June 2013. Madagascar End-of-Spray Report2012-2013. Bethesda, MD. PMI|Africa IRS (AIRS) Project Indoor Residual Spraying (IRS 2) Task Order Four, Abt Associates Inc. Contract No.: GHN-I-00-09-00013-00 Task Order: AID-OAA-TO-11-00039 Submitted to: United States Agency for International Development/PMI Abt Associates Inc. 1 4550 Montgomery Avenue 1 Suite 800 North 1 Bethesda, Maryland 20814 1 T. 301.347.5000 1 F. 301.913.9061 1 www.abtassociates.com 2012-2013 MADAGASCAR END-OF-SPRAY REPORT CONTENTS Contents …. .................................................................................................................................. iii Acronyms … .................................................................................................................................vii Executive Summary ..................................................................................................................... ix 1. Introduction ............................................................................................................................ 1 1.1 Background of IRS in Madagascar ................................................................................ 1 1.2 Objectives for AIRS Madagascar during the 2012-2013 IRS Campaigns .................. 2 2. Pre-IRS Campaign Activities ............................................................................................... -

Dfggfdgfdgsdfsdfdsfdsfsdfsdfdsfs
dfggfdgfdgsdfsdfdsfdsfsdfsdfdsfsdfdsfdmmm REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Fitiavana - Tanindrazana - Fandrosoana ----------------- HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE RESULTATS DEFINITIFS DU SECOND TOUR DE L'ELECTION PRESIDENTIELLE DU 19 DECEMBRE 2018 dfggfdgffhCode BV: 110401010101 dfggfdgffhBureau de vote: EPP AMBOHITROMBY SALLE 1 dfggfdgffhCommune: AMBOHITROMBY dfggfdgffhDistrict: ANKAZOBE dfggfdgffhRegion: ANALAMANGA dfggfdgffhProvince: ANTANANARIVO Inscrits : 506 Votants: 330 Blancs et Nuls: 5 Soit: 1,52% Suffrages exprimes: 325 Soit: 98,48% Taux de participation: 65,22% N° d'ordre Logo Photo Nom et Prenoms Candidat Voix obtenues Pourcentage 13 RAJOELINA Andry Nirina 125 38,46% 25 RAVALOMANANA Marc 200 61,54% Total voix: 325 100,00% Copyright @ HCC 2019 dfggfdgfdgsdfsdfdsfdsfsdfsdfdsfsdfdsfdmmm REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Fitiavana - Tanindrazana - Fandrosoana ----------------- HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE RESULTATS DEFINITIFS DU SECOND TOUR DE L'ELECTION PRESIDENTIELLE DU 19 DECEMBRE 2018 dfggfdgffhCode BV: 110401010102 dfggfdgffhBureau de vote: EPP AMBOHITROMBY SALLE 2 dfggfdgffhCommune: AMBOHITROMBY dfggfdgffhDistrict: ANKAZOBE dfggfdgffhRegion: ANALAMANGA dfggfdgffhProvince: ANTANANARIVO Inscrits : 506 Votants: 320 Blancs et Nuls: 5 Soit: 1,56% Suffrages exprimes: 315 Soit: 98,44% Taux de participation: 63,24% N° d'ordre Logo Photo Nom et Prenoms Candidat Voix obtenues Pourcentage 13 RAJOELINA Andry Nirina 153 48,57% 25 RAVALOMANANA Marc 162 51,43% Total voix: 315 100,00% Copyright @ HCC 2019 dfggfdgfdgsdfsdfdsfdsfsdfsdfdsfsdfdsfdmmm REPOBLIKAN'I -

Indicateurs De Coûts Et De Risque Par Stratégie À Fin 2023
STRATEGIE DE LA DETTE A MOYEN-TERME 2021-2023 Annexe 8 : Résultats des 4 stratégies Annexe 8a : Indicateurs de coûts et de risque par stratégie à fin 2023 2020 S1 S2 S3 S4 Dette nominale (% du PIB)* 41,4 46,7 46,8 46,8 46,8 Valeur actualisée de la dette (% du PIB) 28,7 31,5 32,1 32,7 34,1 Intérêts (% du PIB) 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 Taux d´intérêt moyen pondéré (%) 2,1 1,9 2,1 2,4 2,8 Dette amortie dans un an (% du total) 12,0 9,5 9,5 9,8 9,9 Dette amortie dans un an (% du PIB) 5,0 4,4 4,5 4,4 4,6 Risque de refinancement ATM Dette extérieure (ans) 14,4 13,5 12,9 12,3 12,0 ATM Dette intérieure (ans) 3,1 2,2 2,2 2,2 2,2 ATM Dette totale (ans) 12,1 11,9 11,3 10,9 10,6 ATR Dette totale (ans) 11,4 10,9 10,1 9,8 9,5 Dette à refixer dans un an (% du total) 22,4 24,2 28,4 29,7 22,4 Interest rate risk2 Dette à taux d´intérêt fixe (% du total) 89,2 84,3 80,2 78,9 78,2 BTA (% du total) 4,9 3,5 3,5 3,5 3,5 Dette en devises (% du total) 79,1 85,8 85,8 85,8 85,8 FX risk Dette à court-terme (% des réserves) 6,9 8,5 8,7 9,6 10,0 *L’encours des BTA n’inclut pas les intérêts précomptés.