DE MARTINO, S., F. PECCHIOLI DADDI (Éds.) — Eothen 11
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

IMPACT of a MILITARISTIC SOCIETY: a STUDY on the HITTITES by Amber N. Hawley Submitted to the Faculty of the Archaeological Stud
IMPACT OF A MILITARISTIC SOCIETY: A STUDY ON THE HITTITES By Amber N. Hawley Submitted to the Faculty of The Archaeological Studies Program Department of Sociology and Archaeology in partial fulfillment of the requirements for the degree of Bachelor of Science University of Wisconsin – La Crosse 2012 Copyright © 2012 by Amber N. Hawley All rights reserved ii THE ECONOMIC IMPACT OF A MILITARISTIC SOCIETY: A STUDY ON THE HITTITES Amber N. Hawley, B.S. University of Wisconsin-La Crosse, 2012 The purpose of this study is to better understand the relationship between the military, the economy, and the societal collapse of the Hittites, a militaristic society. The Hittite empire suffered from many problems near the end of its existence, but this research supports the idea that the military‟s demand for subsistence goods was too great for the economy to provide. By analyzing historical documentation, many aspects of the Hittite culture can be examined, such as trade networks as well as military campaign reports. The study also looks at the archaeological excavations of Hattusa, the Hittite capital, and Kaman-Kalehöyük, a supply city that would restock the campaigning military. By examining these cities and historical documentation, better understanding of the economy and military will be attained for militaristic societies; and in the case of the Hittites, their relationship to the societal collapse is determined to be strong. iii ACKNOWLEDGEMENTS First and foremost, I would like to thank my advisors, Dr. David Anderson and Dr. Mark Chavalas for providing me with feedback throughout my research. I would also like to thank my reading group, which consisted of Mitchell Johnson and Maximilian Pschorr for giving me great advice. -

The Rebellion of Ljatti's Syrian Vassals and Egypt's Meddling in Amurru 547
The rebellion oflJatti's Syrian vassals and Egypt's meddling in Amurru J ared L. Miller Mainz Introduction I Recently, during my work at the Akademie der Wissenschaften in Mainz I was able to reconstruct from seven fragments approximately the lower third to one half of what is apparently the obverse of a four-columned tablet in Hittite (see Fig. 1 and Fig. 3)2. Several lines of rev. iii are also partly preserved. I was then able to coUate, join and photograph the fragments in the Anadolu Medeniyetleri Miizesi in Ankara in Sept. 2005, with the exception of Bo 2442, which is housed in the museum in Istanbul. A copy of the reconstructed tablet will appear shortly in KBo 50. Obv. 11 Rev. III Fig. 1: Join sketch of Bo 2442+ l301/u+ 1806/u+1376/u+19l2/u+12S9/u+1984/u I I would like to express my appreciation to Dr. R. Akdogan and her colleagues I. Aykut and ~. Yilmaz for their friendly and patient assistance in the museum, to G. Wilhelm, who read and commented on an early draft of this paper - but who still favours the identity of Nibhururiya with Semenkhere - and to I. Singer, who read and offered several helpful comments on this paper. 2 The joins 1376/u+ 1912/u and 12S9/u+1984/u were already known by the time I began my study. \ 534 Jared L. Miller Only one of the fragments, Bo 2442, has hitherto been published, as KUB 19.15. This piece was treated in 1962 by R. Stefanine, who suggested that it represents a letter from the king of Karkamis during the reign of Mursili II (cf. -

Red River, Volume 25 Free
FREE RED RIVER, VOLUME 25 PDF Chie Shinohara | 184 pages | 14 Apr 2009 | Viz Media | 9781421522517 | English | San Francisco, CA, United States Red River, Vol. 28 | Book by Chie Shinohara | Official Publisher Page | Simon & Schuster Yuri, a teen of the 21st century, has been transported to ancient Anatolia as part of a scheme by the evil Nakia, Queen of the Hittites. Only the intervention of Nakia's stepson, Prince Kail, saved Yuri from the Queen's bloodthirsty intentions. As an unintended consequence, the people of the kingdoms of Anatolia have embraced Yuri as the incarnation of the great war-goddess Ishtar. During the ceremony to install her as tawananna, Yuri tells Kail she's pregnant. Then, in a glimpse into the near future, Kikkuri recounts a day in his life as the chief trainer for the kingdom's horses, and Yuri gets herself into a bit of a fix while visiting Cappadocia. And in the concluding tale, love finds Volume 25 own road Red River the events leading up to the marriage of Ramses, now the Pharoah of Egypt, and Kail and Yuri's granddaughter Naptera. By clicking 'Sign me up' I acknowledge that I have read and agree to the privacy policy and terms of use. Must Red River within 90 days. See full terms and conditions and this month's choices. Tell us what you like and we'll recommend books you'll love. Sign up and get a free eBook! Red River, Vol. By Chie Shinohara. Trade Paperback. About The Book. About The Author. Chie Shinohara. Product Details. -

A Hittite Tablet from Büklükale
AAS XVIII 2013 A Hittite Tablet fom Büklükale 19 A Hittite Tablet from Büklükale Mark WEEDEN London, UK ABSTRACT 2001, 2008) by the Japanese Institute of Anatolian Archaeology, led by S. Omura (id. 1993: 368, Tis article presents the philological publication of a fragment of Büyükkaletepe; 2007: 50). Since 2009 the JIAA a Hittite cuneiform tablet found during excavations conducted by has conducted four years of excavation at Büklükale the Japanese Institute of Anatolian Archaeology under the direc- under the directorship of K. Matsumura (id. 2010; tion of K. Matsumura at the site of Büklükale in 2010. Te frag- 2011). Using the evidence collected from these inves- ment contains part of a letter. Despite its being broken it is possible tigations it has not yet proven possible to arrive at a to suggest on the basis of some of the phraseology that this letter conclusive interpretation of the historical or archaeo- was probably written by a royal personage. Afer a summary con- logical context of the tablet at the site of Büklükale. sideration of the possible geographical implications of the fnd and of potential identifcations of the site with ancient place-names, the fragment is presented in hand-copy (Fig. 1) and photograph (Figs. 2. BÜKLÜKALE AND HITTITE 2-3), transliteration and translation. A detailed philological com- GEOGRAPHY: SOME mentary and palaeographic analysis is appended. PRELIMINARY REMARKS The site of Büklükale, otherwise referred to in some literature as Kapalıkaya, Büyükkale, or 1. INTRODUCTION Büyukkaletepe, is located on the western bend of the Kızılırmak on its western bank, opposite the The tablet fragment under consideration (BKT village of Köprüköy, about 100km southeast of 1) was found in secondary layering at the site of Ankara (coordinates 39° 35’ 0” N by 33° 25’ 42” Büklükale during excavations of the Japanese E, 785m above sea-level). -
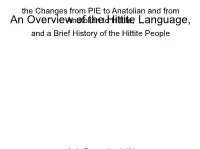
An Overview of the Hittite Language
the Changes from PIE to Anatolian and from An OverviewAnatolian of the to Hittite Hittite, Language, and a Brief History of the Hittite People A.J. Gregoritsch IV The Hittite Language ●Hittite, probably originally called nešili after the city of Neša (sometimes also called Aniša and originally named Kaneš), is an extinct Indo- European language of the Anatolian branch. ●It was spoken by an Indo-European people who at one time controlled much of what is now turkey and Syria. Notable Features of the Language ●Word order is typically SOV. ●It has split ergative alignment. ●Hittite, like PIE, had postpositions. ●Modifiers, including subordinate clauses, typically precede what they modify. ●Sentences and clauses usually begin with a chain of fixed-order clitics. From PIE to Common Anatolian ●Stops: ● Voiced aspirated stops lost their aspiration and merged with the plain voiced stops. – *bh, *b > *b – *dh, *d > *d – *gh, *g > *g – *ǵh, *ǵ > *ǵ – *gwh, *gw > *gw ● This would seem to be a change from the original PIE distinction between voiceless, voiced and voiced aspirated to a new From PIE to Common Anatolian ●Laryngeals: ● Scholars generally agree that *h2 was preserved as a consonant, and it is probable that *h3 was also preserved, though this is disputed. The two also seem to have merged into a single consonant, though there is some small evidence of a possible conditional split w of *h2 into *H and *H . – *h2, *h3 > *H w – also possibly: *h2w, *h2u > *H ● The outcome of *h1 appears to be the same as in the other branches. From PIE to Common -

Die Mittel Der Internationalen Kommunikation Zwischen Ägypten Und Staaten Vorderasiens in Der Späten Bronzezeit
Die Mittel der internationalen Kommunikation zwischen Ägypten und Staaten Vorderasiens in der späten Bronzezeit Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der Philosophischen Fakultät der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i. Br. Vorgelegt von Nasser Mekawi Ouda aus El-Kalyoubia, Ägypten WS 2003/2004 Erstgutachter: Prof. Dr. Horst Steible Zweitgutachter: Prof. Dr. Gerhard Hiesel Vorsitzende/r des Promotionssausschusses Der Gemeinsamen Kommission der Philologischen, Philosophischen und Wirtschafts- und Verhaltenswissenschaftlichen Fakultät: Prof. Dr. Elisabeth Cheauré Datum der letzten Fachprüfung in Rigorosum: 29. Dezember 2003 Inhaltsverzeichnis Dankaussagung………………………………………………………………………………..iii Abkürzungen…………………………………………………………………………………1-7 Bibliographie……………………………………………………………………………….8-11 Einleitung …………………………………………………………………………………12-14 I. Historischer Hintergrund 1. 1. Ägypten und Vorderasien während der Amarnazeit…………………………15-18 1. 2. Burra-Burrijāš II. und die Erlangung der Unabhängigkeit Assyriens………..18-20 1. 3. Die ägyptisch-hethitische Auseinandersetzung……………………………..20-23 2. Die Teilnehmer der internationalen Kommunikation 2. 1. Könige und gleichrangige Herrscher………………………………………...24-31 2. 2. Mitglieder der Königshäuser…………………………………………………31-35 2. 3. Angehörige der Verwaltung……………………………………………………..35 3. Die Ausführenden der internationalen Kommunikation 3.1. Bote…………………………………………………………………………...36-93 3. 2. Dolmetscher und Schreiber…………………………………………………..93-96 4. Die Briefe - Formular und Themenspektrum 4. 1. Allgemein………………………………………………………………………..97 -

THE KINGDOM of the HITTITES This Page Intentionally Left Blank the Kingdom of the Hittites
THE KINGDOM OF THE HITTITES This page intentionally left blank The Kingdom of the Hittites New Edition TREVOR BRYCE 1 3 Great Clarendon Street, Oxford ox2 6dp Oxford University Press is a department of the University of Oxford. It furthers the University’s objective of excellence in research, scholarship, and education by publishing worldwide in Oxford New York Auckland Cape Town Dar es Salaam Hong Kong Karachi Kuala Lumpur Madrid Melbourne Mexico City Nairobi New Delhi Shanghai Taipei Toronto With oYces in Argentina Austria Brazil Chile Czech Republic France Greece Guatemala Hungary Italy Japan Poland Portugal Singapore South Korea Switzerland Thailand Turkey Ukraine Vietnam Oxford is a registered trade mark of Oxford University Press in the UK and in certain other countries Published in the United States by Oxford University Press Inc., New York ß Trevor Bryce 2005 The moral rights of the author have been asserted Database right Oxford University Press (maker) First published 2005 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, without the prior permission in writing of Oxford University Press, or as expressly permitted by law, or under terms agreed with the appropriate reprographics rights organization. Enquiries concerning reproduction outside the scope of the above should be sent to the Rights Department, Oxford University Press, at the address above You must not circulate this book in any other binding or cover and you must impose the same -

Tartu Ülikool Filosoofiateaduskond Ajaloo Ja Arheoloogia Instituut
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by DSpace at Tartu University Library Tartu Ülikool Filosoofiateaduskond Ajaloo ja arheoloogia instituut Hetiidi riigi troonipärilus Bakalaureusetöö Siim Mõttus Teaduslik juhendaja: dotsent Mait Kõiv Tartu 2015 Sisukord Sissejuhatus ............................................................................................................................................ 4 Allikad ................................................................................................................................................. 5 Historiograafia ..................................................................................................................................... 7 Nimekujud ........................................................................................................................................... 8 Ajalooline taust.................................................................................................................................... 8 1 Üldised probleemid ...................................................................................................................... 10 1.1 Kuninga positsioon ja tähtsamad tiitlid ................................................................................. 10 1.2 Kronoloogilised ja genealoogilised probleemid .................................................................... 11 1.3 Valitav kuningavõim ............................................................................................................ -

Hurrian Personal Names in the Kingdom of Hatti
AperTO - Archivio Istituzionale Open Access dell'Università di Torino Hurrian Personal names in the Kingdom of Hatti This is the author's manuscript Original Citation: Availability: This version is available http://hdl.handle.net/2318/87209 since 2015-12-14T10:36:03Z Publisher: Logisma Terms of use: Open Access Anyone can freely access the full text of works made available as "Open Access". Works made available under a Creative Commons license can be used according to the terms and conditions of said license. Use of all other works requires consent of the right holder (author or publisher) if not exempted from copyright protection by the applicable law. (Article begins on next page) 25 September 2021 Collana di studi sulle civiltà dell’Oriente antico 18 1 2 Collana di studi sulle civiltà dell’Oriente antico fondata da Fiorella Imparati e Giovanni Pugliese Carratelli diretta da Stefano de Martino Stefano de Martino HURRIAN PERSONAL NAMES IN THE KINGDOM OF ÷ATTI LoGisma editore 3 Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze Antropologiche, Archeologiche e Storico Territoriali This volume has been printed thanks to a contribution MiUR, PRIN. Stefano de Martino, Hurrian Personal Names in the Kingdom of Ḫatti Copyright © 2011 Stefano de Martino Copyright © 2011 LoGisma editore www.logisma.it - [email protected] ISBN 978-88-87621-67-5 4 Table of Contents 1. Introduction . 7 2. The Members of the Royal Family of ÷atti 2.1. Early Empire . 9 2.2. Imperial Age . 13 2.3. Between Tradition and Innovation . 17 3. Kings and Rulers of Subordinated Countries . 21 4. Hurrian Personal Names in the Hittite Society 4.1. -

Red River, Volume 27 Free
FREE RED RIVER, VOLUME 27 PDF Chie Shinohara | 181 pages | 13 Oct 2009 | Viz Media | 9781421522531 | English | San Francisco, CA, United States Red River Vol 27 GN This illuminating account presents the story of the unique legal and governmental system that attempted to do so and the mixed success it encountered, culminating in the —70 Red River Rebellion and confederation with Canada in A vivid look into early settler life, Law, Life, and Government at Red River offers insights into the political, commercial, and legal circumstances that unfolded during western expansion. It lasted until May 22,when, after suffering significant casualties, the Union army retreated to Simmesport, Louisiana. The campaign was an attempt to prevent Confederate alliance with the French in Mexico, deny supplies to Confederate Volume 27, and secure vast quantities of Louisiana and Texas cotton for Northern mills. With this examination of Confederate leadership and how it affected the Red River Campaign, the author argues against the standard assumption that the campaign had no major effect on the outcome of the war. In fact, the South had—and lost—an excellent opportunity to inflict a decisive defeat that might have changed the course of history. With Volume 27 campaign as an ideal example, the politics Volume 27 military decision- making in general Red River also analyzed. The Confederacy had a great opportunity to turn the Civil War in its favor inbut Red River this chance when it failed to finish off a Union army cornered in Louisiana because of concerns about another Union army coming south from Arkansas. -
ROYAL HITTITE INSTRUCTIONS and RELATED ADMINISTRATIVE TEXTS Writings from the Ancient World
ROYAL HITTITE INSTRUCTIONS AND RELATED ADMINISTRATIVE TEXTS Writings from the Ancient World Theodore J. Lewis, General Editor Associate Editors Billie Jean Collins Daniel Fleming Martti Nissinen William Schniedewind Mark S. Smith Emily Teeter Terry Wilfong Number 31 Royal Hittite Instructions and Related Administrative Texts ROYAL HITTITE INSTRUCTIONS AND RELATED ADMINISTRATIVE TEXTS by Jared L. Miller Edited by Mauro Giorgieri Society of Biblical Literature Atlanta ROYAL HITTITE INSTRUCTIONS AND RELATED ADMINISTRATIVE TEXTS Copyright 2013 by the Society of Biblical Literature All rights reserved. No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording, or by means of any information storage or retrieval system, except as may be expressly permit- ted by the 1976 Copyright Act or in writing from the publisher. Requests for permission should be addressed in writing to the Rights and Permissions Office, Society of Biblical Literature, 825 Houston Mill Road, Atlanta, GA 30329 USA. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Royal Hittite instructions and related administrative texts / edited by Jared L. Miller. pages cm. — (Writings from the ancient world / Society of Biblical Literature ; Number 33) Includes bibliographical references and index. ISBN 978-1-58983-769-0 (hardcover binding : alk. paper) — ISBN 978-1-58983-656-3 (paper binding : alk. paper) — ISBN 978-1-58983-657-0 (electronic format) 1. Hittites—Rites and ceremonies—Sources. 2. Hittites—Kings and rulers—Sources. 3. Oaths—Middle East. 4. Hittite language—Texts. 5. Inscriptions, Hittite. I. Miller, Jared L., author, editor. DS66.R69 2013 939'.3—dc23 2013004122 Printed on acid-free, recycled paper conforming to ANSI/NISO Z39.48-1992 (R1997) and ISO 9706:1994 standards for paper permanence. -

Composizione E Numero Dei Contingenti Militari Nell'età Del
Università di Roma “Sapienza” Dipartimento di Scienze dell’Antichità CORSO DI DOTTORATO IN FILOLOGIA E STORIA DEL MONDO ANTICO CURRICULUM: STORIA ANTICA XXXI CICLO Composizione e numero dei contingenti militari nell’Età del Bronzo. Mesopotamia, Siria e Anatolia A.A. 2018/2019 TUTOR Prof. Maria Giovanna Biga CO-TUTOR Prof. Rita Francia Dott. Valeria degli Abbati Noi vogliamo cantare l’amor del pericolo, l’abitudine all’energia e alla temerità. F.T. Marinetti, Manifesto del Futurismo (1909) INDICE Ringraziamenti 1-2 Introduzione 3-7 Il Periodo Proto-Dinastico Accenni storico-geografici sulla Mesopotamia Proto-Dinastica 9-11 I contingenti militari in Epoca Proto-Dinastica 12-36 Il Periodo Akkadico Accenni storico-geografici sul Periodo Akkadico 38-41 I contingenti militari in Epoca Akkadica 42-58 Il Regno di Ebla Accenni storico-geografici sul Regno di Ebla 60-62 I contingenti militari nel Regno di Ebla 63-70 La III Dinastia di Ur Accenni storico-geografici sull’Età Neo-Sumerica 72-74 I contingenti militari della III Dinastia di Ur 75-84 L’Età di Mari Accenni storico-geografici sull’Età di Mari 86-88 I contingenti militari a Mari 89-102 Babilonia Accenni storico-geografici su Babilonia nell’Età del Bronzo 104-107 I contingenti militari a Babilonia 108-122 Il Mondo Assiro Accenni storico-geografici sul Regno d’Assiria nell’Età del Bronzo 124-127 I contingenti militari in Assiria 128-141 Il Regno di Mitanni Accenni storico-geografici sul Regno di Mitanni 143-149 I contingenti militari nel Regno di Mitanni 150-161 Il Mondo Ittita Accenni storico-geografici sull’Anatolia Ittita 163-171 I contingenti militari Ittiti 172-218 Conclusioni 219-223 Tavole 225-237 Bibliografia 238-260 INDICE DELLE TAVOLE Tavola I: La Geografia del Vicino Oriente Antico Fig.