PD 11: Xiphinema Americanum Sensu Lato
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Morphological Comparisons Between Xiphinema Rivesi Dalmasso and X
Dolichodorus grandaspicatus n. sp.: Robbins 511 scription and SEM observations of Dolichodorus 10:28-34. marylandicus n. sp. with a key to species of 4. Sher, S. A., and A. H. Bell. 1975. Scanning Dolichodorus. J. Nematol. 13:128-135. electron micrographs of the anterior region of 3. Robbins, R. T. 1978. Descriptions of females some species of Tylenchoidea (Tylenchida: Nema- (emended), a male, and juveniles of Paralongidorus toda). J. Nematol. 7:69-83. microlaimus (Nematoda: Longidoridae) J. Nematol. Morphological Comparisons Between Xiphinema rivesi Dalmasso and X. americanum Cobb Populations from the Eastern United States' .X'|AREK 1"~. ~¥OJTOWICZ'-', A. MORGAN GOLDEN :~, L. B. FORER 4, AND R. F. STOUFFER r' Ab.~tract: Tltough in the past Xiphinema americanum has been the most commonly reported dagger nematode in the eastern United States, our studies revealed the presence in l'ennsvlvania of a previously tntrecognized and unreported species related to X. americanum, Morphometric data atul photomicrographs establish the identity of this form as X. rivesi and show expected variations in populations of this species from various locations. Similar data and illustrations are given for X. americam~m populations from Pennsylvania and other areas, showing variations attd relationships. Xiphinema rivesi is widely distributed in the fruit producing area of south- cctttral l'cttnsylvania atttl is also reported herein from raspherry in Vermont and apple in Maryland attd New York. This species is frequently found it, fruit growing areas of Pennsylvania associated with lomatn r'ngspot virus-induced diseases and is also found associated with corn, bluegrass sod, and alfalfa. Key words: Xiphinema amerieanum, X. -

Ribosomal and Mitochondrial DNA Analyses of Xiphinema Americanum-Group Populations Stela S
Journal of Nematology 38(4):404–410. 2006. © The Society of Nematologists 2006. Ribosomal and Mitochondrial DNA Analyses of Xiphinema americanum-Group Populations Stela S. Lazarova,1 Gaynor Malloch,2 Claudio M.G. Oliveira,3 Judith Hübschen,4 Roy Neilson2 Abstract: The 18S ribosomal DNA (rDNA) and cytochrome oxidase I region of mitochondrial DNA (mtDNA) were sequenced for 24 Xiphinema americanum-group populations sourced from a number of geographically disparate locations. Sequences were sub- jected to phylogenetic analysis and compared. 18S rDNA strongly suggested that only X. pachtaicum, X. simile (two populations) and a X. americanum s.l. population from Portugal were different from the other 20 populations studied, whereas mtDNA indicated some heterogeneity between populations. Phylogenetically, based on mtDNA, an apparent dichotomy existed amongst X. americanum- group populations from North America and those from Asia, South America and Oceania. Analyses of 18S rDNA and mtDNA sequences underpin the classical taxonomic issues of the X. americanum-group and cast doubt on the degree of speciation within the X. americanum-group. Key words: 18S rDNA, longidorid, Longidoridae, molecular analysis, mtDNA, nematode, taxonomy. The taxonomy of the Xiphinema americanum-group is and Japan being of particular economic importance, as controversial, comprising either 34 (Luc et al., 1998), they are natural virus-vectors of four members of the 38 (Coomans et al., 2001) or 50 (Barsi and Lamberti, genus Nepovirus (Taylor and Brown, 1997). Biologically, 2004; Lamberti et al., 2004) putative species, depend- some species reported from Africa, Europe and the US ing on the taxonomic authority. For example, Luc et al. have been shown to have only three and not the usual (1998) proposed that X. -

Plant-Parasitic Nematodes in Iowa
Journal of the Iowa Academy of Science: JIAS Volume 96 Number Article 8 1989 Plant-parasitic Nematodes in Iowa Don C. Norton Iowa State University Let us know how access to this document benefits ouy Copyright © Copyright 1989 by the Iowa Academy of Science, Inc. Follow this and additional works at: https://scholarworks.uni.edu/jias Part of the Anthropology Commons, Life Sciences Commons, Physical Sciences and Mathematics Commons, and the Science and Mathematics Education Commons Recommended Citation Norton, Don C. (1989) "Plant-parasitic Nematodes in Iowa," Journal of the Iowa Academy of Science: JIAS, 96(1), 24-32. Available at: https://scholarworks.uni.edu/jias/vol96/iss1/8 This Research is brought to you for free and open access by the Iowa Academy of Science at UNI ScholarWorks. It has been accepted for inclusion in Journal of the Iowa Academy of Science: JIAS by an authorized editor of UNI ScholarWorks. For more information, please contact [email protected]. Jour. Iowa Acad. Sci. 96(1):24-32, 1989 Plant-parasitic Nematodes in Iowa1 DON C. NORTON Department of Plant Pathology, Iowa State University, Ames, IA 50011 Ninety-nine species of plant-parasitic nematodes are recorded from Iowa. Twenty-seven are new scare records. Mose samples were collected from around maize or from prairies or woodlands. Similarity (Sorensen's index) of species was highest for rhe maize-prairie habitats (0.49), compared with maize-woodlands (0. 23), or prairie-woodland (0. 3 7) habirars. Nematode communities were most diverse in prairies with a Shannon-Weiner index (H') of 2.74, compared wirh I.65 and 1.07 for woodlands and maize habitats, respectively. -

Xiphinema Americanum Cobb, 1913
-- CALIFORNIA D EPAUMENT OF cdfa FOOD & AGRICULTURE ~ California Pest Rating Proposal for Xiphinema americanum Cobb, 1913 American dagger nematode Current Pest Rating: C Proposed Pest Rating: C Kingdom: Animalia; Phylum: Nematoda; Class: Enoplea Order: Dorylaimida; Superfamily: Dorylaimoidea; Family: Longidoridae; Subfamily: Xiphineminae Comment Period: 02/27/2020 through 04/12/2020 Initiating Event: On August 9, 2019, USDA-APHIS published a list of “Native and Naturalized Plant Pests Permitted by Regulation”. Interstate movement of these plant pests is no longer federally regulated within the 48 contiguous United States. There are 49 plant pathogens (bacteria, fungi, viruses, and nematodes) on this list. California may choose to continue to regulate movement of some or all these pathogens into and within the state. In order to assess the needs and potential requirements to issue a state permit, a formal risk analysis for Xiphinema americanum is given herein and a permanent pest rating is proposed. History & Status: Background: Xiphinema americanum sensu lato (in the broad sense) is a migratory root ectoparasitic nematode that is widespread in North America (Robbins, 1993). This species inhabits the rhizosphere soils of host plants while feeding on roots. Eggs are laid singly in the soil and hatch in approximately one week. A population may be founded by a single larva. Once hatched, each larval stage must feed in order to molt and develop to the next stage. Larvae and adults feed by means of a long stylet that is used to penetrate the vascular tissue of roots. Males are very rare, and reproduction is apparently by parthenogenesis. The life cycle can take four years to complete (Halbrendt and Brown, 1992 and 1993). -

Xiphinema Americanum Sensu Lato
EPPO quarantine pest Prepared by CABI and EPPO for the EU under Contract 90/399003 Data Sheets on Quarantine Pests Xiphinema americanum sensu lato IDENTITY • Xiphinema americanum sensu lato Name: Xiphinema americanum Cobb sensu lato Synonyms: Tylencholaimus americanus (Cobb) Micoletzky Taxonomic position: Nematoda: Longidoridae Common names: American dagger nematode (English) Notes on taxonomy and nomenclature: For some time the designation of X. americanum has been disputed. Tarjan (1969) considered that X. americanum was a single species with large intraspecific variation, whereas Lima (1968) argued for a species complex containing seven species. Lamberti & Bleve-Zacheo (1979) divided the species into 15 new species and believed that at least 25 species could be recognized as belonging to the species complex. Current opinion puts the number of species at more than 40, one of which is X. americanum sensu stricto. However, the differences between several described species are small, while there is little information on intraspecific variability. For these reasons, and because the illustrations of many of the species are poor, few taxonomists would claim to be able to separate the species with certainty. An international group of taxonomists, under the auspices of EPPO, is currently making a morphological study of the species complex to try to clarify the relationships within it. Other research is directed towards the use of genetic techniques to distinguish species (Vrain et al., 1992). In the meantime, it is difficult to interpret most of the published data on the distribution, host/parasite relationships and virus-vector abilities of the component species. This data sheet considers X. americanum sensu lato, the species complex as a whole. -

Plant-Parasitic Nematodes in Germany – an Annotated Checklist
86 (3) · December 2014 pp. 177–198 Plant-parasitic nematodes in Germany – an annotated checklist Dieter Sturhan Arnethstr. 13D, 48159 Münster, Germany, and c/o Julius Kühn-Institut, Toppheideweg 88, 48161 Münster, Germany E-mail: [email protected] Received 15 September 2014 | Accepted 28 October 2014 Published online at www.soil-organisms.de 1 December 2014 | Printed version 15 December 2014 Abstract A total of 268 phytonematode species indigenous in Germany or more recently introduced and established outdoors are listed. Their current taxonomic status and classification is given, which is not always in agreement with that applied in Fauna Europaea or recent publications. Recently used synonyms are included and comments on the species status are sometimes added. Species originally described from Germany are particularly marked, presence of types and other voucher specimens in the German Nematode Collection - Terrestrial Nematodes (DNST) is indicated; likewise potential occurrence or absence of species in field soil and similar cultivated land is noted. Species known from indoor plants and only occasionally observed outdoors are listed separately. Synonymies and species considered as species inquirendae are listed in case records refer to Germany; records and identifications considered as doubtful are also listed. In a separate section notes on a number of genera and species are added, taxonomic problems are indicated, and data on morphology, distribution and habitat of some recently discovered species and of still unidentified or undescribed species or populations are given. Longidorus macroteromucronatus is synonymised with L. poessneckensis. Paratrophurus striatus is transferred as T. casigo nom. nov., comb. nov. to the genus Tylenchorhynchus. Neotypes of Merlinius bavaricus and Bursaphelenchus fraudulentus are designated. -

Nematoda) from Argentina E
RESEARCH/INVESTIGACIÓN DESCRIPTION OF SOME XIPHINEMA SPECIES POPULATIONS (NEMATODA) FROM ARGENTINA E. J. Chaves1* and E. A. Mondino2 1NEMA-AGRiS, Laboratorio de análisis de nematodos en suelo y plantas, 1900 La Plata, Argentina; 2Laboratório de Biologia do Solo, Depto. de Solos, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, BR-465, km 7 Seropédica, 23890- 000 RJ-Brasil. *Corresponding author: [email protected] ABSTRACT Chaves, E. J., and E. A. Mondino. 2013. Description of some Xiphinema species populations (nematoda) from Argentina. Nematropica 43:68-77. Observations are reported on the morphology and morphometrics of Argentinian populations of Xiphinema krugi, Xiphinema rivesi, Xiphinema vulgare and Xiphinema surinamense found in cultivated and uncultivated soils from the Buenos Aires, Santa Fe, Tucumán and Misiones Provinces. Key words: Xiphinema, morphology, morphometrics, cultivated. RESUMEN Chaves, E. J. and E. A. Mondino. 2013. Descripción de algunas poblaciones de especies de Xiphinema (nematoda) de Argentina. Nematropica 43:68-77. En el presente trabajo son reportadas observaciones morfométricas y morfológicas de poblaciones Argentinas de Xiphinema krugi, X. rivesi, X. vulgare and X. surinamense encontradas en suelos cultivados y no cultivados de las provincias de Buenos Aires, Santa fe, Tucumán y Misiones. Palabras clave: Xiphinema, morfométricas, morfológicas, cultivado. INTRODUCTION information on the occurrence of Xiphinema species in Argentina is provided in this article. Xiphinema, “the dagger nematode”, is one -
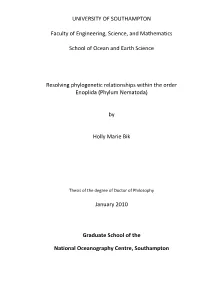
Thesis Outline
UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON Faculty of Engineering, Science, and Mathematics School of Ocean and Earth Science Resolving phylogenetic relationships within the order Enoplida (Phylum Nematoda) by Holly Marie Bik Thesis of the degree of Doctor of Philosophy January 2010 Graduate School of the National Oceanography Centre, Southampton This PhD Dissertation by Holly Marie Bik has been produced under the supervision of the following persons Supervisors Prof John Lambshead Dr Lawrence Hawkins Dr Alan Hughes Dr David Lunt Research Advisor Prof W. Kelley Thomas Chair of Advisory Panel Dr Martin Sheader 2 UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON ABSTRACT FACULTY OF ENGINEERING, SCIENCE & MATHEMATICS SCHOOL OF OCEAN & EARTH SCIENCE Doctor of Philosophy RESOLVING PHYLOGENETIC RELATIONSHIPS WITHIN THE ORDER ENOPLIDA (PHYLUM NEMATODA) by Holly Marie Bik The Order Enoplida (Phylum Nematoda) has been proposed as a divergent nematode lineage—Enoplid nematodes are thought to exhibit morphological and developmental characteristics present in the ‘ancestral nematode’. However, previous molecular phylogenies have failed to unequivocally confirm the position of this group. The Enoplida is primarily comprised of free-living marine species; if these taxa represent close relatives of the nematode ancestor, this relationship would presumably imply a marine origin for the phylum. Prior to this investigation, few publically available gene sequences existed for Enoplid nematodes, and published sequences represented only shallow water fauna from Northwest Europe. This study has aimed to improve resolution at the base of the nematode tree, using drastically increased taxon-sampling within the previously neglected Enoplid clade. Morphological identifications, nuclear gene sequences (18S and 28S rRNA), and mitochondrial gene sequences (Cox1) were obtained from marine specimens representing a variety of deep-sea and intertidal habitats. -
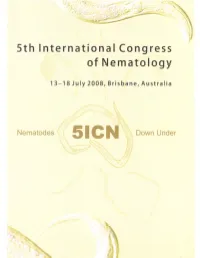
Table of Contents
TABLE OF CONTENTS SESSION ONE – PLENARY SESSION ............................................................................................... 1 CHAIRS: MICHAEL HODDA & DAVID CHITWOOD Is Nematology a Jigsaw, a Tapestry or a Strange Attractor? 1 Hodda, M. Metagenomics, Big Science, and the Reformation of Nematology 2 Powers, T. A Practical Future for Nematology in the Real World 2 Nicol, J. & R. Sikora SESSION TWO – ECOLOGY AND BIODIVERSITY OF SOIL NEMATODES IN SUSTAINABLE SOIL CONSERVATION ............................................................................................ 3 CONVENORS: GREGOR YEATES & NIGEL BELL Nematode Assemblages and Soil Properties Are Closely Linked 3 Sánchez-Moreno, S. & H. Ferris Nematode Diversity and Function in Dutch Sand Dunes 4 Brinkman, E.P., H. Duyts & W.H. Van der Putten Nematode Diversity under Commercial Banana Production 5 Pattison, A., J. Cobon, M. Araya, L. Pocasangre, F. Rosales & R. Sikora How Different or Similar are Nematode Communities in Paddy and Upland Rice Fields 6 Okada, H., W. Abe, M. Komatsuzaki & M. Hiroki A Perspective on Diversity within Nematode Feeding Groups across Ecosystems 7 Yeates, G.W. SESSION THREE – MUTUALISTIC/PHORETIC ASSOCIATIONS AND INVERTEBRATE PARASITIC NEMATODES ............................................................................................................... 8 CONVENORS: ROBIN GIBLIN-DAVIS & KERRIE DAVIES Entomophilic Nematodes for Predictions of Worldwide Nematode Species Diversity 8 Giblin-Davis, R.M., N. Kanzaki & K.A. Davies Host Specificity, -

Longidoridae and Trichodoridae (Nematoda: Dorylaimida and Triplonchida). Lincoln, N.Z.: Landcare Research
2 Xu & Zhao (2019) Longidoridae and Trichodoridae (Nematoda: Dorylaimida and Triplonchida) EDITORIAL BOARD Dr M. J. Fletcher, NSW Agricultural Scientific Collections Unit, Forest Road, Orange, NSW 2800, Australia Prof. G. Giribet, Museum of Comparative Zoology, Harvard University, 26 Oxford Street, Cambridge, MA 02138, U.S.A. Dr R. J. B. Hoare, Manaaki Whenua - Landcare Research, Private Bag 92170, Auckland, New Zealand Mr R. L. Palma, Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa, P.O. Box 467, Wellington, New Zealand Dr C. J. Vink, Canterbury Museum, Rolleston Ave, Christchurch, New Zealand CHIEF EDITOR Prof Z.-Q. Zhang, Manaaki Whenua - Landcare Research, Private Bag 92170, Auckland, New Zealand Associate Editors Dr T. R. Buckley, Dr R. J. B. Hoare, Dr R. A. B. Leschen, Dr D. F. Ward, Dr Z. Q. Zhao, Manaaki Whenua - Landcare Research, Private Bag 92170, Auckland, New Zealand Honorary Editor Dr T. K. Crosby, Manaaki Whenua - Landcare Research, Private Bag 92170, Auckland, New Zealand Fauna of New Zealand 79 3 Fauna of New Zealand Ko te Aitanga Pepeke o Aotearoa Number / Nama 79 Longidoridae and Trichodoridae (Nematoda: Dorylaimida and Triplonchida) by Yu-Mei Xu Agronomy College, Shanxi Agricultural University, Taigu 030801, China Email: [email protected] Zeng-Qi Zhao Manaaki Whenua - Landcare Research, 231 Morrin Road, Auckland, New Zealand Email: [email protected] Auckland, New Zealand 2019 4 Xu & Zhao (2019) Longidoridae and Trichodoridae (Nematoda: Dorylaimida and Triplonchida) Copyright © Manaaki Whenua - Landcare Research New Zealand Ltd 2019 No part of this work covered by copyright may be reproduced or copied in any form or by any means (graphic, elec- tronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping information retrieval systems, or otherwise) without the written permission of the publisher. -
Sensitivity of Nematode Life-History Groups to Ions and Osmotic Tensions of Nitrogenous Solutions
Journal of Nematology 36(1):85–94. 2004. © The Society of Nematologists 2004. Sensitivity of Nematode Life-History Groups to Ions and Osmotic Tensions of Nitrogenous Solutions Mario Tenuta1 and Howard Ferris2 Abstract: Guild designation of nematodes of similar trophic function and life-history strategy provides a basis for using nematode faunal analyses in an integrative assessment of soil food web condition. Omnivorous and predaceous nematodes, categorized at the upper end of a colonizer-persister (c-p) continuum of nematode functional guilds are generally not abundant in cropped soil. These nematodes are more sensitive to heavy metal concentrations than those in other c-p groups, but whether sensitivity to agrochemicals contributes to the observed low abundance of high c-p groups in cropped soils is less well understood. An exposure assay in solution was used to compare the sensitivity of nematodes representing various guilds obtained from field soils and from laboratory culture to several nitrogen sources. Nematodes in c-p groups 4 and 5 were more sensitive to nitrogen solutions than nematodes representing lower c-p groups. There were both osmotic and specific ion effects—the latter most evident in exposure of nematodes to NaNO2 and (NH4)2SO4. The RC50 (concentration resulting in nematode recovery of one half of that of distilled water) for (NH4)2SO4 was < 0.052 M-N for c-p groups 4 and 5 compared to much greater values (0.34 to 0.81 M-N) for c-p groups 1 to 3. In non-ionic polyethylene glycol (PEG) solutions, osmotic tensions of 0.40 to 0.43 MPa reduced the recovery of exposed nematodes by half (RT50; water potential of solution resulting in nematode recovery of one half of that of distilled water) for c-p groups 4 and 5 compared to > 1.93 MPa for c-p groups 1 to 3. -

DP 11: Xiphinema Americanum Sensu Lato INTERNATIONAL STANDARD for PHYTOSANITARY MEASURES PHYTOSANITARY for STANDARD INTERNATIONAL DIAGNOSTIC PROTOCOLS
ISPM 27 27 A NNE X 11 ENG DP 11: Xiphinema americanum sensu lato INTERNATIONAL STANDARD FOR PHYTOSANITARY MEASURES PHYTOSANITARY FOR STANDARD INTERNATIONAL DIAGNOSTIC PROTOCOLS Produced by the Secretariat of the International Plant Protection Convention (IPPC) This page is intentionally left blank This diagnostic protocol was adopted by the Standards Committee on behalf of the Commission on Phytosanitary Measures in January 2016. The annex is a prescriptive part of ISPM 27. ISPM 27 Diagnostic protocols for regulated pests DP 11: Xiphinema americanum sensu lato Adopted 2016; published 2016 CONTENTS 1. Pest Information ............................................................................................................................... 2 2. Taxonomic Information .................................................................................................................... 3 3. Detection ........................................................................................................................................... 3 4. Identification ..................................................................................................................................... 3 4.1 Preparation of material ...................................................................................................... 4 4.1.1 Temporary preparations .................................................................................................... 4 4.1.2 Permanent preparations ....................................................................................................