Document Sur La Redirection Dâ•Žimprimante Dans Le
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Fragment NUMMER 16 | VOORJAAR 2019 TEGENBEELD De Nieuwe Thematentoonstelling in Het Depot
Fragment NUMMER 16 | VOORJAAR 2019 TEGENBEELD De nieuwe thematentoonstelling in Het Depot HET DEPOT Tentoonstellingen, evenementen en andere activiteiten EJA SIEPMAN VAN DEN BERG Haar inspiratiebronnen LOUIS NIËNHUIS Solotentoonstelling WELKOM bij Het Depot Welkom bij Fragment, het tijdschrift van Beeldengalerij Het Depot. In dit nummer van Fragment is sprake van een trendbreuk De Idealenfabriek zou u op het eerste gezicht kunnen denken. In de collectie Een nieuwe activiteit van Stichting Utopa in Leiden, van Het Depot worden alleen sculpturen opgenomen van beeld- Wageningen en Amsterdam houwers die wij behulpzaam kunnen zijn in de ontwikkeling van hun talent. Voor overleden kunstenaars is dat een andere De utopie lijkt opnieuw in de belangstelling te staan. En dat zaak. Wij zijn geen collectioneurs of een museum dat zijn col- hangt natuurlijk niet alleen samen met het feit dat ruim lectie wil completeren. Dat zal ook zo blijven, maar wij hebben vijfhonderd jaar geleden de uitgave van Utopia van Thomas één permanente collectie: die van Eja Siepman van den Berg. More in Leuven van de pers rolde. In de Idealenfabriek wil Een collectie die inmiddels 40 beelden omvat. Om deze in Stichting Utopa haar utopische idealen uitdragen door wis- een bepaald perspectief te plaatsen hebben we beelden aan de selende thema’s aan de orde te stellen middels een tijdschrift, collectie toegevoegd van een aantal beeldhouwers uit vroeger discussies, maaltijden, tentoonstellingen en publicaties. De tijden. In de vorige nummers van Fragment lieten we u al Idealenfabriek wil uitvoerig en gedegen complexe problematie- beelden zien van Eva Mendlik en ‘De Tors’ van Charlotte van ken van alle kanten belichten en zo de samenleving een stukje Pallandt (1930). -
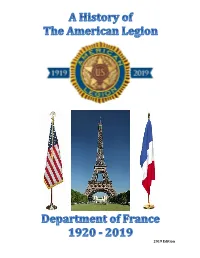
To View Expanded Department of France History
2019 Edition A Message from National Commander Brett P. Reistad The American Legion’s story begins in the Department of France. It was here in the months following the armistice of Nov. 11, 1918, where members of the American Expeditionary Forces waited to re-enter an uncertain future, having fought with their lives to make, as President Woodrow Wilson pledged, the world “safe for democracy.” The cost of fulfilling that pledge can be calculated in many ways, foremost of which is the number of Americans – more than 117,000 – who gave their lives to fulfill it. The enduring benefit of accomplishing such a deadly and difficult mission was a stronger America, a nation that would become revered worldwide as a beacon of hope, liberation and international integrity. When Lt. Col. Theodore Roosevelt, Jr., called three other officers to Paris in January 1919 to discuss the future ahead for America, they did so with the cost of war fresh on their minds. On that occasion, and in a follow-up gathering the next month, they made a commitment that wartime U.S. veterans worldwide would spend the next century fulfilling – to make America stronger, to honor the fallen, to preserve and protect the hard-won peace and to “cement the ties of comradeship” forged in battle. From the Paris Caucus of March 15-17, 1919, through establishment of overseas Memorial Day commemorations and the American Battle Monuments Commission, to the inception of an international coalition of wartime veterans – Federation Interalliee des Anciens Combatants – that laid a foundation later adopted in many ways through NATO, the early American Legion in France built and nurtured respect and understanding of the United States that continues today. -

MB98 Medals Print Catalogue May 2021
SIMMONS GALLERY PO BOX 104, LEYTONSTONE, LONDON E11 1ND, UK TEL: 020 8989 8097 (International + 44 20 8989 8097) Email [email protected] Illustrated online catalogue at simmonsgallery.co.uk MAILBID MB98 Closing for bids online from 12 noon 26 MAY 2021 BST offline bids must be received by first post 24 May 2021 Timed Online Auction British, European and World Commemorative and Art Medals from 18th century to the present British Art Medal Society Medals (BAMS) early issues from beginnings in 1982 to 2000 with other modern art medals Online viewing simmonsgallery.co.uk Buyer’s premium 5% plus VAT at standard rate on all lots MB98 Historical and Modern commemorative, art medals Wednesday 26 May 2021 12 noon Our May auction contains a listing of early British Art Medal Society issues and other medals from the collection of Peter Bagwell Purefoy (PBP). Peter was membership secretary for BAMS for many years. You may remember that we sold some of his collection in previous sales. Of particular interest are Lynn Chadwick’s Diamond, with the rare golden finish, and Ian Hamilton Finlay’s Terror/Virtue medals as they come with such a stellar provenance. Peter Bagwell-Purefoy was great friends with John Lobban, Avril Vaughan and Ron Dutton so no surprise that there are several medals by these artists here, including a complete series of Marks of Time. We’ve had quite a few consignments for the sale (sadly not from EU because of Brexit) but we’re still grouping medals by country. Do look through as there are some great art medals throughout, historical and modern. -

ŒUVRES SUR PAPIER Charles DESPIAU (1874-1946)
VERSAILLES ENCHÈRES 22 février 2020 22 SCULPTURES - ŒUVRES SUR PAPIER - ŒUVRES SCULPTURES Charles DESPIAU (1874-1946) Charles DESPIAU Samedi 22 février 2020 Samedi 22février En 1ère de couverture Charles Despiau dessinant dans son atelier - Circa 1941-1945 - En page de garde du catalogue détail du lot N°2 Samedi 22 février 2020 à 14h30 3, impasse des Chevau-Légers – 78000 Versailles Charles DESPIAU (1874-1946) SCULPTURES & ŒUVRES SUR PAPIER Expositions publiques Tous les jours de 11h à 18h du Jeudi 13 février au Vendredi 21 février 2020 Samedi 22 février 2020 de 11h à 12h Et sur rendez-vous Renseignements : Thierry de CRISNAY au +33(0)1 39 50 69 82 Commissaires-priseurs associés Nathalie HENRIETTE & Thierry de CRISNAY VERSAILLES ENCHERES SAS - 3 impasse des Chevau-Légers -78000 Versailles +33(0)1 39 50 69 82 – [email protected] www.versaillesencheres.com – www.versaillesencheres.auction.fr SVV agrément 2002-120 BIOGRAPHIE CHARLES DESPIAU (1874-1946) Elle lui inspirera par ailleurs ses premiers portraits et ses premières sculptures empreints de modernité ; se détachant progressivement des canons à la fois sobres, géométrisans, nerveux et romantiques de la production de son mentor, le sculpteur Auguste RODIN. Il remporte ses premiers succès. On le gratifie du 1er prix de « figure modelée » à l’occasion d’un petit concours interne aux Beaux-Arts. Entre 1898 et 1900, Charles DESPIAU expose au Salon des Artistes Français. Il occupe une chambre boulevard Montparnasse et pour se détendre préfère la terrasse du Dôme ou des Deux Magots à l’atmosphère des salons. Il va y présenter en 1900 une des versions en plâtre de sa compagne et modèle Mademoiselle Marie RUDEL qu’il représenta en buste à l’Italienne et dont l’original vous sera proposé aux enchères publiques durant notre vacation. -

Vendredi 9 Octobre 2015
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 100 DESSINS - 100 SCULPTURES VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 PARIS DROUOT - SALLE 2 - 14 H EXPOSITIONS PUBLIQUES Hôtel Drouot - salle 2 jeudi 8 octobre de 11h à 21h et vendredi 9 octobre de 11h à 12h Téléphone pendant l’exposition +33 (0)1 48 00 20 02 EXPERT Alexandre LACROIX 69 rue Sainte-Anne 75002 Paris - tél. +33 (0)6 86 28 70 75 [email protected] 5, rue La Boétie - 75008 Paris - tél. +33 (0)1 47 70 48 90 - fax. +33 (0)1 47 42 87 55 [email protected] - www.binocheetgiquello.com Jean-Claude Binoche - Alexandre Giquello - Commissaires-priseurs judiciaires o.v.v. agrément n°2002 389 - Commissaire-priseur habilité pour la vente : Alexandre Giquello Préparez-vous à l’inattendu ENCHÉRIR SUR INTERNET Drouot Live www.drouotlive.com ACHETER SUR INTERNET Drouot Online www.drouotonline.com FACILITER VOS ACHATS Drouot Card www.drouot.com/card S’INFORMER La Gazette Drouot www.gazette-drouot.com EXPÉDIER VOS ACHATS Drouot Transport www.drouot-transport.com Hôtel Drouot 9, rue drouot 75009 Paris +33 (0)1 48 00 20 20 [email protected] www.drouot.com 2 H ent sculptures et cent dessins de sculpteurs sont ici proposés aux enchères. Cet ensemble traverse l’histoire de la sculpture française du XX e siècle avec comme fil conducteur C « la sculpture indépendante ». Ce mouvement artistique est créé à l’aube du XX e siècle par un groupe de sculpteurs, « héritiers apaisés » de l’omniprésent Rodin. Rassemblés autour des frères Schnegg, ils formulent une proposition artistique, axée sur la figure humaine, réinterprétant l’art antique pour s’approcher de son idéal de calme, de sérénité et de dépouillement. -

Guide Pédagogique Les Lieux De Mémoire
SOMMAIRE 7 Avant-propos 9 Introduction Guide pédagogique 13 Neuf étapes de prise en main 13 La Grande Guerre, une résonance mémorielle exceptionnelle 13 Un ouvrage à utiliser au collège comme au lycée 14 Quatre parties pour quatre entrées mémorielles 15 Une démarche inductive préconisée par les programmes 16 Les entrées : structuration des fiches thématiques 16 De nombreuses possibilités de mise en œuvre en classe 17 En 3e, à quel moment de la progression intégrer les séances proposées ? 18 En 1re, à quel moment de la progression intégrer les séances proposées ? 19 Utiliser les documents en classe Les lieux de mémoire 28 Vivre sur le front 30 3e – Une bataille symbolique de la Grande Guerre : Verdun 34 3e – La bataille de la Somme 39 3e – La vie dans les tranchées 44 3e Évaluation par tâche complexe – Les Vosges et le tourisme de mémoire 48 1re euro Allemand – Der erste Weltkrieg aus der deutschen Sicht die Schützengräben 50 1re euro Allemand – Verdun, ein deutscher Erinnerungsort? 54 1re euro Anglais – The Battle of the Somme: from History to Remembrance 58 1re – Les Vosges, lieu de mémoire de la Grande Guerre 61 1re euro Anglais – The Dardanelles: a major British and Commonwealth memorial site of the Great War 65 1re – L’expérience combattante dans une guerre de position 68 1re Évaluation type Bac – Les Vosges, de l’expérience combattante au tourisme de mémoire 70 L'arrière 72 3e – Les hôpitaux durant la Grande Guerre 75 3e – L’occupation allemande en France : le monument allemand de Sedan 79 1re euro Allemand – Sedan während des Ersten -

Alice-Catherine Maire-Carls I. Personal Information
08/20 ALICE-CATHERINE MAIRE-CARLS I. PERSONAL INFORMATION CAMPUS ADDRESS HOME ADDRESS Andy Holt Humanities Building, H322F 144 Saddlebrook Drive Department of History and Philosophy Jackson, TN 38305 (USA) The University of Tennessee at Martin Tel: (731) 664-6038 Martin, TN 38238 (USA) Tel: (901) 587-7472 Fax: (901) 587-7584 Cell: (731) 661-1786 E-mail: [email protected] E-mail: [email protected] II. EDUCATIONAL CREDENTIALS 1973-1976 Université de Paris I-Sorbonne, Paris, France Doctorat de Troisième Cycle, History of International Relations (with distinction). Degree Conferred: October, 1976 1970-1973 Université de Paris IV-Sorbonne, Paris, France B.A. Polish Certificat C1 Conferred: June, 1973 D.U.E.L. Conferred: October, 1972 1972-1973 Institut Libre d'Edudes des Relations Internationales, Paris, France. Second Year Completed: June, 1973 1970-1972 Université de Paris IV-Sorbonne, Paris, France M.A. German Conferred: June, 1972 1967-1970 Université de Paris IV-Sorbonne, Paris, France B.A. German Conferred: June, 1970 D.U.E.L. Conferred: June, 1969 III. EMPLOYMENT HISTORY III.A. EMPLOYMENT 2005-Present Tom Elam Distinguished Professor of History, University of Tennessee at Martin, Martin, TN – Graduate Faculty status 2001-2005 Professor of History, University of Tennessee at Martin, Martin, TN 1997-2000 Associate Professor of History and Chair, Department of History and Political Science, University of Tennessee at Martin, Martin, TN 1996-2001 Associate Professor of History, University of Tennessee at Martin, Martin, TN 1992-1996 Assistant-Professor -

Encyklopédia Kresťanského Umenia
Marie Žúborová - Němcová: Encyklopédia kresťanského umenia Francúzi - francúzski ľudia Francúzska akadémia - Académie Francaise francúzska antikva - antikva francúzska francúzska architektúra - pozri Style Plantagenet, ranyonantná gotika/ Style rayonant, flamboantná gotika/Style flamboant, Louis Quatorze, Louis Quinze/Style rocaille, Louis Seize/luiséz, deuxiéme renaissance, francúzska novogotika; lucarne, klenba angevinská http://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Architecture_en_France francúzska architektúra gotická - pozri gotický sloh, katedrála, opus francigenum http://www.sacred-destinations.com/france/france-cathedrals http://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Architecture_gothique_en_France http://it.wikipedia.org/wiki/Categoria:Architetture_gotiche_della_Francia francúzska architektúra podľa štýlu - http://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Architecture_en_France_par_style francúzska architektúra románska - http://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Architecture_romane_en_France francúzska architektúra 12.st. - http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Arquitectura_en_Francia_del_siglo_XII francúzska kultúra - http://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Culture_en_France francúzska minca - minca francúzska francúzska novogotika - historizujúci sloh 2.pol.19.storočia; pozri historizmus Francúzska revolúcia - pozri Veľká francúzska revolúcia francúzska rímskokatolícka cirkev - http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Roman_Catholic_Church_in_France francúzska tlač - tlač francúzska francúzska záhrada - francúzsky park francúzske -

Les Monuments Publics De Raymond Delamarre (1890-1986)
UNIVERSITE TOULOUSE II UFR D’HISTOIRE DE L’ART CONTEMPORAIN LES MONUMENTS PUBLICS DE RAYMOND DELAMARRE (1890-1986) THÈSE POUR LE DOCTORAT Présentée et soutenue publiquement le Vendredi 29 juin 2012 PAR BEATRICE HAURIE VOLUME II Corpus des monuments tel-00745740, version 1 - 12 Nov 2012 Titre attribué : Figure allégorique du monument commémoratif à Charles Jonnart à Saint-Omer, 1937, Fonds National d'Art Contemporain, achat à l’artiste en 1952, localisation non identifiée { Madame le Professeur Luce BARLANGUE, Directrice { Monsieur le Professeur Dominique DUSSOL Membres du jury de la thèse { Monsieur le Professeur Jean-François PINCHON { Monsieur le Maître de conférences Jean NAYROLLES 1 VOLUME II : CORPUS DES MONUMENTS Première partie : la réussite scolaire .....................................................................................6 La gloire ramène le héros au foyer familial , premier grand prix de Rome de sculpture, 1919..........6 Les envois de la Villa Médicis à Rome (1919-1924) .......................................................................9 Suzanne (femme assise), 1919-1921 .................................................................................................12 Victoire , 1921-1922 ..........................................................................................................................17 Projet pour la 4e station du chemin de croix , 1922-1923 ................................................................20 David, 1923-1924 .............................................................................................................................21 -

Mise En Page 1
1 DEUX SCULPTURES : - E COLE FRANÇAISE DU XX E SIÈCLE Sainte Thérèse Plâtre d’atelier avec mise aux points H. 40 cm - L. 27 cm - P. 17 cm Petits éclats - E COLE FRANÇAISE DE LA FIN DU XIX E SIÈCLE Maternité Esquisse en cire de couleur brun foncé H. 18 cm - L. 20 cm - P. 17 cm 300 / 400 € 2 CHARLES AUFFRET (1929-2001) Nu féminin Plume et lavis d’encre Signé : CH. AUFFRET H. 25 cm - L. 37 cm 300 / 400 € 3 CHARLES AUFFRET (1929-2001) Nu féminin Monotype Signé : CH. AUFFRET H. 18 cm - L. 30 cm 200 / 300 € 4 CHARLES AUFFRET (1929-2001) Femme assise Plume et lavis d’encre Signé : CH. AUFFRET H. 27,5 cm - L. 27,5 cm 300 / 400 € 5 CHARLES AUFFRET (1929-2001) Nu féminin Crayon et aquarelle Signé et daté : CH. AUFFRET 73 H. 28 cm - L. 24,5 cm 300 / 400 € 6 CHARLES AUFFRET (1929-2001) Séduction, vers 1980 Epreuve en bronze, n°4/8 Fonte à la cire perdue Delval Signé : CH. AUFFRET H. 26 cm - L. 11 cm - P. 9 cm 3 000 / 4 000 € 7 CHARLES AUFFRET (1929-2001) L’invitation, vers 1980-1990 Epreuve en bronze, n°1/8 Fonte à la cire perdue Delval Signé : CH. AUFFRET H. 11,5 cm - L. 15 cm - 7,5 cm 1 500 / 2 000 € 8 CHARLES AUFFRET (1929-2001) Femme assise sur un rocher Epreuve en bronze, n°1/8 Fonte à la cire perdue Jean-Marc Bodin Signé : CH. AUFFRET H. 38 cm - L. 23 cm - P. -

Tout Un Cirque Pour Si Peu : Micronouvelles En Traduction
TOUT UN CIRQUE POUR SI PEU : MICRONOUVELLES EN TRADUCTION THÈSE DE MAÎTRISE EN TRADUCTION LITTÉRAIRE Véronique Lessard École de traduction et d’interprétation Université d’Ottawa Directeur : Marc Charron © Véronique Lessard, Ottawa, Canada, 2018 RÉSUMÉ La présente étude invite le lecteur à s’éloigner des longs fleuves d’encre pour plonger dans le monde du bref, du furtif et de l’allusif, et à explorer le genre qu’est la micronouvelle. Cette étude sert de prétexte, paratexte et péritexte à la traduction, de l’espagnol au français, du recueil de micronouvelles Fenómenos de circo (2011) de l’écrivaine argentine Ana María Shua. La micronouvelle jouit d’une diffusion différentielle dans le monde : particulièrement intense dans l’espace hispanophone, beaucoup plus timide dans l’espace francophone. À la traduction du recueil de micronouvelles le plus récent à ce jour d’une auteure connue et réputée en microfiction, j’ajoute la production d’une sorte d’état des lieux thématique des réflexions théoriques actuelles sur ce genre littéraire, sa définition, sa dénomination et une partie de son histoire. J’étudie ensuite huit caractéristiques qui ressortent des œuvres de microfiction en général et de celles d’Ana María Shua en particulier : fractalité, brièveté, métafiction, hybridité, intertextualité, effet de chute, présence du fantastique et rôle actif du lecteur. La traduction de la microfiction ne semble pas fondamentalement différente de la traduction de toute autre œuvre littéraire dans la même combinaison de langues. Elle reçoit néanmoins l’influence du rayonnement différentiel de la micronouvelle dans les espaces hispanophone et francophone ainsi que des caractéristiques propres au genre microfictionnel. -

Le Nouveau Conseil Municipal De
X Élections Voter pour les députés européens p.5 X Val Fleury Ouverture d’une supérette et du parking Gifinfosinfos p.6 et 7 Gif X Exposition Jacques Villeglé et Jacques Bosser Le nouveau conseil p.9, 14 et 15 municipal de Gif n° 398 Mensuel municipal d'informations - Mai 2014 À www.ville-gif.fr 2 Rendez-vous de mai… Dimanches 4 et 18 Vendredi 16 Du jeudi 22 mai au Samedi 24 dimanche 13 juillet Jazz au canapé Café gourmand Fête mondiale Entre les deux 16h30 - Le Canapé Pour les nouveaux du jeu Place de l’Église octogénaires Giffois Jacques Tél. : 01 69 07 74 06 Sur le thème du voyage. www.le-canape.com (nés en 1934). Jacques Villeglé et Jacques Bosser À partir de 15h 14h - Espace du Val de Gif Place du Chapitre Tél. : 01 70 56 52 20 Lundi 5 et Espace du Val de Gif [email protected] Tél. : 01 70 56 52 65 www.ville-gif.fr Rencontre d'auteur Dimanche 18 Alex Cousseau Samedi 24 Théâtre en famille Amour et jambe cassée Chanson française Gérald De Palmas © Jacques Villeglé © Jacques Exposition et animations. Château du Val Fleury À partir de 17h Adam © John Tél. : 01 70 56 52 60 Bibliothèque municipale 16h - La Terrasse www.ville-gif.fr Tél. : 01 70 56 52 66 Tél. : 01 70 56 52 60 Billetterie en ligne : Mercredis 7 et 28 www.ville-gif.fr Vendredi 23 © Jeremiah Escale du chanteur nomade Jazz au canapé Du mardi 20 mai au Cercle littéraire à Gif.