Une Introduction Philosophique Au Copyleft Miguel Quaremme Une Introduction Philosophique Au Copyleft
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Bilan D'activités Open Knowledge Foundation France
Bilan d’activités Open Knowledge Foundation France Décembre 2012 - Août 2013 Vision stratégique Depuis sa création en décembre 2012, le groupe français de l’Open Knowledge Foundation a connu une croissance rapide que le réseau international a eu l’occasion de saluer. Dans l’effervescence du démarrage, l’association a exploré de nombreuses pistes et a participé à de nombreux projets sans avoir en tête une véritable cohérence dans son action. Toutefois, nous avons poursuivi deux objectifs principaux pendant les premiers mois : la constitution d’une communauté de membres actifs conformément à nos statuts et un effort pour la notoriété de l’association ainsi que son réseau international. Les administrateurs de l’association pensent que ces efforts ont porté leurs fruits au détriment de la cohérence de l’ensemble et parfois d’une gouvernance plus ouverte. Dans cet esprit, nous avons souhaité pendant l’été penser les projets prioritaires et la stratégie de développement de l’association avec les membres actifs qui souhaitaient participer. Nous avons ainsi décidé de nous concentrer prioritairement sur le développement de trois projets principaux : ● Le groupe de travail sur le domaine public avec le développement de calculateurs permettant d’identifier la présence d’une oeuvre dans le domaine public et un outilméthodologie pour la réutilisation ouverte des cartes postales du domaine public (OpenPostcards) pouvant déboucher sur une série d’événements grand public ● Le développement d’un portail permettant de rendre public et d’agréger les demandes d’information publique à la manière par exemple du projet “What do they know” au Royaume Uni ● La formation du grand public à la réutilisation des données ouvertes avec la traduction en français des contenus de la School of Data (schoolofdata.org) et le développement de Tada (dans la suite du projet imaginé tada.gouv.fr, voir checkthis.com/tadagouvfr), une méthode et de contenus pour initier les enfants à la réutilisation des données ouvertes. -

Rapport Moral Et Financier De L'association
Rapport moral et financier de l’association Framasoft Année 2011 Table des matières L’association Framasoft...............................................................................................................3 Le but de l’association.............................................................................................................3 Introduction et points clés principaux en 2011........................................................................3 Les ressources humaines........................................................................................................4 Les ressources financières.......................................................................................................4 Compte Emplois-Ressources et affectation des dons..............................................................4 Par activité.......................................................................................................................... 6 Bénévolat valorisé...................................................................................................................9 Analyse de la situation financière..........................................................................................10 Campagne de dons....................................................................................................................12 L'activité du réseau Framasoft en 2011 ....................................................................................13 Statistiques.......................................................................................................................... -
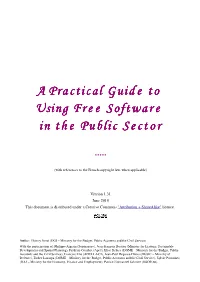
A Practical Guide to Using Free Software in the Public Sector
A Practical Guide to Using Free Software in the Public Sector ***** (with references to the French copyright law, when applicable) Version 1.31 June 2010 This document is distributed under a Creative Commons "Attribution + ShareAlike" licence. Author: Thierry Aimé (DGI – Ministry for the Budget, Public Accounts and the Civil Service) With the participation of: Philippe Aigrain (Sopinspace), Jean-François Boutier (Ministry for Ecology, Sustainable Development and Spatial Planning), Frédéric Couchet (April), Elise Debies (DGME – Ministry for the Budget, Public Accounts and the Civil Service), François Elie (ADULLACT), Jean-Paul Degorce-Duma (DGSIC – Ministry of Defence), Esther Lanaspa (DGME – Ministry for the Budget, Public Accounts and the Civil Service), Sylvie Poussines (DAJ – Ministry for the Economy, Finance and Employment), Patrice-Emmanuel Schmitz (OSOR.eu). A practical guide to using free software in the public sector 2 Contents 1 -What is software?.............................................................................................................................3 2 -Legal regimes governing the use of software..................................................................................3 3 -Who holds the copyright to software?.............................................................................................4 4 -What is a software licence?..............................................................................................................4 5 -What is a free software licence?.......................................................................................................4 -

Technical Workflows and Tools for Experimental Publishing
COPIM • Books Contain Multitudes: Exploring Experimental Publishing Part 3: Technical Workows and Tools for Experimental Publishing Marcell Mars, Tobias Steiner, Janneke Adema Published on: Jan 29, 2021 DOI: 10.21428/785a6451.174760b2 License: Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0) COPIM • Books Contain Multitudes: Exploring Experimental Publishing Part 3: Technical Workows and Tools for Experimental Publishing For this third part of the scoping report, we will be looking at the technical developments around experimental book publishing. We will be doing so in a three-fold manner in the next three sections. First, instead of conducting a landscape study ourselves, we will be reviewing a number of studies and resources that have recently been released and that have tried to categorise, analyse, and map the open source publishing tools and platforms currently available to support open access (book) publishing. Our focus in this analysis will predominantly be on those tools and technologies that can support the kinds of experimental publications that we have identified in the first two parts of this scoping report. Secondly, in section 2, we will outline a proposed methodology to analyse and categorise the currently available tools and technologies to support the creation of an online resource for publishers and authors in year 3 of the COPIM project. This online resource will include the technological support and workflows available to enable more experimental forms of book publishing, whilst showcasing examples and best practices for different levels of technical know-how. Thirdly, in section 3, we will make an initial attempt at categorising a selection of tools following this proposed methodology, where we will be focusing on collaborative writing tools and on annotation tools —and the software, platforms, and workflows that support these—in first instance. -

Logiciels Libres
Logiciels Libres Quoi ? Quand ? Qui ? Où ? Comment ? Pourquoi ? (par Pierre-Yves Gosset - http://www.framasoft.net) Etude de cas : BASIS et l'interopérabilité (par Frédéric Riondet - ENSSIB) Pierre-Yves Gosset - http://www.framasoft.net IntroducIntroductiontion « Framasoft.net est un site internet collaboratif à géométrie variable dont le sujet est le logiciel libre et son état d'esprit » Annuaire de 1 200 notices de logiciels libres Tutoriels libre-diffusion (100) Tribune libre (215) Association (FRAnçais et MAthématiques sur intraNET) Communauté « Utilis'acteurs » Orientation Grand public Si te en perpétuelle évolution Pierre-Yves Gosset - http://www.framasoft.net LLogiogicciielel llibreibre C'est quoi ? Pierre-Yves Gosset - http://www.framasoft.net LLogiciogicieell etet recetrecettete dede cucuiisinesine ● Programme et recette de cuisine ● Programme = recette exécutable = plat cuisiné ● Imaginez un monde... ● où les crêpes ne sont disponibles que toutes prêtes ● où la recette n'est pas disponible ● où il ne viendrait à personne l'idée d'avoir la recette ● Ce monde existe : le monde du logiciel depuis le début des années 80 Pierre-Yves Gosset - http://www.framasoft.net LeLe mmoondende desdes crêpescrêpes lilibresbres ● Liberté de lire, comprendre la recette des crêpes et de les cuisiner ● Liberté de donner à ses amis des crêpes fabriquées avec cette recette ● Liberté de modifier la recette des crêpes ● Liberté de distribuer la recette modifiée des crêpes Pierre-Yves Gosset - http://www.framasoft.net QueQuelllesles llibeiberrttésés ?? -
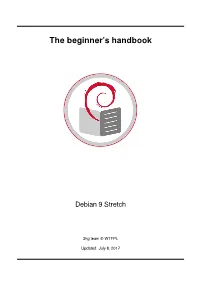
The Beginner's Handbook
The beginner’s handbook Debian 9 Stretch 3hg team © WTFPL Updated: July 8, 2017 – About this manual – “The beginner’s handbook” is a simplied manual to install and take-over the Debian system. You will nd in the following pages the answers to your rst questions concerning the Debian GNU/Linux system , its history, how to obtain it, to install it, to take-over it, to congure and administrate it. You will be able to go further and obtain information concerning the privacy protection, the back- ing up of your data, and the various actors of the Free Software world. Usually, the manuals begin by teaching you the theoretical basis and the usage of the terminal. This manual takes the very side of the “graphical environment”: it is designed to let you start quickly with Debian, screen powered on, ngers on the keyboard and the mouse nearby . – The mission of this manual is not to be comprehensive. – A lot of external links are available in this manual. Don’t hesitate to click on them in order to read more detailed information. For a more detailed documentation, please visit the ocial Debian Wiki: https://wiki.debian.org/ FrontPage If you need a complete Debian manual, please read the Debian Administrator Handbook from Raphaël Hertzog and Roland Mas https://debian-handbook.info/browse/stable/. – How to use this manual?– This PDF version includes a detailed summary and a table of gures at the end of the guide. Note: This manual includes some commands or code blocks that are sometimes longer than the width of the page. -

Digital Social Innovation Ideas Bank
DIGITAL SOCIAL INNOVATION IDEAS BANK An Inspirational Resource for Local Governments Barcelona Activa | May 2019 TABLE OF CONTENTS INTRODUCTION Purpose and scope of this document 7 Structure of this document 8 Tips for using this guide 8 FUNDING Matched crowdfunding 10 · Goteo.org’s matched crowdfunding programme · Nesta’s Arts & Heritage Matched Crowdfunding Pilot · RootProject, blockchain-based crowdsourced fundraising Randomised grant funding for research and innovation 11 · New Zealand Health Research Council’s Explorer Grants · Volkswagen Foundation’s Experiment! - Call in search of bold ideas Public grant funding for community DSI projects 13 · Barcelona City Council’s “We boost what you do” call · The Mayor of London’s Civic Innovation Challenge · European Investment Bank’s Social Innovation Tournament · Amsterdammers, make your city! Challenge · Open Knowledge Foundation’s Prototype Fund Social and Impact investment 16 · Nesta Impact Investments · European Investment Bank Group’s Social Impact Accelerator · UK Government’s Life Chances Fund Public procurement of DSI 18 · UK Social Value Act, social clauses in public procurement of digital services · Italy’s Digital Administration Code, mandating procurement of open source software · EU Innovation Procurement Handbook, supporting collaborative public procurement · Provenance.org, blockchain-based platform to trace the ethical sourcing of electronic products COLLABORATION Networking and community-building opportunities 21 · Maker Faire, open digital fabrication events · The Unusual -

Reprendre Le Contrôle De Son Outil Informatique : Un Petit Aperçu Du Logiciel Libre Et De L'internet Libre
Reprendre le contrôle de son outil informatique : Un petit aperçu du logiciel libre et de l'internet libre. Greg Siebrand Document sous licence Creative Commons Attribution Partage dans les mêmes conditions 2.0 BE 1 Table des matières Reprendre le contrôle de son outil informatique..................................................................................1 Un petit mot, avant de commencer.......................................................................................................3 Les logiciels libres................................................................................................................................3 Un tout petit peu d'histoire (mais, juste un tout petit peu)...............................................................3 Les dangers des logiciels propriétaires............................................................................................4 1. Vous payez pour vous cadenasser dans une certaine utilisation.........................................4 2. Vous payer un logiciel propriétaire pour avoir le droit de vous taire.................................4 3. Souriez, vous êtes espionné!..............................................................................................4 4. La technologie acquise ne vous appartient pas..................................................................4 Qu’est-ce qu’un logiciel libre?........................................................................................................5 Quelques alternatives, dans un joli tableau......................................................................................5 -

Doudoulinux the Computer They Prefer!
DoudouLinux The computer they prefer! User's manual Visit us at http://www.doudoulinux.org/ 2/21/13 DoudouLinux 1/170 Table of contents Table of contents ................................................................................................. 1 About ................................................................................................................... 4 DoudouLinux, the computer they prefer! ............................................................ 6 A simple yet efficient environment ............................................................................................. 6 Also easy for Dad and Mum! ..................................................................................................... 6 And this is 100% legal! .............................................................................................................. 7 Footnotes .................................................................................................................................. 7 About ................................................................................................................... 6 Why should I try DoudouLinux? .......................................................................... 8 Article table of contents ............................................................................................................. 8 Your Concerns ........................................................................................................................... 8 The philosophy of free software -

L'évolution Des Licences Libres Et Open Source : Critères, Finalités Et
L’évolution des licences libres et open source : critères, finalités et complétude ? Benjamin JEAN Au premier regard, l’intérêt d’une étude historique ayant pour objet les licences libres n’est pas évident et l’on tend généralement, avec raison, à considérer que la véritable valeur du Libre réside dans les projets qui le composent (GNU-Linux, Firefox, LibreOffice, Wikipédia, etc.). Ainsi, complexes et hétérogènes, les documents contractuels associés ne seraient qu’une formalisation nécessaire, une attache obligatoire du Libre au sys- tème légal conséquente à la juridicisation de la société actuelle. Une telle approche nierait la place toute particulière des licences au sein du mouvement du Libre en cristallisant les tensions constitutives du sys- tème, assurant l’équilibre d’une équation aux multiples variables. Dès le départ, les licences libres se positionnent en rupture avec les usages tradi- tionnels attirant un nombre important d’« amateurs » (au regard de l’im- portance qu’ils y attachent et de leur grande connaissance du sujet, la plupart étant par ailleurs non juristes), une image qui dénote avec l’aus- térité souvent associée aux documents contractuels et remet en cause le monopole du juriste (lui-même souvent dépassé par la complexité d’un document aussi juridique que social). L’usage du droit s’éloigne donc de la technicité qui le caractérise aujourd’hui pour renouer avec sa mis- sion première d’organisation des relations sociales : formalisant les règles 277 278 Benjamin JEAN relatives aux rapports entre les contributeurs d’un projet et entre les com- munautés, assurant sécurité et une pérennité à leur collaboration. -

Your Keys to a Digital Well-Being Culture June 2018
Version pilot 0.9 Your keys to a digital well-being culture june 2018 n t e r n e t . o r g Philippe Becquelin (Mix & Remix) Contents © Andy PREFACE: netizens 4 Singer COMMON STRUCTURE for all internet users! 6 #1 LITERACY for digital well-being 10 #2 RESPECT to ensure sustainable links 14 #3 FLUIDITY to avoid risks 18 #4 FAIRNESS for our freedom as citizens 22 #5 CONTRIBUTIONS to the Information Society 26 CULTURE #6 INFO MANAGEMENT to avoid infobesity 30 #7 HYGIENE to stay healthy 34 #8 ADAPTATION to the digital economy 38 QUIZ: are you a netizen? 42 Index of all keywords in this booklet 44 Impressum, credits and authors 47 La Vie Moderne" (Modern Life) Contact 48 Andy Singer - Licence CC BY-SA 3.0 2 HOW TO READ THIS BOOKLET 1 chapter = 1 internet key = 4 pages 1 An explanation 2 Definitions 3 Did you know that? 4 An illustration 3 ARE WE ALL NETIZENS? Today, it's difficult to do without digital Florence Devouard is vice-president of the communication, difficult not to be an Internet Ynternet.org Foundation. She is the first user. It is also difficult not to be a citizen in this woman to have chaired Wikimedia, the Foundation managing the free encyclopedia globalized society. Citizens + internet = netizen. In Wikipedia. Florence dedicates her career to fact, are we all netizens? If not now, then maybe the proper sharing of knowledge and common goods in the information society. tomorrow? And who has the license to drive on the information highways? Who understands the Jean-Philippe Trabichet is a professor at HEG jargon of the internet and the stakes involved? Geneva. -

The Public Domain Manifesto
The Public Domain Manifesto http://publicdomainmanifesto.org/node/8 The Public Domain Manifesto was produced within the context of COMMUNIA, the European thematic network on the digital public domain HOME ABOUT THE MANIFESTO SIGN THE MANIFESTO TRANSLATIONS View Signatures Initial Signers - Organizations The Public Domain Manifesto Association for Fair Audiovisual Copyright in Europe - AFACE - printable and editable version Italy Center for the Study of the Public Contents Domain - USA Preamble Center for Technology and Society The Public Domain in the 21st Century at Fundacao Getulio Vargas - Brazil The Public Domain Voluntary commons and user prerogatives General Principles Creative Commons - USA General Recommendations Preamble Digitale Allmend - Switzerland "Le livre, comme livre, appartient à l’auteur, mais comme pensée, il Knowledge Ecology International - appartient—le mot n’est pas trop USA vaste—au genre humain. Toutes les intelligences y ont droit. Si l’un des deux droits, le droit de l’écrivain et le Knowledgeland - Netherlands droit de l’esprit humain, devait être sacrifié, ce serait, certes, le droit de l’écrivain, car l’intérêt public est notre iCommons Ltd - UK préoccupation unique, et tous, je le déclare, doivent passer avant nous." (Victor Hugo, Discours d’ouverture du Intellectual Property Institute - Congrès littéraire international de 1878, Slovenia 1878) Interdisciplinary Center for "Our markets, our democracy, our Computational and Mathematical science, our traditions of free speech, Modelling, University of Warsaw - Poland and our art all depend more heavily on a Public Domain of freely available Luxcommons asbl - Luxembourg material than they do on the informational material that is covered by property rights. The Public Domain is Multimedia Institute - Croatia not some gummy residue left behind when all the good stuff has been NEXA Center for Internet & Society covered by property law.