Architectures, De Saint-Louis À Douala
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Nigerian Nationalism: a Case Study in Southern Nigeria, 1885-1939
Portland State University PDXScholar Dissertations and Theses Dissertations and Theses 1972 Nigerian nationalism: a case study in southern Nigeria, 1885-1939 Bassey Edet Ekong Portland State University Follow this and additional works at: https://pdxscholar.library.pdx.edu/open_access_etds Part of the African Studies Commons, and the International Relations Commons Let us know how access to this document benefits ou.y Recommended Citation Ekong, Bassey Edet, "Nigerian nationalism: a case study in southern Nigeria, 1885-1939" (1972). Dissertations and Theses. Paper 956. https://doi.org/10.15760/etd.956 This Thesis is brought to you for free and open access. It has been accepted for inclusion in Dissertations and Theses by an authorized administrator of PDXScholar. Please contact us if we can make this document more accessible: [email protected]. AN ABSTRACT OF' THE 'I'HESIS OF Bassey Edet Skc1::lg for the Master of Arts in History prt:;~'entE!o. 'May l8~ 1972. Title: Nigerian Nationalism: A Case Study In Southern Nigeria 1885-1939. APPROVED BY MEMBERS OF THE THESIS COMMITIIEE: ranklln G. West Modern Nigeria is a creation of the Britiahl who be cause of economio interest, ignored the existing political, racial, historical, religious and language differences. Tbe task of developing a concept of nationalism from among suoh diverse elements who inhabit Nigeria and speak about 280 tribal languages was immense if not impossible. The tra.ditionalists did their best in opposing the Brltlsh who took away their privileges and traditional rl;hts, but tbeir policy did not countenance nationalism. The rise and growth of nationalism wa3 only po~ sible tbrough educs,ted Africans. -
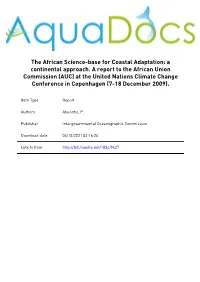
African Oceans and Coasts, a Summary
The African Science-base for Coastal Adaptation: a continental approach. A report to the African Union Commission (AUC) at the United Nations Climate Change Conference in Copenhagen (7-18 December 2009). Item Type Report Authors Abuodha, P. Publisher Intergovernmental Oceanographic Commission Download date 04/10/2021 02:16:24 Link to Item http://hdl.handle.net/1834/9427 The African Science-Base for Coastal Adaptation: A Continental Approach A report to the African Union Commission (AUC) at the United Nations Climate Change Conference in Copenhagen (7-18 December 2009) INTERGOVERNMENTAL OCEANOGRAPHIC COMMISSION OF UNESCO November 2009 Pamela Atieno Abuodha The African Science-Base for Coastal Adaptation: A Continental Approach Table of Contents Table of Contents ii List of Figures iv List of Tables vi Executive Summary vii Acknowledgements xvi PART I CLIMATE IMPACTS AND VULNERABILITIES IN 1 COASTAL LOW-LYING AREAS 1.1 Climate-change effects: the continental view 1 1.1.1 Overview of relevant work in IPCC AR4 2 1.1.2 Overview of more recent science 7 1.1.3 Consequences of climate change on the African coast 8 1.1.4 The most important effects and uncertainties in 12 Africa’s Climate-change adaptation Primary effects of Climate-change 13 1.1.4.1 Atmospheric and ocean temperature rise and acidification 13 1.1.4.2 Sea-level rise and coastal erosion 14 1.1.4.3 Precipitation and Floods 16 1.1.4.4 Drought and Desertification 18 1.1.4.5 Ocean-based hazards and change in currents 21 Compound issues affecting the coastal zone of Africa 24 1.1.4.6 -

Banjul Area, the Gambia Public Works & Landmarks Cape / Point
GreaterGreater BanjulBanjul AArea,rea, TheThe GGambiaambia GGreenreen MMapap Greater Banjul Area, The Gambia Public Works & Landmarks Cape / Point 13 12 16 Atlantic Road7 Atlantic BAKAUBAKAU AtlAtlanticntic 28 Old Cape Road Ocean 27 New Town Road Ocecean Kotu Independence Strand 1 Stadium 14 25 Cape Road CapeCape FAJARAFAJARA 4 Kotu 9 C 5 32 Point 20 r eeke e k 18 Jimpex Road KotuKotu KANIFINGKANIFING Badala Park Way 3 15 Kololi KOTUKOTU 2 Point Kololi Road LATRILATRI Pipeline Road Sukuta Road 21 KUNDAKUNDA OLDOLD 26 22 MANJAIMANJAI JESHWANGJESHWANG KUNDAKUNDA 6 17 19 31 DIPPADIPPA KOLOLIKOLOLI Mosque Road KUNDAKUNDA 11 NEWNEW JESHWANGJESHWANG StS t SERRESERRE r 24 eame a KUNDAKUNDA 10 m 15 30 29 EBOEEBOE TOWNTOWN 0 500 m 23 8 BAKOTEHBAKOTEH PUBLIC WORKS & LANDMARKS 10. SOS Hospital School 11. Westfield Clinic 21. Apple Tree Primary School Cemetery 22. Apple Tree Secondary School 1. Fajara War Cemetery Library 23. Bakoteh School 2. Old Jeshwang Cemetery 12. Library Study Center 24. Charles Jaw Upper Basic School 25. Gambia Methodist Academy Energy Infrastructure Military Site 26. Latri Kunda (Upper Basic) School 3. Kotu Power Station 13. Army Baracks 27. Marina International High School Government Office Place of Worship 28. Marina International Junior School 4. American Embassy 14. Anglican Church 29. Serre Kunda Primary School 5. Senegalese Embassy 15. Bakoteh East Mosque 30. SOS Primary and Secondary School 16. Catholic Church 31. St. Therese Junior Secondary School Hospital 17 . Mosque 32. University of the Gambia 6. Lamtoro Medical Clinic 18. Pipeline Mosque 7. Medical Research Council 19. St. Therese’s Church Waste Water Treatment Plant 8. -

Analyzing Flood Risk in Lagos Island Local Government Area of Lagos State Babalola M
Analyzing flood risk in Lagos island local government area of Lagos state Babalola M. ADEWARA, Hudson E. IRIVBOGBE, Wasiu YUSUF, Mutiu AKITOYE Key words: Flooding, Modelling, Risk Assessment, GIS SUMMARY Lagos Island is a low lying area in Lagos State, plagued by flood on a yearly basis. When intense rainfall occurs, this location is usually flooded, leading to loss and damage of property. In July 2012, extreme rainfall events occurred in this location and this led to severe flooding that caused serious damage to both public and private properties. More extreme flooding occurred in this same location in July 2017. Hence, in this study, the HEC (Hydrological Engineering Centre) modelling packages such as HEC-HMS and HEC-RAS software packages as well as ARCGIS software are used to simulate flood occurrence in Lagos Island. Light Detection and Ranging (LIDAR) and GIS are used for the flood modelling and mapping. LIDAR data, rainfall data, land use maps and GPS points are input data layers in this study. The results indicate that the average flow depths within the study area is 3.2m and over 60% of the Residential and Commercial buildings are at risk. Flood hazard maps are also generated to identify the areas within the city with high risk of flooding. Three-dimensional model of the location with embedded flood inundation map is also generated for a better understanding of the severity of flooding in the location. Analysing Flood Risk in Lagos Island Local Government Area of Lagos State (9593) Hudson Irivbogbe, Monsur Adeware, Wasiu Yusuf and Mutiu Akitoye (Nigeria) FIG Congress 2018 Embracing our smart world where the continents connect: enhancing the geospatial maturity of societies Istanbul, Turkey, May 6–11, 2018 Analyzing flood risk in Lagos island local government area of Lagos state Babalola M. -

The Prevalence and Plasmid Profile of Non-Typhoidal Salmonellosis in Children in Lagos Metropolis, South-Western Nigeria
Open Access Research The prevalence and plasmid profile of non-typhoidal salmonellosis in children in Lagos metropolis, South-western Nigeria Ajoke Olutola Adagbada1,&, Akitoye Olusegun Coker1, Stella Ifeanyi Smith2, Solayide Abosede Adesida3 1Department of Medical Microbiology and Parasitology, College of Medicine, University of Lagos, Lagos, Nigeria, 2Molecular Biology and Biotechnology Division, Nigerian Institute of Medical Research, Yaba, Lagos, Nigeria, 3Department of Microbiology, Faculty of Science, University of Lagos, Akoka, Lagos, Nigeria &Corresponding author: Ajoke Olutola Adagbada, Department of Medical Microbiology and Parasitology, College of Medicine, University of Lagos, Lagos, Nigeria Key words: Prevalence, plasmid, salmonellosis, children Received: 29/12/2012 - Accepted: 17/11/2014 - Published: 09/12/2014 Abstract Introduction: Non-typhoidal Salmonella is the causative agent of gastroenteritis, a food-borne and zoonotic infection which is a major cause of high morbidity and death among children under 5 years of age especially from resource poor settings like the developing countries. Methods: This study was carried out for 6 months to determine the prevalence and plasmid profile of non-typhoidal salmonellosis in children in Lagos metropolis. A total of 105 stool samples were collected from diarrheal children aged 3 months to 12 years and processed during this period. The isolates were identified using Selenite F Broth, Salmonella-Shigella Agar, Kligler Iron Agar, and Motility-indole-Urea medium, citrate and sugar utilization tests. Results: A total number of 127 isolates were identified, 2 of which are Salmonella enteritidis (1.6%). The non-typhoidal Salmonellae were sensitive to ciprofloxacin, cetotaxime, streptomycin, cotrimxazole and tetracycline. Only one of the 2 isolates (50%) was sensitive to amoxillin and sulphonamide while none of them (0%) was sensitive to cefuroxime. -

ANGELA FILENO DA SILVA Vozes De Lagos
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA ANGELA FILENO DA SILVA Vozes de Lagos: brasileiros em tempos do império britânico Versão corrigida São Paulo 2016 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA Vozes de Lagos: brasileiros em tempos do império britânico Costa da Mina, 1840-1900 Angela Fileno da Silva [email protected] [email protected] Tese apresentada ao Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo para obtenção do título de Doutor em História. Área de Concentração: História Social Orientadora: Profa. Dra. Leila Maria Gonçalves Leite Hernandez Versão corrigida São Paulo 2016 2 3 ANGELA FILENO DA SILVA Vozes de Lagos: brasileiros em tempos do império britânico Costa da Mina, 1840-1900 Tese apresentada ao Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, aprovada pela Banca Examinadora constituída pelos seguintes professores: ___________________________________________________ Profa. Dra. Leila Maria Gonçalves Leite Hernandez DH – FFLCH/USP Orientadora ________________________________________ Prof(a) Dr(a) Mônica Lima e Souza – Instituição Universidade Federal do Rio de Janeiro/ CFCH ________________________________________ Prof(a) Dr. Acácio Sidinei Almeida Santos – Instituição Universidade Federal do ABC/ RI ________________________________________ Prof(a) Dr. Alexandre Almeida Marcussi – Instituição Universidade Federal de Minas Gerais/FAFICH ________________________________________ Prof(a) Dr(a) Marina de Mello e Souza – Instituição Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas/DH São Paulo, 25 de abril de 2016. 4 Para minha avó Maria Gonçalves Fileno, que nunca assinou seu próprio nome, mas ensinou aos filhos e netos o valor do conhecimento. -

Volume 10, July 2016
Volume 10, July 2016 A publication of: Faculty of Arts Lagos State University, Ojo Lagos, Nigeria. Email: [email protected] A4 SPECIAL new version EDITION Journal of Humanities copy.indd 1 6/17/2016 3:37:33 PM LASU Journal of Humanities Volume 10, July 2016 © 2016 Faculty of Arts Lagos State University, Ojo Lagos, Nigeria ISSN: 978-274-384-4 Produced by Free Enterprise Publishers, Ibadan HEAD OFFICE: 8/9 Oshodi Street, Felele Layout, Ibadan. 0814.1211.670 LAGOS OFFICE: LASU Strategic Business Unit (L.S.B.U.) Lagos State University Campus, Ojo. A4 SPECIAL new version EDITION Journal of Humanities copy.indd 2 6/17/2016 3:37:33 PM Volume 10, July 2016 A publication of: Faculty of Arts Lagos State University, Ojo A4 SPECIAL new version EDITION Journal of Humanities copy.indd 3 6/17/2016 3:37:34 PM SUBMISSION OF ARTICLES The LASU Journal of Humanities encourages submissions from a variety of theo- retical standpoints and from different disciplines—especially those that traditionally belong to the all-encompassing “Faculty of Arts,” including, however, other areas with which the Faculty has affiliation: anthropology, cultural studies, folklore, media stud- ies, popular culture, communication, sociology and political science. GUIDELINES FOR AUTHORS Articles Authors should submit research articles of (maximum) 10–20 A4 pages, double- spaced, 12-point Times New Roman font type, in accordance with the MLA or APA styles, and include an abstract of no more than 100 words and a Works Cited section. Authors must provide both a paper copy and an electronic copy of their article. -

Global Majority E-Journal, Volume 11, Number 2 (December 2020)
Global Majority E-Journal Volume 11, Number 2 (December 2020) Global Majority E-Journal About the Global Majority E-Journal The Global Majority E-Journal is published twice a year and freely available online at: http://www.american.edu/cas/economics/ejournal/. The journal publishes articles that discuss critical issues for the lives of the global majority. The global majority is defined as the more than 80 percent of the world’s population living in low- and middle-income countries. The topics discussed reflect issues that characterize, determine, or influence the lives of the global majority: poverty, population growth, youth bulge, urbanization, lack of access to safe water, climate change, agricultural development, etc. The articles are based on research papers written by American University (AU) undergraduate students (mostly freshmen) as one of the course requirements for Econ-110—The Global Majority, which is an elective within the New AU Core. Editor Dr. Bernhard G. Gunter, Assistant Professor, Economics Department, American University; Washington, DC; and President, Bangladesh Development Research Center (BDRC), Falls Church, VA, United States. The editor can be reached at [email protected]. Cover Design Based on an animated GIF (Graphics Interchange Format) available as Wikimedia Commons, created in 1998 by Christian Janoff, showing the “Globe” demonstration as it can be found on the Commodore REU 1700/1750 test/demo disk; please see: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Globe.gif. ISSN 2157-1252 Copyright © 2020 by the author(s) for the contents of the articles. Copyright © 2020 by American University for the journal compilation. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored or transmitted in any form or by any means without the prior permission in writing from the copyright holder. -

Iiicial Gazette
ederal Republicof Nigeria iiicial Gazette No. 92 LAGOS- 25th November, 1965 oo. Vol. 52 CONTENTS * - Page Page Movements\ovements.of Officers 1948-56_ BoardRevenuof. CustomsNctoberand1965...Excise, Nigeria—Net“ 4969 Ministry of Defence—Nigerian Air Force— - Loss of Local Purchase Orders- 1970 Promotions 1957 . | Designation of Ministers to advise tHe President - Loss of Railway Warrant .* ” 1970 onthe exercise of the Prerogative of Mercy : 1957 Loss of Cheque : 1970 Appoinunent of Members of the Advisory Loss of TRN 29 Forms . .. 1970 Council on the Prerogative of Mercy 1957 Awards—Honorary Teacher’s Grade III Disposal of Unclaimed Firearms - 1958 Certificate, 1961 . -. 1971 Applications for Registration of Trade Unions , 1958 AveardsHonorary Teacher’s Grade III 1971 Cancellation of Certificates of Registration of Trade Unions 1959 Tenders 1971 Probate Notices Coo 1959-60 canes 1971-80 Report of Loss of Original Documents oard of Customs—Sale of Goods 1980-86 affecting Land ° . 1961 Official Gazette: Renewal Notice 1987 Landrequired for the Services of the Federal InpEx To LEGAL N@TICES IN SUPPLEMENT Government .. 1961 : Applications for Repayment of Import Duty.. 1962 L.N. No. Short Title Pake The General Investment and Trust Company 118 RichardImmi Elbert ArcherProhibited.. 5 (Nigeria) Limited—In Voluntary Liquida- mrmigrants Order 1965 B567 tion 1962 119 Dickson Olu Deportation Order Federal Land Regisry—Applcaton for 1965 - i -» B56? first registration . - 1963-65 ' 120 Weightsand Measures (Primary Lagos City Council—Native Liquor Licences, ! Standards) Order 1965 B568 1966 1965: . 121 Weights and Measures (Definition Western Nigeria Marketing Board 1965-66 of Units) Order 1965 * - BS569 Cocoa Marketing Scheme : Licensed Buying 122 Weights and Measures Regulations Agents ,_ . -

Towards an African Feminist Jurisprudence on the Development of Land Law and Rights in Nigeria 1861- 2011
LEGAL IMPERIALISM AND THE DEMOCRATISATION OF LAW: TOWARDS AN AFRICAN FEMINIST JURISPRUDENCE ON THE DEVELOPMENT OF LAND LAW AND RIGHTS IN NIGERIA 1861- 2011 by ADETOUN OLABISI ILUMOKA BA (Hons.) Law The University of Kent at Canterbury, 1981 LLM. The University of Warwick, 1985 A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY in THE FACULTY OF GRADUATE AND POSTDOCTORAL STUDIES (Law) THE UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA (Vancouver) October 2013 © Adetoun Olabisi Ilumoka, 2013 Abstract This thesis examines the role of law in the establishment of colonial rule in Nigeria in the 19th and early 20th century and argues that the legal imperialism of this period continues to characterize the post- independence modern legal system creating a crisis of legitimacy, relevance and justice which can only be resolved through a process of democratization of law. Focusing on a case study of the development of land law in Southern Nigeria, from 1861 to 2011, and its impact on women’s land rights, the thesis explores the continuities and discontinuities in land use policy, law and practice and options for democratic reform. It demonstrates that there has been a growing centralization and concentration of power over land in this period, which tends to result in widespread abuse and the dispossession of large groups of people of access to land and livelihoods. It shows how women have been disproportionately affected by these developments and how their dispossession has been facilitated by a colonial legal system – through its discourse, legislation and processes of conflict resolution. Colonial conceptions of law and of gender have intersected to produce a dominant discourse and practices relating to “customary” and “modern” law and rights that goes largely unchallenged today. -

The Succession Dispute to the Throne of Lagos and the British Conquest and Occupation of Lagos
AFRREV, 10 (3), S/NO 42, JUNE, 2016 An International Multi-disciplinary Journal, Ethiopia Vol. 10(3), Serial No.42, June, 2016: 207-226 ISSN 1994-9057 (Print) ISSN 2070-0083 (Online) Doi: http://dx.doi.org/10.4314/afrrev.v10i3.14 The Succession Dispute to the Throne of Lagos and the British Conquest and Occupation of Lagos Adekoya, Preye Department of International Studies and Diplomacy Benson Idahosa University P.M. B. 1100, Benin City Edo State, Nigeria E-mail: [email protected] G.S.M. +2348027808770 Abstract This paper examined the role and intervention of the British in the internal family dispute relating to the succession to the throne of Lagos that began in the early nineteenth century. That the usuper to the throne of Lagos, Kosoko who was branded a notorious slave trader was abdicated from the throne on the account of his notoriety as a slave trade dealer by the British and his uncle Akintoye, who was also a known slave dealer was re-installed as the ruler of Lagos on the agreement that the British missionaries and traders were given free course unhindered in their operations, lives much to be wondered about. The paper argued that beyond the moves to discontinue the trade in slaves and Christianize the area, there was much more the motivation for entrenching the British economic foothold beginning with Lagos which offered a leeway into the interior and coastal areas and the eventual colonization of Nigeria. Key Words: Succession Disputes, Church Missionary Society, Foreign Office Copyright © IAARR, 2007-2016: www.afrrevjo.net Indexed African Journals Online: www.ajol.info 207 AFRREV, 10 (3), S/NO 42, JUNE, 2016 Introduction Lagos was a particularly attractive area for the British who had pinned great hopes on the city as the main gateway to the vast, unexplored opportunities of the Yoruba interior (Falola et al, 1991, p. -

The History of Banjul, the Gambia, 1816 -1965
HEART OF BANJUL: THE HISTORY OF BANJUL, THE GAMBIA, 1816 -1965 By Matthew James Park A DISSERTATION Submitted to Michigan State University in partial fulfillment of the requirements for the degree of History- Doctor of Philosophy 2016 ABSTRACT HEART OF BANJUL: THE HISTORY OF BANJUL, THE GAMBIA, 1816-1965 By Matthew James Park This dissertation is a history of Banjul (formerly Bathurst), the capital city of The Gambia during the period of colonial rule. It is the first dissertation-length history of the city. “Heart of Banjul” engages with the history of Banjul (formerly Bathurst); the capital city of The Gambia. Based on a close reading of archival and primary sources, including government reports and correspondences, missionary letters, journals, and published accounts, travelers accounts, and autobiographical materials, the dissertation attempts to reconstruct the city and understand how various parts of the city came together out of necessity (though never harmoniously). In the spaces where different kinds of people, shifting power structures, and nonhuman actors came together something which could be called a city emerged. Chapter 1, “Intestines of the State,” covers most of the 19 th century and traces how the proto-colonial state and its interlocutors gradually erected administration over The Gambia. Rather than a teleology of colonial takeover, the chapter presents the creation of the colonial state as a series of stops and starts experienced as conflicts between the Bathurst administration and a number of challengers to its sovereignty including Gambian warrior kings, marabouts, criminals, French authorities, the British administration in Sierra Leone, missionaries, merchants, and disease. Chapter 2, “The Circulatory System,” engages with conflicts between the state, merchants, Gambian kings, and urban dwellers.