1 - Note De Présentation
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Carteesseillon.Pdf
Vanoise - Maurienne - Savoie - France - Savoie - Maurienne - Vanoise ROYALES FORTERESSES 1 2 Inaugurés le 4 septembre 1829, les forts de l’Esseillon portent les prénoms des FORT MARIE-CHRISTINE membres de la famille royale FORT CHARLES-ALBERT de Savoie : Marie-Thérèse, À DÉCOUVRIR DANS CE FORT Dent Parrachée Victor-Emmanuel, Charles- > Un restaurant gastronomique Barrages 3697 m À l’origine relié par un fossé au fort 1500 m Félix, Marie-Christine et > Gîte de 66 places Plan d’Amont Aussois Marie-Christine qu’il défendait, ce Charles-Albert deviennent > Expositions temporaires Plan d’Aval fort, jamais achevé, fut conçu pour les parrains et marraines > Visite libre repousser d’éventuelles invasions L côtés nord et est. Il n’en reste aujour- de cet ensemble architectural De forme hexagonale, ce fort conçu pour d’hui que deux petits bâtiments de majestueux. Les cinq ouvrages accueillir 150 hommes, est avec le fort Charles- casernement et la base d’une tour. ainsi dressés sur leur muraille Albert l’élément le plus haut perché du dispo- naturelle jouent un rôle sitif, à 1500 m d’altitude. Il défendait les forts dissuasif sur la route royale du Charles-Félix et Victor-Emmanuel ainsi que le Mont-Cenis. 2 1500 m 5 plateau d’Aussois. Un magnifique panorama 1 1500 m 3 avec tables de lecture vous y attend. Portrait de Victor-Emmanuel 1er, duc de Savoie, roi de Sardaigne S > entier du plateau D CIMETIÈRE SARDE (1802-1821) Modane-Chambéry d’Aussois CASCADE SAINT-BENOÎT CD215 D Ce cimetière accueillait les défunts de la garnison et du hameau de l’Esseillon. -

Annexe 2 Listes Communes Isolées AAC Octobre 2019
ANNEXE 2 Listes communes de montagne hors unité urbaine • AIGUEBELETTE-LE-LAC (73610) • AIME-LA –PLAGNE (73210) • AILLON-LE-JEUNE (73340) • AILLON-LE-VIEUX (73340) • AITON (73220) • ALBIEZ-LE-JEUNE (73300) • ALBIEZ-MONTROND (73300) • ALLONDAZ (73200) • APREMONT (73190) • ARGENTINE (73220) • ARITH (73340) • ARVILLARD (73110) • ATTIGNAT-ONCIN (73610) • AUSSOIS (73500) • AVRESSIEUX (73240) • AVRIEUX (73500) • AYN (73470) • BEAUFORT (73270) • BELLECOMBE-EN-BAUGES (73340) • BELMONT-TRAMONET (73330) • BESSANS (73480) • BILLIEME (73170) • BONNEVAL-SUR-ARC (73480) • BONVILLARD (73460) • BONVILLARET (73220) • BOURDEAU (73370) • BOURGET-EN-HUILE (73110) • BOZEL (73350) • BRIDES-LES-BAINS (73570) • CEVINS (73730) • CHAMOUX-SUR-GELON (73390) • CHAMP-LAURENT (73390) • CHAMPAGNEUX (73240) • CHAMPAGNY-EN-VANOISE (73350) • CLERY (73460) • COHENNOZ (73590) • CONJUX (73310) • CORBEL (73160) • COURCHEVEL (73120) • CREST-VOLAND (73590) • CURIENNE (73190) • DOUCY-EN-BAUGES (73630) • DULLIN (73610) • ECOLE (73630) • ENTRELACS (73410) • ENTREMONT-LE-VIEUX (73670) • EPIERRE (73220) • ESSERTS-BLAY (73540) • FEISSONS-SUR-SALINS (73350) • FLUMET (73590) • FONTCOUVERTE-LA TOUSSUIRE (73300) • FRENEY (73500) • FRETERIVE (73250) • GERBAIX (73470) Mis à jour octobre 2019 ANNEXE 2 • GRAND AIGUEBLANCHE (73260) • GRESY-SUR-ISERE (73460) • HAUTECOUR (73600) • HAUTELUCE (73620) • HAUTEVILLE (73390) • JARRIER (73300) • JARSY (73630) • JONGIEUX (73170) • LA BAUCHE (73360) • LA BIOLLE (73410) • LA CHAPELLE (73660) • LA CHAPELLE-BLANCHE (73110) • LA CHAPELLE-DU-MONT-DU-CHAT (73370) -

Plaquette MODANE.Pub
Cantons desservis par CMP MODANE ACCES la structure Le CMP se situe à droite dans la petite rue qui descend à côté de la fontaine, face à la mairie Centre Médico-Psychologique de Modane Canton de MODANE Aussois, Avrieux, Fourneaux, Freney, Modane, Centre d’ Accueil Thérapeutique Saint André, Villarodin Bourget, Val Fréjus à Temps Partiel Partenariats Canton de SAINT MICHEL DE MAURIENNE Orelle, Saint Martin d’Arc, Saint Martin de la Porte, Saint Michel de Maurienne, Valloire, Valmeinier, Beaune, Le Thyl PÔLE DE PSYCHIATRIE L’équipe peut être amenée, en accord avec la famille, à rencontrer différents professionnels qui DE L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT Canton de LANSELEBOURG MONT CENIS s’occupent de l’enfant en lien avec : les établissements scolaires (enseignant, mé- decin, psychologue…) Bessans, Bonneval sur Arc, Bramans, Lansle- bourg, Lanslevillard, Sollières Sardières, Termi- les services sociaux (éducateurs, travailleurs gnon sociaux…) de la ville (CCAS) ou du département 50 rue Sainte Barbe la Maison Départementale des Personnes Han- dicapées (MDPH) Le CMP/CATTP dépend du Immeuble « Les Sarrazins » les services de la Protection Maternelle et In- CHS DE LA SAVOIE 73 500 MODANE fantile ou du Centre Hospitalier (Pédiatrie, Neuro- Chef du Pôle de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent : logie…) Dr Stéphane CABROL Responsable de Service : Dr Anne RAMAUT-ZELLNER les professionnels libéraux ( 04.79.60.52.33 Cadre Supérieur de Santé : J-L. LAPERROUSAZ les établissements spécialisés … 04.79.05.35.07 CHS DE LA SAVOIE BP 41126 www.chs-savoie.fr 73011 CHAMBERY CEDEX 04.79.60.30.30 www.chs-savoie.fr Structure ouverte du lundi au vendredi 8h30 à 17h00 Mise à jour CHS - Mars 2017 Missions Le service public Personnel intervenant La mission de secteur dans le cadre du service public hospitalier est d’assurer et de proposer la prévention et les soins des troubles psychologiques, psychiatriques ou du développement de l’enfant et de l’adolescent (de 0 à 16 ans). -

Derrière La Retenue, Les Chemins De L'eau En Savoie
Derrière la retenue, PARCOURS PHOTOGRAPHIQUE EN MAURIENNE les chemins de l’eau Sylvie Bonnot en Savoie À PARTIR DU 10 JUILLET 2019 Le parcours photographique Derrière la retenue, les chemins de l’eau en Savoie en Maurienne s’inscrit dans la continuité de celui d’Arlysère installé à l’été 2018. Ces 2 parcours prolongent la publication en 2017 du livre du même titre, dont sont en partie issues les photographies de Sylvie Bonnot exposées aujourd’hui en grand format sur le territoire de Maurienne. Depuis 2009, EDF Hydra Alpes et la Fondation Facim développent l’itinéraire de découverte culturelle Les Chemins de l’hydroélectricité ® notamment grâce à des visites guidées de sites hydroélectriques du Pays d’art et d’histoire des Hautes vallées de Savoie ® (Maurienne, Tarentaise, Beaufortain et Val d’ Arly). En 2015-2016, l’artiste plasticienne Sylvie Bonnot a réalisé un reportage photographique à l’échelle des quatre vallées. Au terme d’une année de travail au fil des saisons, suivant Sylvie Bonnot est née en 1982 le cheminement de l’eau, l’artiste à Bourg-en-Bresse. Diplômée de l’École a constitué un important corpus d’images nationale supérieure d’art de Dijon, qui montre comment barrages, conduites elle choisit alors la photographie comme et usines s’intègrent aux autres usages principal médium. Son travail sur de la montagne. À partir de juillet 2019, le paysage a vite été remarqué et salué le fruit de ce travail déjà composé de par la critique: elle montre un intérêt 24 photographies grands formats exposées particulier pour les territoires à forte en extérieur au cœur du Beaufortain identité comme le Grand Nord, et du Val d’ Arly, se complète l’Australie, la Sibérie ou la Savoie. -

Chronique De Maurienne Chronique De Maurienne
Soixante troisième année n° 48 Lundi 3 Décembre 2007 Hebdomadaire Savoyard d'Informations Régionales et d'Annonces Judiciaires et Légales Directeur : Thierry Théolier 18, Avenue de la Liberté - 73500 Fourneaux - Modane (Savoie) LE NUMÉRO : Fondateur : Emile Théolier 0,45 € Abonnement Annuel Téléphone et fax : 04 79 05 04 90 mel : [email protected] R.C. 388 204 166 CCP IMPRIMERIE THÉOLIER 639883 Y Lyon 18 € Adresser les annonces et articles avant le Mercredi dont 2,10 % de TVA Journal habilité à recevoir les annonces légales par arrêté préfectoral pour l'arrondissement de St Jean de Mnne avec les “JB” Avec un regard vers l'avenir pour Renseignements et réservations : mieux construire le quotidien. CHRONIQUE DE * Bramans, le marché de Noël, toute Boucherie Rittaud et ACA, également lors la journée. A partir de 14 h le parcours Quelles seront nos priorités? de la permanence, salle des locaux MAURIENNE sportif ludique (1 € le tour) Améliorer le cadre de vie, faire de sociaux de Fourneaux (à côté du boulo- à Bessans à 14 h la chaîne des ballons Modane une ville dynamique, moderne drome) le mercredi 5 et Vendredi 14 et bien gérée où chacun pourra dire décembre de 17 h à 19 h ou par téléphone à 18 h les lumières de l’espoir qu'il est « bien dans sa ville ». au 04.79.05.30.26 et 04.79.05.13.73 MODANE à Sollières à 18 h à l’église concert Nos projets détaillés seront présentés avec la chorale “La Haute Maurienne par mon équipe dans les prochaines chante” semaines, notamment sur le site internet CONSEIL MUNICIPAL. -
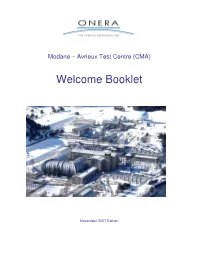
Welcome Booklet
Modane – Avrieux Test Centre (CMA) Welcome Booklet November 2007 Edition CONTENTS 1. HOW TO GET TO THE CMA 3 2. RECEPTION AT CMA 4 3. GENERAL RULES 5 3.1. Circulation in the centre 5 3.2. Centre Hours 5 3.3. Smokers 5 3.4. Work, Visits and Deliveries 6 3.5. Test Zones 7 3.6. Communication Means 7 4. MEANS PUT AT DISPOSAL BY ONERA 8 4.1. Rooms Reserved for Customers 8 4.2. Kitchenette 8 4.3. Staff Canteen 8 5. PREVENTION AND PROTECTION MEASURES 9 6. ONERA TELEPHONE NUMBERS 11 7. PRACTICAL INFORMATION 12 7.1. Lodging 12 7.2. Restaurants 14 7.3. Tourist Internet addresses 16 7.4. Car Rental 17 GENERAL SECURITY INSTRUCTIONS 18 ACCESS MAP TO THE CMA 19 CENTRE MAP 20 2 You will shortly be visiting us at CMA, and we are pleased to place at your disposal this Welcome Booklet, which we hope will go a long way to giving you all the practical information you need to best organise your stay. 1. HOW TO GET TO THE CMA The ONERA test centre of Modane-Avrieux (CMA) is situated in the Savoie region of France, specifically the Maurienne Valley near the boarder with Italy. Access to CMA is available as follows: Train: Take the train to the Modane station, which is on the TGV route between Milan and Paris.. Then rent a car from AVIS at the station ticket office (please book in advance), or take a taxi. Plane: Fly to the nearest commercial airports at Lyon (France), Geneva (Switzerland) or Turin (Italy), and then rent a car (allow a minimum of 2 hours driving). -

Territoire De Maurienne
maurienne charte architecturale & paysagère édito Le Conseil général de la Savoie a confié au Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de la Savoie le soin de réaliser et d’animer une charte architecturale et paysagère sur le Territoire de Maurienne. Cette démarche s’est déroulée en 2008 et 2009, en étroite concertation avec les élus territoriaux et les services de l’État et du Département. Elle fait aujourd’hui l’objet de cette présentation destinée aux élus locaux dans sa première partie, et aux particu- liers et constructeurs dans la seconde partie intitulée “ cahiers d’architecture ”. Cette charte architecturale et paysagère a été portée par le Syndicat du Pays de Maurienne, pour regrouper l’ensemble des intercommunalités de la vallée qui se sont engagées le 27 mars 2009, sur différents objectifs. Aujourd’hui, le premier objectif de la charte a été atteint par la mise en place de six secteurs de consultance architecturale travaillant en synergie avec les intercommuna- lités, et la rédaction de cahiers d’architecture. Cette démarche territoriale va permettre à chaque commune et à chaque particulier de disposer d’un service coordonné de mise en valeur de son territoire en adaptant chacun des projets aux exigen- ces nouvelles, tant de préservation, de performance, d’innovation que d’intégration dans notre environne- ment naturel et bâti. Hervé GAYMARD Christian ROCHETTE François PEILLEX Député Président du Syndicat du Président du CAUE Président du Conseil général Pays de Maurienne de la Savoie de la Savoie Maire de Saint-Rémy- -

VINCI Construction Is Awarded the Contract for Works Package 2 on the Lyon–Turin Rail Line
Rueil Malmaison, 7 July 2021 VINCI Construction is awarded the contract for works package 2 on the Lyon–Turin rail line • A €1.43 billion contract covering construction of 46 km of tunnels between Saint-Martin-la- Porte and Modane, in Savoie (France) • Over 5 years of work As part of the construction of the 57.5 km tunnel that will connect Saint-Jean-de-Maurienne (France) and Susa (Italy), the owner Tunnel Euralpin Lyon-Turin (TELT) has awarded the contract for works package 2 to a consortium* led by VINCI Construction Grands Projets. This €1.43 billion contract covers a 23 km section of twin tube tunnel between Saint-Martin-la-Porte and Modane, in Savoie (France). The works involve digging 25 km of tunnel using three tunnel boring machines and 21 km of tunnel using conventional methods, and creating 71 safety tunnels and several galleries. The project will last over five years and employ up to 1,650 people. VINCI Construction's teams have been active on the Lyon–Turin rail line since September 2020, handling the preparatory work on the Avrieux shafts, perpendicular to the future safety site at Modane. The Lyon–Turin rail line is part of a programme designed to expand trade in Europe upgrade passenger travel. It is setting in motion a sustainable transition in transport by shifting long-distance freight from roads to rail lines. By 2030, it will replace 1 million heavy vehicles on Alpine roads and lower greenhouse gas emissions by about 3 million tonnes of CO2 equivalent per year. VINCI Construction is applying its expertise in underground works in several countries, in particular through public transport projects. -

Journal of Alpine Research | Revue De Géographie Alpine
Journal of Alpine Research | Revue de géographie alpine 96-1 | 2008 Les barrages : vers de nouveaux enjeux pour la montagne Alpine dams From hydroelectric power to artificial snow Alain Marnezy Electronic version URL: http://journals.openedition.org/rga/430 DOI: 10.4000/rga.430 ISSN: 1760-7426 Publisher Association pour la diffusion de la recherche alpine Printed version Date of publication: 15 March 2008 Number of pages: 103-112 ISBN: 978-2-200-92500-0 ISSN: 0035-1121 Electronic reference Alain Marnezy, « Alpine dams », Revue de Géographie Alpine | Journal of Alpine Research [Online], 96-1 | 2008, Online since 03 March 2009, connection on 03 May 2019. URL : http:// journals.openedition.org/rga/430 ; DOI : 10.4000/rga.430 This text was automatically generated on 3 May 2019. La Revue de Géographie Alpine est mise à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International. Alpine dams 1 Alpine dams From hydroelectric power to artificial snow Alain Marnezy EDITOR'S NOTE Translation: Brian Keogh 1 Although the primary aim of mountain dams is still to provide peak-period electrical energy, since their creation there has been a gradual diversification in the uses to which water resources are put: tourism development of mountain lakes, fishing, white-water sports, development of industrial heritage tourism, etc. In recent years, the making of artificial snow in winter sports areas has added yet another use for water resources. Resort managers are not short of arguments, climatic as well as commercial, to develop this type of facility; for the majority of professionals and elected officials in municipalities with winter resorts, this appears as indispensable for ensuring skiing in mountain areas. -

Mise En Page 1
ROYALESFORTERESSES e nc ra -F oie av -S aurienne -M noise Va 1 2 Inaugurés le 4septembre 1829, les forts de l’Esseillon FORT MARIE-CHRISTINE portent les prénoms des FORT CHARLES-ALBERT membres de la famille royale de Savoie :Marie-Thérèse, ÀDÉCOUVRIR DANS CE FORT Dent Parrachée Victor-Emmanuel, Charles- >Unrestaurant gastronomique Barrages 3697 m Àl’origine relié par un fossé au fort 1500 m Félix, Marie-Christine et >Ungîte de 66 places Plan-d’Amont Aussois Marie-Christine qu’il défendait,ce Charles-Albertdeviennent >Des expositions temporaires Plan-d’Aval fort, jamais achevé, fut conçu pour les parrains et marraines >Visite libre repousser d’éventuelles invasions Parc National L côtés NordetEst.Iln’enresteaujour- de cet ensemblearchitectural De forme hexagonale, ce fortconçu pour de la Vanoise d’hui que deux petits bâtiments de majestueux. Lescinq ouvrages accueillir150 hommes, est avec le fortCharles- casernement et la base d’une tour. ainsi dressés surleur muraille Albertl’élémentleplus haut perché du dispo- naturelle jouent un rôle sitif,à1500 md’altitude. Il défendait les forts dissuasif sur la route royale Charles-Félix et Victor-Emmanuel ainsi que le du Mont-Cenis. 2 1500 m 5 plateau d’Aussois. Un magnifique panorama 1 1500 m 3 avec tables de lecturevous yattend. Portrait de Victor-Emmanuel 1er, duc de Savoie, roideSardaigne D CIMETIÈRE SARDE (1802-1821) > Se Modane-Chambéry ntier“duplateaud’Aussois” CASCADE SAINT-BENOÎT CD 215 D Ce cimetièreaccueillait les défunts de la garnison et du hameau de l’Esseillon. En effet, l’Esseillon avait sa 1860 :L’ESSEILLONETLAFRANCE 3 propreparoisse, son état civil 5 et donc soncimetière. -

Direction De La Citoyenneté Et De La Légalité
Direction de la Citoyenneté et de la Légalité Bureau de l’intercommunalité et des élections Arrêté préfectoral n° PREF-DCL-BIE-2020-84 portant nomination des membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales dans les communes de l’arrondissement de Saint Jean-de-Maurienne Le préfet de la Savoie Chevalier de la Légion d’honneur Chevalier de l’ordre national du Mérite Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ; Vu les propositions des maires des communes concernées ; Vu les désignations des représentants par le président du tribunal judiciaire d’Albertville, Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune, les membres de commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ; Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Savoie, ARRÊTE Article 1er Sont désignés, pour trois ans, membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales, les personnes dont les noms figurent dans le tableau annexé ci-après. Article 2 Madame la Secrétaire générale de la préfecture de la Savoie, Monsieur le Sous-préfet de l’arrondissement de Saint Jean-de-Maurienne, Mesdames et Messieurs les maires des communes de l’arrondissement de Saint Jean-de-Maurienne sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Savoie. Chambéry, le 31/12/2020 -

Mise En Page
Territoire de Maurienne E Eau : gestion R Eau : gestion Protection réglementaire E IIISS Cours d'eau réservés AITON Bassins versants BONVILLARET décret 89-265 du 25/04/1989 , R RANDENSRANDENS o relatif à la production RANDENSRANDENS c h e Communes d'énergie hydraulique MONTGILBERT Aménagements hydroélectriques Cours d'eau classés ( les différentes couleurs distinguent MONTSAPEY l'appartenance des éléments décret 90-260 du 21/03/1990, à un même aménagement ) ST-GEORGES-ST-GEORGES- relatif à la protection des poissons migrateurs DES-HURTIERES M o Prise d'eau nt B ar ST-ALBAN-ST-ALBAN-ST-ALBAN- alm ti Outils de gestion ST-ALBAN-ST-ALBAN-ST-ALBAN- e er Conduite DES-HURTIERES ARGENTINE Contrats de rivière Arc ST-PIERRE-ST-PIERRE-ST-PIERRE- Usine DE-BELLEVILLE t EPIERREEPIERRE an EPIERREEPIERRE ru Restitution B ST-LEGERST-LEGER ST-FRANCOISST-FRANCOIS LALA CHAPELLE CHAPELLE ST-FRANCOISST-FRANCOIS BONNEVAL-SUR-ARCBONNEVAL-SUR-ARC -LONGCHAMP-LONGCHAMP-LONGCHAMP L BONNEVAL-SUR-ARCBONNEVAL-SUR-ARC n e o s e e e i s n L g t u a R B e c u l a LESLES CHAVANNES- CHAVANNES- z EN-MAURIENNEEN-MAURIENNEEN-MAURIENNE ST-REMY-ST-REMY-ST-REMY- Retenues d'altitude ST-REMY-ST-REMY-ST-REMY- Doron de Termignon DE-DE- MAURIENNEMAURIENNE N-D-DU-CRUET MONTAIMONT En projet MAURIENNEMAURIENNE MONTAIMONT 2 e tt ST-MARTIN-SUR-LA-CHAMBREST-MARTIN-SUR-LA-CHAMBREST-MARTIN-SUR-LA-CHAMBRE 1 e 0 r e 2 h Merd En travaux c LALALA CHAMBRE CHAMBRE CHAMBRE erel s e e r L A TERMIGNONTERMIGNONTERMIGNON b Existantes ST-ETIENNE-DE-CUINESST-ETIENNE-DE-CUINES ST-AVREST-AVREST-AVRE Eau