UKMO 2020 Workshop
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
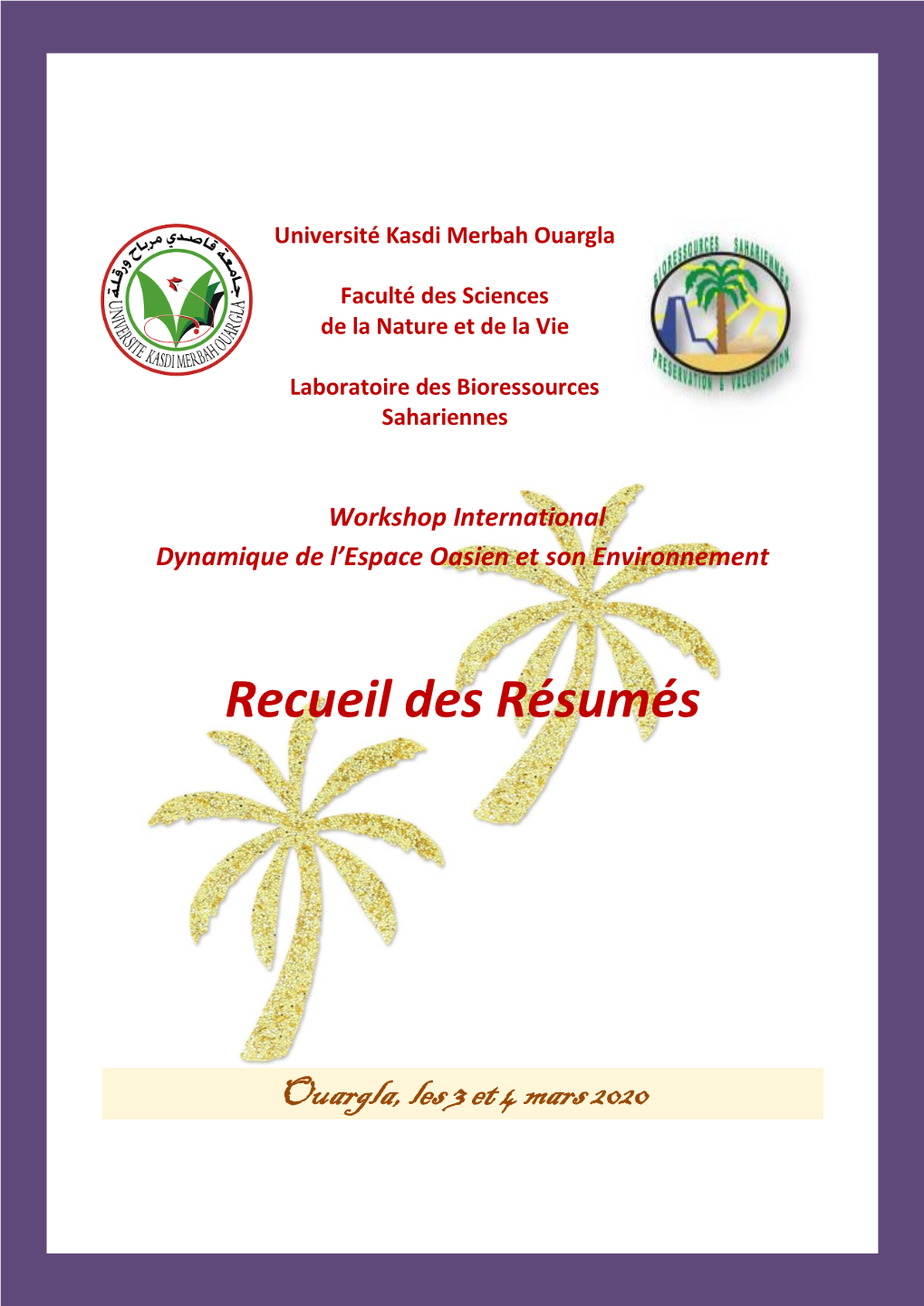
Load more
Recommended publications
-

Algerian Regime to the Test
HUMAN RIGHTS PUT ALGERIAN REGIME TO THE TEST The illusion of change Paris – April 2013 Collective of Families of the Disappeared in Algeria 112, rue de Charenton 75012 Paris – France Telephone: + 33 (0)1 43 44 87 82 – Fax: + 33 (0)1 43 44 87 82 E-mail: [email protected] Website: www.algerie-disparus.org HUMAN RIGHTS PUT ALGERIAN REGIME TO THE TEST The illusion of change Bibliographical information Title: Human Rights Put Algerian Regime to the Test – The illusion of change Author: Collective of Families of the Disappeared in Algeria Publication: Collective of Families of the Disappeared in Algeria Date of the publication: April 2013 Pages: 148 ISBN: 978-2-7466-6386-2 Photos: CFDA, Rachel Corner, El Watan Weekend, Hassen Ferhani, Toufik Hachi, Omar D, Reuters, SOS Disappeared Translation into English and Arabic: Bélaid Hamici / [email protected] Graphic Design: Benjamin Lerasle / [email protected] Reproduction: The Collective of Families of the Disappeared in Algeria authorises the free distribution of extracts of this publication on the condition that it will be properly cited. Collective of Families of the Disappeared in Algeria HUMAN RIGHTS PUT ALGERIAN REGIME TO THE TEST The illusion of change Report 2011-2013 4 Human Rights Put Algerian Regime to the Test - The illusion of change Methodology: Members of the Collective of Families of the Disappeared in Algeria (CFDA) and activists working closely with the CFDA initially came together to form an editorial group. Several meetings were then held in the CFDA office in Paris to select topics to discuss and reflect on the methodology to be followed in preparation for this report. -

Situation Sur La Gestion Des Déchets Solides Hospitaliers De La Ville D'ouargla Page 1
UNIVERSITE KASDI MERBAH, OUARGLA FACULTE DES SCIENCES DE LA NATURE ET DE LA VIE DEPARTEMENT DES SCIENCES BIOLOGIQUES Projet d e Fi n d’Etudes En vue d e l’obtention du diplôme de MASTER Académique Domaine : Sciences de la nature et de la vie Filière : Sciences biologiques Spécialité : Sciences de l’environnement Présenté par : Bourogaa Sara Ouareth Amira Thème Situation sur la gestion des déchets solides hospitaliers de la ville d'Ouargla Soutenu publiquement le : 04/06/2016 Devant le jury : Président: Mr BRADAI. L M.C.A à l’U.K.M.-Ouargla Encadreur: Melle HIDOUCI. S M.C.B à l’U.K.M.-Ouargla Examinateur : Mm KHALAF. S M.A.A à l’U.K.M.-Ouargla Année universitaire: 2015/2016 REMERCIEMENTS Tout d'abord nous remercions le bon dieu tout puissant de la bonne santé, la volonté et la patience qu'il nous a donné tout le long de la période de nos études. Nous exprimons nos profondes reconnaissances et gratitude à toutes les personnes qui ont apporté leur aimable contribution à ce travail par leurs remarques, leurs conseils, leurs encouragements et leurs compétences et en particulier : Dr: HIDOUCI SABRINA, nos encadreur, non seulement pour l’aide très précieuse qu’il nous apporté, mais aussi pour son enthousiasme communicatif, sa patience et son totale disponibilité pour l’encadrement de ce travail. Dr: BRADAI LYAS, pour l'honneur de présider le jury de notre travail. Dr: KHALAF SAKINA qui nous a fait l'honneur d'examiner notre travail. Nous remercions l'ensemble du personnel de l'hôpital Mohammed Boudiaf, l'hôpital Ophtalmologique de Ouargla, et le centre de diagnostique médicale el MORCHED sans l'appui du quel ce travail n'aurait pas vu le jour. -

Assessment of Phytoplankton Diversity in Two Lakes from the Northeastern Algerian Sahara - 3407
Khellou et al.: Assessment of phytoplankton diversity in two lakes from the northeastern Algerian Sahara - 3407 - ASSESSMENT OF PHYTOPLANKTON DIVERSITY IN TWO LAKES FROM THE NORTHEASTERN ALGERIAN SAHARA KHELLOU, M.1,2* – LAIFA, A.2 – LOUDIKI, M.3 – DOUMA, M.3,4 1Bioresources Division, Centre for Scientific and Technical Research on Arid Regions B.P. 1682, 07000 Biskra, Algeria 2Department of Biology, Faculty of Sciences, Badji Mokhtar University of Annaba B.P. 12, 23000 Annaba, Algeria 3Laboratory of Biology and Biotechnology of Microorganisms, Department of Biology, Faculty of Sciences Semlalia, Cadi Ayyad University B.P. 511, 2390 Marrakech, Morocco 4Polydisciplinary Faculty of Khouribga (FPK), Hassan Premier University B.P. 145, 25000 Khouribga, Morocco *Corresponding author e-mail: [email protected] (Received 5th Mar 2018; accepted 21st May 2018) Abstract. Plankton is the basis of many food webs and is the main food of aquatic trophic chains. The primary productivity achieved by phytoplankton depends on the availability of nutriments. Phytoplankton biodiversity of two natural connecting lakes (Lella Fatma and Zerzaim) in the region of Megarine in South East of Algeria was studied during the period from January 2016 to December 2016. The relationships between the biomass of phytoplankton and the physicochemical properties of water were assessed in 28 genera of phytoplankton belonging to five classes (Mediophyceae, Coscinodiscophyceae, Bacillariophyceae, Euglenophyceae and Cyanophyceae). The statistical analysis performed during this study clearly shows that there is a strong correlation between differing physicochemical water parameters of the studied lakes and the influence on the phytoplankton population diversity. Keywords: phytoplankton, Megarine, lakes, diversity, nutriments Introduction Natural lakes in arid areas constitute an important source to both ecological equilibrium and economical uses and in this ecosystem, biotic and abiotic components interact with them and determine the ecological statue of ecosystem (Awah, 2008). -

Press Review
PRESS REVIEW Current Events in Euro-Mediterranean Agriculture, Food and Environment November 2012 1 Cette revue de presse reprend les articles signalés sur le site du CIHEAM en Novembre 2012, à partir du travail de recherche des informations réalisé au sein du Secrétariat Général par Sébastien Abis (administrateur) et Matthieu Brun Abonnez- vous à notre système de veille et suivez jour après jour l’actualité agricole, alimentaire et environnementale en Méditerranée grâce à notre plate- forme informative disponible à l’adresse suivante http://www.scoop.it/t/ciheam-press-review www.ciheam.org 2 Sommaire Brazilian food exports to Arab world exceed $6.6bn from January to August 2012 ................................................. 6 Greece : How Terra Creta Makes and Markets Olive Oil ......................................................................................... 6 Le Maroc revoit sa stratégie agricole et prévoit une hausse de 5% de la valeur ajoutée ........................................ 9 Iran delegation in India to finalize wheat import ..................................................................................................... 10 Investissement étranger en Méditerranée : les défis de la transition ..................................................................... 10 EU Action Plan for Olive Oil Inching Forward ........................................................................................................ 11 Tunisie - Industrie fromagère : soutenir la production pour équilibrer l'offre ......................................................... -

Journal Algérien Des Régions Arides (JARA) 14 (1): 1–14 (2020) 1
Journal Algérien des Régions Arides (JARA) 14 (1): 1–14 (2020) 1 اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺠﺎﻓﺔ Journal Algérien des Régions Arides (JARA) Algerian Journal of Arid Regions Research Paper Contribution à l’étude d’hydrogéochimie d'eaux de surface et eaux souterraines dans la région d'Oued Righ (Sud-Est, Algérie) Contribution to the study of the hydrochemistry of surface water and groundwater in the region of Oued Righ (South-East, Algeria) M.L. BENHADDYA Centre de la Recherche Scientifique et Technique Sur les Régions Arides (CRSTRA) RN N°3 BP 360, Ain Sahara, Nezla, Touggourt, Algeria Received: 12 February 2020 ; Accepted: 18 February 2020 ; Published: February 2020 Résumé Une évaluation hydrogéochimique des eaux de surface et souterrains de la région d'Oued Righ (Algérie) a été réalisée à l'aide de 36 d’échantillons d'eau. L'analyse des échantillons s'est focalisée sur la détermination du calcium, du magnésium, du sodium, du potassium, du chlorure, du sulfate, du bicarbonate et des éléments traces (Cd, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb et Zn), tandis que la conductivité électrique, la température et le pH ont été mesurés sur le site. L'objectif de ce travail est de montré l’état actuel des eaux souterraines et eaux de surface de la région d'Oued Righ, vis-à-vis des différents éléments chimiques surtout les éléments en traces existants et l’origine de chaque éléments en traces. L'étude hydrochimique montre que les eaux des nappes profondes possèdent une salinité élevée, due à l’effet de la dissolution des formations géologiques. Les éléments traces sont observés avec des concentrations très faibles (origine naturel). -

Journal Algérien Des Régions Arides (JARA)
République Algérienne Démocratique et Populaire Ministere de L’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Centre de Recherche Scientifique et Technique sur les Régions Arides, Omar El-Barnaoui (CRSTRA) Journal Algérien des Régions Arides (JARA) Algerian Journal of Arid Areas Revue Scientifique Internationale No 14 – 2017 ISSN 1112-3273 JOURNAL ALGERIEN DES REGIONS ARIDES (JARA) ALGERIAN JOURNAL OF ARID AREAS المجلة الجزائرية للمناطق الجافة ISSN 1112-3273 No 14 / 2017 Centre de recherche scientifique et technique sur les régions arides - Omar El Barnaoui - (CRSTRA) Campus Universitaire, BP no 1682, RP 07000 Biskra. Tél: +213 (0) 33 52 20 91 Fax: +213 (0) 33 52 20 92 http://www.crstra.dz Photo de la couverture Les écosystèmes fragiles des zones arides sont fortement menacés par la pression anthropique et l’effet de stress édaphique (Cliché: Y. Halis 19/04/2016). Journal Algérien des Régions Arides (JARA) / No 14 (2017) Directrice de la revue: LAKHDARI Fattoum Rédacteurs en chef: BELHAMRA Mohamed & HALIS Youcef Coordinatrice de rédaction: HANAFI Asma Comité scientifique ABDELGUERFI Aissa, INA Alger - Algérie FORREST Francis, CIRAD, Montpellier, France ADAMOU Abdelkader, Université de Ouargla, Algérie GAOUAR Abdelaziz, Université de Tlemcen, Algérie AULAGNIER Stéphane, Professeur CEFS-INRA Casta- GHOUL Mostefa, Université de Sétif – Algérie net-Tolosan, France HACINI Salih, Université d’ORAN, Algérie BEDRANI Slimane, CREAD, Alger, Algérie HALILAT M.Tahar, Université de Ouargla – Algérie BEKKI Abdelkader, Université d’Oran - Algérie -

Statuts Et Organigramme Des Etablissements Publics De Santé
Collection Textes Réglementaires sur la Santé en Algérie Statuts et Organigramme des Etablissements Publics de Santé Fascicule N° 2 Textes réunis et classés par : Med Ould Kada 2016 Organigramme/Santé 2016 Page 1 Dans la Collection Gestion des Etablissements Publics de Santé Guide de Gestion Hospitalière Edité en France par EDILIVRE Projet Règlement intérieur des CHU, EHS, EPH et EPSP Dans la Collection Textes Réglementaires sur la Santé en Algérie - Fascicule N°1 : Textes Fondamentaux et autres Textes Utiles - Fascicule N°2 : Statuts et Organigrammes des Etablissements de Santé - Fascicule N°3 : Gestion des Services de l’Economat au niveau des Etablissements Publics de Santé - Fascicule N°4 : Gestion des Services Financiers au niveau des Etablissements Publics de Santé - Fascicule N°5 : Gestion des Ressources Humaines au niveau des Etablissements Publics de Santé - Fascicule N°6 : Statuts des Personnels de Santé - Fascicule N° 7 : Régime Indemnitaire servi aux Personnels de Santé - Fascicule N°8 : Personnels Hospitalo-universitaires - Fascicule N°9 : Formation Continue, Examens, Concours Activités Complémentaires et Service Civil - Fascicule N°10 : Médecine du Travail - Fascicule N°11 : Partenaires Sociaux, Retraite et Œuvres Sociales - Fascicule N°12 : Médicaments & Pharmacie - Fascicule N°13 : Urgences Médico-Chirurgicales, Orsec et Situation d'Urgence - Fascicule N°14 : Bureau des Entrées - Fascicule N°15 : Prévention - Fascicule N°16 : Programmes Nationaux de Santé Publique - Fascicule N° 17 : Hygiène Hospitalière - Fascicule N°18 : Transfusion Sanguine - Fascicule N°19 : Exercice à titre Privé Organigramme/Santé 2016 Page 2 Remerciements Je dédie ce travail à ma famille et à toutes les personnes qui ayant pu – à un moment ou un autre – contribuer à la réalisation de ce travail. -
La Ville Saharienne De Hassi Messaoud : Paradoxe Entre La Prospérité Industrielle Et L’Échec Du Développement Urbain
اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ République Algérienne Démocratique et Populaire وزارة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ و اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﯿﻀﺮ ﺑﺴﻜﺮة Université Mohamed Khider–Biskra ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ Faculté des Sciences et de la technologie ﻗﺴﻢ:اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ Département :Architecture اﻟﻤﺮﺟﻊ:.................... ………………: Ref Mémoire présenté en vue de l’obtention du diplôme de Magister en : Architecture Option : Etablissements humains dans les milieux arides et semi-arides La ville saharienne de Hassi Messaoud : paradoxe entre la prospérité industrielle et l’échec du développement urbain Présenté par : YAHIA CHERIF Halla Soutenu publiquement le ……………… Devant le jury composé de : Pr. BELAKHAL Azzedine………Prof……..… université de Biskra…………… Président Dr. BENABBES Moussadek….. MCA……... université de Biskra…………… Membre Dr. GASMI chawki………………... MCA……... université de Biskra…………… Membre Pr. FARHI Abdallah……………….Prof…….…. université de Biskra………...Rapporteur Année universitaire : 2017 / 2018 Remerciements Avant tout, je remercie ALLAH, le tout puissant, de m’avoir donné le courage et la volonté pour accomplir ce travail de recherche. Je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance au directeur de mémoire Monsieur Abdallah Farhi, Professeur à l’Université de Biskra, pour son suivi, sa patience, sa disponibilité, ses nombreux conseils et ses critiques constructives pour l’élaboration de ce travail. Il m'est particulièrement agréable de remercier toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de ce travail. Finalement, j’adresse mes sentiments les plus respectueux à ma famille et mon mari qui m’ont toujours soutenu et aidé. Résumé L’énergie est le moteur de développement des sociétés. Une grande partie de la demande mondiale en énergie est assurée à partir de ressources fossiles et fissiles (près de 90%). -
Supervised By: Mr
UNIVERSITY AHMED DRAIA OF ADRAR FACULTY OF ARTS AND LANGUAGES DEPARTMENT OF ENGLISH THE USE OF PRAGMATIC MARKERS IN AN ALGERIAN SOCIAL CONTEXT: A CASE STUDY OF OUEDI RIGH SPEECH COMMUNITY Dissertation submitted in Partial Fulfilment for the Requirements of a Master’s Degree in Linguistics & Didactics Presented by: Supervised by: Mr. Amine OUNISSI Pr. Bachir BOUHANIA Academic Year: 2016-2017 I DEDICATION I dedicate this humble work to the most precious people to my heart; to the ones who always support me and whose words of motivation ring in my ears: To my dear mother and beloved father To my respectful and beloved wife To the light of my heart and my eyes; my sons: Abderrahmane and Youcef To my beloved brothers: Walid and Farid To my dear sisters To my Brothers-in-law: Abdelbaset and Mohammed To all those who know me and gave me support during my study II ACKNOWLEDGMENTS First of all, I thank and praise Allah for providing me the blessing and strength to accomplish this research work. I would like to express my sincere thanks and gratitude to my supervisor Pr. Bouhania Bachir for his help, guidance and encouragement during the two years of study. I also thank him again for the excellent lectures in the two modules of sociolinguistics and sociology of language. I also would like to extend my thanks to all the faculty and teachers in the Department of English at the University of Adrar for the respect they showed, and also for giving us an opportunity to learn new things from them. -

Des Engagements En Série Pour Tenter De Convaincre
5,22 milliards de dollars sur neuf mois Le déficit de la balance commerciale se creuse de plus en plus Page 3 Tizi Ouzou La route nationale de nouveau LE JOUR bloquée par des transporteurs D’ALGERIE Votre quotidien national de voyageurs à Makouda Quatorzième année - N° 4939 - Lundi 25 novembre 2019 – Prix : 10 DA Page 24 En cette période de pluie et de neige Les accidents de la route se multiplient et le nombre de morts s'alourditPage 3 Ce printemps Deuxième semaine de campagne électorale qui n'est plus uniquement arabe Par Mohamed Habili Des engagements en série es troubles au Chili ne se sont pas apaisés que voilà la Colombie qui se Ldémonte à son tour, et sur des modes généraux à ce point similaires qu’on dirait une même secousse passant d’un pays à l’autre. C’est pro- pour tenter de convaincre bablement ce qu’on aurait dit d’ailleurs si les deux pays par- Le refus de tageaient des frontières, ce toute qui bien sûr n’est pas le cas. Jusqu’à récemment, on aurait ingérence cru que cette façon qu’ont les étrangère dans colères populaires de traver- ser les frontières était quelque les affaires du chose de particulier au monde pays et la arabe, qui lui se présente comme un continuum. Les question de la médias ont appelé cette pre- récupération mière vague de révoltes le Printemps arabe, soi-disant des fonds en référence au printemps des transférés peuples européens du milieu illicitement, du 19e siècle. Tout récemment encore, on a cru qu’une estimés par deuxième vague enflait, qui les experts à après avoir soulevé le Soudan, a rejailli en Irak, puis dans un des centaines deuxième temps au Liban. -

Memoire De Fin D'etude Theme
الجوهىريت الجسائريت الذيوقراطيت الشعبيت République Algérienne Démocratique et Populaire Nsérie:...… وزارة التعــليـن العالي والــبحـج الـعلـوي Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique جاهـعت الشهيذ حوت لخضر الىادي Université Echahid Hamma Lakhdar -El OUED كليت علىم الطبيعت والحياة Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie قسن البيىلىجيا Département de Biologie MEMOIRE DE FIN D’ETUDE En vue de l’obtention du diplôme de Master Académique en Sciences biologiques Spécialité : Biodiversité et environnement THEME Etude de Diversité floristique du chott Edhiba ( région du Souf ,Sahara septentrional Est) Présenté Par : Melle. HOUAMDI Soumaia Melle .KHELAIFA Hakima Devant le jury composé de : Président : Mr. ALIA Zeid M.C.B, Université d’El Oued Examinateur : Mr. HADDAD Azzeddine M.C.B, Université d’El Oued Promoteur : Mr. KHECHEKHOUCHE E. A. M.C.B, Université d’El Oued Année universitaire 2018 /2019 REMERCIEMENTS Au terme de ce travail, on tient à exprimer notre gratitude et présenter nos vifs remerciements à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la réalisation. On exprime des remerciements spécifiques : À Monsieur ALIA Zeid, Maître des Conférences classe « B » à l’université d’El Oued pour avoir bien voulu accepter de nous honorer de sa présence et de présider notre jury de mémoire de Master Académique en Biodiversité et Environnement. Notre profonde gratitude et nos vifs remerciements s’adressent à notre promoteur M. KHECHEKHOUCHE El Amine, Maître des Conférences classe « B » à l’université d’El Oued, qui a accepté de nous encadrer et de suivre ce travail avec patience, compréhension et vigilance et pour nous avoir donné l’occasion de bénéficier de son expérience. -

Assessment of Phytoplankton Diversity in Two Lakes from the Northeastern Algerian Sahara - 3407
Khellou et al.: Assessment of phytoplankton diversity in two lakes from the northeastern Algerian Sahara - 3407 - ASSESSMENT OF PHYTOPLANKTON DIVERSITY IN TWO LAKES FROM THE NORTHEASTERN ALGERIAN SAHARA KHELLOU, M.1,2* – LAIFA, A.2 – LOUDIKI, M.3 – DOUMA, M.3,4 1Bioresources Division, Centre for Scientific and Technical Research on Arid Regions B.P. 1682, 07000 Biskra, Algeria 2Department of Biology, Faculty of Sciences, Badji Mokhtar University of Annaba B.P. 12, 23000 Annaba, Algeria 3Laboratory of Biology and Biotechnology of Microorganisms, Department of Biology, Faculty of Sciences Semlalia, Cadi Ayyad University B.P. 511, 2390 Marrakech, Morocco 4Polydisciplinary Faculty of Khouribga (FPK), Hassan Premier University B.P. 145, 25000 Khouribga, Morocco *Corresponding author e-mail: [email protected] (Received 5th Mar 2018; accepted 21st May 2018) Abstract. Plankton is the basis of many food webs and is the main food of aquatic trophic chains. The primary productivity achieved by phytoplankton depends on the availability of nutriments. Phytoplankton biodiversity of two natural connecting lakes (Lella Fatma and Zerzaim) in the region of Megarine in South East of Algeria was studied during the period from January 2016 to December 2016. The relationships between the biomass of phytoplankton and the physicochemical properties of water were assessed in 28 genera of phytoplankton belonging to five classes (Mediophyceae, Coscinodiscophyceae, Bacillariophyceae, Euglenophyceae and Cyanophyceae). The statistical analysis performed during this study clearly shows that there is a strong correlation between differing physicochemical water parameters of the studied lakes and the influence on the phytoplankton population diversity. Keywords: phytoplankton, Megarine, lakes, diversity, nutriments Introduction Natural lakes in arid areas constitute an important source to both ecological equilibrium and economical uses and in this ecosystem, biotic and abiotic components interact with them and determine the ecological statue of ecosystem (Awah, 2008).