Joly-Corcoran Marc 2013 These.Pdf (3.738Mb)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

(Dunlop) Determination 2004 (No 1)*
Australian Capital Territory Public Place Names (Dunlop) Determination 2004 (No 1)* PN2004-1 Disallowable Instrument DI2004-12 made under the Public Place Names Act 1989, section 3 (Minister to determine names) I DETERMINE the names of the public places that are Territory Land as specified in the attached schedule and as indicated on the attached plan. Neil Savery Neil Savery Delegate of the Minister Dated the twentieth day of January 2004. *Name amended under Legislation Act 2001 s 60 Authorised by the ACT Parliamentary Counsel—also accessible at www.legislation.act.gov.au SCHEDULE Public Place Names (Dunlop) Determination 2004 (No 1) PN2004-1 Division of Dunlop: Inventors, Inventions and Artists NAME ORIGIN SIGNIFICANCE Binney Close Muriel Mary Australian Inventor and artist. Sutherland Binney Muriel Binney was a painter, etcher, designer (nee Hasler) and inventor. In her mid and later life she (1873-1949) frequently travelled overseas in connection with her inventions. In 1929, she presented her inventions to the British Society of Inventors and showed some at the International Exhibition of Inventions, her leg prosthesis was awarded a silver medal. Muriel’s other exhibits were a portable shoe-stand and travelling case, which were awarded a certificate of merit, and a cigarette smoker’s combined case and stand. Eldershaw Flora Eldershaw Australian Artist – Poet Crescent (1897-1956) Flora Eldershaw was born at Darlinghurst, Sydney. While studying at the University of Sydney, she met Marjorie Barnard with whom she was to collaborate on several novels and other prose works. Their first novel, A House is Built (1929) shared first prize in the Bulletin novel competition. -

Soixantetroisieme
MAX ENGAMMARE MAX ENGAMMARE AMMARE ENG SOIXANTE-TROIS AX SOIXANTE-TROIS M LA PEUR DE LA GRANDE ANNÉE AvaNT-PROPOS DE CLIMACTÉRIQUE À LA RENAISSANCE JACQUES ROUBAUD TITRE TITRE COURANT COURANT Depuis l’Antiquité, les hommes ont interprété la numé ration des années de leur vie, tel l’empereur Auguste, autre manière de retenir le temps qui fuit. Des théories médicales ont ainsi avancé que la matière se renouve- lait toutes les sept ou neuf années. Le produit de ces deux chiffres (l’un dévolu au corps, l’autre à l’esprit) donne soixante-trois, et la soixante-troisième année de la vie humaine, grande climactérique, était regardée comme très critique. C’est sous le signe du nombre et du temps que Max Engammare fait l’histoire de l’intérêt inquiet pour cette année qui reprend vigueur à la Renaissance, avec Pétrarque, mais surtout avec Marsile Ficin. On croisera la plupart des grands noms du temps, dont des théologiens, à l’instar de Philipp Melanchthon, le bras droit de Luther, et de Théodore de Bèze, celui de Calvin, mais aussi de Rabelais, celui qui a introduit le mot en français. La question du soixante-troisième roi de France, Henri III ou Henri IV, sera également posée par des Ligueurs qui ne savaient pas en 1587 ou 1588 que les deux mourraient assassinés, et l’on jouera même au jeu de l’oie. Il s’agit de comprendre l’arithmétique de ces peurs antiques e réactualisées dès la fin du XV siècle et qui n’ont TE-TROIS pas complètement disparu aujourd’hui, preuve en est Sigmund Freud ou la soi-disant malédiction des 27 N répertoriant tous les artistes célèbres morts à l’âge de vingt-sept ans (trois fois neuf). -

Catharina Street, Eonth Side Vacant Lots Catharine Street North, East Side, from 104 $Ing East to the Bay 2 a Harvey & Co, M
HAMILTO N ?40 STREST DIRECTOR Y 22 1 CAT. CAT . CAT . CAT. 127 John Elliott, labore r 110 John Flemming, blacksmith 5 81 J C McCraken, book- 1 72 James Donohue, laborer 129 Addison & Sons, builders r " J Mulholland . teamster keeper 174 John Duggan, laborcr r " J Connolly, labore r 6o Alex McNaughton Wellington-st intersects 176 David Hurly, engineer 114 James Leonard, laborer 64 Fr-d E Ritchie 178 John Baine, labore r Catharina Street, eonth side 116 Win Montgomery, tailot 66 Robt 1V Illamey, machinist 1 8o Patrick Falahee. laborer 120 John Welsh, painte r 7 0 J H Mattice, book-keeper t82 Chas Williams, plasterer Vacant lots 72 Nath Hammond, ins agent Liberty and Aurora sts interseet 184 Francis Connolly, laborer 74 Thomas Smith, builde r Hughson-st intersects Vacant lots 122 Vacan t Cannon-st i ntersects 8 Thos Meade, carpenter I 124 John Sheehan, carpenter Murray -rt intersects 12 Thos Meade, carpenter 126 Mrs Margaret Baker Thos I)oherty, spice mill s 202 Mrs Mary Moran " Win J Brown, moulder 128 Edw Fox, carpenter 94 Charles If Egg, cler k 204 James Ganey, laborer 1 4 T Moynihan, labore r 130 Michael I)wyer, shoemaker 96 Miss Jane Wheeler, board- 206 Nicholas Magerus, j laborer " Thos Udy, mine r 132 Robt McLennan, laborer ing r " John Hayes, laborer 16 Mrs Elizabeth Williamso n 136 Jas H Hamilton, carpenter r" Mrs Jane Matthews r " Peter Shorts, painte r too J S Guthrie, corset manufr Wellington-+t intersects John or intersat s 102 A Rossell, agen t 0 WiRailrouy track intersects 24 Mrs John Barlow east side, " George Marcham, laborer 210 John Beaufort, carpente r Catharine Street North, 110 I) Moore & Co, founders 26 Charles Durr, barber from 104 $ing east to the Bay 28 Win John, lathe r Strackan-st intersects s Robert-st intersect s 1 . -
THE CHRONICLE of Mt. Juliet LARGEST CIRCULATION IN
THE CHRONICLE Celebrating our 35th year as the leading newspaper in Mt. Juliet and West Wilson County www.tcomj.com • 615-754-6111 of Mt. Juliet LARGEST CIRCULATION IN WILSON COUNTY • FEBRUARY 11, 2015 • VOLUME 35, NUMBER 6 Search begins West Wilson Middle Cheer place for location for 6th at Nationals, 4th at Worlds new fire station By Kenny Howell said that he didn’t want Managing Editor to bind the resolution to just there. He said he A resolution request- didn’t want politics to ing the City Manager to play into the decision initiate a site selection and the best location process for a new fire not be chosen. He said station was approved a county commissioner Monday. said that happened with Commissioner Ray the county. Justice wanted to add “I don’t want us to re- language to the res- peat that mistake,” said olution saying that it Hagerty. should be located on the Justice said that peo- north side but the spon- ple on the north side sor, Mayor Ed Hagerty See BOC, Page 5 The West Wilson Middle Cheer Squad traveled this past weekend for the UCA National High School Cheerleading Champi- onship at Disney’s ESPN Wide World of Sports. They placed 6th in the Large Middle School Division at Nationals Saturday, WCHS students then placed 4th in Worlds Sunday. ~Photo by Melanie Gnewikow, Melanie G. Photography donate their locks Man arrested after stabbing juvenile in fight From Wilson Coun- the victim told the de- ty Sheriff’s Office tectives he and suspect Joseph Ray Griffith had A 20-year-old man arranged via Facebook has been arrested after messages to meet for a stabbing a 17-year-old fight at the recreation during a fight at the center at 2 a.m. -

Inventing Television: Transnational Networks of Co-Operation and Rivalry, 1870-1936
Inventing Television: Transnational Networks of Co-operation and Rivalry, 1870-1936 A thesis submitted to the University of Manchester for the degree of Doctor of Philosophy In the faculty of Life Sciences 2011 Paul Marshall Table of contents List of figures .............................................................................................................. 7 Chapter 2 .............................................................................................................. 7 Chapter 3 .............................................................................................................. 7 Chapter 4 .............................................................................................................. 8 Chapter 5 .............................................................................................................. 8 Chapter 6 .............................................................................................................. 9 List of tables ................................................................................................................ 9 Chapter 1 .............................................................................................................. 9 Chapter 2 .............................................................................................................. 9 Chapter 6 .............................................................................................................. 9 Abstract .................................................................................................................... -

AJTDE Volume 5, Number 2, June 2017 Table of Contents
Australian Journal of Telecommunications and the Digital Economy AJTDE Volume 5, Number 2, June 2017 Table of Contents Editorial A Time For Renewal ii Mark A Gregory Public Policy Discussion The role of regulation in preventing Wi-Fi over-congestion in densely populated areas 1 Frank den Hartog, Jan de Nijs Articles Implementation of PCC-OFDM on a software-defined radio testbed 17 Gayathri Kongara, Jean Armstrong An Evaluation and Enhancement of a Novel IoT Joining Protocol 46 Tyler Nicholas Edward Steane, PJ Radcliffe Utilisation of DANGER and PAMP signals to detect a MANET Packet Storage Time Attack 61 Lincy Elizebeth Jim, Mark A Gregory U.S. Telco Industry History as a Prologue to its Future 98 Carol C McDonough Household bandwidth and the ‘need for speed’: Evaluating the impact of active queue management for home internet traffic 113 Jenny Kennedy, Grenville Armitage, Julian Thomas Social Network Behaviour Inferred from O-D Pair Traffic 131 Mostfa Mohsin Albdair, Ronald Addie, David Fatseas Making ICT Decommissioning Sexy! Challenges and Opportunities 151 Peter Hormann History of Australian Telecommunications Interference to Telephone Lines 35 Simon Moorhead Fact or Fraud? 75 Ian Campbell Australian Journal of Telecommunications and the Digital Economy, ISSN 2203-1693, Volume 5 Number 2 June 2017 Copyright © 2017 i Australian Journal of Telecommunications and the Digital Economy A Time for Renewal Editorial Mark A Gregory RMIT University Abstract: The Telecommunications Association has commenced the second phase of the renewal process that started in 2013. As part of the first phase of this renewal process a key decision was to relaunch the Telecommunications Journal of Australia as the Australian Journal of Telecommunications and the Digital Economy. -

July 2019 Newsletter
PATRON: The Hon Linda Dessau AC PRESIDENT: Mr David Zerman Governor of Victoria This Month’s Events… 6th July: Taking Care of Nature: Linking Backyards to Bush A joint workshop with Gardens for Wildlife Victoria and the Victorian Environment Friends Network 25th July: Social Work: Collaborative Human-Robot Interaction With Professor Elizabeth A. Croft 26th – 27th July: Campfires & Science: Wild DNA at Toolangi Advance Notice National Science Week @ RSV: July 2019 8th August: Mind over Faecal Matter: Gut Biome & Mental Health Newsletter With Associate Professor Print Post Approved 100009741 Elisa Hill-Yardin & Associate Professor Ashley Franks The Royal Society of Victoria Inc. 8 La Trobe Street, th 9 August: Science at the Extreme (launch at Melbourne Melbourne Victoria 3000 Museum) Tel. (03) 9663 5259 With Dr Darlene Lim, Dr Kate Selway, Dr Dianne rsv.org.au Bray and Mr Nate Byrne 10th August: Extrasensory (main event at the Parliament of Victoria) 14th August: Stories from the Cosmos: what Indigenous storytelling can teach us about memory With Dr Simon Cropper, Ms Kat Clarke, Dr Lynne Kelly, Dr Duane Hamacher and Dr Meredith McKague 15th August: Young Scientist Research Prizes July Events Taking Care of Nature: Linking Backyards to Bush Saturday, 6th July 2019 from 9:30am to 3:00pm Hear fascinating stories of people caring for nature in diverse places, from schools to suburban gardens, creeks and nature reserves. How can this work transform a landscape? How do you start? Be inspired, learn what you can do, network and get involved! Speakers include Peter Noble (Ballarat Environment Network – linking groups to transform landscapes), Irene Kelly and Kerry Davies (Knox Gardens for Wildlife – linking schools and gardens for wildlife), Anthony Bigelow (First Friends of Dandenong Creek – crowdfunding and revitalising a Friends group), Charlotte Fletcher (Cranbourne Gardens, helping bandicoots from reserves to suburbs), amongst others. -

Cumberland Byway Cumberland Gap
Cumberland Byway Cumberland Gap Jellico Celina Byrdstown Corridor ManagementOneida Plan Winfield for: Standing Stone Alliance for the Cumberlands State Park Jamestown Huntsville LaFollette Allardt Livingston Jacksboro Rugby Robbins Caryville Charrette: August 19-22, 2013 December 18, 2013 Alliance for the Cumberlands, c/o Extended Services, TTU, Box 5073, Cookeville, TN 38505 Introduction Acknowledgements The Cumberland Historic Byway Corridor Management Plan has been prepared for the Alliance for the Cumberlands by Farmer | Morgan, L.L.C. The funding was provided by the Tennessee Department of Transportation through Kwill Consultants. The Cumberland Historic Byway Corridor Management Plan is intended to serve as a guide for future development and redevelopment of the Cumberland Historic Byway in Claiborne, Campbell, Scott, Morgan, Fentress, Pickett, Overton, and Clay counties in the State of Tennessee. The project components that are proposed in this Benjamin Farmer document are results of a public visioning session and design Principal- Managing Partner [email protected] charrette conducted by Farmer | Morgan with the help of 334-444-2893 PM Environmental, Tennessee Valley Archaeological Research, Mollie Henry Marketing, Ben Johnson Illustrations, and students from the Auburn University Landscape Architecture John Hargraves, P.G. program. PM Environmental, Inc. Regional Manager [email protected] Alliance for the Cumberlands 423.468.1105 Dawn Kupferer Ted Karpynec Project Coordinator TVAR- Sr. Planner [email protected] -
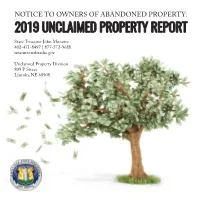
2019 Unclaimed Property Report
NOTICE TO OWNERS OF ABANDONED PROPERTY: 2019 UNCLAIMED PROPERTY REPORT State Treasurer John Murante 402-471-8497 | 877-572-9688 treasurer.nebraska.gov Unclaimed Property Division 809 P Street Lincoln, NE 68508 Dear Nebraskans, KUHLMANN ORTHODONTICS STEINSLAND VICKI A WITT TOM W KRAMER TODD WINTERS CORY J HART KENNETH R MOORE DEBRA S SWANSON MATHEW CLAIM TO STATE OF NEBRASKA FOR UNCLAIMED PROPERTY Reminder: Information concerning the GAYLE Y PERSHING STEMMERMAN WOLFE BRIAN LOWE JACK YOUNG PATRICK R HENDRICKSON MOORE KEVIN SZENASI CYLVIA KUNSELMAN ADA E PAINE DONNA CATHERNE COLIN E F MR. Thank you for your interest in the 2019 Property ID Number(s) (if known): How did you become aware of this property? WOODWARD MCCASLAND TAYLORHERDT LIZ “Claimant” means person claiming property. amount or description of the property and LARA JOSE JR PALACIOS AUCIN STORMS DAKOTA R DANNY VIRGILENE HENDRICKSON MULHERN LINDA J THOMAS BURDETTE Unclaimed Property Newspaper Publication BOX BUTTE Unclaimed Property Report. Unclaimed “Owner” means name as listed with the State Treasurer. LE VU A WILMER DAVID STORY LINDA WURDEMAN SARAH N MUNGER TIMOTHY TOMS AUTO & CYCLE Nebraska State Fair the name and address of the holder may PARR MADELINE TIFFANY ADAMS MICHAEL HENZLER DEBRA J property can come in many different Husker Harvest Days LEFFLER ROBERT STRATEGIC PIONEER BANNER MUNRO ALLEN W REPAIR Claimant’s Name and Present Address: Claimant is: LEMIRAND PATTNO TOM J STREFF BRIAN WYMORE ERMA M BAKKEHAUG HENZLER RONALD L MURPHY SHIRLEY M TOOLEY MICHAEL J Other Outreach -

The Star Wars Timeline Gold: Appendices 1
The Star Wars Timeline Gold: Appendices 1 THE STAR WARS TIMELINE GOLD The Old Republic. The Galactic Empire. The New Republic. What might have been. Every legend has its historian. By Nathan P. Butler - Gold Release Number 49 - 78th SWT Release - 07/20/11 _________________________________________ Officially hosted on Nathan P. Butler’s website __at http://www.starwarsfanworks.com/timeline ____________ APPENDICES ―Look at the size of that thing!‖ --Wedge Antilles Dedicated to All the loyal SWT readers who have helped keep the project alive since 1997. -----|----- -Fellow Star Wars fans- Now that you‘ve spent time exploring the Star Wars Timeline Gold‘s primary document and its Clone Wars Supplement, you‘re probably curious as to what other ―goodies‖ the project has in store. Here, you‘ll find the answer to that query. This file, the Appendices, features numerous small sections, featuring topics ranging from G-Canon, T-Canon, and Apocryphal (N-Canon) timelines, a release timeline for ―real world‖ Star Wars materials, information relating to the Star Wars Timeline Project‘s growth, and more. This was the fourth file created for the Star Wars Timeline Gold. The project originally began as the primary document with the Official Continuity Timeline, then later spawned a Fan Fiction Supplement (now discontinued) and an Apocrypha Supplement (now merged into this file). The Appendices came next, but with its wide array of different features, it has survived to stand on its own alongside the primary document and continues to do so alongside the newer Clone Wars Supplement. I hope you find your time spent reading through it well spent. -

THE STAR WARS TIMELINE GOLD the Old Republic
THE STAR WARS TIMELINE GOLD The Old Republic. The Galactic Empire. The New Republic. What might have been. Every legend has its historian. By Nathan P. Butler – Gold Release Number 42 – 71st SWT Release – 01/01/07 _________________________________________ Officially hosted on Nathan P. Butler’s website __at http://www.starwarsfanworks.com/timeline ____________ APPENDICES “Look at the size of that thing!” --Wedge Antilles Dedicated to All the loyal SWT readers who have helped keep the project alive since 1997. -----|----- -Fellow Star Wars fans- Now that you’ve spent time exploring the Star Wars Timeline Gold’s primary document, you’re probably curious as to what other “goodies” the project has in store. Here, you’ll find the answer to that query. This file, the Appendices, features numerous small sections, featuring topics ranging from G-Level and Apocryphal (N-Level) Canon timelines, rosters for Rogue Squadron and other groups, information relating to the Star Wars Timeline Project’s growth, and more. This was the fourth file created for the Star Wars Timeline Gold. The project originally began as the primary document with the Official Continuity Timeline, then later spawned a Fan Fiction Supplement (now discontinued) and an Apocrypha Supplement (now merged into this file). The Appendices came last, but with its wide array of different features, it has survived to stand on its own alongside the primary document. I hope you find your time spent reading through it well spent. Welcome to the Star Wars Timeline Gold Appendices. --Nathan Butler January 1, 2007 All titles and storylines below are trademark/copyright their respective publishers and/or creators. -

History of Radio Callsigns in Australia
AUSTRALIAN AMATEUR RADIO CALL SIGNS A HISTORY OVERVIEW The current series of Australian Amateur Radio Call Signs may seem a little baffling but looking back at the way in which our call signs have evolved shows that it has been much more confusing in the past. We know that there were wireless experimenters in most states of Australia from about 1897, very soon after Marconi's demonstrations in London. Engineers from the Post & Telegraph Dept., University researchers and a few individuals duplicated Marconi's wireless system in the period 1900-1904, with varying degrees of success. There were no call signs at that time, and operators simply used their station location or their names or initials as identifiers. Experimenters were supposed to obtain permission from the Royal Navy on Australian Station, ie before the formation of the Australian Navy, but most didn't bother and the Navy had no wireless to hear them anyway, although occasionally visiting Navy ships were equipped with wireless equipment. The PMG’s department was launched in Federation in 1901, but was not involved at this point in time. By 1904 the Australian Navy (actually the Royal Navy on Australian Station) did have several ships equipped with wireless and used the ship's names or initials as identification. For example the RNS "St George" was just "SG". The Navy was keen to restrict wireless to military purposes only, but wireless manufacturers saw Australia as a lucrative commercial market and demanded access. The Australian Government therefore enacted The Wireless Telegraphy Act of 1905 (October 1905) to place control of wireless under the PMG's Department.