Chapitreii : Evolution De L'edifice De La Mosquee
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
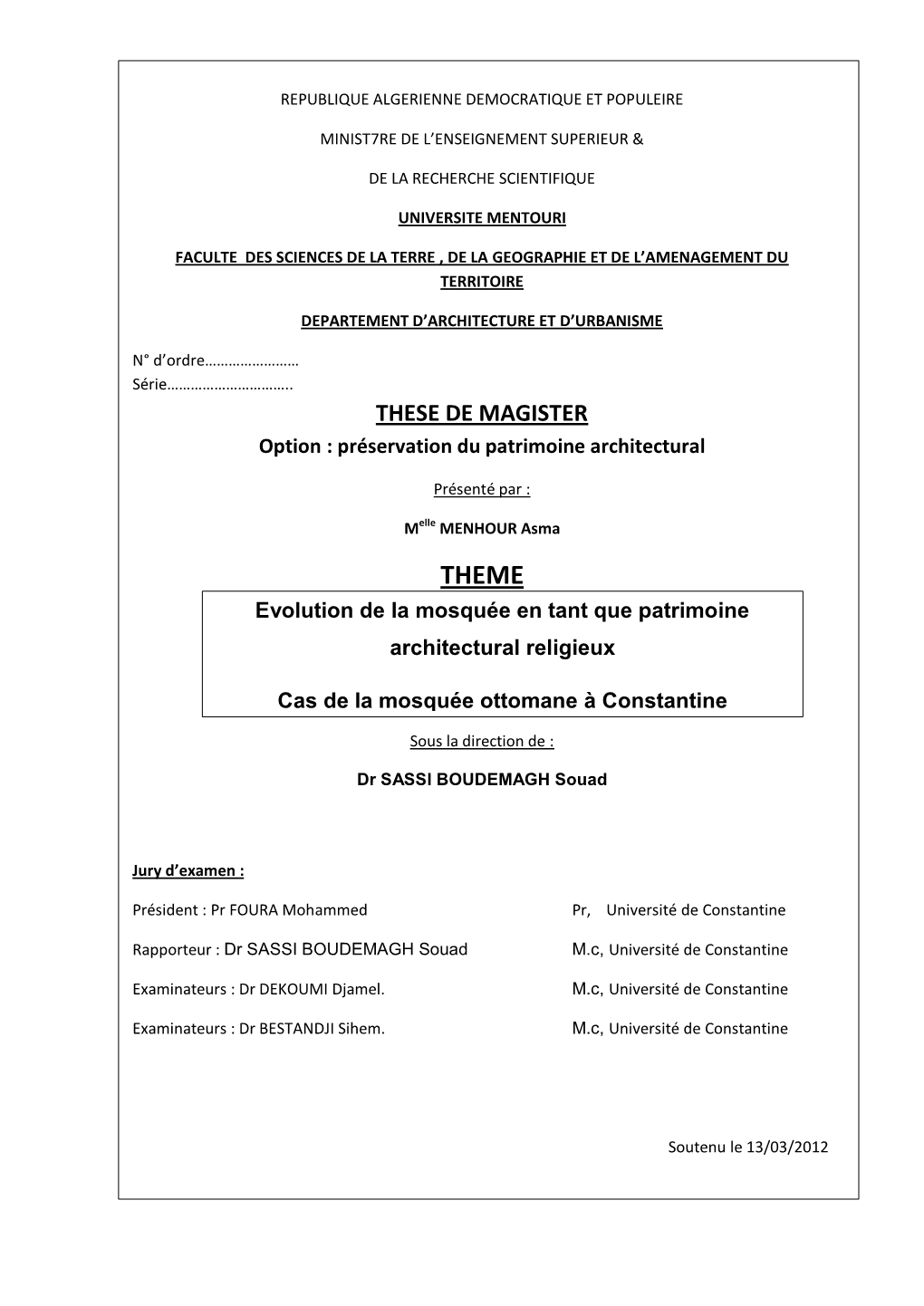
Load more
Recommended publications
-

Cas Des Mosquées –
جملة منرب الرتاث اﻷثري العـــدد:السابع،ص -96 69 ISSN: 2335-1500, EISSN: 2602-7267 Le rôle de la lumière du jour dans la sacralité des espaces religieux musulmans -cas des mosquées – BENHARKAT Amina Laboratoire patrimoine archeologique et sa valorisation Université Abou Bakr Belkaid Tlemcen Directeur de thèse: MAROUF BELHADJ Professeur .Université Abou Bakr BElkaid Tlemcen اتريخ اﻻستﻻم:00/03/2012 اتريخ القبول:2012/03/12 Summary: The search needs a look of naturel light in cultuel space which has frequently associated to divine, wether religions it is reflect. It’s may in effect help to turn the expirement from the side itself in a religious expirement perfectly singular. By an analysis applied generally of Maghrebine mosques,which are particularly in the town of Tlemcen, we treat every aspects of light in interest about light of relation’s side or object and the light which dialogues and change mutually, we take care of lighting device: their formes, directions and their areas to reinforce ones and the others. The work architectural of light of organization to procure visuel comfort, like in any building profane and the diffusion of the light is homogenous and regular and the principal source of naturel light come from court of the mosque. Finnaly : architectes, archeologues, designers, artists or others are calling to take in consideration this factor till elaboration of projects’ cultuels types. Key words: Natural Light, side lighting, Divine Light, daylighting, lighting device. امللخص: يطرح البحث نظرة عن الضوء الطبيعي داخل حيز طقوسي إذ يرتبط الضوء يف الغالب ابلفكر الديين ابلنسبة للدايانت السماوية، فهي يف الوقت نفسه اﻻنعكاس واﻷداة واخلاصية، اليت حتّول التجربة ابيحليز نفسه، إيل جتربة دينية منفردة. -

Algeria Cultural Discovery
Algeria Cultural Discovery 9 Days Algeria Cultural Discovery Take the road less traveled on this incredible adventure in Algeria — one of the least visited countries in the world! Experience the rare beauty of cosmopolitan Algiers, with its historic Casbah and labyrinthine old quarter. Then explore the impressive and well-preserved Roman ruins at Tipasa, beautifully situated on the Mediterranean, and Timgad. Travel deep into the heart of the M'Zab Valley and explore its enchanting fortress cities rising from the dunes. With deep history and ancient UNESCO-listed relics at every step, you'll find yourself in a fascinating land wondering why it wasn't on your radar sooner. Details Testimonials Arrive: Algiers, Algeria “We have traveled throughout the world, but never experienced a level of service and attention to detail Depart: Algiers, Algeria as we did with MT Sobek.“ Dennis G. Duration: 9 Days Group Size: 4-12 Guests “I have taken 12 trips with MT Sobek. Each has left a positive imprint on me—widening my view of the Minimum Age: 14 Years Old world and its peoples.” Jane B. Activity Level: . REASON #01 REASON #02 REASON #03 MT Sobek captures the best Our team of local guides This 9-day adventure has been of Algeria on this unique and are true experts and have crafted to pair effortlessly with immersive insider adventure decades of experience leading a 6-day extension to help you spanning the country's guests through Algeria. maximize your time in Algeria. historical and cultural wonders. ACTIVITIES LODGING CLIMATE In-depth cultural touring, including Luxurious 4- and 5-star hotels Algeria's coastal areas have a exploring five UNESCO World with elegant rooms and typical Mediterranean climate Heritage wonders and enjoying scenic locations - all carefully with warm, dry summers authentic local encounters. -

Publication Provisoire Publication Provisoire CIRCUIT IV Premier Jour
Publication provisoire Publication provisoire CIRCUIT IV Premier jour Tlemcen, Nédroma, berceaux zyanide et almohade Amine Semar Premier jour : Tlemcen, ville d’art IV.1 MANSOURAH IV.2 TLEMCEN IV.2.a Djamaa al-Kabir (Grande Mosquée) IV.2.b Mosquée Sidi Bel-Hassan IV.2.c Le Méchouar IV.2.d Mosquée Sidi Brahim IV.2.e Hammam Essebaghine Café des Grenadiers IV.2.f Mosquée Sidi el-Haloui IV.2.g Minaret d’Agadir IV.2.h Koubba de Sidi Ouahab et Tombeau de la Princesse IV.3 EL EUBAD IV.3.a Mosquée Sidi Boumediène IV.3.b Tombeau de Sidi Boumediène IV.3.c La madrasa Sidi Boumediène Bab el-Khemis Publication provisoire Publication provisoire Grande Mosquée de Tlemcen, coupole 183 CIRCUIT IV Tlemcen, Nédroma, berceaux zyanide et almohade Tlemcen, ville d’art Tout de blanc parée, construite sur sition à Agadir l’ancienne. En fusion- un haut plateau bordé de falaises rou- nant, Tagrart à l’ouest et Agadir à l’est geâtres et cerné de verdure, Tlemcen, formeront Tlemcen, “sources d’eau” en l’antique Pomaria (littéralement “les berbère. Mais les Almoravides, austères vergers”) des Romains, est encore Sahariens, n’étaient pas des construc- cette ville arrosée d’eau et parsemée teurs, et à part la Grande Mosquée de beaux jardins. Grâce à la proximité qu’ils ont tôt fait de bâtir, ils n’ont pas de la mer qui atténue l’effet desséchant tout de suite contribué à la grandeur de des plaines présahariennes, Tlemcen a la ville. Mais ils n’allaient pas s’arrêter gardé son charme, ombragée par ses à Tlemcen. -
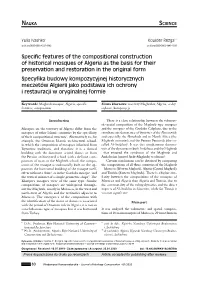
Specific Features of the Compositional Construction Of
NAUKA SCIENCE Yulia Ivashko* Kouider Rezga** orcid.org/0000-0003-4525-9182 orcid.org/0000-0002-1843-1605 Specific features of the compositional construction of historical mosques of Algeria as the basis for their preservation and restoration in the original form Specyfika budowy kompozycyjnej historycznych meczetów Algierii jako podstawa ich ochrony i restauracji w oryginalnej formie Key words: Maghreb mosque, Algeria, specific Słowa kluczowe: meczety Maghrebu, Algeria, cechy features, composition stylowe, kompozycja Introduction There is a close relationship between the volumet- ric-spatial composition of the Maghreb type mosques Mosques on the territory of Algeria differ from the and the mosques of the Cordoba Caliphate, due to the mosques of other Islamic countries by the specificity simultaneous dominance of dynasties of the Almoravids of their compositional structure1. Alternatively to, for and especially the Almohads and in North Africa (the example, the Ottoman Islamic architectural school, Maghreb countries) and the Perinea Peninsula (the so- in which the composition of mosques inherited from called Al-Andalus)3. It was this simultaneous domina- Byzantine traditions, and therefore it is a domed tion of the dynasties in both Andalusia and the Maghreb building with the dominant central dome; or from that ensured the symbiosis of the Maghreb and the Persian architectural school with a definite com- Andalusian (united Arab-Maghreb) traditions4. position of iwan; in the Maghreb school, the compo- Certain conclusions can be obtained by comparing sition of the mosque is traditionally built on the op- the compositions of all three countries of the Maghreb position the horizontal building of the mosque itself, – Morocco (Western Maghreb), Algeria (Central Maghreb) often without a dome, as in the Cordoba mosque, and and Tunisia (Eastern Maghreb). -

French Memoricides in Algeria: a Study on Socialization Institutions
ISSN (Online): 2350-0530 International Journal of Research -GRANTHAALAYAH ISSN (Print): 2394-3629 July 2020, Vol 8(07), 340 – 353 DOI: https://doi.org/10.29121/granthaalayah.v8.i7.2020.729 FRENCH MEMORICIDES IN ALGERIA: A STUDY ON SOCIALIZATION INSTITUTIONS Delliou Foudil *1 *1 University of Constantine 3, Algeria DOI: https://doi.org/10.29121/granthaalayah.v8.i7.2020.729 Article Type: Case Study ABSTRACT The French occupation of Algeria was a colonial as well as a cultural Article Citation: Delliou Foudil. one, during which many criminal practices were committed against the (2020). FRENCH MEMORICIDES IN Algerians. This work aims to highlight some of these practices, which ALGERIA: A STUDY ON undoubtedly amount to war crimes of cultural genocide against all types of SOCIALIZATION INSTITUTIONS. International Journal of Research - Algerian socialization institutions: religious, educational, media, sports, GRANTHAALAYAH, 8(7), 340-353. charitable ones ... We will try to present some edifying samples of these https://doi.org/10.29121/granthaa institutions after a brief preamble about the Algerian socialization system, layah.v8.i7.2020.729 and how French military and colonists deal with this system through philosophical premises and practical procedures. Finally we will end the Received Date: 13 July 2020 work by citing some reactions of Algerian resistant reactions to these criminal practices. Accepted Date: 31 July 2020 Keywords: French Memoricides Algeria Socialization Institutions 1. INTRODUCTION The French occupation of Algeria (1830-1962) was a settlement and a cultural occupation with a hostile perspective whose background may be traced back to the Crusades, and for that purpose it committed many crimes, which have had the most severe and widespread effects on Algerian generations. -

The Architecture of the Mosque in Algeria Between the Identity of Islamic Civilization and Contemporary Developments Senior Lect
مجلة العمارة والفنون العدد الخامس عشر The architecture of the mosque in Algeria between the identity of Islamic civilization and contemporary developments Senior Lect. Meriem Redjem Senior Lecturer, department of architecture, university of Annaba, PhD student university of Mohamed Khider - Biskra- Algeria. [email protected] Prof. Dr. Said Mazouz Architecture Department, Larbi Ben Mhidi University - Oum El Bouaghi- Algeria. Abstract: The cultural heritage represents the most important foundation for creating and maintaining identity; “Heritage is what contemporary society inherits and passes on; thus, it does not represent only the past but also the present use of the past” (Laura Di Pietro et al, 2018, p. 97). Identity and Contemporary are the problems of every civilization. Identity is defined as consisting of “customary practice and of beliefs, values, sanctions, rules, motives and satisfactions associated whit it” (Jensen et al, 2011, p. 286). Life can never be satisfied in the old past, despite its origin and originality separate from his present, and impossible to live and grow outside the womb of his assets without identity; therefore, it was necessary for The genius civilization to live its present depends on its authentic identity in a modern and sophisticated spirit that takes from its past to lead its future. The research discusses the problem of loss of identity in the designs on the Arab and Islamic architecture and especially on contemporary mosques in Algeria characterized by an architectural weakness on their spatial organization, mihrabs, minarets, domes and others; where non-observance of values and aesthetic design of proportions and dimensions and measurements at simulation Heritage styles which could lead to loss of identity design. -

5 Erasing the Ketchaoua Mosque
5 Erasing the Ketchaoua Mosque Catholicism, assimilation, and civic identity in France and Algeria Ralph Ghoche “Touche pas à mon église” (“Don’t touch my church”) reads the cover of the July 2015 issue of Valeurs actuelles, a French conservative news magazine. The slogan, and the movement that it sparked, were devised in response to comments made by Dalil Boubakeur, the rector of the Paris Grand Mosque, in a televised interview a month earlier. Asked whether disused churches in France could be transformed into mosques, Boubakeur had paused momentarily and answered: “Why not? It is the same God. The rites are similar, fraternal. I think that Muslims and Christians can coexist.”1 The reply generated controversy, as it seemed to feed conspirac- ist suspicions, fueled by the growing power of identitarian movements, that a grander cultural displacement of the white, Christian population by Arab Muslims was underway.2 So ferce was the backlash that Boubakeur published a retraction soon after the interview.3 The author of the Valeurs actuelles article, Denis Tillinac — though himself a conservative Catholic — performed some masterly sleights of hand as he shifted the ground of debate from religion to cultural values, from Christianity to such French Republican convictions as secularism and freedom of speech. He spoke of churches less as objects of Christian worship than as sites for the preservation of national identity, rooted in cultural landscapes and historical memory. The slogan “Don’t touch my church” too was deceptive and calculated as it co-opted the famous anti-racist slogan “Touche pas à mon pote” (“Don’t touch my buddy”) that issued from marches in the mid-1980s condemning a wave of race-based violence against adolescents of North African descent residing in France. -

The Architecture of the Mosque in Algeria Between the Identity Of
مجلة العمارة والفنون العدد الخامس عشر The architecture of the mosque in Algeria between the identity of Islamic civilization and contemporary developments Meriem Redjem Senior Lecturer, department of architecture, university of Annaba, PhD student university of Mohamed Khider - Biskra- Algeria. [email protected] Prof. Dr. Said Mazouz Architecture Department, Larbi Ben Mhidi University - Oum El Bouaghi- Algeria. Abstract: The cultural heritage represents the most important foundation for creating and maintaining identity; “Heritage is what contemporary society inherits and passes on; thus, it does not represent only the past but also the present use of the past” (Laura Di Pietro et al, 2018, p. 97). Identity and Contemporary are the problems of every civilization. Identity is defined as consisting of “customary practice and of beliefs, values, sanctions, rules, motives and satisfactions associated whit it” (Jensen et al, 2011, p. 286). Life can never be satisfied in the old past, despite its origin and originality separate from his present, and impossible to live and grow outside the womb of his assets without identity; therefore, it was necessary for The genius civilization to live its present depends on its authentic identity in a modern and sophisticated spirit that takes from its past to lead its future. The research discusses the problem of loss of identity in the designs on the Arab and Islamic architecture and especially on contemporary mosques in Algeria characterized by an architectural weakness on their spatial organization, mihrabs, minarets, domes and others; where non-observance of values and aesthetic design of proportions and dimensions and measurements at simulation Heritage styles which could lead to loss of identity design. -

Patrimonial Policy During the French Colonial Period in Algeria 1830-1962 Walid HAMMA
Algerian Journal of Engineering Architecture and Urbanism Vol. 2. Nr. 1 . 201 8 Patrimonial policy during the French colonial period in Algeria 1830-1962 Walid HAMMA Received: 19 December 2017 • Revised: 21 February 2018 • Accepted: 13 March 2018 PATRIMONIAL POLICY DURING THE FRENCH COLONIAL PERIOD IN ALGERIA 1830-1962 Walid HAMMA Lecturer, Dr, Arch, Abu Bekr BELKAID University of Tlemcen, Faculty of Technology, Department of Architecture, e-mail: [email protected] Abstract: Some heritage specialists consider that France has preserved many monuments in Algeria and that this country owes it the promulgation of laws and the establishment of institutions for the preservation of heritage. To verify this observation, we studied the heritage policy of this period. We have found that France promotes the Christian heritage and paens of Phoenician, Roman, Byzantine and Spanish civilizations to the detriment of the Numidian and Mauritanian monuments. It also favors Sufi religious drift constructions. The Orientalists, for their part, added the Arabic term to the Muslim monuments built by the Amazighs. Key words: Policy, heritage, colonial period, Algeria. Introduction The concept of heritage is a Western creation, imported in the Maghreb, by the colonizers. In the Maghreb, the question of heritage and patrimonialization results, therefore, largely from the view taken by European scholars, to the local culture and the concept of heritage, constructed by this distancing. This exogenous gaze will evolve, at the beginning of the XXth century, towards a consideration, of the local material culture native. This consideration of local heritage presents a policy of discrimination that we will see in the case of Algeria. -

Countries Common Project
ABSTRACT An Erasmus+ project By „One fo all, All for Green” project members from Greece, Hungary, Italy, Portugal, Scotland and Spain. ALGERIA Contents Chapter 1 ................................................................................................................................................. 3 The Country ............................................................................................................................................. 3 Algeria .................................................................................................................................................. 3 History ................................................................................................................................................. 3 Culture, Music ..................................................................................................................................... 4 Literature ............................................................................................................................................. 4 Religion ................................................................................................................................................ 4 Cuisine ................................................................................................................................................. 5 Population ........................................................................................................................................... 5 Fun facts -

Algeria Storymap Copyright Information
Algeria StoryMap Copyright Information CC-BY-1.0 License link: http://creativecommons.org/licenses/by/1.0/legalcode Caption: Belezma National Park Welcome Sign Author: Nemencha Image Link: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/60/Entr%C3%A9e_Parc_du_Belezma.JPG CC-BY-SA-1.0 License Link: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0/legalcode Caption: A View of Oran and the Santa Cruz Chapel from Fort Santa Cruz Author: Vatekor Image Link: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/59/ChapelleSantaCruz2.jpeg CC-BY-2.0 License Link: https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/legalcode Caption: Tassili Cave Painting Depicting People, taken April 15, 2006 Author: Patrick Gruban Image Link: https://www.flickr.com/photos/19473388@N00/137420662 Caption: A Daytime View of the Algiers Cityscape Author: Patrick Gruban Image Link: https://farm1.staticflickr.com/53/137345066_6fdb6bd817_b.jpg Caption: Explore Algerian History at Ahmed Zabana National Museum, Oran Author: Maya-Anaïs Yataghène Image Link: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/df/Mus%C3%A9e_national_d'Oran.jpg CC-BY-SA-2.0 License link: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode Caption: Merguez Sausage, the Algerian Beef or Mutton Alternative Author: Stu Spivack Image Link: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bc/Merguez_sausages.jpg Caption: Cathédrale du Sacré-Cœur d'Alger, Exterior View from Didouche Mourad Author: Yves Jalabert Image Link: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/89/Sacred_heart_of_Algiers_as_seen_from_Didou -
Characteristics of the Medina of Tlemcen Walid HAMMA Received: 15 June 2017 • Revised: 22 July 2017 • Accepted: 24 August 2017
International Journal of Human Settlements Vol. 1 . Nr. 2 . 2017 Characteristics of the medina of Tlemcen Walid HAMMA Received: 15 June 2017 • Revised: 22 July 2017 • Accepted: 24 August 2017 CHARACTERISTICS OF THE MEDINA OF TLEMCEN Walid HAMMA Lecturer, Dr, Arch, Abu Backr Belkaid Tlemcen University, Faculty of Technology, Department of Architecture, email: [email protected] Abstract: The ancient vernacular city of Tlemcen is called Islamic Medina. Through this study we want to confirm that its name is not fortuitous. It has characteristics of an Islamic city. To confirm this hypothesis, we analyzed its urban tissues using a typo-morphological and functional approach, also studying the following elements: urban frame and spatial organization, urban roads, squares, souks, gardens, fountains and the large pond, the ramparts and gates, symbolic elements, arches and skifas, mosques, medersas, zawiyas, palaces, fondouks, ferrane, hammams, mausoleums, tanneries and mills, houses. Key words: Medina, architecture, urbansim, Islam, Tlemcen Introduction The medina is a Muslim city whose functions, organization (urban and society) and architecture obey the precepts of Islam, it presents the apogee of the Islamic civilization. UNESCO defined it in 1995 through a detailed study of this urban entity: "The medina, in Arabic, was the integrated and integral city, a social unit of reference, exclusive habitat to the consolidation of sedentary lifestyle. Nucleus permeable space rural areas that feed it and the commercial activities that support it despite the ramparts that close it and protect it from the threat of the invaders. Inside of his walls germinates to a living social fabric with his passions of love and war capable of building the history of his own identity, and his own identity signs and the translation of lifestyles to the literary and artistic creation, and the architectural expression and craft" (UNESCO, 1995).