Rapport D'enquête Sociolinguistique Des Dialectes Du
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more
Recommended publications
-

Central & Northern Mali Emergency Response
CENTRAL & NORTHERN MALI EMERGENCY RESPONSE SITUATION REPORT | SEPTEMBER, 2019 Mali Response To Remain Category III June 2019 to 168,515, by 8 August, the majority of them National Office Response from Mopti and Segou regions. UN Hosts High-Level Meeting on Mali and • A total of 81,338 people are at risk of flooding, with78,115 the Sahel Highlights A World Vision Declaration Decision Group (DDG), that already affected. Stronger precipitations are expected, while On September 25th 2019, the United Nations hosted a high-lev- discusses the magnitude of each humanitarian emergency, the level of Niger river may rise as waters are released from making decisions on categorization, has reviewed the Cen- el meeting on Mali and the Sahel at the United Nations General dams in Guinea and Mali. Assembly. The meeting was opened by the Secretary-General tral and Northern Mali Emergency Response (CNMER). Its • Reports reveal that 920 schools remained closed at the end resolution, the Central and Northern Mali Emergency of the United Nations, Mr. António Guterres, together with the of the school year. Of these, 598 were in the Mopti region, President of the Republic of Mali, H.E. Mr. Ibrahim Boubacar Response remains a Category Three National Office affecting 276,000 children. Response. Keïta, among other Heads of State and dignitaries. • A total of 650,000 people are expected to be at risk of severe Participants discussed the implementation of the Agreement for This is because of the magnitude of the crisis that has over food insecurity and livelihood compared to 416,000 initially, Peace and Reconciliation in Mali, originating from the Algiers 3.9 million people affected by the emergency. -

Impact De La Mise E Chance Dans La Régio
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de République du Mali la Recherche Scientifique ------------- ----------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi Universités des Sciences, des Techniques et des Te chnologies de Bamako (USTTB) --------------- Thèse N°…… Faculté de Médecine et d’Odonto -Stomatologie Année Universitaire 2011/2012 TITRE : Impact de la mise en œuvre de la stratégie chance dans la région de Mopti : résultat de l’enquête 2011 Thèse présentée et soutenue publiquement le………………………/2013 Devant la Faculté de Médecine et d’Odonto -Stomatologie Par : M. Boubou TRAORE Pour obtenir le grade de Docteur en Médecine (Diplôme d’Etat) JURY : Président : Pr Tiéman COULIBALY Membre : Dr Alberd BANOU Co-directeur : Dr Mamadou DEMBELE Directeur de thèse : Pr Sanoussi BAMANI Thèse de Médecine Boubou TRAORE 1 DEDICACES A MA MERE : Fanta FANE Je suis fier de t’avoir comme maman Tu m’as appris à accepter et aimer les autres avec leurs différences L’esprit de tolérance qui est en moi est le fruit de ta culture Tu m’as donné l’amour d’une mère et la sécurité d’un père. Tu as été une mère exemplaire et éducatrice pour moi. Aujourd’hui je te remercie d’avoir fait pour moi et mes frères qui nous sommes. Chère mère, reçois, à travers ce modeste travail, l’expression de toute mon affection. Q’ALLAH le Tout Puissant te garde longtemps auprès de nous. A MON PERE : Feu Tafara TRAORE Ton soutien moral et matériel ne m’as jamais fait défaut. Tu m’as toujours laissé dans la curiosité de te connaitre. Tu m’as inculqué le sens du courage et de la persévérance dans le travail A MON ONCLE : Feu Yoro TRAORE Ton soutien et tes conseils pleins de sagesse m’ont beaucoup aidé dans ma carrière scolaire. -

FINAL REPORT Quantitative Instrument to Measure Commune
FINAL REPORT Quantitative Instrument to Measure Commune Effectiveness Prepared for United States Agency for International Development (USAID) Mali Mission, Democracy and Governance (DG) Team Prepared by Dr. Lynette Wood, Team Leader Leslie Fox, Senior Democracy and Governance Specialist ARD, Inc. 159 Bank Street, Third Floor Burlington, VT 05401 USA Telephone: (802) 658-3890 FAX: (802) 658-4247 in cooperation with Bakary Doumbia, Survey and Data Management Specialist InfoStat, Bamako, Mali under the USAID Broadening Access and Strengthening Input Market Systems (BASIS) indefinite quantity contract November 2000 Table of Contents ACRONYMS AND ABBREVIATIONS.......................................................................... i EXECUTIVE SUMMARY............................................................................................... ii 1 INDICATORS OF AN EFFECTIVE COMMUNE............................................... 1 1.1 THE DEMOCRATIC GOVERNANCE STRATEGIC OBJECTIVE..............................................1 1.2 THE EFFECTIVE COMMUNE: A DEVELOPMENT HYPOTHESIS..........................................2 1.2.1 The Development Problem: The Sound of One Hand Clapping ............................ 3 1.3 THE STRATEGIC GOAL – THE COMMUNE AS AN EFFECTIVE ARENA OF DEMOCRATIC LOCAL GOVERNANCE ............................................................................4 1.3.1 The Logic Underlying the Strategic Goal........................................................... 4 1.3.2 Illustrative Indicators: Measuring Performance at the -

FALAISES DE BANDIAGARA (Pays Dogon)»
MINISTERE DE LA CULTURE REPUBLIQUE DU MALI *********** Un Peuple - Un But - Une Foi DIRECTION NATIONALE DU ********** PATRIMOINE CULTUREL ********** RAPPORT SUR L’ETAT DE CONSERVATION DU SITE «FALAISES DE BANDIAGARA (Pays Dogon)» Janvier 2020 RAPPORT SUR L’ETAT ACTUEL DE CONSERVATION FALAISES DE BANDIAGARA (PAYS DOGON) (MALI) (C/N 516) Introduction Le site « Falaises de Bandiagara » (Pays dogon) est inscrit sur la Liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO en 1989 pour ses paysages exceptionnels intégrant de belles architectures, et ses nombreuses pratiques et traditions culturelles encore vivaces. Ce Bien Mixte du Pays dogon a été inscrit au double titre des critères V et VII relatif à l’inscription des biens: V pour la valeur culturelle et VII pour la valeur naturelle. La gestion du site est assurée par une structure déconcentrée de proximité créée en 1993, relevant de la Direction Nationale du Patrimoine Culturel (DNPC) du Département de la Culture. 1. Résumé analytique du rapport Le site « Falaises de Bandiagara » (Pays dogon) est soumis à une rude épreuve occasionnée par la crise sociopolitique et sécuritaire du Mali enclenchée depuis 2012. Cette crise a pris une ampleur particulière dans la Région de Mopti et sur ledit site marqué par des tensions et des conflits armés intercommunautaires entre les Dogons et les Peuls. Un des faits marquants de la crise au Pays dogon est l’attaque du village d’Ogossagou le 23 mars 2019, un village situé à environ 15 km de Bankass, qui a causé la mort de plus de 150 personnes et endommagé, voire détruit des biens mobiliers et immobiliers. -

Inventaire Des Aménagements Hydro-Agricoles Existants Et Du Potentiel Amenageable Au Pays Dogon
INVENTAIRE DES AMÉNAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES EXISTANTS ET DU POTENTIEL AMENAGEABLE AU PAYS DOGON Rapport de mission et capitalisation d’expérienCe Financement : Projet d’Appui de l’Irrigation de Proximité (PAIP) Réalisation : cellule SIG DNGR/PASSIP avec la DRGR et les SLGR de la région de Mopti Bamako, avril 2015 Table des matières I. Introduction .................................................................................................................................... 3 II. Méthodologie appliquée ................................................................................................................ 3 III. Inventaire des AHA existants et du potentiel aménageable dans le cercle de Bandiagara .......... 4 1. Déroulement des activités dans le cercle de Bandiagara ................................................................................... 7 2. Bilan de l’inventaire du cercle de Bandiagara .................................................................................................... 9 IV. Inventaire des AHA existants et du potentiel aménageable dans les cercles de Bankass et Koro 9 1. Déroulement des activités dans les deux cercles ............................................................................................... 9 2. Bilan de l’inventaire pour le cercle de Koro et Bankass ................................................................................... 11 Gelöscht: 10 V. Inventaire des AHA existants et du potentiel aménageable dans le cercle de Douentza ............. 12 VI. Récapitulatif de l’inventaire -

M700kv1905mlia1l-Mliadm22305
! ! ! ! ! RÉGION DE MOPTI - MALI ! Map No: MLIADM22305 ! ! 5°0'W 4°0'W ! ! 3°0'W 2°0'W 1°0'W Kondi ! 7 Kirchamba L a c F a t i Diré ! ! Tienkour M O P T I ! Lac Oro Haib Tonka ! ! Tombouctou Tindirma ! ! Saréyamou ! ! Daka T O M B O U C T O U Adiora Sonima L ! M A U R I T A N I E ! a Salakoira Kidal c Banikane N N ' T ' 0 a Kidal 0 ° g P ° 6 6 a 1 1 d j i ! Tombouctou 7 P Mony Gao Gao Niafunké ! P ! ! Gologo ! Boli ! Soumpi Koulikouro ! Bambara-Maoude Kayes ! Saraferé P Gossi ! ! ! ! Kayes Diou Ségou ! Koumaïra Bouramagan Kel Zangoye P d a Koulikoro Segou Ta n P c ! Dianka-Daga a ! Rouna ^ ! L ! Dianké Douguel ! Bamako ! ougoundo Leré ! Lac A ! Biro Sikasso Kormou ! Goue ! Sikasso P ! N'Gorkou N'Gouma ! ! ! Horewendou Bia !Sah ! Inadiatafane Koundjoum Simassi ! ! Zoumoultane-N'Gouma ! ! Baraou Kel Tadack M'Bentie ! Kora ! Tiel-Baro ! N'Daba ! ! Ambiri-Habe Bouta ! ! Djo!ndo ! Aoure Faou D O U E N T Z A ! ! ! ! Hanguirde ! Gathi-Loumo ! Oualo Kersani ! Tambeni ! Deri Yogoro ! Handane ! Modioko Dari ! Herao ! Korientzé ! Kanfa Beria G A O Fraction Sormon Youwarou ! Ourou! hama ! ! ! ! ! Guidio-Saré Tiecourare ! Tondibango Kadigui ! Bore-Maures ! Tanal ! Diona Boumbanke Y O U W A R O U ! ! ! ! Kiri Bilanto ! ! Nampala ! Banguita ! bo Sendegué Degue -Dé Hombori Seydou Daka ! o Gamni! d ! la Fraction Sanango a Kikara Na! ki ! ! Ga!na W ! ! Kelma c Go!ui a Te!ye Kadi!oure L ! Kerengo Diambara-Mouda ! Gorol-N! okara Bangou ! ! ! Dogo Gnimignama Sare Kouye ! Gafiti ! ! ! Boré Bossosso ! Ouro-Mamou ! Koby Tioguel ! Kobou Kamarama Da!llah Pringa! -

World Bank Document
PROCUREMENT PLAN (Textual Part) Project information: [Mali] [Reinsertion of Ex-Combatants Project] [P157233] Project Implementation agency: [Project Implementation Unit (PIU) of the National Disarmament, Demobilization, and Reinsertion Commission (NDDRC)] Public Disclosure Authorized Date of the Procurement Plan: [01/28/2018] Period covered by this Procurement Plan: [02/15/2018 to 07/28/2019] Preamble In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project. Public Disclosure Authorized This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP. The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP. National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables Public Disclosure Authorized in STEP), the country’s own procurement procedures may be used. When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in the [Decree No. 2015-3721 /MEF-SG dated October 22, 2015], such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations. -

Annuaire Statistique 2015 Du Secteur Développement Rural
MINISTERE DE L’AGRICULTURE REPUBLIQUE DU MALI ----------------- Un Peuple - Un But – Une Foi SECRETARIAT GENERAL ----------------- ----------------- CELLULE DE PLANIFICATION ET DE STATISTIQUE / SECTEUR DEVELOPPEMENT RURAL Annuaire Statistique 2015 du Secteur Développement Rural Juin 2016 1 LISTE DES TABLEAUX Tableau 1 : Répartition de la population par région selon le genre en 2015 ............................................................ 10 Tableau 2 : Population agricole par région selon le genre en 2015 ........................................................................ 10 Tableau 3 : Répartition de la Population agricole selon la situation de résidence par région en 2015 .............. 10 Tableau 4 : Répartition de la population agricole par tranche d'âge et par sexe en 2015 ................................. 11 Tableau 5 : Répartition de la population agricole par tranche d'âge et par Région en 2015 ...................................... 11 Tableau 6 : Population agricole par tranche d'âge et selon la situation de résidence en 2015 ............. 12 Tableau 7 : Pluviométrie décadaire enregistrée par station et par mois en 2015 ..................................................... 15 Tableau 8 : Pluviométrie décadaire enregistrée par station et par mois en 2015 (suite) ................................... 16 Tableau 9 : Pluviométrie enregistrée par mois 2015 ........................................................................................ 17 Tableau 10 : Pluviométrie enregistrée par station en 2015 et sa comparaison à -

Termes De Reference
DI 04- Contractualisation des travailleurs indépendants Annexe 01- Trame de Termes de Référence TERMES DE REFERENCE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT (BUREAU D’ETUDES) EN CHARGE D’ELABORER LES ETUDES TECHNIQUES ET LE SUIVI-CONTROLE RELATIVES À L’EXECUTION DES PROJETS INNOVANTS. Projet Accompagnement de la jeunesse et des Collectivités Projet Territoriales dans leurs Initiatives de Formation et d’insertion professionnelle « ACTIF » Pays République du Mail Région Mopti Financement Agence Française de Développement Autorité Humanité & Inclusion contractante 1. CONTEXTE Le Projet ACTIF (Accompagnement de la jeunesse et des Collectivités Territoriales dans leurs Initiatives de Formation et d’insertion professionnelle) s’inscrit dans le cadre des politiques de développement du Conseil Régional de Mopti (CRM) en lien avec son Plan Stratégique de Développement Régional (PSDR) couvrant la période 2011-2020 et le Schéma Directeur Régional de Formation Professionnelle et Technique et de l'Emploi (2018-2022) en cours d’actualisation. Le Projet, Accompagnement de la Jeunesse et des Collectivités Territoriales dans leurs Initiatives de Formation et d’insertion Professionnelle "ACTIF" est une initiative du Conseil Régional de Mopti, mis en œuvre par le consortium d’ONG Humanité & Inclusion (nouveau nom de Handicap International) et Aide- Action pour adresser la question de l’employabilité des jeunes, d’accompagnement des collectivités territoriales et de soutien au secteur de l’éducation dans la région. L’intervention du projet s’étendra sur l’ensemble des huit (8) cercles de la région et les 108 communes dans le domaine de l’appui à la maîtrise d’ouvrage des collectivités territoriales. D’une durée de quatre (04) ans (Janvier 2018 – Décembre 2021), le Projet ACTIF est Financé par l’Agence Française de Développement (AFD). -

View the PDF Document
REPUBLIQUE DU MALI - UN PEUPLE UN BUT UNE FOI - MINISTÈRE DE LA SANTÉ DIRECTION DE LA PHARMACIE ET DU MÉDICAMENT CARTOGRAPHIE ET EVALUATION APPROFONDIE DU SYSTEME D’APPROVISIONNEMENT ET DE DISTRIBUTION DES MEDICAMENTS ET AUTRES PRODUITS DE SANTE AU MALI Août 2008 1 TABLE DES MATIÈRES REMERCIEMENTS .............................................................................................................. Page 3 ACRONYMES ...................................................................................................................... Page 4 INTRODUCTION …………………………………………..………………………………………. Page 6 RÉSUMÉ .............................................................................................................................. Page 7 1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE ET ORGANISATION DU SYSTÈME DE SANTÉ .. ........ ........ ..... ....... .. ..... .. ...... ... .......... .. ......................................... ........ ..... ....... ........ Page 10 1.1. Présentation du pays..... ... ....... .. .......... .. ..... ........... ... .. ..... ... ................ .. .................... Page 10 1.2. Organisation et fonctionnement du système de santé du Mali ......... .......... .... ........ .. Page 11 1.3. Organisation et fonctionnement du secteur pharmaceutique du Mali ………………Page 12 2. OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE ....................................................... Page 15 2.1. Objectifs de l’étude................................................................................................. Page 15 2.2. Méthodologie de l’étude......................... -
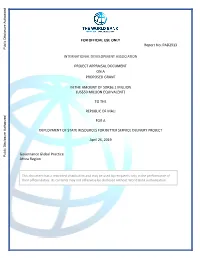
Decentralization in Mali ...54
FOR OFFICIAL USE ONLY Report No: PAD2913 Public Disclosure Authorized INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION PROJECT APPRAISAL DOCUMENT ON A PROPOSED GRANT IN THE AMOUNT OF SDR36.1 MILLION (US$50 MILLION EQUIVALENT) TO THE Public Disclosure Authorized REPUBLIC OF MALI FOR A DEPLOYMENT OF STATE RESOURCES FOR BETTER SERVICE DELIVERY PROJECT April 26, 2019 Governance Global Practice Public Disclosure Authorized Africa Region This document has a restricted distribution and may be used by recipients only in the performance of their official duties. Its contents may not otherwise be disclosed without World Bank authorization. Public Disclosure Authorized CURRENCY EQUIVALENTS (Exchange Rate Effective March 31, 2019) Currency Unit = FCFA 584.45 FCFA = US$1 1.39 US$ = SDR 1 FISCAL YEAR January 1 - December 31 Regional Vice President: Hafez M. H. Ghanem Country Director: Soukeyna Kane Senior Global Practice Director: Deborah L. Wetzel Practice Manager: Alexandre Arrobbio Task Team Leaders: Fabienne Mroczka, Christian Vang Eghoff, Tahirou Kalam SELECTED ABBREVIATIONS AND ACRONYMS AFD French Development Agency (Agence Française de Développement) ANICT National Local Government Investment Agency (Agence Nationale d’Investissement des Collectivités Territoriales) ADR Regional Development Agency (Agence Regionale de Developpement) ASA Advisory Services and Analytics ASACO Communal Health Association (Associations de Santé Communautaire) AWPB Annual Work Plans and Budget BVG Office of the Auditor General ((Bureau du Verificateur) CCC Communal Support -

Rapport Final Diagnostic Sur L'etat Des Lieux Sur L
PNE-Mali RAPPORT FINAL DIAGNOSTIC SUR L’ETAT DES LIEUX SUR L’EXISTENCE ET LA FONCTIONNALITE DES CONVENTIONS DE GESTION DES RESSOURCES NATURELLES DANS LES COMMUNES/VILLAGES DE : OUROUBE-DOUDE, KOUBAYE, TOGUE-MOURARI, OURO-MODI, SALSALBE, TOGORO-KOTIA, DIALLOUBE, TOGUERE-COUMBE, DEBOYE, KOROMBANA, SOYE, KOMI, DIWAKOU ET SOCOURA DANS LA REGION DE MOPTI 1 Cofinancement: Octobre 2013 Rapport diagnostic provisoire 04102013 CLGRN Projet MYP/PASAGE Sommaire : …………………………………………………………….….………………… 2 I. Introduction…………………………………………………………….……………………………. 3 1.1 Objectif global ………………………………………………………………………………….……..………………. 3 1.2 Objectifs spécifiques …………………………………………………………………………………………...…… 4 1.3 Déroulement des enquêtes ………………………………………………….………..……………………….…4 1.4 Méthodologie des enquêtes ……………………………………………………………….……………………4 II. Analyse des résultats des enquêtes de terrain ……………………………………… 5 2.1 Identification des Ressources disponibles …………………………….…………………………………. 5 2.2 Mode de gestion des Ressources naturelles …………………………….……………………………… 6 2.3 Les conventions locales de gestion des ressources des communes enquêtées………... 7 III. Analyse de la fonctionnalité des Conventions locales identifiés ……..…… 7 3.1 Historique des conventions locales au Mali …………………………………………….………..………7 3.2 Définition d’une convention locale ……………………………………………………...……….…….……9 3.3 Objectif d’une convention locale …………………………………………………….………………...…..…9 3.4 Typologie des conventions locales diagnostiquées ……………………………………………..……9 3.5 Forces ……………………………………………………………………………………….…………………..…….10 3.6 Faiblesses