Evaluation Environnementale Strategique
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
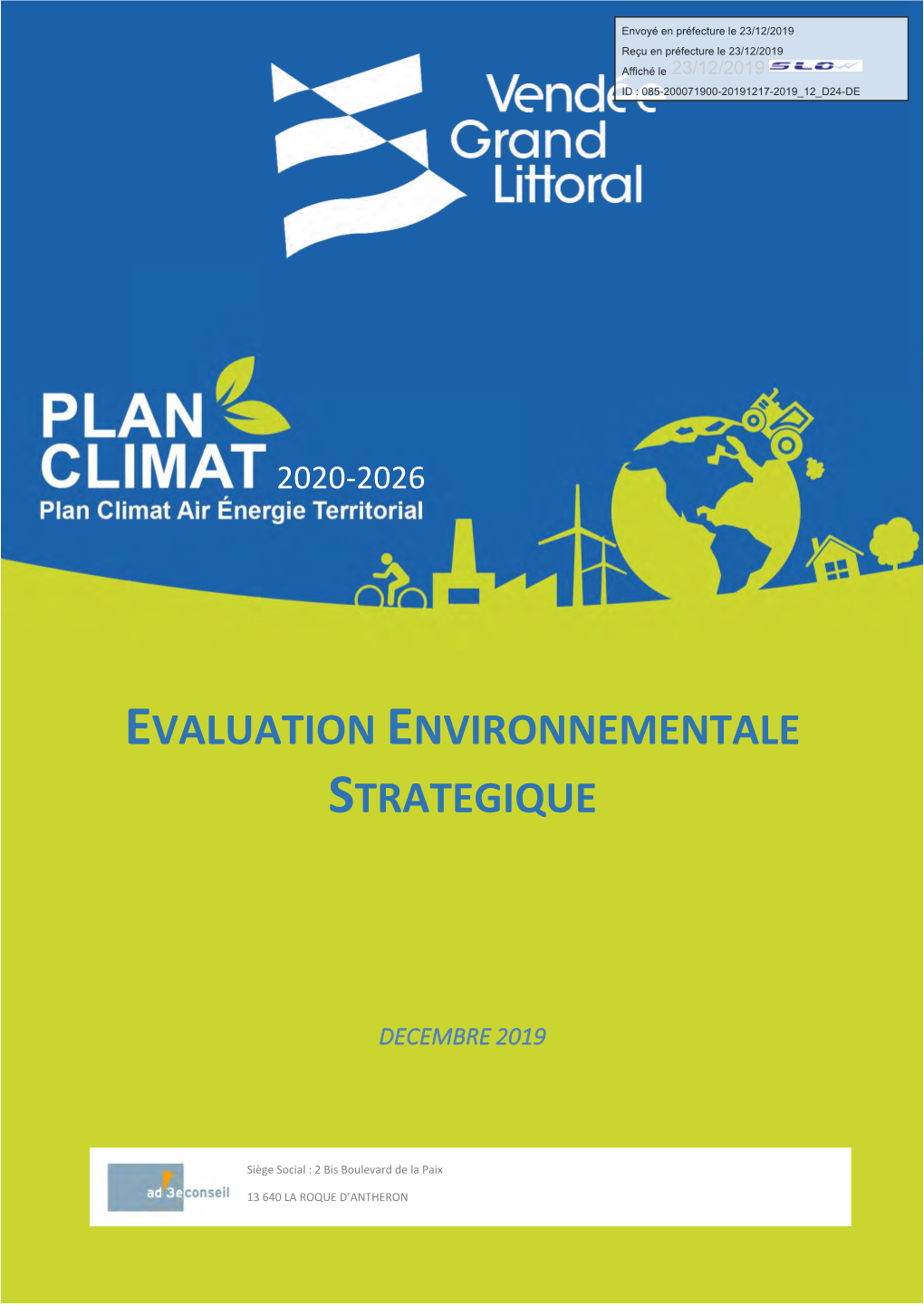
Load more
Recommended publications
-

Lieux De Permanence Des Conciliateurs De
Lieux de permanence des conciliateurs de justice LIEU DE PERMANENCE PERMANENCE COMMUNES RATTACHÉES CONCILIATEUR Beauvoir-sur-Mer Mairie : Place de l’Hôtel de Ville - 85230 Beauvoir sur Bouin Mer 1er et 3ème mercredi du mois sur rendez-vous Saint-Gervais Michel DU BOISGUEHENEUC 14h00-17h00 Saint-Urbain Contact : 02.51.68.70.32 Brétignolles-sur-Mer Mairie : Avenue de Verdun - 85470 Brétignolles sur Mer 3ème mercredi du mois sur rendez-vous Brem-sur-Mer Michelle AUGER 08h30-12h30 Contact : 02.51.55.79.79 Challans Bois-de-Céné Mairie Service « Vie Sociale » 1er mardi, 1er mercredi et 1er jeudi du mois sur Châteauneuf 1 Boulevard Lucien Dodin – 85300 Challans rendez-vous Froidfond Jean-Claude THAREAU 09h-12h00 / 13h45-17h00 La Garnache Contact : 02.51.60.02.10 Sallertaine [email protected] Landevieille Coëx 2ème lundi du mois sur rendez-vous L’Aiguillon-sur-Vie Mairie : 9 rue Jean Mermoz – 85220 Coëx 09h00-12h00 La Chaize-Giraud Michel-Jacques PESSON 2ème vendredi du mois sur rendez-vous Saint-Révérend Contact : 07.82.25.42.58 18h00-20h00 Martinet La Chapelle-Hermier Commequiers Saint-Maixent-sur-Vie Mairie : Place du 8 mai – 85220 Commequiers 2ème mercredi du mois sur rendez-vous Notre-Dame-de-Riez Michel-Jacques PESSON 14h00-18h00 Soullans Contact : 07.82.25.42.58 Ile d'Yeu CCAS 38 rue du Puits neuf - 85350 L’Ile d’Yeu Deux jours par mois sur rendez-vous Jacques ARNAULT Se renseigner auprès de la mairie ou du CCAS Contact mairie : 02.51.59.45.45 Contact CCAS : 02.28.12.91.36 La Tranche-sur-Mer 1er et 3ème lundi du mois sur rendez-vous -

Le Jardin Aux 1001 Sens
Retrouvez toutes les informations pratiques sur notre site internet www.potagerextraordinaire.com HORAIRES 2018 DU 1ER JUILLET AU 31 OCTOBRE 1er JUILLET au 2 SEPTEMBRE : tous les jours 10h - 19h UN PARCOURS SENSORIEL, 3 SEPTEMBRE au 15 OCTOBRE : jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi 14h - 18h30 18 OCTOBRE au 31 OCTOBRE : UNE EXPÉRIENCE UNIQUE À VIVRE EN VENDÉE tous les jours 14h - 18h30 Goûtez, touchez, sentez la nature comme vous ne l’avez 6 et 8 OCTOBRE : jamais fait auparavant. Fermeture exceptionnelle Découvrez des plantes extraordinaires, arpentez des espaces uniques pensés pour mettre la nature en valeur et tarifs d’entrée participez à des ateliers ludiques et étonnants. TARIFS Adultes Enfants Réduit Carte Famille individuels 5-17 ans fidélité (2 adult. + 2 enf.) Aménagé autour de 12 jardins thématiques, Le Potager 1er JUIL. Extraordinaire met en lumière plus de 1500 curiosités au 30 SEPT. 7,50 € 4 € 7 € 21 € végétales chaque année. La myriade de couleurs et de 13 € formes captivera petits et grands, amateurs comme le 1er au 31 OCT. 6,50 € 3,50 € 6 € 19 € plus aguerri venus à la rencontre de l’insolite. Le tunnel Tarifs adaptés en fonction des groupes : nous contacter. des gourdes, dernière collection labellisée de France, en Groupes scolaires : des ateliers pédagogiques sont proposés. est le plus bel exemple ! Réservation auprès de La Cicadelle au 02 51 34 72 57 Nos partenaires : Visit this unique garden, where you will find around 1500 plants. Some are exotic, some tropical, and some are very strange. A plant which tastes of oysters, another smells of de Calliopé, Shutterstock. -

Communes Actionnaires Mise À Jour Janvier 2017
Communes actionnaires Mise à jour janvier 2017 Cugand Noirmoutier en l'Ile La Bernardière Bouin La Bruffière L'Epine St Hilaire de Loulay Tiffauges St Philbert de Bouaine La Guérinière Treize Septiers St Aubin des Ormeaux Barbâtre Montaigu St Martin des Tilleuls Mortagne sur Sèvre Boufféré La Guyonnière Bois de Cené Les Landes Genusson La Verrie St Gervais St Laurent sur Sèvre Beauvoir sur Mer La Boissière de Montaigu Châteauneuf Rocheservière St Georges La Gaubretière de Montaigu St Malo du Bois Mallièvre Treize Vents La Garnache L'Herbergement Bazoges en Paillers St Urbain Chambretaud Montréverd La Barre de Monts Les Brouzils Chavagnes en Paillers Beaurepaire Les Epesses Sallertaine Froidfond Falleron Grand'Landes Les Lucs sur Boulogne La Rabatelière Les Herbiers Notre Dame de Monts La Copechagnière Challans St Fulgent St Mars la Réorthe St Etienne du Bois St Denis la Chevasse Mesnard la Barotière Le Perrier St Christophe du Ligneron Chauché Soullans St André St Paul en Pareds Sèvremont St Paul Mont Penit Beaufou Goule d'Oie Vendrennes St Jean de Monts Palluau La Chapelle Palluau Ste Florence Mouchamps Le Boupère Bellevigny Boulogne St Mesmin Commequiers L'Oie Maché Essarts- Rochetrejoux Pouzauges Notre Dame de Riez en-Bocage Le Poiré sur Vie Apremont Dompierre sur Yon St Hilaire de Riez La Merlatière St Prouant Montournais L'Ile d'Yeu St Maixent sur Vie Aizenay St Maixent sur Vie St Vincent Sterlanges La Meilleraie Tillay La Genétouze Le Fenouiller St Martin des Noyers St Germain de Prinçay Monsireigne St Révérend Coëx Menomblet Mouilleron -

Bien Vivre Chez Soi Ateliers De Prévention Rencontres, Bien-Être & Partage
Bien vivre chez soi Ateliers de prévention Rencontres, bien-être & partage À partir de 60 ans Février-Juin 2021 1 Le mot du Vice-président Action sociale Il n’y a pas si longtemps que cela, le célèbre chanteur Jacques Brel bien connu des gens de notre génération se permettait de chanter : « Les vieux ne bougent plus, leurs gestes ont trop de rides leur monde est trop petit, Du lit à la fenêtre, puis du lit au fauteuil et puis du lit au lit… » C’était hier et pourtant qu’il est loin ce temps-là. Que de chemin parcouru jusqu’à l’épanouissement atteint de nos jours. © DR Quelle fantastique évolution pour ces seniors qui, après des années de dur labeur, prennent la vie à bras le corps, tout simplement pour vivre et profiter d’un temps de loisir bien mérité. En effet, et en partie grâce à la communauté de communes et son service prévention seniors, les diverses activités qui vous sont proposées, peuvent être considérées comme un outil de création du lien social et du maintien de l’autonomie puisqu’elles vont vous permettre de sortir de l’isolement, et par la même occasion de chez soi. Et c’est ainsi que jouer avec sa mémoire, réviser le code de la route, rencontrer des jeunes, prendre soin de son image, en- tretenir ses capacités physiques ou encore découvrir internet deviennent le meilleur des médicaments pour faire reculer la dépendance. Qu’il est agréable de vous voir participer. Qu’il est plaisant de Vos coordonnées sont enregistrées dans un fichier informatisé par vous sentir enthousiasmé par la préparation d’un séjour hors la Communauté de communes du Pays des Achards dans le but de de notre territoire. -

2Ème Avis Presse
Ouest-France Vendée Judiciairesetlégales Jeudi13septembre 2018 Avis de marchéspublics Viedes sociétés Procédureadaptée Marchésinférieurs à90000 €HT Syndicat Mixte VENDÉE COEUR OCÉAN Réalisationd'auditsénergétiquesetDPE Constructionde6logements MAD, ruedel'Auzance Sociétéd'avocats 301, rue du Maréchal-Ferrant 2, rue Maurice-Edgar-Coindreau après travaux de l'ensemble du patrimoine àSaint-Georges-de-Pointindoux BP 20 BP 382 de Maine-et-Loire Habitat, accord-cadre 2ans 85440TALMONT-SAINT-HILAIRE 85010LAROCHE-SUR-YONcedex PROCÉDURE ADAPTÉE Schéma de cohérence territoriale GLC PROCÉDURE ADAPTÉE 1. Pouvoiradjudicateur :Vendée Habitat,CS60045,85002 La Roche-sur-Yon Sociétéàresponsabilitélimitée Maine-et-LoireHabitat,M.LaurentColobert,directeur général,11, rue du Clon, cedex, 28,rue Benjamin-Franklin, tél. 02 51 09 85 85. Établissementpublic territorial àactivité de logement et de développementcol- 2E AVIS Au capitalde5000 euros CS 70146, 49001Angers01. Tél. 02 41 81 68 00. Siège social : Réhabilitationde4logements individuels, Référenceacheteur:1-18S0101. lectif (7). D’ENQUÊTEPUBLIQUE Pouvoiradjudicateuragissantpourson compte. 97,rue du Président-de-Gaulle lotissementdes Buttes(Tr 0402), L'avisimpliqueunmarchépublic. Pararrêtén°2018-02duprésident du 85000 LA ROCHE-SUR-YON Objet:réalisationd'auditsénergétiquesetDPE aprèstravaux de l'ensemble du Personne habilitéeàsigner :Mme le Directeur général ou sonreprésentant. Faveraye-Machelles 2. Cadreinternational SyndicatMixte Vendée CoeurOcéan en patrimoine de Maine-et-LoireHabitat,accord-cadre2ans. -

BM St Julien 2021-12-12-20.Indd
COMMUNE ATTRACTIVE BULLETIN MUNICIPAL 2 2 0 2 1 1 3 4 5 6 Les beaux chemins de notre commune Saurez-vous reconnaître les chemins de St Julien que vous avez pu emprunter lors de vos promenades ? 7 4 - Chemin de La Baudrière. 5 - Chemin derrière la zone artisanale qui mène au village des Suries. 6 - Chemin de Lande d’Homme. 7 - Chemin des Mocquillons. des Chemin - 7 d’Homme. Lande de Chemin - 6 Suries. des village au mène qui artisanale zone la derrière Chemin - 5 Baudrière. La de Chemin - 4 1 - Chemin de La Richard. 2 - Chemin entre la route de La Chaize-Giraud et la rue du Lac. 3 - Chemin qui mène du chemin des Mocquillons au lotissement de La Bassetière. Bassetière. La de lotissement au Mocquillons des chemin du mène qui Chemin - 3 Lac. du rue la et Chaize-Giraud La de route la entre Chemin - 2 Richard. La de Chemin - 1 mer… mer… s de la s de la La nature à deux pa La nature à deux pa www.stjuliendeslandes.fr www.stjuliendeslandes.fr VIE MUNICIPALE CARNET D’ADRESSES Nom de l’association Président Page T é l . fi x e Tel. portable e-mail et/ou organisme et/ou Référent Nouvelle équipe ASSOCIATIONS SPORTIVES 21 Badminton Club de St Julien des Landes Sophie COUSINEAU 06.03.16.20.27 [email protected] Joël BRET, 21 Entente Sportive St Julien Vairé Basket Emilie MERIEAU 06.84.53.60.08 [email protected] Bruno VOYER 02.51.46.68.41 06.88.77.39.19 [email protected] Maire 20 Football Club St Julien Vairé Serge MIGNÉ 06.40.11.86.70 [email protected] 20 Gymnastique Volontaire Jeanine PIVETEAU 02.51.46.66.92 07.81.75.59.62 [email protected] 21 Tennis Club Landais Gaëtan GODET 06.12.84.00.89 [email protected] Aurélien FOUQUET 06.10.02.00.01 [email protected] 20 US Tennis de Table Les Achards Adjoints Stéphanie BOURMAUD 06.76.39.83.38 ASSOCIATIONS FAMILLES ET LOISIRS Comité d’animation Benoit MORNET 06.24.72.03.44 24 Responsable matériel Pascal COLVRAY 0 6 . -

Communes Electeurs Emplacements D'affichage Grandes Affiches Petites
QUANTITES DE DOCUMENTS DE PROPAGANDE SUSCEPTIBLES D'ETRE PRISES EN CHARGE PAR L'ETAT Communes Electeurs Emplacements Quantités de documents de propagande par tour de scrutin d'affichage Grandes Petites Bulletins de Circulaires affiches affiches vote Les Achards 3 837 2 4 4 4 029 8 441 L'Aiguillon-sur-Mer 1 825 2 4 4 1 916 4 015 L'Aiguillon-sur-Vie 1 561 2 4 4 1 639 3 434 Aizenay 7 137 4 8 8 7 494 15 701 Angles 2 552 3 6 6 2 680 5 614 Antigny 765 1 2 2 803 1 683 Apremont 1 221 1 2 2 1 282 2 686 Aubigny-Les Clouzeaux 5 107 4 8 8 5 362 11 235 Auchay-sur-Vendée 857 2 4 4 900 1 885 Avrillé 1 080 1 2 2 1 134 2 376 Barbâtre 1 500 3 6 6 1 575 3 300 La Barre-de-Monts 1 904 4 8 8 1 999 4 189 Bazoges-en-Paillers 913 1 2 2 959 2 009 Bazoges-en-Pareds 849 1 2 2 891 1 868 Beaufou 1 113 1 2 2 1 169 2 449 Beaulieu-sous-la-Roche 1 635 2 4 4 1 717 3 597 Beaurepaire 1 692 2 4 4 1 777 3 722 Beauvoir-sur-Mer 3 321 2 4 4 3 487 7 306 Bellevigny 4 540 5 10 10 4 767 9 988 Benet 3 040 5 10 10 3 192 6 688 La Bernardière 1 290 1 2 2 1 355 2 838 Le Bernard 1 015 1 2 2 1 066 2 233 Bois-de-Céné 1 503 1 2 2 1 578 3 307 La Boissière-de-Montaigu 1 725 2 4 4 1 811 3 795 La Boissière-des-Landes 1 044 1 2 2 1 096 2 297 Bouin 1 747 3 6 6 1 834 3 843 Le Boupère 2 376 2 4 4 2 495 5 227 Bournezeau 2 391 2 4 4 2 511 5 260 Brem-sur-Mer 2 297 3 6 6 2 412 5 053 Bretignolles-sur-Mer 4 423 2 4 4 4 644 9 731 Les Brouzils 2 117 2 4 4 2 223 4 657 La Bruffière 2 932 3 6 6 3 079 6 450 La Caillère-Saint-Hilaire 805 2 4 4 845 1 771 Chaillé-les-Marais 1 335 5 10 10 1 402 2 937 La Chaize-Giraud -

Recueil Des Actes Administratifs Juillet a Septembre 2020
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS JUILLET A SEPTEMBRE 2020 Conformément aux dispositions de l’article L.5211 – 47 du Code Général des Collectivités Territoriales, la Communauté de Communes du Pays des Achards édite un Recueil des Actes Administratifs. Ce recueil rassemble les actes à caractère réglementaire pris par l’assemblée délibérante et par les organes exécutifs à savoir les délibérations prises par le conseil communautaire, les arrêtés et décisions du Président. SOMMAIRE : Décisions du Président – Juillet 2020 Pages 2 à 24 Délibérations du Conseil Communautaire – 22 juillet 2020 Pages 25 à 49 Décisions du Président – Août 2020 Pages 50 à 56 Décisions du Président – Septembre 2020 Pages 57 à 64 Délibérations du Conseil Communautaire – 23 sept 2020 Pages 65 à 87 1 DECISIONS DU PRESIDENT – JUILLET 2020 Décision CONVENTION AVEC L’ARBRE A PLUMES RGLT_20_441_D146 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 5211-9 et L 5211-10, Vu la délibération n°RGLT_20_325_076 du Conseil Communautaire du 3 juin 2020 portant délégation de pouvoirs à M. Patrice Pageaud, Président. DECIDE : Article 1er : d’approuver la convention avec L’Arbre à Plumes pour un atelier origami encadré par Laëtitia BERLIOZ le 12 août 2020 ; dans le cadre des Jaunay’Scapades pour un montant de 150 €. Article 2 : La présente décision sera communiquée au Conseil Communautaire lors de sa séance la plus proche et inscrite au registre des décisions de la Communauté de communes. Une publicité sera faite dans les formes requises pour les délibérations -

DGF) Des Communes De Vendée Année 2020
Dotation globale de fonctionnement (DGF) des communes de Vendée Année 2020 Cugand Noirmoutier- en-l'île La Bernardière L'Épine St-Philbert- La Bruffière La Guérinière Bouin de-Bouaine Treize- Septiers Tiffauges St-Aubin- des-Ormeaux MORTAGNE Barbâtre MONTAIGU-VENDÉE SUR SEVRE Bois-de-Cené St-Martin- Les Landes- St-Gervais des-Tilleuls Chanverrie St-Laurent- La Boissière- Genusson Beauvoir- Chateauneuf Rocheservière sur-Sèvre sur-Mer de-Montaigu L'Herbergement La Gaubretière La Garnache Bazoges- St-Malo- La Barre- St-Urbain Montréverd Chavagnes- en Paillers du-Bois Treize-Vents de-Monts Froidfond en-Paillers Sallertaine Les Brouzils Beaurepaire Mallièvre Notre-Dame- Falleron Grand' Les Lucs- St Fulgent Les Epesses de-Monts LES HERBIERS CHALLANS Landes sur-Boulogne Le Perrier La Copechagnière La Rabatelière Mesnard St-Mars- St-Christophe- St-Etienne- la Barotière la-Réorthe du-Bois St-Denis- St-André- ST-JEAN-DE-MONTS du-Ligneron Beaufou Sèvremont Soullans la-Chevasse Chauché Goule-d'Oie St-Paul- St-Paul-Mt-Penit Palluau Vendrennes en-Pareds Bellevigny Commequiers La Chapelle-Palluau St-Mesmin Maché Essarts en Bocage Mouchamps Port Joinville Notre-Dame- Le Poiré-sur-Vie de-Riez Apremont Rochetrejoux Le Boupère Pouzauges ST-HILAIRE- Dompierre- DE-RIEZ St-Maixent- AIZENAY sur-Yon La Merlatière L'ILE-D'YEU sur-Vie Le Fenouiller St-Vincent- St-Prouant Montournais La Génétouze La Ferrière Sterlanges Monsireigne La Meilleraie-Tillay St-Révérend St-Martin-des-Noyers St-Germain- St-Gilles- Coëx Mouilleron-le-Captif de-Princay Croix-de-Vie Givrand -

Mfr De Vendee Une Enquête Des Maisons Familiales Rurales
MFR DE VENDEE UNE ENQUÊTE DES MAISONS FAMILIALES RURALES 7ÈME ÉDITION L’EXCELLENTE INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES SORTANT DE MFR Enquête réalisée au 1er trimestre 2021 WWW.FORMATION-ALTERNANCE-VENDEE.COM - 02 51 44 37 80 @MFRvendee MFR DE VENDÉE QUE FONT LES JEUNES 6 MOIS Un taux d’emploi très APRÈS LA SORTIE DE MFR ? supérieur à la moyenne 86,1 % Taux d’emploi des jeunes actifs, Des emplois de qualité 6 mois après la sortie de formation de MFR de Vendée Les jeunes sortant de MFR réussite en insertion professionnelle accèdent dès 6 mois à des postes correspondant à leur projet. 70 % Ensemble des apprentis * des Pays de la Loire** 88,3% 86,1% Sont à temps plein 62 % Ensemble des apprentis de France** 78,9 % 42 % 1 309 réponses sur 1 405 jeunes, Travaillent dans le secteur professionel lié à leur formation sortis d’une formation en MFR en Jeunes sortant du lycée pro** juin 2020, soit 93,2 % de taux de **Source DEPP : Direction de l’Évaluation de la Prospective et de la Performance, note d’information N°21.06 – février réponse. 58 % 2021 - jeunes sortis en juin 2019. *enquête insertion 2021 des jeunes Sont en CDI : Le taux d’emploi des sortis de formations MFR en 2020 jeunes actifs est calculé sur la Les MFR, un tremplin vers somme des jeunes qui sont en l’emploi et les formations supérieures emploi et de ceux qui cherchent un emploi. Ceux qui sont en formation 6 mois après la sortie de MFR, 91,2 % des élèves poursuivent leur ne sont pas comptés dans ce cas. -

FICHE DE PRÉSENTATION ET TARIFS Les Sables-D’Olonne
FICHE DE PRÉSENTATION ET TARIFS Les Sables-d’Olonne SERVICES À LA PERSONNE TARIFS APPLICABLES AU 4 NOVEMBRE 2020 Votre référent : Jean-Charles ROTIVAL Horaires d’ouverture : Adresse : 2 route du Château d’Olonne du lundi au vendredi : 9h30-12h30 / 85100 Les Sables-d’Olonne 14h-18h Tél. : 02 51 32 54 60 Transports : email : [email protected] Bus D, Arrêt : Bon Coin Site web : www.apef.fr Bus E, Arrêt : Loti Structure Déclarée / Agréée / Autorisée(1) : SAP882098320 Plan d’accès : Organigramme : GÉRANT Jean-Charles ROTIVAL Intervenants à domicile ZONE D’INTERVENTION : Olonne-sur-Mer, Talmont-Saint-Hilaire, Bretignolles- sur-Mer, Les Achards, Château-d’Olonne, Talmont- Saint-Hilaire, L’Île-d’Olonne, Les Sables-d’Olonne, Longeville-sur-Mer, Sainte-Foy, Jard-sur-Mer, Coëx, Brem-sur-Mer, Saint-Mathurin, Givrand, Vairé, Avrillé, L’Aiguillon-sur-Vie, Saint-Hilaire-la-Forêt, Grosbreuil, Landevieille, Poiroux, La Chapelle-Hermier, Le Bernard, La Chaize-Giraud, Saint-Julien-des-Landes, Saint-Vincent-sur-Jard. LISTE DES PARTENARIATS ET CONVENTIONNEMENTS : Conseil départemental de la Vendée, Inter Mutuelles Assistance, Bien-Etre Assistance, Axa assistance, April Assistance, Domiserve, Domplus, Europ Assistance (Téléassistance), Indépendance Royale (Equipements de maintien à domicile), Réseau gérontologique local, Travailleurs sociaux, Caisses de retraites et mutuelles diverses. (1) Conseil départemental de Vendée : 40 Rue du Maréchal Foch, 85000 La Roche-sur-Yon DIRECCTE Rue du 93E Régiment d’Infanterie, 85000 La Roche-sur-Yon INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : • Le client peut bénéficier d’un crédit d’impôts de 50% des sommes engagées, hors paiement en espèces, selon la législation en vigueur. Article 199 sexdecies du Code Général des Impôts. -

Soutien À Domicile - Annuaire De La Commune De ANGLES (Territoire D'action Sociale – LITTORAL)
Vendée Grand Littoral Soutien à domicile - Annuaire de la Commune de ANGLES (Territoire d'action sociale – LITTORAL) ACCUEIL ET INFORMATION CCAS D'ANGLES (Centre Communal/Intercommunal d'Action Sociale) Adresse : 5 rue de la Garde 85750 Angles France ; tél : 02 51 97 52 24 ; @ : [email protected] MDSF MOUTIERS LES MAUXFAITS (Maison Départementale des Solidarités et de la Famille) Adresse : 6 place St Jacques 85540 Moutiers-les-Mauxfaits ; tél : 02.28.85.76.30 ; @ : [email protected] INTERVENTION D'UNE AIDE AUX TÂCHES DOMESTIQUES / AIDE À LA PERSONNE => Informations détaillées : www.vendee-senior.fr/Services-d-aide-Etablissements/Annuaire-des-services-d-aide-a-domicile TÉLÉALARME/TÉLÉASSISTANCCE => Informations détaillées : www.vendee-senior.fr/Soutien-a-domicile/TELEALARME-TELEASSISTANCE SOINS À DOMICILE (SUR PRESCRIPTION MÉDICALE) ADMR CSI DE ANGLES - CSI (Centre de soins infirmiers) Adresse : 5 Rue de l'Avenir La Dugeonnière 2 - 85750 Angles France ; tél : 02 51 97 55 32 ; @ : [email protected] Contact : Maryline SICARD, Infirmière Responsable ; Commentaires : Pansements, soins d'hygiène, injection, prise de sang, nutrition parentérale ou entérale, pilulier SSIAD ADMR MOUTIERS LES MAUXFAITS (Service de Soins Infirmiers à Domicile) Adresse : ZONE ACTIVITES DE LA POIRAUDIERE, 85540 MOUTIERS LES MAUXFAITS ; tél : 02 51 98 99 57 Commentaires : Soins d'hygiène, aide à la toilette, aide au lever, aide au coucher, aide à l'habillage, observance du traitement HAD VENDÉE (Hospitalisation à Domicile) Adresse : Boulevard Stephane Moreau