Le Trièves-Résistant
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
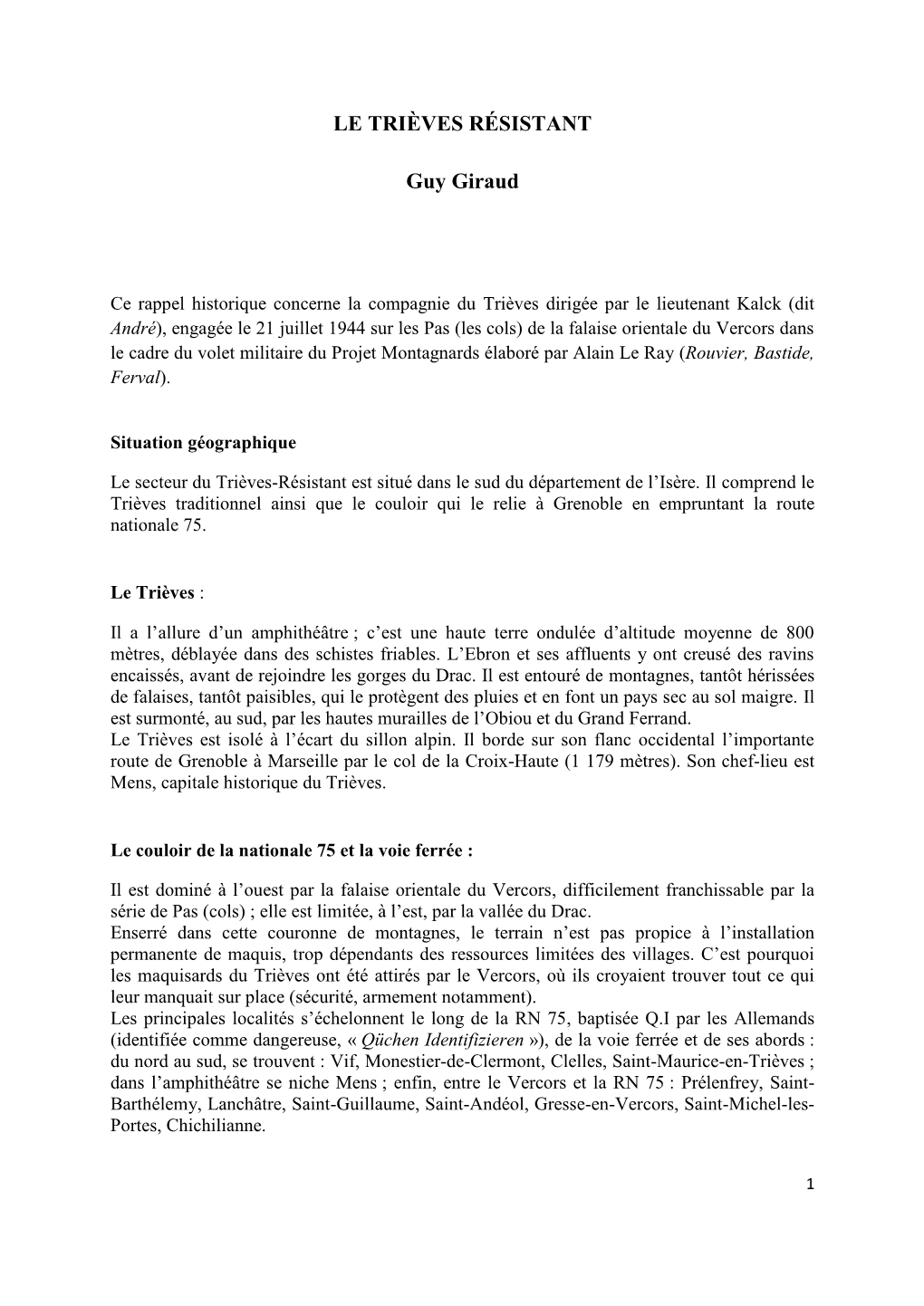
Load more
Recommended publications
-

Archives Départementales De L'isère
Archives départementales de l’Isère Archives du château du Pin 8 J Répertoire numérique détaillé par Elisabeth Rabut conservateur Archives départementales1972 de l’Isère Archives départementales de l’Isère 8 J – Fonds du Château du Pin Le don fait aux Archives de l’Isère en 1946 par le comte Alain du Parc Locmaria ne comprend pas l’ensemble des archives du château du Pin1, dont il était propriétaire du chef de sa mère2, mais celles des familles auxquelles cette demeure a appartenu aux XVIIe et XVIIIe siècles. Ce fonds est constitué pour l’essentiel d’actes et documents provenant de la famille Vincent, dont l’un des membres, Antoine Vincent, avait acquis le château du Pin dans la vente des biens de l’hoirie d’André Basset, seigneur de Saint-Nazaire, en 1646 ; son fils Jean de Vincent, auquel il l’avait donné lors de son mariage en 16633, le fit reconstruire à partir de 1670. A côté de l’éclairage qu’il apporte sur l’histoire de la famille Vincent, l’extension progressive de ses biens dans la région de Montferrat, Paladru, La Buisse, La Tour-du-Pin, son ascension sociale – Guillaume Vincent Merlin est marchand de Montferrat, son petit-fils Antoine, secrétaire au Parlement4, est anobli en 16535, et Jean de Vincent conforte l’insertion de cette famille dans la noblesse de robe par l’achat en 1649 d’un office de trésorier général de France en Dauphiné6, ce fonds est d’un intérêt premier pour les papiers de fonction qu’il contient : recette des décimes du diocèse de Grenoble, activité d’un trésorier général de France en Dauphiné dans la seconde moitié du XVIIe siècle. -

3B2 to Ps Tmp 1..94
1975L0271 — DE — 01.05.1993 — 012.001 — 1 Dieses Dokument ist lediglich eine Dokumentationsquelle, für deren Richtigkeit die Organe der Gemeinschaften keine Gewähr übernehmen ►B RICHTLINIE DES RATES vom 28. April 1975 betreffend das Gemeinschaftsverzeichnis der benachteiligten landwirtschaftlichen Gebiete im Sinne der Richtlinie 75/268/EWG (Frankreich) (75/271/EWG) (ABl. L 128 vom 19.5.1975, S. 33) Geändert durch: Amtsblatt Nr. Seite Datum ►M1 Richtlinie 76/401/EWG des Rates vom 6. April 1976 L 108 22 26.4.1976 ►M2 Richtlinie 77/178/EWG des Rates vom 14. Februar 1977 L 58 22 3.3.1977 ►M3 Entscheidung 77/3/EWG der Kommission vom 13. Dezember 1976 L 3 12 5.1.1977 ►M4 Entscheidung 78/863/EWG der Kommission vom 9. Oktober 1978 L 297 19 24.10.1978 ►M5 Entscheidung 81/408/EWG der Kommission vom 22. April 1981 L 156 56 15.6.1981 ►M6 Entscheidung 83/121/EWG der Kommission vom 16. März 1983 L 79 42 25.3.1983 ►M7 Entscheidung 84/266/EWG der Kommission vom 8. Mai 1984 L 131 46 17.5.1984 ►M8 Entscheidung 85/138/EWG der Kommission vom 29. Januar 1985 L 51 43 21.2.1985 ►M9 Entscheidung 85/599/EWG der Kommission vom 12. Dezember 1985 L 373 46 31.12.1985 ►M10 Entscheidung 86/129/EWG der Kommission vom 11. März 1986 L 101 32 17.4.1986 ►M11 Entscheidung 87/348/EWG der Kommission vom 11. Juni 1987 L 189 35 9.7.1987 ►M12 Entscheidung 89/565/EWG der Kommission vom 16. -

Le Bilan De La Concertation
01 SOMMAIRE Introduction générale .............................................................................. 3 Le projet d’aménagements proposé par le Département .................... 4 a) Les grandes caractéristiques du projet .......................................................................... 4 b) Les aménagements proposés ......................................................................................... 6 c) Un projet d’aménagement soumis à concertation afin d’associer les acteurs du territoire à la réflexion........................................................................................................... 9 Objectifs, périmètre et modalités de la concertation préalable ........ 10 a) Les objectifs de la concertation préalable.................................................................... 10 b) Les modalités et le périmètre de la concertation préalable ......................................... 10 Le dispositif mis en place lors de la concertation ............................. 11 a) Le dispositif d’annonce de la concertation .................................................................. 11 b) Le dispositif d’information ............................................................................................ 15 c) Le dispositif de participation ........................................................................................ 17 Synthèse quantitative des expressions du public ............................. 20 a) Chiffres clés de la participation ................................................................................... -

Mont Ventoux Givors
7 D307 15 D30 la Verpillière 6 D1516 Marcieux St-Symphorien-d'Ozon l'Isle-d'Abeau Montcarra D1075 Chazelles- Mornant A43 St-Genis- sur-Lyon St-Symphorien- Grigny A46 Villefontaine E70 7 la Bâtie- Aoste sur-Coise la Tour- Montgascon sur-Guiers 9 Diémoz 8 8 11 St-Galmier Cessieu du-Pin E70 10 GIVORS D75 Bourgoin- A43 Grammond A47 la Septème Nivolas- D1006 Veauche E70 Loire-sur-Rhône D518 Jallieu Bridoire Fontanès 9 D502 Vermelle 11 D386 les Abrets le Pont-de- Rive-de-Gier Vienne Estrablin Moidieu- St-Jean- D1085 la Bâtie- Beauvoisin St-Romain-en-Gal Badinières re 12 Détourbe de-Bournay rb Divisin St- St-Héand Grange-Neuve ou 10 D41 Eclose B RHÔNE la Rosière D502 Châtonnay Virieu Montferrat Béron A72 la Grand- 11 Jardin Gervonde Biol Paladru 14 St-Bueil E70 la Talaudière Croix D386 D41B Eyzin-Pinet D518 e A48 le Pin 10 D1498 n St-Geoire- D1006 16 Condrieu ô Côte d'Eyzin-Pinet Champier Châbons 12 St-Chamond h A7 D538 E711 en-Valdaine R e Roche- 15 les Roches-de-Condrieu E15 les Côtes- Varèz Semons Eydoche D1075 les Echelles LOIRE d'Arey Cour-et-Buis Charavines la-Molière 17 le Grand- Chirens D1086 Monsteroux- Côte de Primarette St-Laurent- Cheyssieu D1085 Lemps du-Pont le Chambon- St-Etienne t Pélussin Milieu l a Primarette 9 Feugerolles i la Frette N88 P la Côte- la Frette t St-Maurice-l'Exil l'Embranchement Voiron n Pisieu ISÈRE St-Joseph- o St-André D520 M D71 D119 de-Rivière D1082 le Péage-de-Roussillon Roussillon Pact Pajay Rives Firminy le Bessat Marcilloles 10 la Buisse St-Appolinard Salaise-sur-Sanne Beaurepaire D519 Brézins St-Etienne- -

Compte-Rendu Du 05 Mars 201896.26 Ko
CONSEIL DE COMMUNAUTE Communauté de Communes du Du 5 mars 2018 Trièves Compte-rendu Sous réserve de validation en séance le 9 avril 2018 Béatrice Vial est désignée secrétaire de séance. Approbation du compte rendu du conseil du 29 janvier 2018 F 2 abstentions 1- Déploiement du Très Haut Débit dans le Trièves – Présentation effectuée par Damien Michallet, Vice-président délégué à l’aménagement numérique et aux systèmes d’informations en présence d’Eric Menduni et Alexia Marcus du Département de l’Isère Monsieur Michallet rappelle l’investissement du Département en faveur du déploiement de la fibre optique pour l’intégralité de l’Isère. Ainsi, une direction dédiée au Très Haut Débit composée de 14 personnes a été créée en octobre 2016. Ce projet se décline en 3 lots pour sécuriser les appels d’offres et minorer les risques. Il présente le panneau qui sera installé et le logo « Isère THB le Très Haut Débit pour tous ». L’installation du réseau THD est rendue complexe par d’importants délais liés aux prés-requis ; de nombreux travaux sont nécessaires en amont. En effet, il convient de constituer le réseau structurant, puis les nœuds de raccordement optiques (NRO) et ensuite la desserte (entre 12 et 15 mois). 108 NRO sont prévus dans l’Isère dont 4 dans le Trièves. Les NRO constituent le pivot de la construction du réseau ; sans eux, le déploiement de la fibre est impossible. Une DSP a été signée avec Isère Fibre (SFR collectivités) en avril 2016 pour une durée de maintenance du réseau de 25 ans. Leur rôle est de commercialiser le réseau. -

Arrêté Préfectoral N°DREAL-2016
PRÉFET DE L’ISÈRE Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes Unité départementale de l'Isère Pôle Climat Air Énergie (PRICAE) Grenoble, le 26 mai 2016 Arrêté préfectoral n°DREAL-2016 relatif à la mise en œuvre de la mesure 11 du plan de protection de l’atmosphère (PPA) de la région grenobloise : conformité des installations de combustion individuelles utilisant de la biomasse et mises en service dans les communes du périmètre du PPA Le Préfet de l'Isère Chevalier de la Légion d'Honneur Chevalier de l'Ordre National du Mérite Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L.222-4 à L.222-7, et R.222-13 à R.222-36 ; Vu l’arrêté inter-préfectoral n°2014056-0035 du 25 février 2014 approuvant le projet de révision du plan de protection de l’atmosphère (PPA) de la région grenobloise ; Vu le décret n°2004-374 modifié du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements et notamment son article 43 ; Vu le plan régional pour la qualité de l’air de la région Rhône-Alpes approuvé par arrêté préfectoral du 1er février 2001 ; Vu le plan de protection de l’atmosphère de la région grenobloise et particulièrement sa mesure n°11 : « Interdire l’installation d’appareils de chauffage au bois non performants sur la zone PPA » ; Vu le rapport de synthèse de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes, unité départementale de l'Isère (DREAL-UDI), du 2 février 2016 -

3B2 to Ps Tmp 1..75
1975L0271 — DA — 05.01.1977 — 003.001 — 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor ►B RÅDETS DIREKTIV af 28. april 1975 om fællesskabslisten over ugunstigt stillede landbrugsområder i henhold til direktiv 75/268/EØF (Frankrig) (75/271/EØF) (EFT L 128 af 19.5.1975, s. 33) Ændret ved: Tidende nr. side dato ►M1 Rådets direktiv 76/401/EØFaf 6. april 1976 L 108 22 26.4.1976 ►M2 Rådets direktiv 77/178/EØFaf 14. februar 1977 L 58 22 3.3.1977 ►M3 Kommissionens beslutning 77/3/EØFaf 13. december 1976 L 3 12 5.1.1977 Berigtiget ved: ►C1 Berigtigelse, EFT L 288 af 20.10.1976, s. 27 (76/401/EØF) 1975L0271 — DA — 05.01.1977 — 003.001 — 2 ▼B RÅDETS DIREKTIV af 28. april 1975 om fællesskabslisten over ugunstigt stillede landbrugsområder i henhold til direktiv 75/268/EØF (Frankrig) (75/271/EØF) RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR — under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europæiske økono- miske Fællesskab, under henvisning til Rådets direktiv 75/268/EØFaf 28. april 1975 om landbrug i bjergområder og i visse ugunstigt stillede områder (1), særlig artikel 2, stk. 2, under henvisning til forslag fra Kommissionen, under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet, under henvisning til udtalelse fra Det økonomiske og sociale Udvalg (2), og ud fra følgende betragtninger: Republikken Frankrigs regering har i henhold til artikel 2, stk. 1, i direktiv 75/268/EØFgivet Kommissionen meddelelse om de områder, der i henhold til artikel 3, stk. 3, i dette direktiv egner sig til optagelse på fællesskabslisten over ugunstigt stillede landbrugsområder, samt oplysninger om disse områders særlige kendetegn; oplysningerne om de områder, der er beliggende i oversøiske departementer, er ikke tilstrækkeligt fuldstændige til, at Kommissionen for øjeblikket kan fremsætte nogen udtalelse herom; som kendetegn for meget vanskelige klimatiske forhold i henhold til artikel 3, stk. -

3B2 to Ps Tmp 1..96
1975L0271 — EN — 14.04.1998 — 014.001 — 1 This document is meant purely as a documentation tool and the institutions do not assume any liability for its contents ►B COUNCIL DIRECTIVE of 28 April 1975 concerning the Community list of less-favoured farming areas within the meaning of Directive No 75/268/EEC (France) (75/271/EEC) (OJ L 128, 19.5.1975, p. 33) Amended by: Official Journal No page date ►M1 Council Directive 76/401/EEC of 6 April 1976 L 108 22 26.4.1976 ►M2 Council Directive 77/178/EEC of 14 February 1977 L 58 22 3.3.1977 ►M3 Commission Decision 77/3/EEC of 13 December 1976 L 3 12 5.1.1977 ►M4 Commission Decision 78/863/EEC of 9 October 1978 L 297 19 24.10.1978 ►M5 Commission Decision 81/408/EEC of 22 April 1981 L 156 56 15.6.1981 ►M6 Commission Decision 83/121/EEC of 16 March 1983 L 79 42 25.3.1983 ►M7 Commission Decision 84/266/EEC of 8 May 1984 L 131 46 17.5.1984 ►M8 Commission Decision 85/138/EEC of 29 January 1985 L 51 43 21.2.1985 ►M9 Commission Decision 85/599/EEC of 12 December 1985 L 373 46 31.12.1985 ►M10 Commission Decision 86/129/EEC of 11 March 1986 L 101 32 17.4.1986 ►M11 Commission Decision 87/348/EEC of 11 June 1987 L 189 35 9.7.1987 ►M12 Commission Decision 89/565/EEC of 16 October 1989 L 308 17 25.10.1989 ►M13 Commission Decision 93/238/EEC of 7 April 1993 L 108 134 1.5.1993 ►M14 Commission Decision 97/158/EC of 13 February 1997 L 60 64 1.3.1997 ►M15 Commission Decision 98/280/EC of 8 April 1998 L 127 29 29.4.1998 Corrected by: ►C1 Corrigendum, OJ L 288, 20.10.1976, p. -

Départ Distance Dénivelé Difficulté Mens 75,1Km +1410M Descriptif De L'itinéraire
Parcours varié, qui permet d'apprécier la beauté des paysages du Trièves coté Vercors et côté Dévoluy. En fin de parcours, le passage par le village de Tréminis et le col de Mens est splendide. Départ Distance Dénivelé Difficulté Mens 75,1km +1410m Descriptif de l'itinéraire Depuis l'Office de Tourisme de Mens, prendre direction Saint Sébastien en prenant la D66. A Saint Sébastien, suivre direction La Mure - Ponsonnas en empruntant la D227. Au pied de la descente (au croisement), prendre à gauche direction Saint Jean d'Hérans. A Saint Jean d'Hérans, tourner à droite pour prendre la D34b qui passe à Villard Touage. Au croisement de "l'Homme du Lac", tourner à droite vers Grenoble via la D34, puis vers Lavars en empruntant la D34a. A Lavars, continuer sur la D34a jusqu'au croisement avec la D526 où vous prendrez la direction de Clelles. Sur la place centrale de Clelles, tourner à gauche (D252) en direction de Longefonds. ATTENTION, il faut emprunter la RD1075 à forte circulation sur 300m, avant de basculer sur la gauche vers Longefonds. Suivre la D252 pour rejoindre Le Percy, puis Monestier du Percy et le Serre des Bayles. Continuer sur la D253a puis la D253 jusqu'à Saint Maurice en Trièves. Tourner à gauche vers Lalley (D66b), Avers (D66) puis Tréminis (D216). Grimper au sommet du Col de Mens (altitude 1 111m), puis redescendre vers Saint Baudille et Pipet et ensuite Mens en suivant la D66. Profil Tracé Le tracé de ce circuit au format gpx est en téléchargement ici: www.trieves-vercors.fr/cyclotourisme.html Services le long de l'itinéraire Dans chaque antenne de l’Office de Tourisme du Trièves (Mens et Gresse en Vercors), vous trouverez le nécessaire pour les petites réparations (outillage, pompe, rustines, BTR…). -
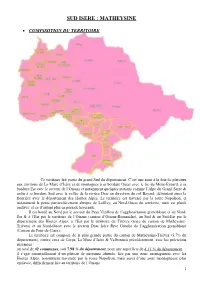
Sud Isère : MATHEYSINE Pdf 499 Ko
SUD ISERE : MATHEYSINE • COMPOSITION DU TERRITOIRE Ce territoire fait partie du grand Sud du département. C’est une zone à la fois de plateaux aux environs de La Mure d’Isère et de montagnes à sa bordure Ouest avec le lac du Mont-Eynard, à sa bordure Est avec le secteur de l’Oisans et notamment quelques stations comme l’Alpe du Grand Serre & enfin à sa bordure Sud avec la vallée de la rivière Drac en direction du col Bayard, délimitant ainsi la frontière avec le département des Hautes Alpes. Le territoire est traversé par la route Napoléon, et notamment la pente particulièrement abrupte de Laffrey, au Nord-Ouest du territoire, mais est plutôt enclavé, et ce d’autant plus en période hivernale. Il est bordé au Nord par le secteur du Pays Vizillois de l’agglomération grenobloise et au Nord- Est & à l’Est par le territoire de l’Oisans (canton d’Oisans-Romanche), au Sud & au Sud-Est par le département des Hautes Alpes, à l’Est par le territoire du Trièves (reste du canton de Matheysine- Trièves) et au Nord-Ouest avec le secteur Drac Isère Rive Gauche de l’agglomération grenobloise (Canton du Pont-de-Claix). Le territoire est composé de la plus grande partie du canton de Matheysine-Trièves (5,7% du département), contre ceux de Corps, La Mure d’Isère & Valbonnais précédemment, avec les précisions suivantes : un total de 42 communes, soit 7,98 % du département, pour une superficie de 8,11 % du département il s’agit essentiellement d’un plateau de moyenne altitude, liée par une zone montagneuse avec les Hautes Alpes, notamment traversée par la route Napoléon, mais aussi d’une zone montagneuse plus enclavée, difficilement liée au territoire de l’Oisans. -

LIVRET D'accueil Été 2020
LIVRET D'ACCUEIL ÉTÉ 2020 sports concerts animations expositions decouvertes temps forts Face aux évolutions régulièresGresse liées à la crise En sanitaire, Vercors nous vous invitons Animations à vérifier le maintien des activités ou animations. Les Temps forts de l'été... 14 juillet MARDI 14 JUILLET | GRATUIT VENEZ LÉZARDER À GRESSE-EN-VERCORS ! DU 25 JUILLET AU 8 AOÛT DE 11H À 19H30 19h15 | CONCERT On the road/Rock devant l’Office de Tourisme avec Barbecue et buvette EXPOSITION entrée LES ARTS D'ETE libre lEs arts d'ETE Du 25 juillet au 8 août de 11h à 19h30 VERNISSAGE DU 25 JUILLET AU 8 AOÛT | 11h - 19h30 Chaque samedi à 18h30 RENDEZ-VOUS à la Maison du Grand Veymont | Entrée libre maison du Grand Veymont (station de ski) LesArts d'Ete En collaboration avec Exposition d'artistes peintres régionaux organisée LA COMMUNE DE GRESSE EN VERCORS par la Commune de Gresse en Vercors et les artistes. & LES ARTISTES Plus d’infos sur www.gresse-en-vercors.com/arts_ete.htm SUr les chemIns de l'aLpaGE 21, 22 & 23 AOÛT | Gratuit Vendredi 21conférence au cinéma Samedi 22sur l’alpage de Serpaton Dimanche 23animations champêtres à la station Animations et petite restauration pot d'accueil DU 5 JUILLET AU 16 AOÛT | Office de Tourisme Gresse-en-Vercors | Gratuit RDV les dimanches à 17h dans le jardin de l’Office de Tourisme pour une présentation des animations et activités ! Les professionnels seront présents pour vous détailler l’éventail des possibilités, répondre à vos questions et prendre les inscriptions. Pour finir, un moment convivial avec cocktail rafraîchissant : chartreuse-soleil vous sera offerte à la fin du pot d’accueil (avec modération). -

Liste Des Communes Objets De La Demande De Reconnaissance En
Liste des communes objets de la demande de reconnaissance en calamité sécheresse 2018 secteur n°1 centre Isère : communes de : Allevard, Autrans-Méaudre en Vercors, Barraux, Bernin, Biviers, Bresson, Brié-et- Angonnes, Champ-sur-Drac, Champagnier, Chamrousse, Chapareillan, Château-Bernard, Châtelus, Chichilianne, Choranche, Claix, Corenc, Corrençon-en-Vercors, Coublevie, Crêts en Belledonne, Crolles, Domène, Échirolles, Engins, Entre-deux-Guiers, Eybens, Fontaine, Froges, Gières, Goncelin, Grenoble, Gresse-en-Vercors, Herbeys, Hurères, Jarrie, La Buissière, La Chapelle-du-Bard, La Combe-de-Lancey, La Ferrière, La Flachère, La Pierre, La Sure en Chartreuse, La Terrasse, La Tronche, Lans-en-Vercors, Laval, Le Champ-près-Froges, Le Cheylas, Le Gua, Le Moutaret, Le Pont-de-Claix, Le Sappey-en- Chartreuse, Le Touvet, Le Versoud, Les Adrets, Lumbin, Malleval-en-Vercors, Meylan, Miribel-Lanchâtre, Miribel-les-Échelles, Mont-Saint-Marn, Montaud, Montbonnot-Saint-Marn, Montchaboud, Murianee, Notre-Dame-de-Mésage, Pinsot, Poisat, Pont-en-Royans, Pontcharra, Presles, Proveysieux, Quaix-en-Chartreuse, Rencurel, Revel, Saint-Andéol, Saint-Aupre, Saint-Bernard, Saint-Christophe-sur- Guiers, Saint-Éenne-de-Crossey, Saint-Guillaume, Saint-Hilaire, Saint-Ismier, Saint-Jean-le-Vieux, Saint- Joseph-de-Rivière, Saint-Laurent-du-Pont, Saint-Marn-d'Hères, Saint-Marn-d'Uriage, Saint-Maximin Saint-Michel-les-Portes, Saint-Mury-Monteymond, Saint-Nazaire-les-Eymes, Saint-Nicolas-de-Macherin, Saint-Nizier-du-Moucheroe, Saint-Pancrasse, Saint-Paul-de-Varces, Saint-Pierre-d'Entremont,