Victor Hugo: Odes Et Ballades a M. Alexandre Soumet. ODE
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
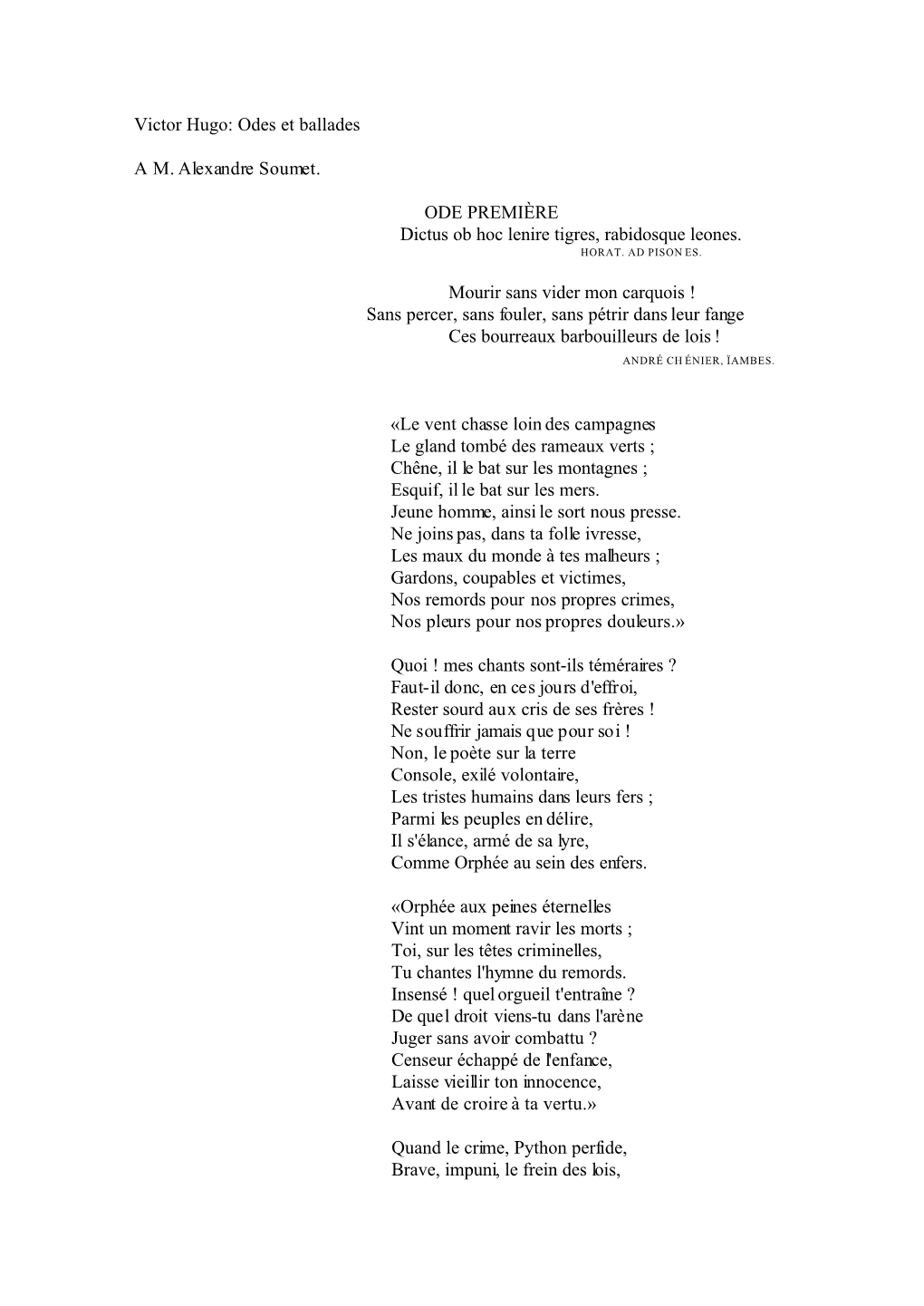
Load more
Recommended publications
-

Le Roi S'amuse Hugo, Victor
Le Roi s'amuse Hugo, Victor Publication: 1832 Catégorie(s): Fiction, Théâtre, XIXe siècle Source: http://www.ebooksgratuits.com 1 A Propos Hugo: Victor-Marie Hugo (26 February 1802 — 22 May 1885) was a French poet, novelist, playwright, essayist, visual artist, states- man, human rights campaigner, and perhaps the most influen- tial exponent of the Romantic movement in France. In France, Hugo's literary reputation rests on his poetic and dramatic out- put. Among many volumes of poetry, Les Contemplations and La Légende des siècles stand particularly high in critical es- teem, and Hugo is sometimes identified as the greatest French poet. In the English-speaking world his best-known works are often the novels Les Misérables and Notre-Dame de Paris (so- metimes translated into English as The Hunchback of Notre- Dame). Though extremely conservative in his youth, Hugo mo- ved to the political left as the decades passed; he became a passionate supporter of republicanism, and his work touches upon most of the political and social issues and artistic trends of his time. Source: Wikipedia Disponible sur Feedbooks pour Hugo: • Fantine (1862) • Cosette (1862) • Jean Valjean (1862) • Marius (1862) • Le Dernier Jour d'un condamné (1829) • Notre-Dame de Paris - 1482 (1831) • L'idylle rue Plumet et l'épopée rue Saint-Denis (1862) • La fin de Satan (1886) • Les Contemplations (1859) • Les Burgraves (1843) Note: Ce livre vous est offert par Feedbooks. http://www.feedbooks.com Il est destiné à une utilisation strictement personnelle et ne peut en aucun cas être vendu. 2 L’apparition de ce drame au théâtre a donné lieu à un acte ministériel inouï. -

1 Dictée Du 14 Janvier 2019 : Texte De Victor Hugo * Spectre
Dictée du 14 janvier 2019 : texte de Victor Hugo La monarchie de Juillet est le nom du régime politique de la France de juillet 1830 à février 1848. C'est une monarchie constitutionnelle avec pour roi Louis-Philippe Ier. Le régime politique repose sur le suffrage censitaire qui donne le pouvoir à la petite partie la plus riche de la bourgeoisie française. Hier, 22 février [1846], j'allais à la Chambre des pairs. Il faisait beau et très froid, malgré le soleil de midi. Je vis venir rue de Tournon un homme que deux soldats emmenaient. Cet homme était blond, pâle, maigre, hagard ; trente ans à peu près, un pantalon de grosse toile, les pieds nus et écorchés dans des sabots avec des linges sanglants roulés autour des chevilles pour tenir lieu de bas ; une blouse courte et souillée de boue derrière le dos, ce qui indiquait qu'il couchait habituellement sur le pavé, nu-tête et les cheveux hérissés. Il avait sous le bras un pain. Le peuple disait autour de lui qu'il avait volé ce pain et que c'était à cause de cela qu'on l'emmenait. En passant devant la caserne de gendarmerie, un des soldats y entra et l'homme resta à la porte, gardé par l'autre soldat. Une voiture était arrêtée devant la porte de la caserne. C'était une berline armoriée portant aux lanternes une couronne ducale, attelée de deux chevaux gris, deux laquais en guêtres derrière. Les glaces étaient levées mais on distinguait l'intérieur tapissé de damas bouton d'or. -

Bibliographie
BIBLIOGRAPHIE I. ŒUVRES DE VICTOR HUGO A. ŒUVRES COMPLETES 1. Éditions publiées du vivant de Victor Hugo 2. Les grandes éditions de référence. B. ŒUVRES PAR GENRES 1. Poésie Anthologies Recueils collectifs Œuvres particulières 2. Théâtre Recueils collectifs Divers Œuvres particulières 3. Romans Recueils collectifs L’Intégrale Œuvres particulières 4. Œuvres « intimes » Correspondance Journaux et carnets intimes 5. Littérature et politique Littérature Politique Divers 6. Voyages 7. Fragments et textes divers 8. Œuvre graphique II. L’HOMME ET SON ŒUVRE Études d’ensemble A. L’HOMME 1. Biographies 2. Victor Hugo et ses contemporains Ses proches Le monde artistique et littéraire 3. Aspects, événements ou épisodes de sa vie Exil Lieux familiers Politique Voyages B. L’ŒUVRE 1. Œuvre littéraire Critique et interprétation Hugo vu par des écrivains du XXe siècle Esthétique Thématique Influence, appréciation 2. Genres littéraires Poésie Récits de voyage Romans Théâtre 3. Œuvres particulières 4. Œuvre graphique, illustration I. ŒUVRES DE VICTOR HUGO A. ŒUVRES COMPLÈTES Cette rubrique présente une sélection d’éditions des œuvres complètes de Victor Hugo : d’abord celles parues du vivant de l’auteur, puis quatre éditions qui font autorité. On trouve plus loin, classées aux différents genres abordés par l’écrivain : la collection « L’Intégrale », publiée par les Éditions du Seuil (Théâtre, Romans, Poésie) et divers recueils collectifs, en particulier les « Œuvres poétiques », publiées par Gallimard dans la « Bibliothèque de la Pléiade ». 1. Éditions publiées du vivant de Victor Hugo Il ne s’agit pas d’œuvres complètes au vrai sens du terme, puisque Victor Hugo continuait à écrire au moment même de leur publication. -

Les Orientales De Hugo Y El Romancero
Les Orientales de Hugo y el Romancero José Manuel Losada Goya Universidad Complutense de Madrid No me deja de sorprender la contundencia de Víctor Hugo cuando, adelan- tándose a Flaubert, afirma que "tout a droit de cité en poésie" {Les Orientales, Préface de Védition origínale, 1992: 577). Esta sentencia es de las que sólo se deberían poder escribir sobre mármol, por utilizar la conocida frase de Gautier. En efecto, el hecho de que Yvetot nada tenga que envidiar a Constantinopla, presupone que para los románticos tanto montaba, montaba tanto, el Génesis como el Corán, Esquilo como Shakespeare, un suceso de un periódico como un nombre inusual encontrado en un viejo diccionario: lo único importante era que la obra resultante fuera buena o mala (ibid.); más allá de este campo, la labor del crítico, incurría en una injerencia imperdonable. En otros térmi- nos, en enero de 1829, Hugo preparaba lo que había de promulgar catorce meses después en su Préface d'HernanV al tiempo que reincidía —con una ligera variante— en lo que ya anunciara en su Préface de Cromwell catorce meses antes e incluso en su Préface a las Odes et poésies diverses2. En efecto, después de encararse con el arbitrario distingo de los géneros literarios, lan- zaba una auténtica carga de profundidad contra las habituales reglas: "On ne ruinerait pas moins aisément la prétendue régle des deux unités. Nous disons deux et non trois unités, l'unité d'action ou d'ensemble, la seule vraie et fondée, étant depuis longtemps hors de cause" (1985: 427-428). Era todo ello un mo- vimiento que daba prioridad, como venía haciéndose en gran medida hasta entonces, no ya al tema elegido ni a las razones que lo aconsejaban, sino más bien a la manera de tratarlo. -

Victor Hugo's Paris J-Term Course in Paris, France, 2019
Victor Hugo’s Paris J-Term course in Paris, France, 2019 (ISHU 3720) BIS Program, School of Continuing and Professional Studies December 28, 2018-January 10, 2019 Syllabus DRAFT NB: Details may change because of specialists’ availability, site openings, weather or text availability. Program Director & Instructor: Marva Barnett Professor Emeritus (formerly professor at the UVA Center for Teaching Excellence and in the Drama and French Departments) Important Contact Info Marva Barnett’s cell in France: US cell: TBA Assistant’s US cell in France: TBA “To study in Paris is to be born in Paris!” « Étudier à Paris, c’est être né à Paris! » ― Victor Hugo, Les Misérables I, 3, ii “Whoever contemplates the depths of Paris is seized with vertigo. Nothing is more fantastic, nothing is more tragic, nothing is more superb.” « Qui regarde au fond de Paris a le vertige. Rien de plus fantasque, rien de plus tragique, rien de plus superbe. » ― Victor Hugo, Introduction to Paris-Guide, Part III, 1867 “To stray is human; to saunter is Parisian.” « Errer est humain, flâner est parisien. » ― Victor Hugo, Les Misérables III, 4, i Note: To get Hugo’s joke, you need to understand the French pun. “Errer” means both “to err” and “to stray, or get lost” and “errer est humain“ is as familiar as our “to err is human.” Course Description: One might argue, as slate.fr has, that Victor Hugo is Paris. A great Romantic poet and world-renowned novelist and social-justice fighter, Victor Hugo dominated nineteenth-century Paris. Students taking this BIS-affiliated J-Term course, “Victor Hugo’s Paris” will explore the City of Lights from literary, historical, artistic, biographical and cultural perspectives. -

Dieu De Victor Hugo: Une Etude Du Nombre
TIPHAINE SAMOYAULT Ecole Normale Superieure, Paris DIEU DE VICTOR HUGO: UNE ETUDE DU NOMBRE L'inJini est une exactitude. Le proJond mot Nombre est ala base de la pensee de l'homme; il est, pour notre intelligence, element; il signifie harmonie aussi bien que mathematique. Le nombre se revele a l'art par le rhythme, qui est le battement du coeur de l'injini. Dans le rhythme, loi de l'ordre, on sent Dieu. Un vers est nombreux comme une Joule. (Hugo, William Shakespeare, I, Ill, 2) Apres la publication des Chatiments, en novembre 1853, Victor Hugo s'engage dans un immense projet de poeme metaphysique intitule dans son esprit Dieu . Le 12 avril 1856, il en a deja compose mille sept cent verso Il prevoyait la publication de l'ouvrage pour l'annee 1857 mais Hetzel, son ooiteur, l'en dissuade: il pense que la tentative, cette fois, ne correspond pas a l'horizon d'attente du public. Hugo abandonne alors provisoirement le projet. 11 ne le reprendra que partiel lement pour l'abandonner definitivement au retour de l'exil, et ce n'est qu'en 1891, six ans apres la mort de son auteur, que Hetzellance l'ooition du poeme inacheve sous son titre initial de Dieu .1 On ne connalt pas avec exactitude les etapes de la gene se du poeme. Le point de depart en est sans doute donne par Vacquerie qui, le 11 fevrier 1855, lors d'une seance de tables tournantes, demande it «Jesus-Christ», apparu ce jour: «Veux tu m'expliquer ce que le christianisme a ajoute au druidisme, la revolution fran~aise au christianisme, et ce que les tables ajoutent a la revolution ?»2 Litteratures, n° 8 (1991) 28 LlITERATURES Avec Solitudines Coeli - qui deviendra L'Ocean d'en haut , second volet de Dieu - Hugo lui don ne une fonne de reponse. -

Writing Against the Reader: Poetry and Readership in France 1840-1880
Writing Against the Reader: Poetry and Readership in France 1840-1880 Jacqueline Michelle Lerescu Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Graduate School of Arts and Sciences COLUMBIA UNIVERSITY 2015 © 2015 Jacqueline Michelle Lerescu All rights reserved ABSTRACT Writing Against the Reader: Poetry and Readership 1840-1880 Jacqueline Michelle Lerescu This dissertation examines the changing ways in which nineteenth-century French poets addressed readers and constructed relationships with them from the late Romantic period through the rise of the Symbolist movement. While poetry’s increased isolation from the public is recognized as an important facet of the evolution of nineteenth-century poetry, the specific reasons for this have not been broadly studied. This dissertation first examines the poet-reader relationship in prefaces to poetic works, examining the shift from Romantic poets such as Victor Hugo and Alphonse de Lamartine, who considered addressing humanity an important part of their vocation, to mid-century poets such as Charles Baudelaire, Lautréamont and Charles Cros, who used prefaces to criticize and chase away readers, to later poets such as Stéphane Mallarmé and Arthur Rimbaud, who abstained from addressing readers by not writing prefaces or publishing their poetry. In order to understand the reasons for this shift, this dissertation examines new media and new readers which these poets rejected as the antithesis of poetry: the press, women and working-class readers. This dissertation studies poetry and critical articles in the mainstream press, women’s publications and publications by and for workers to reveal the models of the poet-reader relationship they presented. -

Victor Hugo Dictateur
VICTOR HUGO DICTATEUR › Jean-Marc Hovasse Hugo continue à nous fasciner pour son ambition – « Chateaubriand ou rien » – et son gigantisme. Mais il a une manière à lui de faire de cette ambition un service et de mettre le gigantisme à la portée de tous. Il aime ainsi les institutions, les assemblées, les académies, on dirait aujourd’hui les collectifs, pas le pouvoir personnel qui isole. Il est attiré par la grandeur, mais il apprécie surtout le « grandissement » – c’est son mot – possible pour chacun. Lionel Jospin, discours de Besançon, 25 février 2002. propos de Victor Hugo et de ses relations avec le pouvoir en France, les images ne manquent pas. Aucun lecteur des Misérables ne peut oublier l’ex- traordinaire portrait de Louis-Philippe, nourri des entretiens personnels de l’auteur avec le dernier roi qu’ilÀ retranscrivait en des notes aujourd’hui publiées dans Choses vues (choisir impérativement l’édition « Bouquins », chez Laffont). Les lec- teurs d’Actes et paroles connaissent les remarquables discours de Victor Hugo à l’Assemblée nationale sous la IIe République, quand il était représentant du peuple (député). Ils se souviennent de son glissement de Lamartine, dépassé par les événements, à Louis-Napoléon Bonaparte, soutenu dans un premier temps pour échapper au général Cavaignac, puis combattu au fur et à mesure qu’il dévoilait son véritable visage MAI 2017 MAI 2017 61 l’écrivain face au pouvoir d’aventurier impérial – et non point parce qu’il ne l’avait pas choisi comme ministre, vieille calomnie à laquelle il avait déjà répondu en son temps, mais qui n’en finit pas de reparaître. -

"Des Odes Et Ballades Aux Orientales ,Vers Une Libre Circulation De La
1 "Les Orientales de Victor Hugo", Etudes réunies par Cl. Millet, Revue des Lettres modernes, Minard, 2001. Ludmila CHARLES-WURTZ Université de Tours Des Odes et Ballades aux Orientales , vers une libre circulation de la parole poétique Le "jardin de poésie" Dans un poème de 1859 intitulé "Le chêne du parc détruit", Hugo associe le jardin français à la Lenôtre à la monarchie d'Ancien Régime : le chêne y était gardé par une "grille verrouillée", "loin des grandes routes / Où va le peuple, incorrect". "Le goût fermait (s)a clôture ; / Car c'est pour lui l'A B C / Que, dans l'art et la nature, / Tout soit derrière un fossé."1 Pour Hugo comme pour tous les romantiques, l'esthétique classique est indissociable de la politique d'Ancien Régime. C'est à cette esthétique autant qu'à cette politique que 1789 met fin : Je redeviens le vrai chêne. Je croîs sous les chauds midis ; Quatre-vingt-neuf se déchaîne Dans mes rameaux enhardis. (...) Décloîtré, je fraternise Avec les rustres souvent.2 La Révolution française "déchaîn(e)" et "décloîtr(e)" le "jardin de poésie" aussi bien que la société : la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen accorde en droit à tous les individus le statut de sujet politique, esthétique et énonciatif, abolissant ainsi les règles qui régissaient l'art classique. Cette révolution esthétique, qui n'est que l'autre versant de la révolution politique, a lieu pour Hugo quelque trente ans avant la publication des Chansons des rues et des bois : elle commence dans les Odes et Ballades, dont la préface de 1826 décrit la pensée comme "une terre vierge et féconde 1 Les Chansons des rues et des bois, Livre I, V, 1, "Le chêne du parc détruit". -

Caroline Raulet-Marcel: "Le Bug Jargal De 1826: Les Enjeux D'un Dispositif D'énigme Caduc"
Retour Caroline Raulet-Marcel : Le Bug-Jargal de 1826 : les enjeux d’un dispositif d’énigme caduc Communication au Groupe Hugo du 26 septembre 2009. Ce texte peut être téléchargé soit tel quel, soit aux formats doc ou pdf Le 30 janvier 1826, Victor Hugo publie Bug-Jargal chez l’éditeur Gosselin. Ce roman, alors attribué à « l’auteur de Han d’Islande » sur sa page de titre, est la deuxième version remaniée, enrichie, d’un premier récit du même nom, paru en cinq livraisons de mai à juin 1820 dans Le Conservateur littéraire[1]. Dans les deux cas, le récit est en grande partie délégué à un capitaine – Delmar dans la première version, Léopold d’Auverney dans la deuxième – qui narre une partie de son passé à ses compagnons d’armes afin de rendre une nuit de bivouac moins longue. Le personnage raconte de quelle manière sa vie a été bouleversée par la révolte des Noirs à Saint-Domingue en 1791. Neveu d’un riche colon, très cruel avec ses esclaves, le personnage, alors tout jeune homme[2], est fasciné par Pierrot, un jeune noir jeté en prison pour avoir sauvé un esclave endormi de la fureur de son maître. Delmar / D’Auverney lui rend visite en prison et se lie peu à peu d’amitié avec lui. Figure mystérieuse, Pierrot éveille sa curiosité – il inspire un profond mais inexplicable respect à tous ses camarades, il parle plusieurs langues… – mais refuse de lui raconter son passé. C’est alors que la révolte des esclaves éclate et Delmar / D’Auverney soupçonne Pierrot, qui s’est évadé, d’avoir assassiné son oncle. -

DE VICTOR HUGO • ••••• »••••••••*••"•••-••••• ••••••-•'•-••-• DEPOSITED 1 I Y the COMMITTEE O N (Srabuate Stuoies
DE VICTOR HUGO • ••••• »••••••••*••"•••-••••• ••••••-•'•-••-• DEPOSITED 1 i Y THE COMMITTEE O N (Srabuate Stuoies. ACC. NO DATE LE THEATEE EU LIBSETS DE VICÏOE EUGO îhèse présentée par Alice M. Sharples, pour le degré de Maître-ès-Arts. -«-00 TABLE LES MATIERES. 1. PREFACE. S. ORIGINE ET HISTORIQUE LU THEATRE EU LIBERTE. A. Les Origines. B. Musset, Précurseur de Victor Hugo. C. Historique. D. Critique Contemporaine. 3. RAPPORT LU THEATRE EN LIBERTE AVEC LTOEUVRE ROMANTIQUE DE VICTOR HUGO. A. Personnages et Situations B. L'Evolution des Idées Religieuses de Victor Hugo. C. LfEvolution des Idées Politiques de Victor Hugo. 4. LA NOUVEAUTE DU THEATRE EN LIBERTE. A. Renouvellement des Formules. B. La Forme. 5. CONCLUSION. 6. BIBLIOGRAPHIE. PBEFACE. En étudiant le "Théâtre en liberté", nous avons trouvé les divisions suivantes qui nous paraissent logiques: La première traitera des origines, et de l'historique du Théâtre. Cette division renfermera des remarques sur le théâtre d'Alfred de Musset,-qui, comme nous tacherons de le montrer, a été le précurseur de Victor Hugo, dans ce genre dramatique,- et les jugements de la critique contemporaine. Une deuxième division discutera les rapports du "Théâtre en Liberté1*, avec l'oeuvre Romantique de Victor Hugo. Nous voulons nous débarrasser, tout d'abord, des réminis cences et des échos de l'inspiration romantique, qui sont présents dans le théâtre livresque, et puisqu'il nous paraît que ce sont surtout les^ situations et les personnages, qui sont encore de l'ancienne école, nous allons ainsi intituler la section A de cette division. Les sections B, et G, mon treront l'évolution des idées politiques et religieuses du poète, ainsi qu'elles se manifestent dans le "Théâtre en Liberté" Dans notre troisième division, nous essayerons de montrer les. -

Nº 4, Abril De 2008 Artículos La Presencia Del Lector En La Narrativa De Victor Hugo
ISSN: 1699-4949 nº 4, abril de 2008 Artículos La presencia del lector en la narrativa de Victor Hugo (1823-1834)* Francisco Aiello Universidad Nacional de Mar del Plata Comité Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Argentina [email protected] Résumé Abstract Le lecteur est fortement présent dans The reader is very present in Victor les romans de Victor Hugo publiés dans Hugo’s novels published during the period la période 1823-1834 grâce à différentes 1823-1834 thanks to different textual stra- stratégies. Alors, on trouve un riche dialo- tegies. So there is a rich dialogue between gue entre lui et l’auteur, qui sont tous les him and the author. Both of them are con- deux considérés dans cet article comme sidered in this article as textual construc- constructions textuelles au lieu d’êtres tions instead of empiric beings. The analysis empiriques. L’analyse révèle que la rela- shows that the relationship author-reader is tion est évidement asymétrique, étant clearly asymmetric as it is only the author donné que ce n’est que l’auteur qui pos- who has got the control of the stories and sède le contrôle des histoires et leur inter- its interpretation. That is why he decides to prétation. Voilà pourquoi il décide d’ins- instruct the reader, whose reading skills are truire le lecteur, dont il estime les compé- poor, by helping him to understand and by tences de lecture insuffisantes, en l’aidant teaching him anything that could be neces- à comprendre et en leur apprenant ce qui sary to appreciate the novel.