Andreas Ladner
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
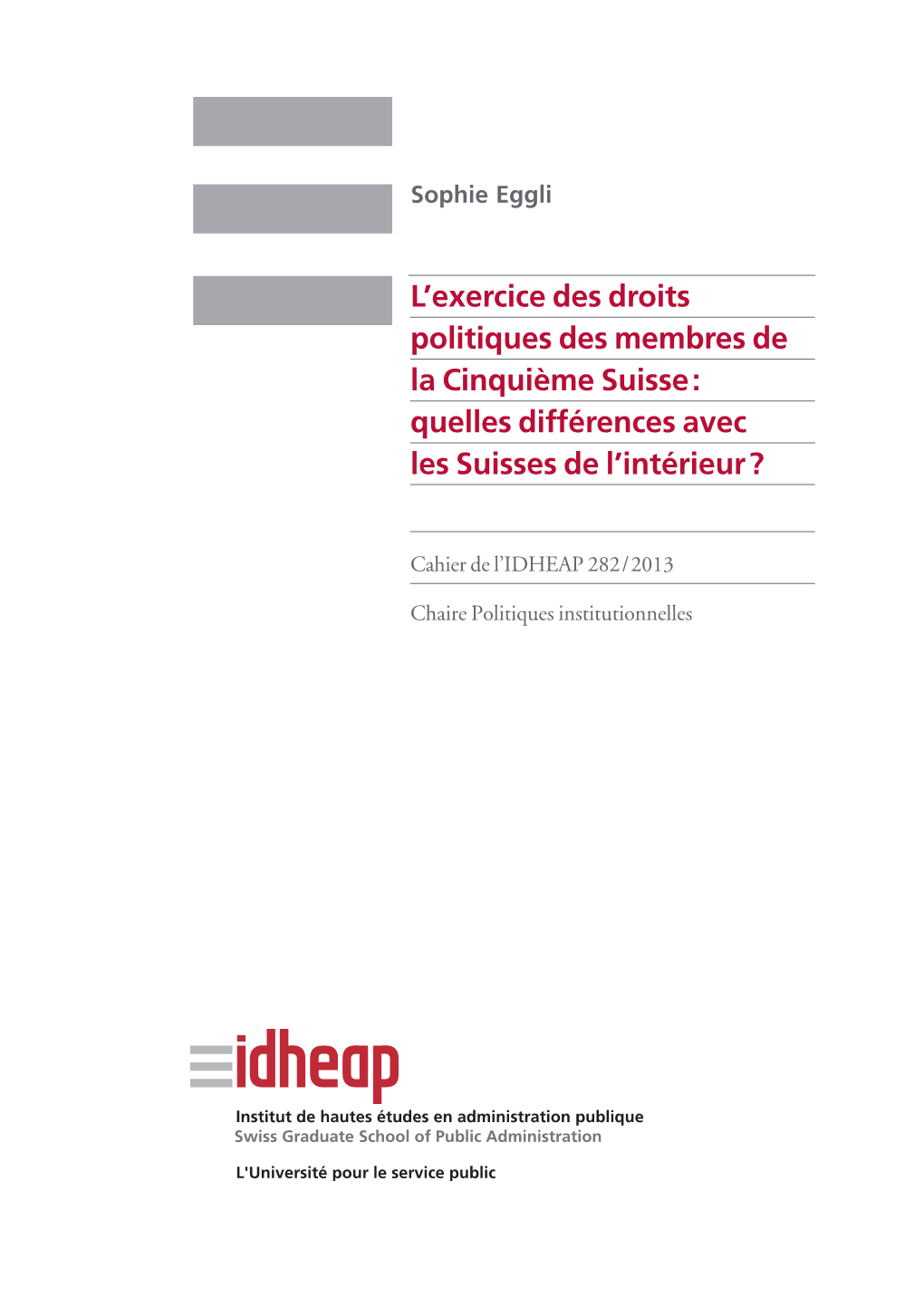
Load more
Recommended publications
-

The European Campaign to End the Siege on Gaza (ECESG) Is an Anti-Israel, Pro-Hamas Umbrella Organization Which Participated in the Mavi Marmara Flotilla
The Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center October 5, 2010 The European Campaign to End the Siege on Gaza (ECESG) is an anti-Israel, pro-Hamas umbrella organization which participated in the Mavi Marmara flotilla. The ECESG is currently involved in organizing an upgraded flotilla, and in other projects to further isolate Israel, part of the campaign to delegitimize it. The Sfendoni 8000, the ECESG's vessel in the Mavi Marmara flotilla. The number refers to the 8000 Palestinian terrorists detained by Israel. 253-10 2 Overview 1. The European Campaign to End the Siege on Gaza (ECESG) is an anti-Israel, pro Hamas umbrella organization operating in Europe. It participated in the last flotilla (which ended with a violent confrontation aboard the Mavi Marmara) along with a coalition of four other anti-Israel organizations led by the Turkish IHH. Since then the ECESG and the other coalition members have been intensively promoting new programs with the objective of embarrassing Israel and deepening its isolation. The coalition projects include an upgraded flotilla which has been organizing for several months as Freedom Fleet 2 (its organizers hope to include more than 20 ships from various countries), and sending a plane to the Gaza Strip. 2. The ECESG was founded in 2007, the same year as Hamas' violent takeover of the Fatah and Palestinian Authority institutions in the Gaza Strip. Its declared objectives are "the complete lifting" of the so-called Israeli "siege" of the Gaza Strip and bringing humanitarian assistance to its residents. However, beyond that goal, which is supported by Western human rights organizations and activists, lie hidden its undeclared political objectives. -

Archives Cantonales Vaudoises
Archives cantonales vaudoises Histoire de l’administration cantonale vaudoise : pouvoir exécutif et administratif 1970-1998 Par Gilbert Coutaz Recettes et dépenses d'exploitation de l'Etat Vaud entre 1987 et 1997 Recettes Milliers de fr. 5'500'000 Dépenses 30'000 5'000'000 Différence -20'000 4'500'000 -70'000 4'000'000 . -120'000 r 3'500'000 f 3'000'000 -170'000 de 2'500'000 os -220'000 i M 2'000'000 -270'000 1'500'000 -320'000 1'000'000 500'000 -370'000 0 -420'000 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Années L’étude constitue le dossier thématique du Rapport d’activité 2006 des Archives cantonales vaudoises. Chavannes-près-Renens, octobre 2007 1200 exemplaires Page de couverture : Recettes et dépenses d’exploitation de l’Etat de Vaud entre 1987 et 1997. Source de référence : Annuaire statistique du canton de Vaud . © Archives cantonales vaudoises 2 « Je regrette que d’une façon générale, les préavis qui nous sont présentés soient dépourvus d’une analyse historique, de toute sensibilité historique – c’est très bien de savoir l’anglais, c’est très bien de pratiquer l’informatique, mais ce serait peut-être encore mieux de souvenir de nos racines ; cela éviterait quelques dérives de nos anciens conseillers d’Etat, soit dit en passant ! (Rires) » (Maurice Meylan, Bulletin des séances du Grand Conseil, 17 juin 1997, p. 1534) Introduction* Les années noires Le 7 février 1995, le Conseil d’Etat tenait une conférence de presse au cours de laquelle il révélait de graves événements survenus au Département des finances : il annonçait avoir dû licencier sur le champ Pierre-Alain Buffat, chef du Service de l’administration des finances, en charge depuis 1975 et accusé d’avoir dissimulé un montant de 106 millions de francs en relation avec l’acquisition d’un programme informatique, dénommé Procofiev. -

HEADS of STATE NOBEL PRIZE 1. Alberto Fernández, President Of
HEADS OF STATE NOBEL PRIZE 1. Alberto Fernández, President of Argentina (2019-), lawyer, Professor of criminal law (UBA), former Chief of the Cabinet of Ministers, adviser to Deliberative Council of Buenos Aires and the Argentine Chamber of Deputies, deputy director of Legal Affairs of the Economy Ministry, Argentina 2. Adolfo Pérez Esquivel, Nobel Peace Prize laureate (1980), Pacem in Terris Prize (1999), activist, painter, sculptor, Professor of architecture, co-founder oft he Service, Peace and Justice Foundation (SERPAJ), Argentina 3. Álvaro García Linera, Vice President of Bolivia (2006-2019), mathematician, academic, Bolivia 4. Cristina Fernández de Kirchner, Vice President of Argentina (2019-), President of Argentina (2007-2015), lawyer, Argentina 5. Dilma Rousseff, President of Brazil (2011-2016), economist, former Minister of Energy and former Chief of Staff of the Presidency of the Republic, Brazil 6. Ernesto Samper, President of Colombia (1994-1998), lawyer, economist, former Secretary-General of UNASUR, Senator of the Republic and Minister of Economic Development, Ambassador of Colombia in Spain, Colombia 7. Evo Morales Ayma, President of Bolivia (2006-2019), trade unionist, activist and Bolivian leader of Aymara descent, President of the Six Federations of the Tropic of Cochabamba, Former President pro tempore of UNASUR and CELAC, Bolivia 8. Fernando Lugo, President of Paraguay (2008-2012) Senator, Roman Catholic priest and bishop, Paraguay 9. José Luis Zapatero, Prime Minister of Spain (2004-2011), lawyer, Professor of Constitutional Law at the Faculty of Law of the University of León, former Deputy in General Courts by Madrid, Deputy in General Courts of Spain, president of the Council of the European Union, Spain 10. -

24 Heures | Lundi 6 Août 2018 GMT+3 Un Tour Du Monde En 41 Portraits Vaud Pour L’Enfant D’Immigrés En Quête De Racines, Patmos Est Une Révélation
24 La derPatmos Par monde et par 24 heures | Lundi 6 août 2018 GMT+3 Un tour du monde en 41 portraits Vaud Pour l’enfant d’immigrés en quête de racines, Patmos est une révélation Josef Zisyadis (24/41) Amoureux de l’île grecque depuis trente ans, l’ancien conseiller d’État et ancien conseiller national vaudois y poursuit son projet viticole, sociétal et agraire Claude Ansermoz Texte et photo est un exil volon- taire, bref et récur- rent. Chaque année, depuis 1985, Josef Zi- syadis s’exporte à Patmos. Sur cette île C’de bien des légendes où l’apôtre Jean, déporté par les Romains, aurait écrit la révélation de l’Apocalypse, dernier chapi- tre du Nouveau Testament. Là où, en 1088, le religieux Théodule a construit ce monastère en forme de mastodonte forte- resse pour la protéger des pirates. Faisant de Chora la capitale, la Jérusalem de l’Egée, second lieu saint de l’Orthodoxie après le mont Athos, inscrite au Patri- moine mondial de l’Unesco. Alors oui, pour ce Grec né orthodoxe à Istanbul, devenu protestant puis pasteur, «ce lieu a forcément servi d’aimant. Moi l’enfant d’immigré en quête perpétuelle de raci- nes. Qui suis toujours un étranger ici et en Suisse.» Nous surplombons la baie de Vagia. Avec une vue sur cette chambre de bonne que Josef Zisyadis a louée pendant 20 ans. «J’ai toujours eu un rapport très casanier aux vacances. Le vrai luxe, c’est d’y avoir ses habitudes. Mais, très vite, la beauté du lieu ne m’a pas suffi. -

Populaire (POP) Vaudois, À Travers Quelques Événements Signifiants De Son Histoire Contemporaine
Session d'été, juin 2009 Représentations médiatiques de la vie politique locale: l'exemple du Parti Ouvrier et Populaire (POP) vaudois, à travers quelques événements signifiants de son histoire contemporaine. Mémoire en sciences sociales, orientation « sociologie de la communication et de la culture ». Présenté par Julien Sansonnens, en vue de l'obtention de la Maîtrise universitaire en sciences sociales. Sous la direction de Madame la Professeure Laurence Kaufmann, de l'Université de Lausanne. « L’Université n’entend donner aucune approbation ou improbation aux opinions émises dans ce mémoire. Ces opinions doivent être considérées comme propres à leur auteur ». Remerciements Nous tenons à exprimer notre gratitude envers celles et ceux sans qui nous n'aurions pu mener à bien cette recherche. Nos remerciements vont à Madame la Professeure Laurence Kaufmann pour la direction de ce mémoire, à Mon- sieur Olivier Voirol pour son expertise, à nos amis du POP vaudois pour les in- nombrables informations apportées, à l'historien Pierre Jeanneret pour sa relec- ture du manuscrit et ses conseils, ainsi qu'à la Professeure Véronique Mottier pour son enseignement et ses commentaires. Nous adressons nos remercie- ments au personnel des Archives de la ville de Lausanne pour sa disponibilité, à Madame Hélène Joly du Centre de documentation sur la vie politique ro- mande de l'Université de Lausanne, ainsi qu'à toutes celles et ceux qui, d'une manière ou d'une autre, nous ont apporté leur aide. ii Table des matières Contact..............................................................................................................1 -

RAPPORT DU CONSEIL D'etat AU GRAND CONSEIL Sur Le Projet D
5113 Bulletin des séances du Grand Conseil du Canton de Vaud No 42 I Séance du mercredi après-midi 6 décembre 2000 ____________ Présidence de M. André GASSER, président ____________ TABLE DES MATIERES RAPPORT DU CONSEIL D'ETAT AU GRAND CONSEIL sur le projet d’innovation et de coordination, Sciences, Vie, Société, entre l’Université de Genève, l’Université de Lausanne, l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, dit « projet triangulaire » (200) (Suite du 2e débat).................... 5115 EXPOSÉ DES MOTIFS ET PROJET DE DÉCRET pour la mise en œuvre du « projet triangulaire » et ses conséquences sur le budget de fonctionnement de l’Université de Lausanne (200) (Suite du 2e débat) ...... 5115 EXPOSE DES MOTIFS ET PROJET DE LOI modifiant la loi du 6 décembre 1977 sur l’Université de Lausanne (200) (Suite du 2e débat)...... 5115 RÉSOLUTION MARTIAL GOTTRAUX ET JOSEF ZISYADIS relative aux subsides de l'assurance maladie (Développement) ................................ 5119 EXPOSE DES MOTIFS ET PROJET DE DECRET accordant des crédits supplémentaires au budget 2000 (deuxième série) (233) (1er débat) ........... 5138 5114 Séance du mercredi après-midi 6 décembre 2000 EXPOSE DES MOTIFS (232) (1er débat) − et projet de budget des charges et des revenus de fonctionnement de l'Etat de Vaud pour l'année 2001 ............................................................. 5263 − et projet de budget d'investissement pour l'année 2001 ........................... 5263 − et projet de loi sur l'impôt 2001 ............................................................... 5263 − et projet de décret fixant le plafond des emprunts contractés par l'Etat de Vaud pour l'exercice 2001................................................................... 5263 Rapport complémentaire au budget 2001 du Conseil d'Etat au Grand Conseil relatif au budget 2001 des Hospices cantonaux. -

Federal Elections 2007 the Voters Will Determine the Country's Future Why
THE MAGAZINE FOR THE SWISS ABROAD AUGUST 2007 / NO. 4 Federal elections 2007 The voters will determine the country’s future Why is Switzerland so politically stable? How the Swiss abroad can take part in the elections Your direct contact to Switzerland PUBLICIS www.swissinfo.org Swiss news International news Specials Forums Swiss links 70 years of quality reporting Contact Content also available via Mobile/PDA/Newsletter/Audio Download/News Feeds EDITORIAL CONTENTS 3 Wealth problems n the autumn of 1987, shortly before the Swiss elections, I met a 35-year-old Amer- Special election 2007 issue ican primary school teacher from Los Angeles in Asia. I will never forget the stimu- Ilating conversation we had. Phil – for that was his name – told me about how diffi - cult life was for American teachers, that for instance he wasn’t paid over the summer holidays and that his salary was in any case so low that he had to teach English to immi- grants three evenings a week simply to make ends meet. He said he liked travelling, and thanks to a thrifty lifestyle and his extra income he could afford to take an extended hol- iday every few years. Without complaining about his lot, he answered all my questions on life in LA, describing the crime in the sprawling conurbation, the drug problems and the appalling living conditions faced by illegal immigrants from Mexico. However, suddenly he turned the tables on me and asked, “What are the principal 5 problems in Switzerland?” I thought it over for a moment and told Phil that we were Mailbag about to go to the polls and that environmental protection was the main election issue. -
Current Concerns
10 December 2012 No 51 ISSN 1664-7963 Current Concerns PO Box CH-8044 Zurich Current Concerns Switzerland The international journal for independent thought, ethical standards, moral responsibility, Phone: +41 44 350 65 50 Fax: +41 44 350 65 51 and for the promotion and respect of public international law, human rights and humanitarian law E-Mail: [email protected] Website: www.currentconcerns.ch English Edition of Zeit-Fragen “Maintaining productivity at today’s level of self-sufficiency of at least net 54 percent” “Feeding the population reasonably on the basis of family farming” Interview with National Councillor Markus Ritter, CVP SG, president of the Swiss Farmers’ Association thk. On 12 De- What are the priorities of the new Agri- cember, the sec- cultural Policy? Art. 104 Agriculture ond chamber It includes an increased focus on the ob- 1The Confederation shall ensure that agri- of Parliament, jectives of our Constitution. The basic cultural sector, by means of a sustainable the Council of idea is that each constitutional objective and market oriented production policy, States, discussed is converted into concrete actions and ap- makes an essential contribution towards: the bill on Ag- propriate instruments using an appropri- a. the reliable provision of the population with foodstuffs; ricultural Poli- ate incentive process. The result is that the b. the conservation of natural resources cy 2014 to 2017. constitutional objectives, security of sup- and the upkeep of the countryside; After the Na- ply and maintenance of the countryside as c. decentralised population settlement of tional Council well as the whole range of environmental the country. -

2013 Paola Viesi © Paola
SLOW FOOD Mission Report at Closure of Balance Sheet, as at 31/12/2013 Paola Viesi Paola © SLOW FOOD Piazza XX Settembre 5 – 12042 Bra (CN) C.F. 91019770048 – P.IVA 02743970044 fondo sociale 25.807€ CONTENTS Introduction 3 Organization 4 1. Mission and identity 6 2. Institutional activities 9 3. Fundraising 19 4. Financial and economic situation 20 5. Other information 24 Explanatory note 29 Alberto Peroli © 2 INTRODUCTION Dear councilors, It is not easy to recount the activities of a year such as 2013 due to the large number of projects, activities and cam- paigns that were undertaken in order to meet the goals we set ourselves during the International Congress held in Turin in October 2012. There are different ways to evaluate and understand this fiscal year: An economic and financial analysis is obviously of great importance as available resources enable Slow Food to operate and handle overall management; however the social aspect is equally important. This includes all of the activities and projects that Slow Food takes on to support small-scale producers and family farms. A social evaluation also takes into account the health of people and of our planet, and considers additional factors such as animal welfare: aspects that we must consider if we are to be holistic in our approach. The cultural component must also not be forgotten, as it comes to the fore in much of our work to promote the education of consumers, both in our large international events and in individual initiatives that the Slow Food convivia undertake around the world. -

R Apport De Gestion 2017
Musée national suisse. Rapport de gestion 2017. FR_UG_Geschäftsbericht_2017.indd 1 Rapport de gestion 2017. 12.03.18 11:10 2 1 Un aperçu de l’exposition « L’abbaye d’Einsiedeln. 1000 ans de pèlerinages » au Musée national Zurich. 2 Débats et entretiens passion- nants lors du « Festival du dialogue » au Musée national Zurich. 3 Visite guidée de l’exposition permanente « Archéologie Suisse » au Musée national Zurich. 4 Des collaboratrices du Forum de l’histoire suisse Schwytz attendent leur intervention lors du vernissage de l’exposition « Que mange la Suisse ? ». 5 « Dîners anecdotiques » dans le jardin potager du Château de Prangins. 1 FR_UG_Geschäftsbericht_2017.indd 2 12.03.18 11:10 3 4 5 FR_00_Geschäftsbericht_Inhalt_2017_(Layout) [P].indd 1 09.03.18 16:12 Table des matières. 03 Éditorial. 04 Expositions, manifestations & médiation culturelle. 04 Musée national Zurich. 14 Château de Prangins. 18 Forum de l’histoire suisse Schwytz. 22 Autres lieux d’exposition. 24 Statistique des visiteurs et des visites guidées. 26 Prêteurs. 28 Collections. 28 Centre des collections. 36 Choix de dons et d’acquisitions. 44 Centre d’études. 46 Donatrices et donateurs. 47 Emprunteurs. 48 Recherche & enseignement. 62 Extension et rénovation du Musée national Zurich. 64 Durabilité. 66 Organisation. 67 Conseil du musée. 68 Organigramme. 69 Direction. 70 Collaboratrices et collaborateurs. 72 Partenaires & organes. 75 Aperçu des comptes annuels. 77 Invités. 78 Épilogue. 79 Achevé d’imprimer. Annexe à part : comptes annuels 2017 FR_00_Geschäftsbericht_Inhalt_2017_(Layout) [P].indd 2 09.03.18 16:12 Éditorial. Depuis l’inauguration du nouveau Musée national à l’été 2016, nous avons pu acquérir une précieuse expérience en ce qui concerne l’ex- ploitation du nouveau bâtiment et des nouvelles infrastructures. -

Lesvertsetlagauchedoivent Mettreunfreinàleurérosion Echéances Électorales IV/IV Les Partis Préparent Déjà Activement Les Prochaines Élections
18 24heures | Jeudi-vendredi 17-18 avril 2014 Vaud LesVertsetLaGauchedoivent mettreunfreinàleurérosion Echéances électorales IV/IV Les partis préparent déjà activement les prochaines élections. Dernier tour d’horizon avec les Verts et la gauche de la gauche Renaud Bournoud/Justin Favrod Fédérales n est inquiet, on est in- quiet! Les Verts vaudois tout comme la gauche de la gauche peuvent enton- RaphaëlMahaimpourremonterlapente ner le refrain du chanson- Onier Gilles. Que va-t-il advenir de leurs Les écologistes n’ont pas trop de souci formations aux élections fédérales de à se faire pour recruter de la relève LerêvedesVerts, 2015, communales de 2016 et cantonales à Berne. En effet, ils reprennent les de 2017? mêmes et recommencent. Luc c’estderetrouver La situation est moins sombre pour les Recordon se représente aux Etats. letroisièmesiègeperdu écologistes que pour l’extrême gauche. Les sortants Adèle Thorens et Chris- En 2011, les écologistes ont perdu un siège tian van Singer vont se lancer au sur trois au Conseil national. L’an suivant, Conseil national. leur représentation au Grand Conseil dé- Pour les Etats, les écologistes n’ont gringolait de 24 à 19 députés. Aux com- peur que de Pascal Broulis. Si le Raphaël Mahaim Adèle Thorens Luc Recordon munales de 2011, les Verts ont gagné dans magistrat se présente contre Luc les communes où ils lançaient pour la Recordon, il pourrait faire trébucher première fois une liste séparée des roses. le sénateur. A l’heure actuelle, on ne A Lausanne, leur représentation s’est éro- voit en effet pas quel autre candidat Conseil. Il aura alors fini son stage De son côté, la gauche de la gauche SolidaritéS plaide pour une liste dée de 22 à 20 sièges. -

The Swiss Confederation: a Brief Guide 2011
THE SWISS CONFEDERATION A BRIEF GUIDe 2011 Index Accumulation 16 Cantons 15, 24, 25, 28 Collegiality 43 Committees 34, 35 Communes 15 Concordance 43 Confederation 15 Council of States 25, 28, 29, 30, 31 Delegations 34 Departments (overview) 44, 45 Executive 15, 40 Federal Assembly 30, 31 Federal Chancellery 46, 47 Federal Council 15, 40–43 Federal Offices (overview) 44, 45 Federal Supreme Court 15, 77, 78, 79 Half-cantons 28 Initiative 17, 33 Cover picture: Interpellation 33 With the parliament building behind her, ‘Lora’ can be seen almost every day Judiciary 15, 76–80 on the Bundesplatz in Bern. She is not posing for journalists or TV cameras Legislature 15, 32 in the hope of becoming a national star; she is watching her master’s and his Magic Formula 43 opponent’s every move in a game of chess. Which player will put the other in Mandatory referendum 16, 17 check, and when and how will they do it? Or will it be a tie again? Motion 33 Content National Council 25, 26, 27, 30, 31 Information services of the Federal Chancellery, the Departments, Optional referendum 16, 17 Parliamentary Services and Federal Courts Parliament 22–36 Jeanmaire & Michel AG Parliamentary groups 34, 36 Concept, design, composition Parliamentary services 37 Je anmaire & Michel AG, www.agentur.ch Parties 18–21, 30, 31, 43 Photography Petition 17 Alexander Jaquemet, Erlach Postulate 33 Parliamentary and Federal Council photos: Monika Flückiger, Bern Photos of Micheline Calmy-Rey pages 4–7: Manuel Bauer, Winterthur Proportional representation 16, 25 Party landscape, page 21: Michael Hermann, Geographical Institute, Referendum 16, 17 University of Zurich Right to elect 16 Editorial deadline Right to vote 16 31 December 2010 Separation of powers 15 Sessions 32, 33 This publication is also available in German, French, Italian and Romansh.