Dossier D'enquête Publique
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
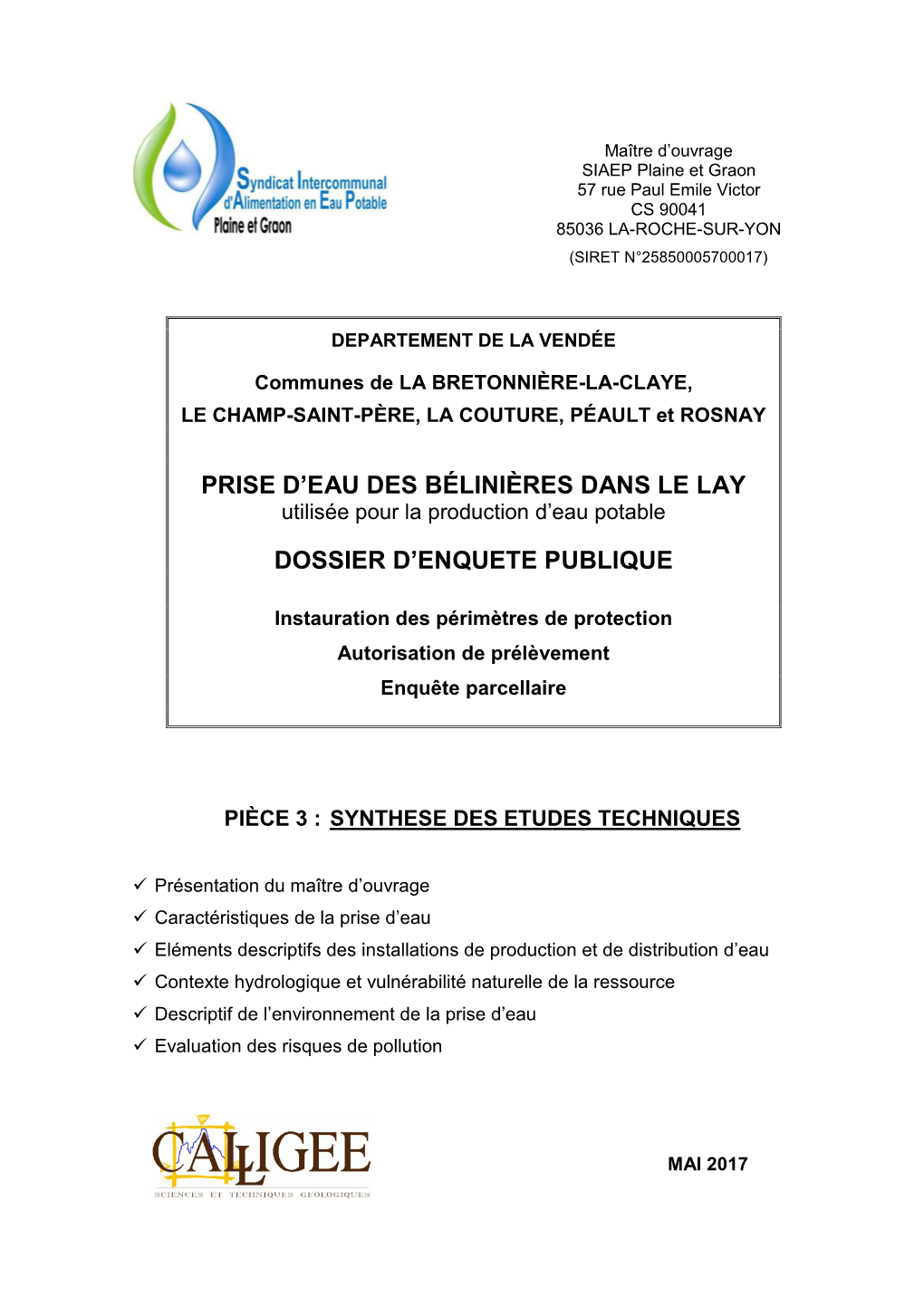
Load more
Recommended publications
-

Recueil Des Actes Administratifs
ISSN 0984-2543 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS N° 2009/18 __________________ Document affiché en préfecture le 23 avril 2009 1 SOMMAIRE DU RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS N° 2009/18 ____ Document affiché en préfecture le 23 avril 2009 SERVICE INTERMINISTERIEL DE DEFENSE ET DE LA PROTECTION CIVILE ....................................................4 Arrêté n° 09/CAB-SIDPC/014 portant mise à jour de la liste des Etablissements Recevant du Public (E.R.P.) et des Immeubles de Grande Hauteur (I.G.H.) du département de la Vendée ............................................................4 DIRECTION DE L’ACTION INTERMINISTERIELLE ..................................................................................................5 Arrêté n° 09-DAI/3 - 39 portant dissolution de la régie de recettes instituée auprès du Centre des impôts foncier des Sables d’Olonne, relevant de la Direction des services fiscaux de la Vendée ..................................................5 Arrêté n° 09-DAI/3 - 40 portant dissolution de la régie de recettes instituée auprès du Centre des impôts foncier de Challans, relevant de la Direction des services fiscaux de la Vendée ................................................................5 Arrêté n° 09-DAI/3 - 49 portant dissolution de la régie de recettes instituée auprès du Centre des impôts foncier de La Roche-Sur-Yon, relevant de la Direction des services fiscaux de la Vendée ................................................5 Arrêté n° 09-DAI/3 - 50 portant dissolution de la régie de recettes instituée auprès -

Télécharger Ce Numéro
Aubigny-Les Clouzeaux / Dompierre-sur-Yon / La Ferrière / La Chaize-le-Vicomte / Fougeré / Landeronde / Mouilleron-le-Captif / Nesmy / La Roche-sur-Yon / Le Tablier / Rives de l’Yon / Thorigny / Venansault PLUS ROCHETOUTE L’ACTUALITÉ DE VOTRE AGGLOMÉRATION / N°56 / JUILLET-AOÛT 2021 LE DOSSIER Les pieds dans l’Yon PAGE INTERIEURE 1 - ROCHE PLUS JUILLET 2021.indd 1 21/06/2021 17:21 ÉDITO SOMMAIRE AU FIL DE L’ACTU LE DOSSIER TERRITOIRE TEMPS LIBRE PRATIQUE TRIBUNES JUILLET-AOÛT 2021 LA NATURE AU FIL DE L’YON oici enfin l’heure de ralentir le rythme, d’ou- L’Yon dessine ici un espace riche à découvrir, mais aussi vrir grands les yeux et de se laisser aller au à protéger. Parce qu’il n’est pas de découverte sans res- plaisir des journées chaudes et ensoleillées pect, nous devons en effet veiller sur ce qui constitue V de l’été. l’un des atouts de nos paysages. L’Agglomération met en œuvre une politique de protection de la vallée, des Profitons-en pour partir à la découverte de notre berges, du cours même de la rivière et de ses affluents. vallée et de celle qui en dessine les formes, l’Yon. Petite rivière bien paisible, elle arrose, de La Chaize- Afin de rétablir l’écoulement naturel de l’Yon, certains le-Vicomte au Tablier, une bonne partie de l’agglomé- ouvrages ont été effacés, permettant par conséquent la ration, et c’est sans compter avec ses petits affluents libre circulation des poissons et des sédiments, pour une qui drainent pour le coup l’ensemble de notre territoire. -

RÉSIDENCES Le Magazine Des Locataires De Vendée Habitat / N°58 Octobre 2020
RÉSIDENCES Le magazine des locataires de Vendée Habitat / N°58 Octobre 2020 ZOOM SUR... / PAGE 4 LA MINISTRE DU LOGEMENT EN VISITE SUR LE CHANTIER DES HAUTS DE MONTAIGU La ministre du logement Emmanuelle WARGON est venue QUOI DE NEUF DE VOUS À NOUS faire un état des lieux Page 2 Page 7 du logement dans LOCATIFS ET GAZ : les territoires à fort ACCESSION À LA PRÉCAUTIONS dynamisme économique. PROPRIÉTÉ D'USAGE AU SOMMAIRE AU ZOOM SUR… Page 4 LES HAUTS DE MONTAIGU Le futur a de l’expérience RESIDENCES n58.indd 1 07/10/2020 15:56:56 2 / RÉSIDENCES QUOI DE NEUF ? 1 Montaigu-Vendée ménages de prendre possession d’un logement locatif sur cette ÉDITO Visite ministérielle commune très prisée. Avec la … La Ministre du Logement location accession (ou PSLA), le Emmanuelle Wargon était en visite ménage est d’abord locataire et peut devenir propriétaire en levant Pierre BERTHOMÉ le 2 septembre dernier en Vendée. Président de Vendée Habitat Elle s'est rendue sur l'un de nos l’option d’achat. Il bénéficie de chantiers de rénovation urbaine : nombreux avantages (exonération les "Hauts de Montaigu". Ce de taxe foncière, frais de notaires nouveau quartier comprendra 22 réduits ...). Depuis le début du Investir dans logements locatifs, un pôle médical dispositif, ce sont ainsi 205 PSLA qui et une pharmacie. ont été vendus par Vendée Habitat les Territoires sur le département. Cette visite s’inscrit dans le cadre au profit des d’une rencontre avec les chefs 2 d’entreprise sur le sujet du manque Vendéens de logements dans le Nord-est Vendéen. -

Annuaire 2016 Medico-Social
2016 Annuaire medico-social unes Communauté de Comm L’édiTO L’annuaire médico-social du Pays de La Châtaigneraie a été élaboré dans le cadre du Contrat Local de Santé : Action 1.3 « Développer la connaissance des ressources existantes en santé ». Connaître les professionnels, les structures, les établissements et les associations œuvrant dans le secteur sanitaire, social et médico-social constitue une étape essentielle de l’accès aux droits et aux soins. En mettant à disposition une information claire des principales ressources du territoire et au-delà, l’objectif final est alors d’améliorer le parcours de soins de la population. Cet annuaire a été construit autour de 5 thématiques : - Soins-Santé Annuaire Médico-Social n°1 - Social Décembre 2015 - Enfance-Famille Directeur de la publication : - Personnes âgées Eric RAMBAUD - Handicap Crédit Photos : Je souhaite que cette initiative puisse faire mieux Fotolia connaître les services dont bénéficie notre territoire, et être utile à tous. N° ISSN : 2115-9602 Communauté de Communes Eric RAMBAUD du Pays de La Châtaigneraie Les Sources de la Vendée 85120 La Tardière Tél : 02.51.69.61.43 Fax : 02.51.52.69.20 www.pays-chataigneraie.fr Cet annuaire est une première sur le Pays de La Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi Châtaigneraie et sera complété et actualisé chaque de 9h à 13h et de 14h à 17h30 année. En cas d’oublis ou d’erreurs, merci d’adresser vos remarques à la coordinatrice du contrat local de santé au 07 76 93 22 58 ou [email protected] 2 SOMMAIRE URGENCES ������������������������������� -

Services De Soins Infirmiers À Domicile - ADMR Vendée
Services de soins infirmiers à domicile - ADMR Vendée Association locale ADMR du SSIAD Association locale ADMR du SSIAD des rives de la Boulogne Association locale ADMR du SSIAD de l’Ile de Noirmoutier 02 51 43 91 20 Association locale ADMR de Mortagne Sur Sèvre 02 51 39 07 88 du SSIAD Amaryllis 02 51 65 20 39 Noirmoutier 02 51 98 57 63 en Cugand l'Île La Bernardière L'Épine Saint Saint Hilaire La Bruffière La Guérinière Philbert de Treize Tiffauges Bouin de Loulay Septiers Bouaine Saint Mortagne Association locale Bois Saint Aubin sur de Montaigu Martin des Sèvre Barbâtre Ormeaux Saint Céné La Guyonnière des ADMR santé Gervais Boufféré Les Landes Tilleuls La Verrie Saint Saint Genusson Saint Beauvoir La Boissière Laurent sur Châteauneuf André Georges de Marillet Vouraie Treize de de sur Mer Rocheservière Montaigu Voies Montaigu La Gaubretière SaintSèvre La Garnache Malô 02 51 05 70 55 Bazoges du Treize La Barre Saint L'Herbergement Chambretaud Vents Mormaison Chavagnes en Bois de Urbain Beaurepaire Association locale ADMR Monts Froidfond Saint en Paillers Mallièvre Sallertaine Sulpice Les Brouzils Paillers le Notre Falleron aide et soins de l’Ile d’Yeu Les Lucs Verdon Les Epesses Dame Saint sur Saint de Étienne Saint La Rabatelière Monts Challans Boulogne La Copechagnière Fulgent Saint Les Châtelliers 02 51 58 38 67 Grand'Landes du Denis Mesnard Les Herbiers Saint Le Perrier Bois la la Mars Châteaumur Association locale ADMR Jean Saint Chevasse Saint Barotière la Saint Association locale ADMR Christophe Saint Saint Réorthe de Beaufou -

Carte Centres De Vaccination Vendée
Carte des centres de vaccination en Vendée Inscriptions en ligne sur Santé.fr ou au N° national 0800 009 110 Pays de la Loire Noirmoutier-en-l’Île La Roche-sur-Yon Montaigu-Vendée Espace Hubert Poignant Petite salle des fêtes Salle Dolia Place de la Prée aux Ducs du Bourg-sous-La Roche Allée des Cressonières 80 rue Emile Baumann Cugand Noirmoutier -en-l'île La Bernardière Les Herbiers L'Épine La Bruffière Espace Herbauges La Guérinière Bouin St-Philbert- Treize- de-Bouaine Septiers Tiffauges St-Aubin- Rue des Bains Douches des-Ormeaux MORTAGNE Barbâtre MONTAIGU- St-Martin- SUR SEVRE Bois-de-Cené VENDÉE Les Landes- des-Tilleuls St-Gervais Genusson Beauvoir- La Boissière- Chanverrie St-Laurent- sur-Mer Chateauneuf Rocheservière de-Montaigu sur-Sèvre La Gaubretière La Garnache L'Herbergement Bazoges- St-Malo- La Barre- St-Urbain en Paillers du-Bois Treize-Vents de-Monts Montréverd Chavagnes- Mallièvre Sallertaine Froidfond en-Paillers Beaurepaire Les Brouzils Les Epesses Challans Notre-Dame- Falleron Grand' de-Monts Landes Les Lucs- St Fulgent St-Etienne- LES HERBIERS CHALLANS du-Bois sur-Boulogne La Copechagnière La Rabatelière St-Mars- Salles Louis-Claude Roux Mesnard la-Réorthe Le Perrier la Barotière St-Christophe- St-Denis- St-André- 1 rue des Plantes ST-JEAN-DE-MONTS Beaufou la-Chevasse du-Ligneron Chauché Goule-d'Oie St-Paul- Sèvremont Soullans St-Paul-Mt-Penit Palluau Vendrennes en-Pareds La Chapelle-Palluau Bellevigny Mouchamps St-Mesmin Commequiers Maché Essarts en Bocage Port Joinville Notre-Dame- Rochetrejoux Le Boupère de-Riez -

Moreilles 2021
2021 CALENDRIER DE COLLECTE DES DÉCHETS > MOREILLES JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN Sacs jaunes V 1 Férié L 1 L 1 J 1 S 1 M 1 S 2 M 2 M 2 V 2 D 2 M 2 Le mercredi D 3 M 3 M 3 S 3 L 3 J 3 L 4 J 4 J 4 D 4 M 4 V 4 (semaines paires) M 5 V 5 V 5 L 5 M 5 S 5 Sortez votre sac M 6 S 6 S 6 M 6 J 6 D 6 la veille de la J 7 D 7 D 7 M 7 V 7 L 7 collecte V 8 L 8 L 8 J 8 S 8 M 8 S 9 M 9 M 9 V 9 D 9 M 9 D 10 M 10 M 10 S 10 L 10 J 10 Ordures L 11 J 11 J 11 D 11 M 11 V 11 ménagères M 12 V 12 V 12 L 12 M 12 S 12 S 13 S 13 M 13 J 13 D 13 M 13 Tous les vendredis J 14 D 14 D 14 M 14 V 14 L 14 V 15 L 15 L 15 J 15 S 15 M 15 Sortez votre bac S 16 M 16 M 16 V 16 D 16 M 16 la veille de la D 17 M 17 M 17 S 17 L 17 J 17 collecte L 18 J 18 J 18 D 18 M 18 V 18 M 19 V 19 V 19 L 19 M 19 S 19 M 20 S 20 S 20 M 20 J 20 D 20 J 21 D 21 D 21 M 21 V 21 L 21 L 22 L 22 J 22 S 22 M 22 V 22 Le 1er janvier, S 23 M 23 M 23 V 23 D 23 M 23 D 24 M 24 M 24 S 24 L 24 J 24 les collectes sont L 25 J 25 J 25 D 25 M 25 V 25 décalées au M 26 V 26 V 26 L 26 M 26 S 26 lendemain M 27 S 27 S 27 M 27 J 27 D 27 J 28 D 28 D 28 M 28 V 28 L 28 V 29 L 29 J 29 S 29 M 29 S 30 M 30 V 30 D 30 M 30 D 31 M 31 L 31 Une question ? [email protected] 02 49 58 00 99 Contactez le service Gestion des déchets www.cc-sudvendeelittoral.fr 2021 CALENDRIER DE COLLECTE DES DÉCHETS > MOREILLES JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE Sacs jaunes J 1 D 1 M 1 V 1 L 1 M 1 V 2 L 2 J 2 S 2 M 2 J 2 S 3 M 3 V 3 D 3 M 3 V 3 Le mercredi D 4 M 4 S 4 L 4 J 4 S 4 (semaines paires) L 5 J 5 D 5 M 5 V 5 D 5 Sortez -

Patterns of Reptile Road-Kills in the Vendée Region of Western France
HERPETOLOGICAL JOURNAL 19: 135–142, 2009 Patterns of reptile road-kills in the Vendée region of western France Roger Meek Chasnais, France Road mortalities of two lizard and four snake species were recorded in the Vendée region of western France over a period of four years. Road-kills were more frequent in the foraging snakes Hierophis (= Coluber) viridiflavus and Natrix natrix as well as the lizard Lacerta bilineata, and lower in the small lizard Podarcis muralis and the sedentary snakes Vipera aspis and Natrix maura. Road-kills were found throughout the active year, with differences in size class and monthly frequencies in H. viridiflavus, N. natrix and L. bilineata commencing in June. Pearson rank correlation coefficients revealed a significant positive association between monthly road-kill and monthly live counts of H. viridiflavus and N. natrix, suggesting regular road crossings in these species. Road traffic volume was related to the number of road deaths using regression analysis of the log-transformed data. This gave an allometric equation with an exponent of 0.75, which was not significantly different from 1, the exponent required if road-kills increase in direct proportion to increasing road traffic volume. The highest traffic volume route showed lower than expected mortalities, but fewer numbers of species living in the vicinity. Models of road-kill vulnerability in H. viridiflavus and N. natrix, derived from the integration of size frequencies of road-kill and live distributions, predict high vulnerability in small and large individuals. In lizards, particularly L. bilineata, road basking is probably the main factor determining mortality, in addition to species velocities, traffic volumes, road widths, abundance at the sides of roads, and behaviour and activity patterns. -

Communes Actionnaires Mise À Jour Janvier 2017
Communes actionnaires Mise à jour janvier 2017 Cugand Noirmoutier en l'Ile La Bernardière Bouin La Bruffière L'Epine St Hilaire de Loulay Tiffauges St Philbert de Bouaine La Guérinière Treize Septiers St Aubin des Ormeaux Barbâtre Montaigu St Martin des Tilleuls Mortagne sur Sèvre Boufféré La Guyonnière Bois de Cené Les Landes Genusson La Verrie St Gervais St Laurent sur Sèvre Beauvoir sur Mer La Boissière de Montaigu Châteauneuf Rocheservière St Georges La Gaubretière de Montaigu St Malo du Bois Mallièvre Treize Vents La Garnache L'Herbergement Bazoges en Paillers St Urbain Chambretaud Montréverd La Barre de Monts Les Brouzils Chavagnes en Paillers Beaurepaire Les Epesses Sallertaine Froidfond Falleron Grand'Landes Les Lucs sur Boulogne La Rabatelière Les Herbiers Notre Dame de Monts La Copechagnière Challans St Fulgent St Mars la Réorthe St Etienne du Bois St Denis la Chevasse Mesnard la Barotière Le Perrier St Christophe du Ligneron Chauché Soullans St André St Paul en Pareds Sèvremont St Paul Mont Penit Beaufou Goule d'Oie Vendrennes St Jean de Monts Palluau La Chapelle Palluau Ste Florence Mouchamps Le Boupère Bellevigny Boulogne St Mesmin Commequiers L'Oie Maché Essarts- Rochetrejoux Pouzauges Notre Dame de Riez en-Bocage Le Poiré sur Vie Apremont Dompierre sur Yon St Hilaire de Riez La Merlatière St Prouant Montournais L'Ile d'Yeu St Maixent sur Vie Aizenay St Maixent sur Vie St Vincent Sterlanges La Meilleraie Tillay La Genétouze Le Fenouiller St Martin des Noyers St Germain de Prinçay Monsireigne St Révérend Coëx Menomblet Mouilleron -

CC Du Pays De La Châtaigneraie (Siren : 248500415)
Groupement Mise à jour le 01/07/2021 CC du Pays de la Châtaigneraie (Siren : 248500415) FICHE SIGNALETIQUE BANATIC Données générales Nature juridique Communauté de communes (CC) Commune siège La Tardière Arrondissement Fontenay-le-Comte Département Vendée Interdépartemental non Date de création Date de création 28/12/2000 Date d'effet 01/01/2001 Organe délibérant Mode de répartition des sièges Accord local Nom du président M. Valentin JOSSE Coordonnées du siège Complément d'adresse du siège Rond point des Sources de la Vendée Numéro et libellé dans la voie BP 5 Distribution spéciale Code postal - Ville 85120 LA TARDIERE Téléphone 02 51 69 61 43 Fax 02 51 52 69 20 Courriel [email protected] Site internet http://www.pays-chataigneraie.fr Profil financier Mode de financement Fiscalité professionnelle unique Bonification de la DGF non Dotation de solidarité communautaire (DSC) oui Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) non Autre taxe non Redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM) non Autre redevance non Population Population totale regroupée 15 974 1/4 Groupement Mise à jour le 01/07/2021 Densité moyenne 50,23 Périmètre Nombre total de communes membres : 18 Dept Commune (N° SIREN) Population 85 Antigny (218500056) 1 072 85 Bazoges-en-Pareds (218500148) 1 176 85 Breuil-Barret (218500379) 627 85 Cezais (218500411) 308 85 Cheffois (218500676) 1 006 85 La Chapelle-aux-Lys (218500536) 259 85 La Châtaigneraie (218500593) 2 601 85 La Tardière (218502896) 1 346 85 Loge-Fougereuse (218501252) 402 85 Marillet (218501369) 120 85 Menomblet -

Prefecture De La Vendee Liste Des Emplacements D
PREFECTURE DE LA VENDEE LISTE DES EMPLACEMENTS D'AFFICHAGE 2020 POUR L'ENSEMBLE DU DEPARTEMENT DE LA VENDEE Code Nombre Communes Canton Adresse canton emplacements - Place de l’hôtel de Ville (ex- La Mothe-Achard)) LES ACHARDS 17 TALMONT SAINT HILAIRE 2 - Place de la mairie (ex-La Chapelle-Achard) - "Salle des fêtes" - avenue Amiral Courbet L’AIGUILLON-sur-MER 9 MAREUIL SUR LAY DISSAIS 2 - "Cantine scolaire" - boulevard du Communal L’AIGUILLON-sur-VIE 15 SAINT HILAIRE DE RIEZ 1 - Foyer rural (rue de l'Eglise) - Rue des Jardins - près de la salle Georges Hillairiteau - Passage entre la Place des Halles et la Place de l’Hôtel de Ville AIZENAY 1 AIZENAY 4 - Centre de Loisirs - rue du Bourg aux Moines - Groupe scolaire Louis Buton - Rue du Pont de 4 mètres - Place du Champ de Foire ANGLES 9 MAREUIL SUR LAY DISSAIS 3 - Parking de l'école du Dauphin Bleu, rue Albert Deman - Salle polyvalente « la Détente Angloise » ANTIGNY 4 CHATAIGNERAIE (La) 1 - Place de la mairie APREMONT 2 CHALLANS 1 - Parking de la mairie - place du Calvaire - Mairie délégué d'Aubigny, Grand'rue - Groupe scolaire (rue de l'école) - Aubigny AUBIGNY-LES CLOUZEAUX 13 ROCHE SUR YON (La) 2 4 - Salle communale, Rue des Sports - Les Clouzeaux - Village de la Soulinière - Les Clouzeaux - Parking de la mairie - 34 rue Jacques de Maupéou - Auzay AUCHAY-SUR-VENDEE 5 FONTENAY LE COMTE 2 - Place de la Mairie - Chaix AVRILLE 17 TALMONT SAINT HILAIRE 1 - Mairie - 2 avenue du Général de Gaulle - Mairie (Rue de la Cure) BARBATRE 16 SAINT JEAN DE MONTS 3 - Ecole de la Fosse (rue de l'Estacade) -

Pays De La Châtaigneraie (85) | 2017
PORTRAIT ENVIRONNEMENT DE TERRITOIRE Pays de la Châtaigneraie (85) | 2017 Réalisation : CPIE Sèvre et Bocage Pour l'Union régionale des CPIE des Pays de la Loire Claire Boucheron - Laurent Desnouhes Janvier 2018 Les partenaires et fournisseurs de données Sommaire Géographie administrative du territoire Localisation du Pays de la Châtaigneraie dans la région des Pays de la Loire.................................. 4 Les communes qui composent le Pays de la Châtaigneraie............................................................. 6 Géographie physique du territoire Le relief............................................................................................................................................... 8 Les unités paysagères ligériennes.................................................................................................... 10 Milieux naturels Les cours d'eau et leur bassin versant............................................................................................. 12 L'état écologique des eaux de surface.............................................................................................14 Les zones humides.…....................................................................................................................... 16 Les étangs........................................................................................................................................ 18 Les mares........................................................................................................................................