Les Dessous De L'isère
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
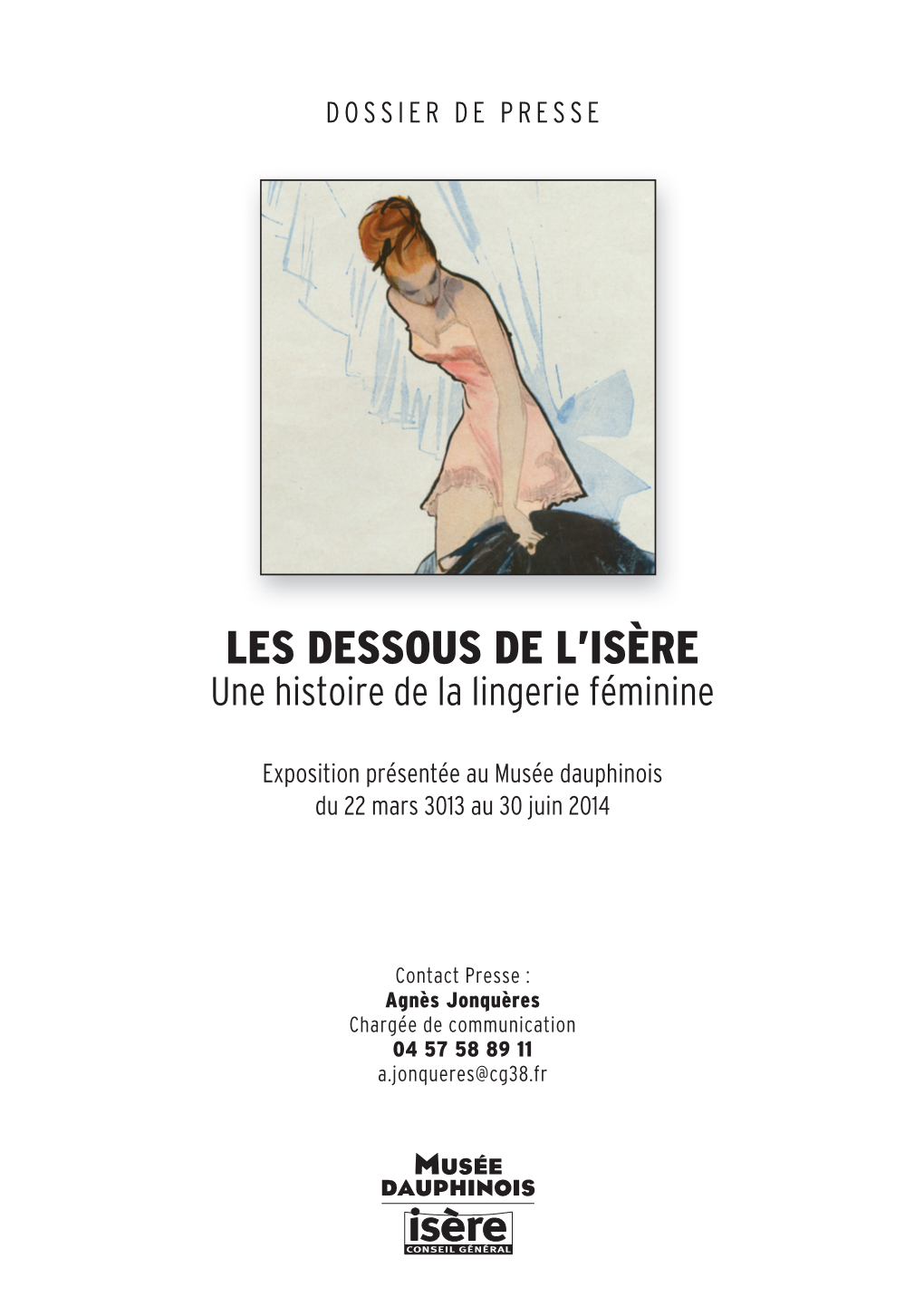
Load more
Recommended publications
-

Hanesbrands CDP Water 2017 Report
Water 2017 - Hanesbrands Inc. CDP Module: Introduction Page: W0. Introduction W0.1 Introduction Please give a general description and introduction to your organization HanesBrands, based in Winston-Salem, N.C., is a socially responsible leading marketer of everyday basic innerwear and activewear apparel in the Americas, Europe, Australia and Asia-Pacific. The company sells its products under some of the world’s strongest apparel brands, including Hanes, Champion, Maidenform, DIM, Bali, Playtex, Bonds, JMS/Just My Size, Nur Die/Nur Der, L’eggs, Lovable, Wonderbra, Berlei, and Gear for Sports. The company sells T-shirts, bras, panties, shapewear, underwear, socks, hosiery, and activewear produced in the company’s low-cost global supply chain. A member of the S&P 500 stock index, Hanes has approximately 68,000 employees in more than 40 countries and is ranked No. 432 on the Fortune 500 list of America’s largest companies by sales. Hanes takes pride in its strong reputation for ethical business practices. The company is the only apparel producer to ever be honored by the Great Place to Work Institute for its workplace practices in Central America and the Caribbean, and is ranked No. 110 on the Forbes magazine list of America’s Best Large Employers. For eight consecutive years, Hanes has won the U.S. Environmental Protection Agency Energy Star sustained excellence/partner of the year award – the only apparel company to earn sustained excellence honors. The company ranks No. 172 on Newsweek magazine’s green list of 500 largest U.S. companies for environmental achievement. More information about the company and its corporate social responsibility initiatives, including environmental, social compliance and community improvement achievements, may be found at www.Hanes.com/corporate. -

For Immediate Release
FOR IMMEDIATE RELEASE Contact – Lectra Headquarters / Press Dept.: Nathalie Fournier-Christol Email: [email protected] Tel.: +33 (0)1 53 64 42 37 – Fax: +33 (0)1 53 64 43 40 DBA adopts Lectra Fashion PLM V3 to manage collection lifecycles Paris, June 21, 2012 – Lectra, the world leader in integrated technology solutions dedicated to industries using soft materials—textiles, leather, industrial fabrics, and composite materials—is pleased to announce that the DBA Group has chosen Lectra Fashion PLM V3 to support a strategic change initiative intended to boost innovation, competitiveness, and quality of service. The multinational DBA Group is the European leader in lingerie, hosiery, and undergarments for men and women. The Group’s brand portfolio includes DIM, Playtex, Wonderbra, Nur Die, Abanderado, and Loveable. For more than 20 years, DBA has successfully leveraged Lectra’s apparel design and development solutions to create, produce, and distribute products. Over the years, a strong partnership has developed between the two companies. Faced with a constantly fluctuating textile market, the stakes for DBA are high: develop full visibility in order to strengthen control over development cycles and increase the capacity to deliver high quality, innovative products to consumers. DBA plans to reorganize operations and focus its expertise on harmonizing and improving product development across brands. “We chose Lectra because they place the same emphasis on customer satisfaction and market needs,” explains Xavier Lepingle, Chief Operations Officer at DBA. “In our apparel business, it is critical that we remain flexible in order to keep pace with the unpredictability of the market. -

HAAS SOCIALLY RESPONSIBLE INVESTMENT FUND Annual
HAAS SOCIALLY RESPONSIBLE INVESTMENT FUND Annual Report May 2018 Annual Report Haas Socially Responsible Investment Fund Table of Contents HSRIF 2017-2018 ANNUAL LETTER FROM THE FACULTY ADVISOR………………...i 1. INTRODUCTION ................................................................................................................ 1 2. PORTFOLIO PERFORMANCE ......................................................................................... 2 OVERALL PORTFOLIO........................................................................................... 2 CONCENTRATED EQUITIES PORTFOLIO ................................................................ 4 THE HSRIF’S LONG TERM PERFORMANCE .......................................................... 6 CONTRIBUTION TO THE CRB ............................................................................... 7 3. DESCRIPTION & RATIONALE FOR REBALANCING DECISIONS ............................... 8 REASSESSING THE KLD 400 ............................................................................... 8 ADDITION OF FACEBOOK ..................................................................................... 9 INCREASE IN HANES POSITION ........................................................................... 10 DECREASE IN MASTERCARD POSITION ............................................................... 10 4. DESCRIPTION & RESULTS OF STRATEGIC PROJECTS .......................................... 11 INVESTMENT BELIEFS & ESG APPROACH .......................................................... 11 IDEA -

Hanesbrands Inc. (Exact Name of Registrant As Specified in Its Charter)
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 8-K CURRENT REPORT Pursuant to Section 13 OR 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 Date of Report (Date of earliest event reported): October 27, 2016 Hanesbrands Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) Maryland 001-32891 20-3552316 (State or other jurisdiction (Commission File Number) (IRS Employer Identification of incorporation) No.) 1000 East Hanes Mill Road Winston-Salem, NC 27105 (Address of principal executive offices) (Zip Code) Registrant’s telephone number, including area code: (336) 519-8080 Check the appropriate box below if the Form 8-K filing is intended to simultaneously satisfy the filing obligation of the registrant under any of the following provisions: Written communications pursuant to Rule 425 under the Securities Act (17 CFR 230.425) Soliciting material pursuant to Rule 14a-12 under the Exchange Act (17 CFR 240.14a-12) Pre-commencement communications pursuant to Rule 14d-2(b) under the Exchange Act (17 CFR 240.14d-2(b)) Pre-commencement communications pursuant to Rule 13e-4(c) under the Exchange Act (17 CFR 240.13e-4(c)) Item 2.02. Results of Operations and Financial Condition On October 27, 2016, Hanesbrands Inc. (the “Company”) issued a press release announcing its financial results for the third quarter ended October 1, 2016. A copy of the press release is attached as Exhibit 99.1 to this Current Report on Form 8- K. Exhibit 99.1 is being “furnished” and shall not be deemed “filed” for purposes of Section 18 of the Securities Exchange Act of 1934 (the “Exchange Act”), nor shall Exhibit 99.1 be deemed incorporated by reference in any filing under the Securities Act of 1933 (the “Securities Act”) or the Exchange Act, except as shall be expressly set forth by specific reference in such filing. -

UNITED STATES SECURITIES and EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 8-K CURRENT REPORT Pursuant to Section 13 OR 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 Date of Report (Date of earliest event reported): August 29, 2014 Hanesbrands Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) Maryland 001-32891 20-3552316 (State or other jurisdiction (Commission File Number) (IRS Employer Identification No.) of incorporation) 1000 East Hanes Mill Road Winston-Salem, NC 27105 (Address of principal executive offices) (Zip Code) Registrant’s telephone number, including area code: (336) 519-8080 Check the appropriate box below if the Form 8-K filing is intended to simultaneously satisfy the filing obligation of the registrant under any of the following provisions: o Written communications pursuant to Rule 425 under the Securities Act (17 CFR 230.425) o Soliciting material pursuant to Rule 14a-12 under the Exchange Act (17 CFR 240.14a-12) o Pre-commencement communications pursuant to Rule 14d-2(b) under the Exchange Act (17 CFR 240.14d-2(b)) o Pre-commencement communications pursuant to Rule 13e-4(c) under the Exchange Act (17 CFR 240.13e-4(c)) Item 2.01 Completion of Acquisition or Disposition of Assets On August 29, 2014, Hanesbrands Inc. (the “Company”) completed its previously announced acquisition of DBA Lux Holding S.A. (“DBA”). Pursuant to a Share Purchase Agreement and a Supplement Deed to the Share Purchase Agreement, each dated as of August 25, 2014 (collectively, the “Transaction Documents”), by and among the Company, MFB International Holdings S.à r.l. -

Pacific Brands Board Unanimously Recommends Acquisition Proposal from Hanesbrands
28 April 2016 Pacific Brands Board unanimously recommends acquisition proposal from HanesBrands . Pacific Brands has entered into a Scheme Implementation Deed with HanesBrands to acquire 100% of Pacific Brands shares for A$1.15 per share in cash (‘Cash Consideration’) . The Cash Consideration represents: ‒ 13.5x F15 EV / EBITDA1 and 12.0x F16 EV / EBITDA based on broker consensus2 ‒ a 22% premium to Pacific Brands last closing price3 ‒ a 30% premium to the 5 day volume weighted average price of Pacific Brands shares4 ‒ a 26% premium to the 3 month volume weighted average price of Pacific Brands shares4 ‒ An implied market capitalisation of A$1.1 billion5 . HanesBrands unsolicited proposal represents a premium to current trading multiples and compares favourably to prior transactions in the global underwear and basic apparel sector . Pacific Brands proposes to pay a fully franked special dividend of 9.4 cents per Pacific Brands share (‘Special Dividend’) if the transaction proceeds, potentially providing an additional benefit of up to 4.0 cents per Pacific Brands share for shareholders who can capture the full benefit of the franking credits. To the extent the Special Dividend is paid, the Cash Consideration will be reduced by the cash amount of the Special Dividend . Those shareholders who are able to realise the full benefit of franking credits will receive $1.19 value per share in respect of the proposal, which represents a 34% premium to the 5 day volume weighted average price of Pacific Brands shares4. Whether a shareholder will be able to capture the full benefit of the franking credits will depend on their individual tax circumstances . -

Investor Day 2018 May 15 Safe Harbor
Investor Day 2018 May 15 Safe Harbor Forward-looking Statements These presentation slides and the related presentation contain certain forward-looking statements, as defined under U.S. federal securities laws, with respect to our long-term goals and trends associated with our business, as well as guidance or projections as to future performance. These forward-looking statements are based on our current intent, beliefs, plans and expectations. The audience is cautioned not to place any undue reliance on any forward-looking statements. Forward-looking statements necessarily involve risks and uncertainties, many of which are outside of our control, that could cause actual results to differ materially from such statements and from our historical results and experience. These risks and uncertainties include such things as: • the highly competitive and evolving nature of the industry in which we compete; • the rapidly changing retail environment; • any inadequacy, interruption, integration failure or security failure with respect to our information technology; • the impact of significant fluctuations and volatility in various input costs, such as cotton and oil-related materials, utilities, freight and wages; • our ability to properly manage strategic projects; • significant fluctuations in foreign exchange rates; • our ability to attract and retain a senior management team with the core competencies needed to support our growth in global markets; • legal, regulatory, political and economic risks related to our international operations; • our ability to successfully integrate acquired businesses; • our reliance on a relatively small number of customers for a significant portion of our sales; and • other risks identified from time to time in our most recent Securities and Exchange Commission reports, including our annual report on Form 10-K and quarterly reports on Form 10-Q. -

Qualitative Observations on the Design of Sports Bras for Wear
DesTech Conference Proceedings The International Conference on Design and Technology (2017), Volume 2017 Conference Paper Qualitative Observations on the Design of Sports Bras for Wear under Body Armour Sara Elizabeth Niemczyk, Lyndon Arnold, and Lijing Wang School of Fashion and Textiles, RMIT University, Brunswick, VIC 3056, Australia Abstract This paper presents the results of preliminary research designed to explore in depth the design, fit and comfort of selected sports bras for large breasted women worn under soft body armour. Female armed personnel need to feel safe and protected in soft armour vests, giving them physiological comfort to perform their duties daily. Troublesome physical and additional physiological problems in relation to the female body are frequently caused due to the poor design of various bra components. Different breast sizes require unique bras designs. Specifically, when it comes to plus-size breasts, all the difficulties of fitting are more evident. In general, retail bra designs are not overcoming the above-mentioned bra’s wear problems even before consideration of how they relate to be worn under the soft body armour. As breast size and shape vary greatly between individuals, the design of bra size and style are important. In addition, fit and comfort are the most important factors of concern to the customers. With an aim to achieve a perfect bra shape, fit and Corresponding Author: Lijing comfort, designers have a strong drive to develop a superior quality bra by properly Wang; email: [email protected] using components and materials with high performance. Five commercial sports bras were selected based on their suitability for wear under Received: 28 November 2016 body armour. -

Global Underwear Market 2014
GLOBAL UNDERWEAR MARKET 2014 August 2014 Global Underwear Market 2014 General Information Product Details Language: English Format: PDF & Power Point Number of Pages/Charts: 153 Covered Countries/Regions: USA, Brazil, Germany, France, UK, Italy, Spain, Russia, Turkey, China, Japan, India, South Korea, Australia, Saudi Arabia, Egypt Prices Single User License: € 3,950 (excl. VAT) € 1,950 (excl. VAT) Site License: € 5,925 (excl. VAT) € 2,925 (excl. VAT) Global Site License: € 7,900 (excl. VAT) € 3,900 (excl. VAT) Questions Answered in This Report What is the current state of the global underwear market and what are the major trends? How do underwear market conditions and growth prospects differ across various countries? Which countries show the fastest current and expected growth rate in underwear sales? What are the trends in imports and exports of underwear in various markets? Who are the major players on the underwear market in different countries? - 2 - Global Underwear Market 2014 Key Findings (1 of 2) Emerging Economies Lift Global Underwear Market The latest publication of Hamburg-based business intelligence organization yStats.com “Global Underwear Market 2014” reveals a variety of trends at work affecting sales of this commodity worldwide. While some market leaders are familiar, there are also new stars rising. Some markets have sluggish or negative growth, and at the same time there is rapid increase in other countries. The yStats.com publication finds that expansion in the global underwear market in the near future will come primarily from emerging markets where consumers with growing incomes increase their spending on this category. Growth is expected also from product segments with untapped potential in the advanced markets, such as functional underwear and plus size lingerie. -

Global Underwear Market 2014
GLOBAL UNDERWEAR MARKET 2014 August 2014 Global Underwear Market 2014 General Information Product Details Language: English Format: PDF & Power Point Number of Pages/Charts: 153 Covered Countries/Regions: USA, Brazil, Germany, France, UK, Italy, Spain, Russia, Turkey, China, Japan, India, South Korea, Australia, Saudi Arabia, Egypt Prices Single User License: € 3,950 (excl. VAT) Site License: € 5,925 (excl. VAT) Global Site License: € 7,900 (excl. VAT) Questions Answered in This Report What is the current state of the global underwear market and what are the major trends? How do underwear market conditions and growth prospects differ across various countries? Which countries show the fastest current and expected growth rate in underwear sales? What are the trends in imports and exports of underwear in various markets? Who are the major players on the underwear market in different countries? - 2 - Global Underwear Market 2014 Key Findings (1 of 2) Emerging Economies Lift Global Underwear Market The latest publication of Hamburg-based business intelligence organization yStats.com “Global Underwear Market 2014” reveals a variety of trends at work affecting sales of this commodity worldwide. While some market leaders are familiar, there are also new stars rising. Some markets have sluggish or negative growth, and at the same time there is rapid increase in other countries. The yStats.com publication finds that expansion in the global underwear market in the near future will come primarily from emerging markets where consumers with growing incomes increase their spending on this category. Growth is expected also from product segments with untapped potential in the advanced markets, such as functional underwear and plus size lingerie. -

The Year in Fashion
THE YEAR IN FASHION WWDFRIDAY, DECEMBER 19, 2014 ■ $3.00 ■ WOMEN’S WEAR DAILY Terry J. Lundgren NEWSMAKER OF THE YEAR Macy’s Inc.’s chief executive offi cer is the staunchest defender of the department store and one of retailing’s most innovative players, fulfi lling omnichannel initiatives, setting a site for Macy’s fi rst overseas store and unveiling a dramatic renovation at Herald Square, among other major accomplishments this year. THE TOP 12 STORIES 1. ALIBABA’S MAGIC TOUCH 2. OSCAR DE LA RENTA: PASSING OF AN ICON 3. TECH WEARABLES GET REAL 4. THE MARIGAY MOVEMENT 5. THE SAGA OF SEARS 6. THE CYBER FRAUD EPIDEMIC 7. ETERNAL YOUTH 8. ACTIVE TAKES OFF 9. THE FLIGHT OF DOV CHARNEY 10. THE ITALIAN TAX MAN 11. ALL THINGS KARDASHIAN 12. GAULTIER’S BOLD MOVE PLUS: ● They Said It ● Beauty’s Biggies ● Party Hardy PHOTO BY KYLE ERICKSEN T:21 in S:20.5 in S:13.375 in T:13.875 in T:13.875 44765RL_WWD_TRIBUTE_AD.indd 1 12/18/14 1:57 PM MISC. PRINT SPECS Stock: SNAP Quantity: N/A Inks: 4c Process Match PMS 295C & PMS 7406C Notes/Misc: Logo page - yellow = 4c tint match 7406C and blue = 4c tint match 295C T:21 in S:20.5 in S:13.375 in S:13.375 in T:13.875 in in T:13.875 T:13.875 44765RL_WWD_TRIBUTE_AD.indd 1 12/18/14 1:57 PM MISC. PRINT SPECS Stock: SNAP Quantity: N/A Inks:Inks: 4c Process Match PMS 295C & PMS 7406C Notes/Misc: LogoLogo pagepage -- yellowyellow == 4c4c tinttint matchmatch 7406C7406C andand blueblue == 4c4c tinttint matchmatch 295C295C 4 WWD FRIDAY, DECEMBER 19, 2014 WWD.COM Calvin’s E-commerce Push DIGITAL BRIEFING BOX FOR MORE COVERAGE, FIND US ON WWD.COM, SOCIAL AND MOBILE. -

Lingerie (Fabrication Et Distribution)
Lingerie (fabrication et distribution) Juin 2007 / DSY & GJO / ISE Zoom Consommation des ménages en vêtements de dessous unité : % des variations annuelles en volume, estimation et prévision Xerfi / Source : INSEE 7-DIS-09/X7 5% 4,6% 4,4% NAF : 52.4C/18.2G 3,8% NACE : 52.42/18.23 4% CITI : 5240/18.10 3% Prévisions 2007 2,1% 2% Consommation 1,2% -0,5% des ménages (volume) 1% Production (volume) -2,0% 0% -0,3% -0,3% Les chiffres clés (*) -1% -0,5% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006(e) 2007(p) Conso. des ménages 8,5 MdE en vêtements de dessous Croissance en valeur 0,0% A retenir Croissance en volume -0,3% Pas d’embellie pour les ventes de lingerie en 2007. Dans Prix à la consommation 0,3% la lignée des deux précédentes années, la consommation Production -9,9% des ménages en vêtements de dessous restera sur une Solde commercial -2,3 MdE tendance baissière (-0,5% en volume). Pris en étau entre Croissance imports 3,6% les dépenses contraintes et l’engouement pour les biens Croissance exports 8,7% technologiques et de loisirs, les Français rognent sur leurs Les fabricants leaders (*) dépenses en habillement, dont la lingerie. En valeur, la CHANTELLE FRANCE demande n’est pas plus dynamique du fait de la faible DIM croissance des tarifs, résultat de la hausse des produits PETIT BATEAU importés à bas prix, mais aussi du succès des lots sur le TRIUMPH INTERNATIONAL segment des sous-vêtements masculins. (*) classement alphabétique Dans un tel contexte, les offensives des distributeurs Les enseignes leaders (*) s’accentuent.