Composer Sous Vichy
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
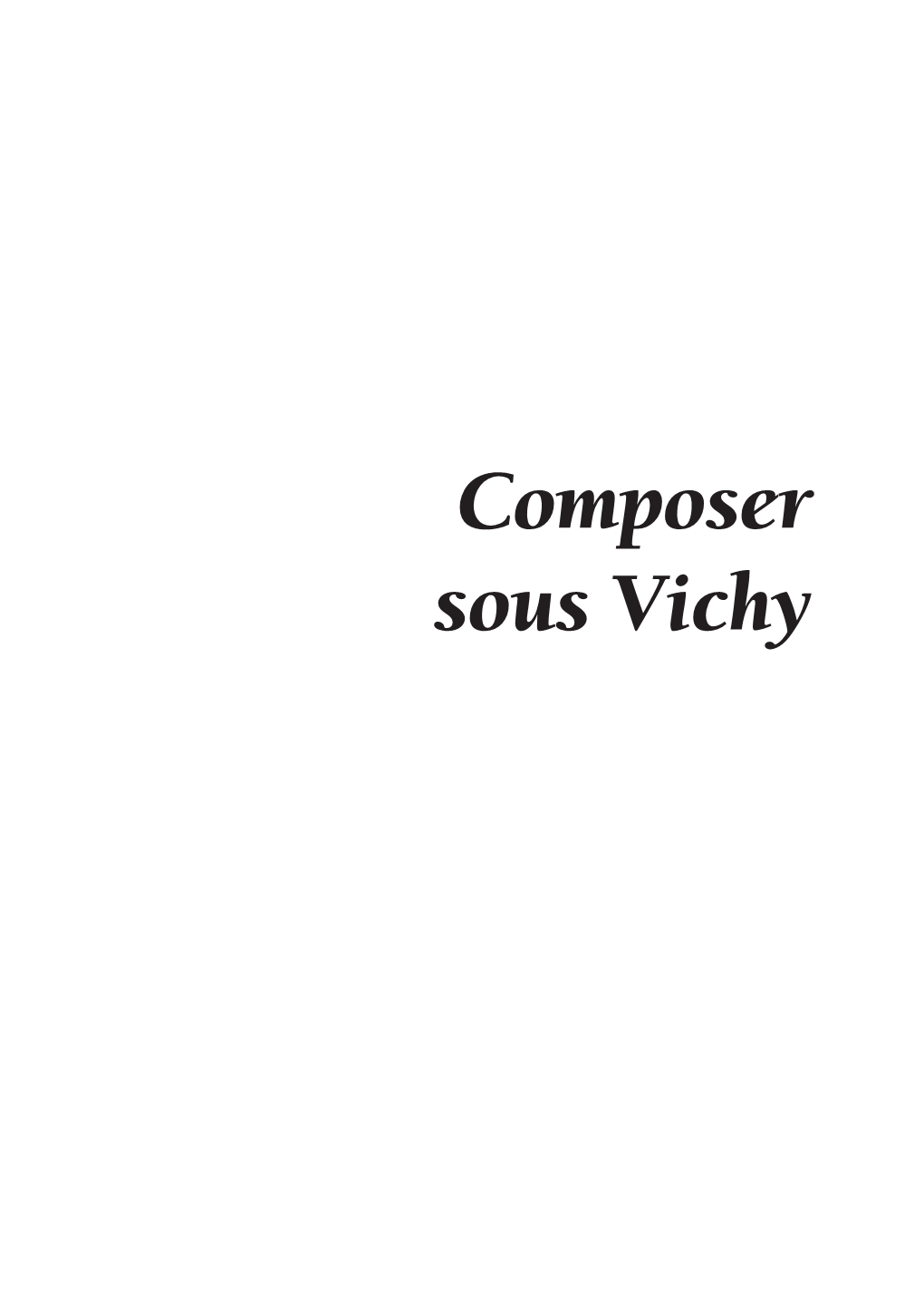
Load more
Recommended publications
-
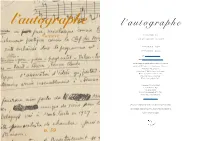
L'autographe SA
l’autographe L’autographe S.A. 24 rue du Cendrier, CH - 1201 Genève +41 22 510 50 59 (mobile) +41 22 523 58 88 (bureau) web: www.lautographe.com mail: [email protected] All autographs are offered subject to prior sale. Prices are quoted in EURO and do not include postage. All overseas shipments will be sent by air. Orders above € 1000 benefts of free shipping. We accept payments via bank transfer, Paypal and all major credit cards. We do not accept bank checks. Postfnance CCP 61-374302-1 3, rue du Vieux-Collège CH-1204, Genève IBAN: CH 94 0900 0000 9175 1379 1 SWIFT/BIC: POFICHBEXXX paypal.me/lautographe The costs of shipping and insurance are additional. Domestic orders are customarily shipped via La Poste. Foreign orders are shipped via Federal Express on request. Autographs and manuscripts 1. Franco Alfano (Posillipo, 1875 - Sanremo, 1954) Autograph musical quotation signed “Franco Alfano” dated “Torino 5 Marzo 927” by the Italian composer and pianist, best known for his opera Resurrezione (1904) and for having completed Giacomo Puccini’s Turandot (1926). Alfano inscribes 5 bars of a Lento from the 2nd act his opera Resurrezione, dedicating it to the “Valentissima signor.na Giannina Rota con ammirazione”. One page (17 cm x 13,5 cm), in fine condition. € 120 2. Albert I, King of Belgium (Bruxelles, 1875 - Marche-les-Dames, 1934) 3. Augustus II (Dresden 1670 - Warsaw 1733) Photograph signed “Albert, 1918” by the King of Belgium from 1909 until his death. Albert I had Document signed “Augusto Re” dated “Dresda 13. Genn.ro 1722” by the Elector of Saxony as Frederick bravely led the Belgian army while the Belgian government took refuge in Saint-Adresse, France during Augustus I and King of Poland from 1709. -

“L'art N'a Pas De Patrie?” Musical Production and Resistance in Nazi
Title Page “L’art n’a pas de patrie?” Musical Production and Resistance in Nazi-Occupied Paris, 1940-1944 by Julie Ann Cleary B.M. in Clarinet Performance, Rhode Island College, 2012 M.F.A. in Historical Musicology, Brandeis University, 2014 Submitted to the Graduate Faculty of the Kenneth P. Dietrich School of Arts & Sciences in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy University of Pittsburgh 2019 Committee Membership Page UNIVERSITY OF PITTSBURGH DIETRICH SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES This dissertation was presented by Julie Ann Cleary It was defended on April 22, 2019 and approved by Dr. Olivia Bloechl, Professor, Department of Music Dr. Lisa Brush, Professor, Department of Sociology Dr. Michael Heller, Associate Professor, Department of Music Dr. Deane L. Root, Professor, Department of Music Dissertation Director: M.A. James P. Cassaro, Professor, Department of Music ii Copyright © by Julie Ann Cleary 2019 iii Abstract “L’art n’a pas de patrie?” Music Production and Resistance in Nazi-Occupied Paris, 1940-1944 Julie Ann Cleary, Ph.D. University of Pittsburgh, 2019 Scholarship from various fields including history, Vichy studies, sociology, and musicology have dissected myths surrounding the Occupation of France (1940-1944), which fall into two generalities of total collaboration or total resistance. The reality lies in the middle, in which many individuals participated in resistance or collaboration in a variety of degrees. I argue that composing, performing, and listening to music are substantial resistant acts, using the resistance movements in Occupied Paris as a case study. This study has two overarching goals. -

Der Phonographische Ernst Busch (Albis International 2005) Korrekturen Und Ergänzungen, März
Der Phonographische Ernst Busch (albis international 2005) Korrekturen und Ergänzungen, März. 2020 Zuarbeit u.a. durch Kurt Berg/Wittenberg, Jürgen Elsner /Berlin, Helmut Heinrich /Berlin; Jochen Kowalski /Berlin, David Mason /London, Frank Oehme /München, Georg Richter (Hourdi) /Berlin, Carola Schramm, Berlin, Silvio Stock /Breese, auf Seite 22 hinter „FOX AUF 78“ ergänzen: und im Vorwort zum AMIGA-ETERNA-Katalog „Die ‚Ewige Freundin’“, albis- international, Dresden-Ústí: 2006. auf Seite 24 links unten nach der Erwähnung des „Ketten-Albums“ einfügen: Unabhängig von den Takes und den zwei Aufnahmezeiten von 1946 und 1947 wäre eine vollständige Belegung des Albums mit allen 10 Spanienliedern in folgender Kopplungen möglich. LdZ 101Spanien Juli 1936 / Die Thälmann-Kolonne LdZ 102Hans Beimler/ Jaramafront LdZ 103Der Revoluzzer / Einheitsfront LdZ 104Solidarität / Die Moorsoldaten LdZ 105Adelante Campesinos / Ballade der XI. Brigade In unterschiedlicher Zusammenstellung dieser fünf Best.=No. wurden von den folgenden 29 Takes sowie als dritte Variable die A- und B-Seite ca. 40 Veröffentlichungen realisiert. 566 Solidarität XI/47 567 Einheitsfront II/46 II/47 IV/47 568 Thälmann=Kolonne IV/46 I/47 IV/47 V/47 VI/47 569 Jaramafront I/47 IX/47 X/47 570 Hans Beimler I/46 571 Spanien Juli 1936 V/46 V/47 VI/47 XI/47 XII/47 572 Der Revoluzzer /46 I/47 II/47 573 Ballalde. d. deutschen Brigade /46 I/46 V/47 574 Die Moorsoldaten /46 I/47 588 Adelante. Campesinos I/47 VII/47 III/47T auf Seite 27, linke Spalte oben unter „20 000 Schallplatten“ richtigstellen : Lied der Zeit, und damit Ernst Busch, hatte 1950 zum Pfingsttreffen der deutschen Jugend (also nicht zu den III. -

MAURICE RAVEL Orchestral Works Vol
MAURICE RAVEL Orchestral Works Vol. 2 Ma mère l’oye Pavane pour une infante défunte Shéhérazade: Ouverture Une barque sur l’océan L’éventail de Jeanne: Fanfare Menuet antique Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR Stéphane Denève 02 Maurice Ravel (1875 – 1937) Musikalische Maskenspiele 03 1 Pavane pour une infante défunte [06:12] 9 Une barque sur l’océan [07:29] Maurice Ravels erste veröffentlichte Komposition Celesta waren zwei Harfen vorgesehen sowie zu- erschien 1898 unter dem paradox-anachronisti- sätzlich zur großen Bläserbesetzung ein Sarruso- 10 Ma mère l’oye Shéhérazade. Ouverture de féerie [13:30] schen Titel Menuet antique. Dass das Menuett phon, das im 19. Jahrhundert in Frankreich als Ballett in 6 Bildern für Orchester [29:50] dem Namen nach erst seit dem 16. Jahrhundert kräftigere Alternative zu Oboe und Fagott entwi- Deutsch 2 Prélude [03:35] 11 Menuet antique [07:02] existierte, wusste Ravel selbstverständlich, als er ckelt worden war. Die Uraufführung am 27. Mai 3 Danse du rouet et scène [03:47] die Komposition für Klavier 1895 vollendete. 1899 war nicht nur Ravels Debüt als Dirigent, son- 4 Pavane de la Belle au bois dormant [02:49] 12 Fanfare pour l’éventail de Jeanne [01:50] Dennoch verlieh er der Musik durch bestimmte dern auch ein ziemliches Debakel: „Wenn Herr 5 Les entretiens de la Belle et de la Bête [05:28] harmonische Mittel – etwa durch die Vermeidung Ravel glaubt, dass dies eine Ouvertüre nach der 6 Petit poucet [05:05] des Leittons oder durch einen mixolydischen klassischen Struktur ist [so hatte der Komponist 7 Laideronnette, impératrice des pagodes [05:04] TOTAL TIME [66:20] Schluss – einen Charakter, der antiken Tonarten im Programmheft behauptet], so muss man zuge- 8 Apothéose. -

Schriftenreihe Des Sophie Drinker Instituts Band 4
Schriftenreihe des Sophie Drinker Instituts Herausgegeben von Freia Hoffmann Band 4 Marion Gerards, Freia Hoffmann (Hrsg.) Musik – Frauen – Gender Bücherverzeichnis 1780–2004 BIS-Verlag der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 2006 Das Werk ist einschließlich aller seiner Teile urheberrechtlich ge- schützt. Jede Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechts bedarf der Zustimmung der Autorinnen. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Medien. © BIS-Verlag, Oldenburg 2006 Umschlaggestaltung: Marta Daul Layout und Satz: BIS-Verlag Verlag / Druck / BIS-Verlag Vertrieb: der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg Postfach 25 41, 26015 Oldenburg Tel.: 0441/798 2261, Telefax: 0441/798 4040 e-mail: [email protected] Internet: www.bis.uni-oldenburg.de ISBN 3-8142-0966-4 Inhaltsverzeichnis Vorwort 3 Hinweise zur Benutzung 5 1 Nachschlagewerke 9 1.1 Lexika und biographische Nachschlagewerke 9 1.2 Bibliographien 14 1.3 Notenverzeichnisse 17 1.4 Diskographien 22 2 Einführende Literatur 24 2.1 Kunstmusik 24 2.2 Populäre Musik (Jazz, Rock, Pop, Volksmusik, Chansons, Weltmusik u. ä.) 42 2.3 Stilübergreifend und Sonstige 50 3 Personenbezogene Darstellungen 54 3.1 Kunstmusik 54 3.2 Populäre Musik (Jazz, Rock, Pop, Volksmusik, Chansons, Weltmusik u. ä.) 320 3.3 Stilübergreifend und Sonstige 433 4 Spezielle Literatur 446 4.1 Kunstmusik 446 4.2 Populäre Musik (Jazz, Rock, Pop, Volksmusik, Chansons, Weltmusik u. ä.) 462 4.3 Stilübergreifend -

The Emergence of Spanish Impressionism
Abstract Title of dissertation: THE EMERGENCE OF SPANISH IMPRESSIONISM AND ITS INTERACTION WITH FRENCH IMPRESSIONISM IN MUSIC AT THE TURN OF THE TWENTIETH CENTURY: SELECTIONS FROM THE SOLO AND COLLABORATIVE PIANO REPERTOIRE Harmony Yang, Doctor of Musical Arts, 2016 Dissertation directed by: Professor Rita Sloan School of Music French Impressionism is a term which is often used in discussing music originating in France towards the end of the nineteenth century. The term Spanish Impressionism could also be used when discussing Spanish music written by the Spanish composers who studied and worked in Paris at the same time as their French counterparts. After all, Spanish music written during this time exhibits many of the same characteristics and aesthetics as French music of the same era. This dissertation will focus on the French and Spanish composers writing during that exciting time. Musical impressionism emphasizes harmonic effects and rhythmic fluidity in the pursuit of evocative moods, sound pictures of nature or places over the formalism of structure and thematic concerns. The music of this time is highly virtuosic as well as musically demanding, since many of the composers were brilliant pianists. My three dissertation recitals concentrated on works which exhibited the many facets of impressionism as well as the technical and musical challenges. The repertoire included selections by Spanish composers Manuel de Falla, Isaac Albéniz, Enrique Granados, Joaquín Turina, and Joaquín Rodrigo and French composers Claude Debussy and Maurice Ravel. The recitals were on April 30, 2013, February 23, 2014 and October 11, 2015. They included solo piano works by Granados and Albéniz, vocal works by Debussy, Ravel, de Falla, Turina and Rodrigo, piano trios by Granados and Turina, instrumental duos by Debussy, Ravel and de Falla, and a two-piano work of Debussy transcribed by Ravel. -

Georges Dandelot (1895-1975)
1/10 Data Georges Dandelot (1895-1975) Pays : France Langue : Français Sexe : Masculin Naissance : 02-12-1895 Mort : 17-08-1975 Note : Compositeur. - Critique musical. - Professeur au Conservatoire national supérieur de musique de Paris ISNI : ISNI 0000 0001 2123 2749 (Informations sur l'ISNI) Georges Dandelot (1895-1975) : œuvres (458 ressources dans data.bnf.fr) Œuvres musicales (217) Fantaisie et fugue Un vieux cimetière (1974) (1951) Le pont Mirabeau À Clotilde (1948) (1942) Symphonie. Ré mineur En vacances (1941) (1936) Chansons de Bilitis La belle Yolande (1929) (1924) "Sonates. Violoncelle, basse continue. Mi mineur. No 5. RV 40" de Antonio Vivaldi avec Georges Dandelot (1895-1975) comme Arrangeur Voir plus de documents de ce genre data.bnf.fr 2/10 Data Œuvres textuelles (13) Cent nouvelles dictées musicales à une voix, classées par Étude du rythme, en trois cahiers. 3e cahier. Rythmes ordre progressif (de moyenne force à très difficile). 2° simultanés recueil (1936) (1934) Théorie musicale. Questionnaire contenant quatre cents Cent dictées musicales assez faciles et de moyenne questions. à l'usage des élèves du degré supérieur difficulté classées par ordre progressif (1932) (1930) Vingt leçons de solfège en clé de sol, avec accompagnement de piano, classées par ordre progressif et précédées d'une notice sur les principes de la transposition Vingt leçons de solfège classées par ordre progressif (1929) (1929) Cent dictées musicales à une voix, classées par ordre progressif. Première partie : cinquante dictées faciles et de moyenne force. Deuxième partie : cinquante dictées assez difficiles et difficiles (1927) Voir plus de documents de ce genre Manuscrits et archives (227) "Dandelot, Georges (1895-1975). -

Maurice Ravel Chronology
Maurice Ravel Chronology by Manuel Cornejo 2018 English Translation by Frank Daykin Last modified date: 10 June 2021 With the kind permission of Le Passeur Éditeur, this PDF, with some corrections and additions by Dr Manuel Cornejo, is a translation of: Maurice Ravel : L’intégrale : Correspondance (1895-1937), écrits et entretiens, édition établie, présentée et annotée par Manuel Cornejo, Paris, Le Passeur Éditeur, 2018, p. 27-62. https://www.le-passeur-editeur.com/les-livres/documents/l-int%C3%A9grale In order to assist the reader in the mass of correspondence, writings, and interviews by Maurice Ravel, we offer here some chronology which may be useful. This chronology attempts not only to complete, but correct, the existent knowledge, notably relying on the documents published herein1. 1 The most recent, reliable, and complete chronology is that of Roger Nichols (Roger Nichols, Ravel: A Life, New Haven, Yale University, 2011, p. 390-398). We have attempted to note only verifiable events with documentary sources. Consultation of many primary sources was necessary. Note also the account of the travels of Maurice Ravel made by John Spiers on the website http://www.Maurice Ravel.net/travels.htm, which closed down on 31 December 2017. We thank in advance any reader who may be able to furnish us with any missing information, for correction in the next edition. Maurice Ravel Chronology by Manuel Cornejo English translation by Frank Daykin 1832 19 September: birth of Pierre-Joseph Ravel in Versoix (Switzerland). 1840 24 March: birth of Marie Delouart in Ciboure. 1857 Pierre-Joseph Ravel obtains a French passport. -

FRENCH CONCERTOS from the 19Th Century to the Present A
FRENCH CONCERTOS From the 19th Century to the Present A Discography Of CDs And LPs Prepared by Michael Herman Edited by Stephen Ellis Composers A-K LOUIS ABBIATE (1866-1933) Born in Monaco. He learned the piano, organ and cello as a child and then attended the Conservatories Turin and Paris where he studied the cello. He worked as a cellist in the Monte Carlo Orchestra and then at Milan's La Scala. He taught the cello at the St. Petersburg Conservatory for some years and after the Russian Revolution returned to Monaco and became the first director of its École Municipale de Musique. He composed orchestral, chamber, instrumental and vocal works. Concerto Italien in A major for Piano and Orchestra, Op. 96 (1922) Maurice Bousquet (piano)/Louis Frémaux/Orchestre du Théâtre National de l'Opéra de Monte Carlo ( + Monaecencis) ECCE MUSICA CM 306 (LP) (1970s) Concerto for Cello and Orchestra in D minor, Op. 35 (1895) Elaine Magnan (cello)/Louis Frémaux/Orchestre du Théâtre National de l'Opéra de Monte Carlo ( + Les Elfes and Le Songe d'Or) ECCE MUSICA CM 312 (LP) (1970s) Monaecencis for Piano and Orchestra, Op. 110 (1925) Maurice Bousquet (piano)/Richard Blareau /Orchestre du Théâtre National de l'Opéra de Monte Carlo ( + Concerto Italien) ECCE MUSICA CM 306 (LP) (1970s) JEAN-LOUIS AGOBET (b. 1968) Born in Blois, Loir-et-Cher, Centre. He studied composition and electronic music at the Ecole Normale de Musique in Aix-en-Provence, followed by further studies at the Conservatoire National à Rayonnement in Nice and then with Philippe Manoury at the Conservatoire de Lyon. -
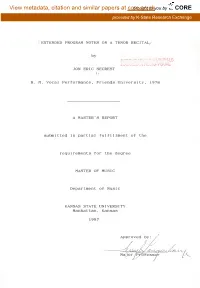
Extended Program Notes on a Tenor Recital
View metadata, citation and similar papers at core.ac.ukbrought to you by CORE provided by K-State Research Exchange EXTENDED PROGRAM NOTES ON A TENOR RECITAL/ by JON ERIC SECREST B. M. Vocal Performance, Friends University, 1978 A MASTER'S REPORT submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree MASTER OF MUSIC Department of Music KANSAS STATE UNIVERSITY Manhattan, Kansas 1987 Approved by •^'fcWA/>^^////. ^^^( v l^ IMIIIIII1IIIII TABLE OF CONTENTS Page Master's Recital Program 1 Historical and Musical Analysis 2 Texts and Translations 30 Bibliography 50 Abstract of the Master's Report 52 JON ERIC SECREST, TENOR Bachelor of Music, Friends University Assisted by A. Edward Wolfe, Piano Monday, November 17, 1986 All Faiths Chapel 8: 00 p.m. Malinconia, Ninfa gentile Vincenzo Bellini Vanne, o rosa fortunate (1801-1835) Bella Nice, che d'amore "Ich baue ganz auf deine Starke" w. a. Mozart from Die Entfuhrung aus dem Serai 1 (1756-1791) Don Quichotte a Dulcinee Maurice Ravel Chanson romanesque (1875-1937) Chanson epique Chanson a boire ich trage meine Minne, Op. 32, No. 1 . .Richard Strauss Heimliche Auf f orderung, Op. 27, No. 3 (1864-1949) Traum durch die Dammerung, Op. 29, No. 1 "Di rigori armato" from Per Rosenkaval i er Songs of Travel Ralph Vaughan Williams The Vagabond (1872-1958) Let Beauty Awake The Roadside Fire Youth and Love In Dreams The Infinite Shining Heavens Whither must I wander? Bright is the Ring of Words I have trod the Upward and the Downward Slope (1) (2) vincenzo Bellini (1801-1835) Vincenzo Bellini, Italian opera composer, was born into a musical family. -

The Record and Guide. 703
May 29, 1886 The Record and Guide. 703 ning of an enterprise the completion of which would so greatly THE RECORD AND GUIDE, advantage the metropolis and all who own real estate therein. Published every Saturday. 191 Broadweiv, N". 1?. The work of reconstructing New York city keeps right on, for in Our Telephone Call is JOHN 370. addition to the new houses in every street of any size can be seen the tearing away of old landmarks, to be replaced in time by struct TERMS: ures more worthy the city. But should not something be done to ONE YEAR, in advance, SIX DOLLARS. prevent the interruption to city travel by reason of new construc tion in business streets ? There ought to be an ordinance prevent Communications should be addressed to ing the tearing down or building of houses during business hours. C. W. SWEET, 191 Broadway. Night has been abolished, so far as building is concerned, by the J. T. LINDSBY, Business Manager. new iliuminants, especially the electric light, and there is no rea son why new construction should not be confined to the hours VOL. XXXVII. MAY 29, 1886. No. 950. between sunset and sunrise. Of course this would not be necessary in streets where there is little business transacted, but great avenues like Broadway should not be the scene of interruption during busi This is generally rather a slack season in ordinary business years, ness hours. but some of the markets have shown unwonted activity during the « past week. The new impulse was first felt in our stock mar The Democrats will try to push through the Morrison revised ket, which was taken hold of by the bulls here and in the West, tariff bill, but there does not seem much likelihood of an indorse and quotations were very smartly advanced. -

Musiciennes:Women Musicians in France During the Interwar Years
Musiciennes: Women Musicians in France during the Interwar Years, 1919-1939 Laura Ann Hamer Submitted for the Degree of Doctor of Philosophy Cardiff University, 2009 UMI Number: U584377 All rights reserved INFORMATION TO ALL USERS The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. In the unlikely event that the author did not send a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if material had to be removed, a note will indicate the deletion. Dissertation Publishing UMI U584377 Published by ProQuest LLC 2013. Copyright in the Dissertation held by the Author. Microform Edition © ProQuest LLC. All rights reserved. This work is protected against unauthorized copying under Title 17, United States Code. ProQuest LLC 789 East Eisenhower Parkway P.O. Box 1346 Ann Arbor, Ml 48106-1346 Abstract The musical life of interwar France (1919-39) has fascinated many writers; however, the part played by women musicians has been much neglected. This thesis seeks to rectify this situation by presenting a study of the activities and reception of the musiciennes of interwar France. The thesis is divided into three parts: part one provides a contextual framework within which to situate the pursuits of women musicians by considering both their contemporary social position and the gender- specific conditions which affect the lives, careers, and reception of musiciennes. Part two focuses on conductors and composers. Jane Evrard and her Orchestre feminin de Paris are discussed within the context of the contemporaneous development of the all woman orchestra and rise of the first professional female conductors.