Cahiers De La Méditerranée, 94
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
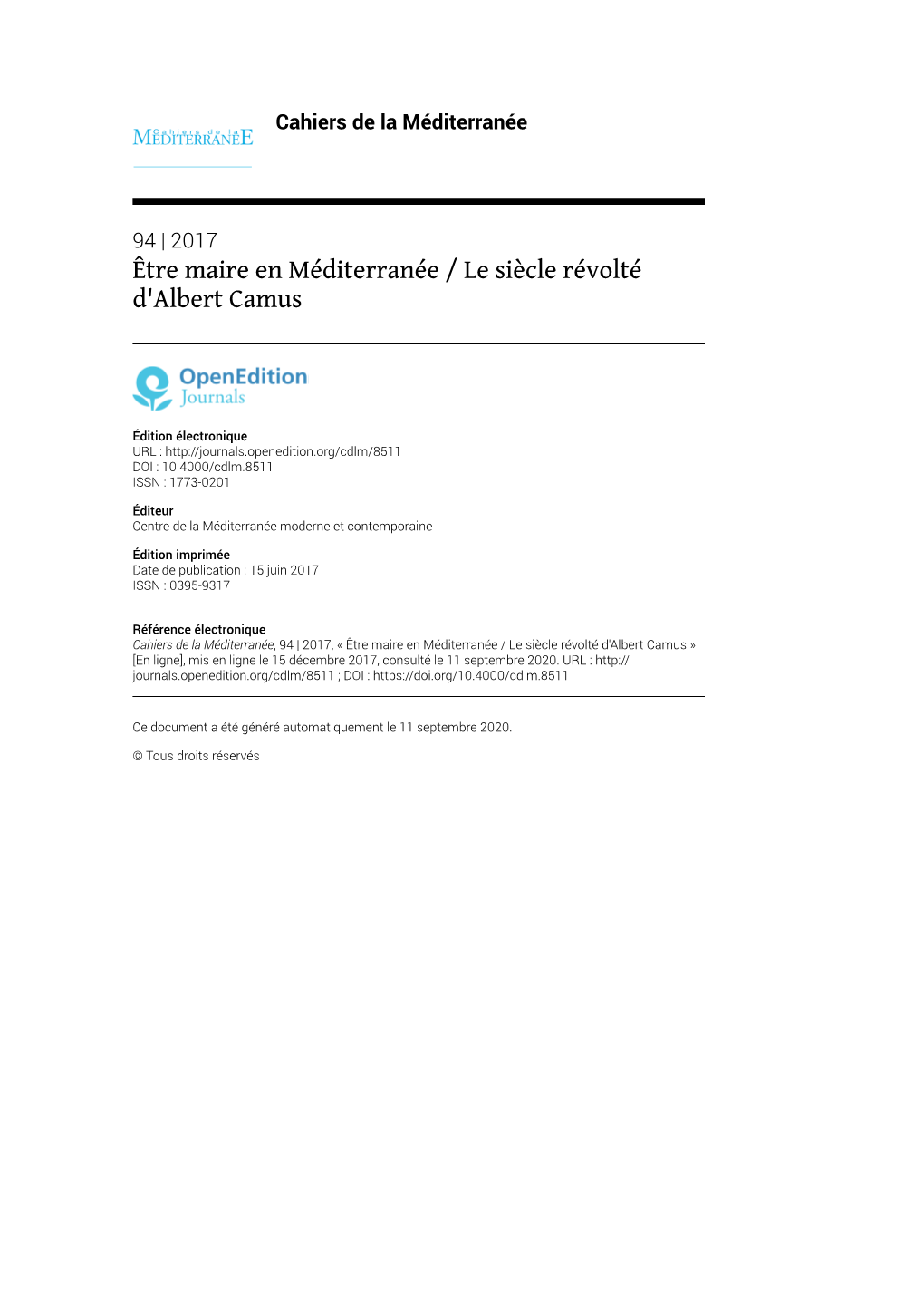
Load more
Recommended publications
-

The Labor Problem and the Social Catholic Movement in France
THE LABOR PROBLEM AND THE SOCIAL CATHOLIC MOVEMENT IN FRANCE ..s·~· 0 THE MACMILLAN COMPANY NEW VORIC • BOSTON • CHICAGO • DALlAS ATLANTA • SAN FRANCISCO MACMILLAN &: CO., LtMITIID LONDON • BOMBAY • CALC1/TTA MBLBOURNII THE MACMILLAN CO. OF CANADA, LTD. TORONTO THE LABOR PROBLEM AND THE SOCIAL CATHOLIC MOVEMENT IN FRANCE A Study in the History of Social Politics BY PARKER THOMAS MOON Instructor in History in Columbia University Jat\tl !llOtk THE MACMILLAN COMPANY 1921 COPYBIGilT, 1921, BY THE MACMILLAN COMPANY. Set up and printed. •Published Ma.y, 1921. !'BIN I'Bb lll' 'l.'lm l1NlTIII> S'l.'AflS OJ Alo!UIOA TO MY MOTHER PREFACE Nor until quite recently: in the United States, has anything like general public attention been directed to one of the most powerful and interesting of contemporary movements toward the solution of the insistent problem of labor unrest. There is a real need for an impartial historical study of this movement and a critical analysis of the forces which lie behind it. Such a need the present narrative does not pretend to satisfy com pletely; but it is hoped that even a preliminary survey, such as this, ·will be of interest to those who concern themselves with the grave social and economic problems now confronting po litical democracy. The movement in question,- generally known as the Social Catholic movement,- has expanded so rapidly in the last few decades that it may now be regarded as a force compar able in magnitude and in power to international Socialism, or to Syndicalism, or to the cooperative movement. On the eve of the Great War, Social Catholicism was represented by or ganizations in every civilized country where there was any considerable Catholic population. -

2015-08-06 *** ISBD LIJST *** Pagina 1 ______Monografie Ni Dieu Ni Maître : Anthologie De L'anarchisme / Daniel Guérin
________________________________________________________________________________ 2015-08-06 *** ISBD LIJST *** Pagina 1 ________________________________________________________________________________ monografie Ni Dieu ni Maître : anthologie de l'anarchisme / Daniel Guérin. - Paris : Maspero, 1973-1976 monografie Vol. 4: Dl.4: Makhno ; Cronstadt ; Les anarchistes russes en prison ; L'anarchisme dans la guerre d'Espagne / Daniel Guérin. - Paris : Maspero, 1973. - 196 p. monografie Vol. 3: Dl.3: Malatesta ; Emile Henry ; Les anarchistes français dans les syndicats ; Les collectivités espagnoles ; Voline / Daniel Guérin. - Paris : Maspero, 1976. - 157 p. monografie De Mechelse anarchisten (1893-1914) in het kader van de opkomst van het socialisme / Dirk Wouters. - [S.l.] : Dirk Wouters, 1981. - 144 p. meerdelige publicatie Hem Day - Marcel Dieu : een leven in dienst van het anarchisme en het pacifisme; een politieke biografie van de periode 1902-1940 / Raoul Van der Borght. - Brussel : Raoul Van der Borght, 1973. - 2 dl. (ongenummerd) Licentiaatsverhandeling VUB. - Met algemene bibliografie van Hem Day Bestaat uit 2 delen monografie De vervloekte staat : anarchisme in Frankrijk, Nederland en België 1890-1914 / Jan Moulaert. - Berchem : EPO, 1981. - 208 p. : ill. Archief Wouter Dambre monografie The floodgates of anarchy / Stuart Christie, Albert Meltzer. - London : Sphere books, 1972. - 160 p. monografie L' anarchisme : de la doctrine à l'action / Daniel Guerin. - Paris : Gallimard, 1965. - 192 p. - (Idées) Bibliotheek Maurice Vande Steen monografie Het sociaal-anarchisme / Alexander Berkman. - Amsterdam : Vereniging Anarchistische uitgeverij, 1935. - 292 p. : ill. monografie Anarchism and other essays / Emma Goldman ; introduction Richard Drinnon. - New York : Dover Public., [1969?]. - 271 p. monografie Leven in de anarchie / Luc Vanheerentals. - Leuven : Luc Vanheerentals, 1981. - 187 p. monografie Kunst en anarchie / met bijdragen van Wim Van Dooren, Machteld Bakker, Herbert Marcuse. -

Anarchisme Français De 1950 À 1970 1
Anarchisme français de 1950 à 1970 1 Cédric Guérin Introduction “ Y en a pas un sur cent et pourtant ils existent La plupart fils de rien ou bien fils de si peu Qu’on ne les voit jamais que lorsqu’on a peur d’eux. ” C’est le 10 mai 1968, pendant la nuit des barricades, que Léo Ferré créa sa célèbre chanson “ Les anarchistes ”. Ce couplet traduit dans une certaine mesure la surprise des observateurs attentifs à la renaissance du drapeau noir lors des manifestations et des défilés de Mai. L’antibureaucratisme, l’autogestion, la spontanéité révolutionnaires sont autant de mots qui donnent à la révolte de Mai 1968 un caractère libertaire, et Edgar Morin peut écrire : “ C’est la renaissance intellectuelle de l’anarchisme, teinté de marxisme et de situation-nisme. ” Paradoxalement, c’est un fait acquis que les organisations “ officielles ” ne sont pas ou pratiquement pas intervenues dans les événements, alors que ceux-ci témoignent d’une indéniable présence intellectuelle de l’anarchisme ; même si on peut s’interroger sur la nature de l’anarchisme estudiantin décrit par Morin. Cette apparente contradiction entre l’inaction des organisations et l’explosion des thèmes libertaires détermine dans une large mesure le caractère spécifique de l’anarchisme, révolte à la fois individuelle et collective. Les traits de l’anarchisme sont difficiles à cerner. Ses “ maîtres ” n’ont presque jamais condensé leurs pensées en des traits systématiques. Quand, à l’occasion, ils en ont fait l’essai, ça n’a été qu’en de minces brochures de propagande et de vulgarisation, où n’en affluent que des bribes. -

Période 1871-1913
1 Période 1871-1913 : 2 ACRACIA : Suplemento a Tierra y Libertad Revista sociológica Barcelona Années : 1908 (Año I) : n°1 (Sept.), 2 (Oct.) 14 ASP 2106 1909 (Año II) : n°5 (Enero), 6 (Feb.) Fonds Lamberet ACTION (L’) : Réd. en chef : Bernard Lazare Paris Hebdomadaire 1896 : n°1 14 ASP 563 Continué par l’Action Sociale Fonds Picart ACTION ANARCHISTE (L’) : Organe révolutionnaire communiste Adm. Réd. : Jean Kroonen Retinnes-Micheroux Bimensuel 1913 (1ère année) : n°7 (30 juin) 14 ASP 585 Don Ancely ACTION ANTIMILITARISTE (L’) : Organe de combat Marseille Mensuel 1904 (Année I) : n°1 (15 sept.), n° spécial (5 nov.) 14 ASP 2203 Fonds Lamberet ACTION D’ART (L’) : Organe de l’individualisme héroïque Dir : André Colomer et Marcel Say Paris Bimensuel 3 1913 : n°1 à 18 14 ASP 29 Fonds Armand ACTION DIRECTE (L’) : Revue syndicaliste révolutionnaire Bureaux : 1 bis, Bd Magenta, Paris (10e) Années : 1903 : n°1 (juil.) à 5 (déc.) 14 AS 119 (1) 1904 : n°6 (janv./fév.) à 8 (août) 1905 : n°9 (fév.) ACTION DIRECTE (L’) : Réd. et adm. : 122, Quai Jemmapes, Paris (10e) 1908 (1ère année) : n°1 (15 janv.) à 32 (30 sept.) 14 AS 119 (1) ACTION SOCIALE (L’) : Réd. en chef : Bernard Lazare (Continue l’Action) Paris Hebdomadaire 1896 : n°2 à 5 14 ASP 563 Fonds Picart AFFAME (L’) : Organe communiste-anarchiste Adm. : 24 rue Fongate, Marseille Bimensuel 1884 (1ère année) : n°1 (15 mai) à 6 (9 août) 14 AS 119 (2) AFFRANCHI (L’) : Organe anarchiste paraissant irrégulièrement Raphaël Fraigneux, 28 Bd d’Anderlecht, Bruxelles Années : 1910 : n°1 (25 sept.), 3 (23 oct.), 4 (19 nov.), 5 (25 14 ASP 1109 déc.) Fonds Armand 1911 : n°6 (23 janv.), 7 (5 fév.), 7 (8 mars), 1 (31 mars), 2 (22 mai), 3 (10 mai), 6 (25 juil.), 6 (15 nov.) [sic] 1912 : n°7 (12 janv.), 8 (6 fév.), 8 (19 mars), 1 (2 avril), 2 (20 avril), 5 (30 mai), 9 (5 oct.), 10 (26 oct.) 4 1913 : n°2 (5 avril), 2 (22 mai), 2 (16 sept.), 3 (25 oct.), 4 (23 déc.) ALARME (L’) : Journal anarchiste continué par le Droit Anarchiste Hebdomadaire 1884 : avril à juin (coll. -

(1920-2010): Une Figure Internationale Du Communisme Libertaire
Alternative Libertaire n°198 Septembre 2010 Georges FONTENIS (1920-2010): une figure internationale du communisme libertaire ... La disparition de notre vieux camarade Georges Fontenis a été accueillie avec beaucoup d'émotion par les militantes et les militants d'Alternative, mais aussi par l’ensemble du courant communisme libertaire internatinal. La semaine de sa disparition, des message d'amitié nous sont parvenus des différents continents, du Chili à la Grèce en passant par l’Italie ou le Canada. Partout, les camarades rendaient hommage à un révolutionnaire qu’ils considèrent comme une référence. Georges, beaucoup d’entre nous l’avaient découvert en lisant ses Mémoires. On y suivait une vie qui, pendant plusieurs décennies, a été intimement lié à celle du mouvement ouvrier et de son courant libertaire. Ce mouvement, Georges en avait partagé les avancées, les reculs et les luttes passionnées. Militant politique, il savait tirer les enseignements des échecs, avec lucidité et franchise, sans se renier ni céder au découragement. Et cela représentait, pour ses camarades, pour nous tous, une certaine leçon d’humanité et de ténacité. Ceux et celles qui l’ont côtoyé dans ses combats en garderont, pour beaucoup, le souvenir d’un camarade chaleureux, bon vivant, doué d’humour et d’une grande droiture. Ce souvenir avive la douleur que nous partageons avec sa compagne Marie-Louise et avec sa famille. Georges Fontenis fut une grande figure. Alternative libertaire et, au delà, le courant communiste libertaire international savent ce qu’ils lui doivent, et c’est pour cette raison que nous rendons hommage à un homme qui, désormais, appartient à l’Histoire. -

Village De Ferais, Vers 1851
Minas e minurs Le causse de Mondalazac possède sur une étendue de près de huit- cents hectares, une couche de minerai de fer dont l’épaisseur varie d’un tAtniU» BE l'ATETEOM. mètre à deux mètres cinquante. Il s’agit d’une hématite rouge à gangue essentiellement calcaire dont la teneur en fer est de 18 à 28 %. La décou verte de cette richesse naturelle remonte à bien longtemps. A CONCESSION des Mines de Fer l>B SOLSAC ET MONDALAZAC, A l’origine, le duc Decazes... Le 16 juin 1826, la Société des houillères et fonderies de l’Aveyron est créée. Le principal actionnaire en est le duc Decazes. La Société a pour but la production de fonte et la fabrication d’acier. Cet indus triel, pour rendre plus productive son usine de la Forézie, près de Firmi, ne pouvait se contenter de ses seules concessions de la Sala et de Firmi. Dès 1827, l’acquisition de nouvelles concessions fut décidée : les mines de houille de Cérons et Palayret, et les mines de fer de Montbazens, Lugan, Roussennac, Aubin, Veuzac, Kaymar, Solsac et Mondalazac. Le commencement... L’ensemble de ces concessions couvrait plus de quatre-mille-huit-cent- cinquante hectares. La concession de Solsac et Mondalazac fut accordée au duc Deca zes, par ordonnance royale, le 23 janvier 1828. Les premières recherches Ml A Mondalazac on garde encore le souvenir des premières recherche? : “Ma grand-mère me disait que quand ils ont commencé d’extraire, deux ingénieurs du bassin sont arrivés avec un bâton et un baluchon et ils sor taient le minerai sur le dos, presque à quatre pattes. -

Théories Et Essais Utopiques Libertaires Pédagogiques L'importance
Michel ANTONY THÉORIES ET ESSAIS UTOPIQUES LIBERTAIRES PÉDAGOGIQUES L'IMPORTANCE DES « UTOPÉDAGOGIES » VII. B. Les utopédagogies Page 1/241 VII. ESSAIS UTOPIQUES LIBERTAIRES DE « PETITE » DIMENSION : 2° partie sur LES MICROCOSMES. B. THÉORIES ET ESSAIS UTOPIQUES LIBERTAIRES PÉDAGOGIQUES : L'IMPORTANCE DES « UTOPÉDAGOGIES »1 VII. ESSAIS UTOPIQUES LIBERTAIRES DE « PETITE » DIMENSION :............................................................................ 2 B. THÉORIES ET ESSAIS UTOPIQUES LIBERTAIRES PÉDAGOGIQUES : L'IMPORTANCE DES « UTOPÉDAGOGIES » ................... 2 1. Un arrière plan théorique et expérimental très important et très riche : ................................................................ 7 a) Quelques précurseurs plus ou moins libertaires… ........................................................................................................... 7 b) L’innovant Charles FOURIER, le prudent Victor CONSIDÉRANT et quelques autres disciples… Présentation de «l'éducation naturelle ou harmonienne».................................................................................................................................... 11 c) Les premiers anarchistes : William GODWIN et Mary WOOLSTONECRAFT................................................................ 30 d) L’éducation exigeante de Max STIRNER ....................................................................................................................... 32 e) Primauté du travail et de l’éducation chez PROUDHON : pour une démopédie ........................................................... -
La Biblioteca Hemeroteca I Arxiu Del AEP
La Biblioteca Hemeroteca i Arxiu del AEP /CDHS disposa actualment d’uns 26000 (llibres i follets) així com d’unes 8000 capçaleres de premsa (diaris, revistes butlletins, fanzines, circulars, etc) a més a més d’innumerables dossiers i de documentació d’arxiu relacionats amb els moviments obrers des de la Primera Internacional fins els nostres dies. (Documentació aquest ultima, que en aquest moment s’està començant a treballar i esperem que comenci a donar resultats profitosos dintre d’un any ). Ara be, retornant a l ‘apartat d’Hemeroteca i com aquesta informació la tenim en suport de paper (fitxa tècnica) i en procés d’informatització, mentres tant poc a poc però sense pauses transcriurem i donarem a conèixer en aquest apartat de Biblioteca de la nostra web bona part de la documentació de la que som dipositaris i gestors amb el fi de ajudar a tots aquells interessats per la història contemporània i els moviments socials. Amb el fi de que des de el seu lloc d’origen es pugui desenvolupar un treball previ a la consulta del document, en aquest cas amb l’apartat de “Premsa” Dades més comunes : Nom de la publicació amb Negreta, Subtítol, editor, lloc d’edició, format , any de publicació amb color Fucsia números que disposem de la publicació entre guió (-) inclou tots els números entre si mateixos i en color Blau la ubicació topogràfica dins de l’Hemeroteca de l’AEP /CDHS També volem fer una crida a altres entitats, col·lectius, socis, amics e interessats per l’ història per què ens ajudin a completar cada una de les col·leccions de premsa, per disposar cada dia més d’una millor i més gran hemeroteca sobre els moviments obrers i socials. -

1° Partie Sur LES MICROCOSMES
VII. ESSAIS UTOPIQUES LIBERTAIRES DE « PETITE » DIMENSION : 1° partie sur LES MICROCOSMES. VII. ESSAIS UTOPIQUES LIBERTAIRES DE « PETITE » DIMENSION :.....................................................................1 A. L’EXTREME VARIETE DES « MICROCOSMES » LIBERTAIRES , ALTERNATIFS ET AUTOGESTIONNAIRES ... :...............................2 1. Des définitions fort diverses pour cet « anarchisme mode de vie » et d’action ....................................................2 a) Définitions et analyses «classiques» :.............................................................................................................................. 2 b) Nouveaux Mouvements sociaux : anti-globalisation, Indignés… ..................................................................................... 9 2. Quelques essais souvent spécifiquement urbains : ............................................................................................13 a) Une communauté de « réfractaires » autour de « l’anarchie » :..................................................................................... 14 b) D’innombrables ateliers communautaires, coopératives, fraternelles (Saint-Claude…) et associations de commerce équitable.................................................................................................................................................................................... 16 c) Essais mutualistes plus contemporains et liaison rural-urbain : trocs, monnaie sociale, échanges solidaires, auto- organisations communautaires, associations -

News of the Profession
NEWS OF THE PROFESSION I. The Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA): State of Affairs and Prospects 1. The Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA) up to 1991 1.1 Historical background The idea of a historical-critical edition of the collected works of Marx and Engels was raised even before 1914; at the time, however, it was not considered viable.1 After the October Revolution of 1917 David Ryazanov, who had already been committed to it previously, began work in Moscow to bring it to fruition. Appointed director of the newly founded Marx-Engels Institute at the beginning of 1921, he carried out comprehensive preparatory work, receiving support from the German Social Democratic Party, which at the time had the Marx-Engels papers in its possession.2 In 1927 the first volume of a projected forty-two volumes of the "first" MEGA (MEGA1) appeared in Frankfurt am Main with the support of the Institute for Social Research there. Eight more volumes followed between 1929 and 1932, published by the Marx-Engels-Verlag in Berlin. The "first" MEGA remained incomplete because of Hitler seizing power and Stalin's worsening terror since the late 1920s, to which Ryazanov as well as many of his collaborators also fell victims. Between 1933 and 1935 four more volumes were published by the Publishing Co-operative of Foreign Workers in the Soviet Union in Moscow and Leningrad. After that the edition was suspended. Marx's Grundrisse der Kritik der politischen Okonomie of 1857-58, published in two half-volumes by the Moscow Foreign Language Publishing House in 1939 and 1941, was prepared on MEGA principles but did not appear under this name. -

CIRCOLO CARLO VANZA Pag.1 Via Convento 4 CH-6500 Bellinzona (Canton Ticino) SVIZZERA
CIRCOLO CARLO VANZA pag.1 Via Convento 4 CH-6500 Bellinzona (Canton Ticino) SVIZZERA Nessun titolo su 5992 in archivio. AUTORE TITOLO EDIZIONE LUOGO ANNO SEGNATURA SETTORE ARGOMENTI pelloutier *** Lettere apocrife di Enrico Berlinguer MOB Verbania CVM Op14 Anarchismo Anarchismo; Italia *** Vademecum per il cittadino militare Nuovi Tempi Roma CVM Op36 Antimilitarismo Antimilitarismo; Italia *** Peace Plan of the German Government of 31.3.1936 Berlin CVM Op71 Antimilitarismo Antimilitarismo *** Astensionismo elettorale anarchico L'Internazionale CVM Op181 FL Anarchismo *** Lotte operaie in Spagna Collettivo editoriale Librirossi Milano CVM L150 Anarchismo, Storia Movimento operaio; Spagna CIRCOLO CARLO VANZA pag.2 Via Convento 4 CH-6500 Bellinzona (Canton Ticino) SVIZZERA Nessun titolo su 5992 in archivio. AUTORE TITOLO EDIZIONE LUOGO ANNO SEGNATURA SETTORE ARGOMENTI *** Manifest 77 CVM Doc012 Sindacato *** Convegno regionale dei delegati sindacali Zurigo CVM Doc014 Sindacato Svizzera *** Per un risveglio della coscienza. Messaggio degli Irochesi al mondo occidentale La Fiaccola Ragusa CVM L217 FL Scienze umane Scienze umane; Antropologia/Etnologia; NordAmerica *** F. Domela Nieuwenhuis De As 87 CVM Op287 Anarchismo *** Manifesto degli Anarchici Contro il militarismo La Rivolta Ragusa CVM Op294 Antimilitarismo Antimilitarismo *** Le marxisme contre le maoïsme Novosti Moskwa CVM Op295 Socialismo Comunismo *** Testimonianze sullo sviluppo della Rivoluzione Russa Reprint CVM Op301 Socialismo *** Six morts sur ordonnance Tout Va Bien Genève CVM Op323 FL Carcere *** Lotte operaie in Svizzera Nuovi Editori Zürich CVM Op343 Svizzera Movimento operaio; Autonomia; Svizzera *** Dedicato alla mia donna cicl. in prop. Torino CVM Op355 Anarchismo *** The History of Monte Verità Monte Verità S.A. Bellinzona CVM Doc025 Anarchismo / Ticino Utopia; Svizzera *** La casa borghese nel Cantone Ticino Mobili Pfister Contone CVM Op409 Ticino Anarchismo; Svizzera *** Guerre du peuple Vaugondry CVM L480 Storia *** La lupara e l'aspersorio. -

New Perspectives on Anarchism, Labour and Syndicalism
New Perspectives on Anarchism, Labour and Syndicalism New Perspectives on Anarchism, Labour and Syndicalism: The Individual, the National and the Transnational Edited by David Berry and Constance Bantman New Perspectives on Anarchism, Labour and Syndicalism: The Individual, the National and the Transnational, Edited by David Berry and Constance Bantman This book first published 2010 Cambridge Scholars Publishing 12 Back Chapman Street, Newcastle upon Tyne, NE6 2XX, UK British Library Cataloguing in Publication Data A catalogue record for this book is available from the British Library Copyright © 2010 by David Berry and Constance Bantman and contributors Cover image © Collection International Institute of Social History, Amsterdam All rights for this book reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the copyright owner. ISBN (10): 1-4438-2393-7, ISBN (13): 978-1-4438-2393-7 Pour François Poirier, qui aimait les anarchistes, le syndicalisme et les études transnationales. CB For René Bianco, for all the help and encouragement he gave a young and ignorant PhD student. DB TABLE OF CONTENTS Acknowledgements .................................................................................... ix Acronyms .................................................................................................... x Introduction ................................................................................................