La Terre Et La Vie
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
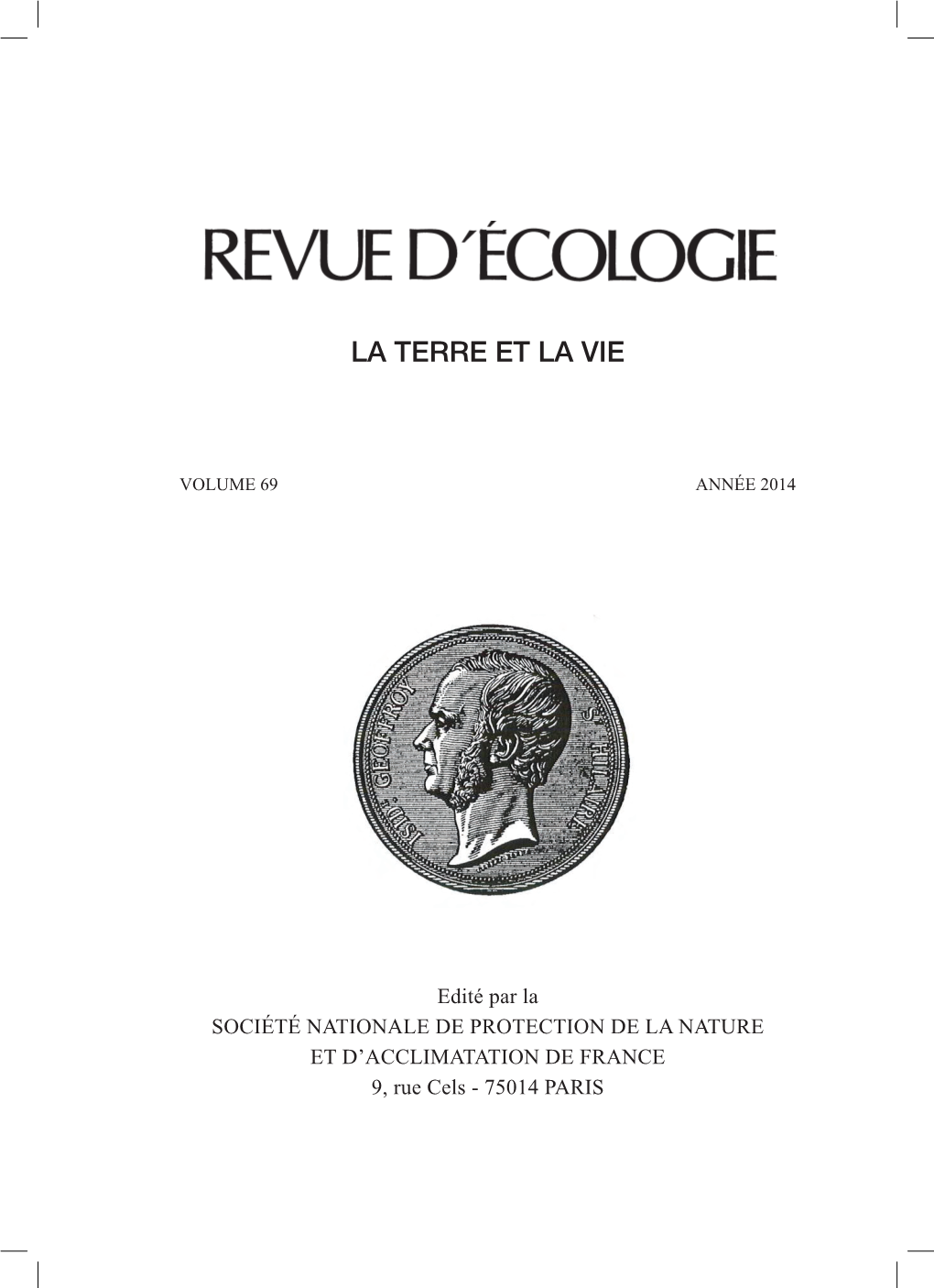
Load more
Recommended publications
-

MEMOIRE KADA RABAH Fatima Zohra Thème Etude Comparative
République Algérienne Démocratique et Populaire Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique UNIVERSITE DE TLEMCEN Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie et Sciences de la Terre et de l’Univers Département d’Ecologie et Environnement Laboratoire d’Ecologie et Gestion des Ecosystèmes Naturels MEMOIRE Présentée KADA RABAH Fatima Zohra En vue de l’obtention du Diplôme de MASTER en ECOLOGIE VEGETALE ET ENVIRONNEMENT Thème Etude comparative des Fabacées de 1962 et actuellement dans la région de Tlemcen. Soutenue le 11-07-2017.devant le jury composé de : Président TABTI Nassima M.C.B Université de Tlemcen Encadreur STAMBOULI Hassiba M.C.A Université de Tlemcen Examinateur HASSANI Faïçal M.C.A Université de Tlemcen Année Universitaire : 2016 /2017 Remerciement Mes grands remerciements sont à notre Dieu qui m’a aidé et m’a donné le pouvoir, la patience et la volonté d’avoir réalisé ce modeste travail. me J’exprime ma profonde reconnaissance à M STAMBOULI- MEZIANE Hassiba – maître de conférences –, dont les conseilles et les critiquesm’ont été d’une grande aide, en suivant le déroulement de mon travail. Mr. HASSANI Faïçal; Maitre de conférence à l’Université Abou Bakr Belkaïd de Tlemcen, d’avoir accepté de juger ce travail et qu’il trouve ici toute ma sympathie. Mme TABTI Nassima ; Maître de conférences – d’avoir accepter de présider le jury de ce mémoire. Dédicaces Je dédie ce travail A mes très chérs parents qui m’on toujours soutenue malgré les difficultés du déroulement de ce travail. A mon frère : Mohammed. A mes sœurs : Wassila , Khadidja , Amina , et Marwa A Les enfants : Bouchra, Nardjesse, Meriem et Boumediene. -

Review with Checklist of Fabaceae in the Herbarium of Iraq Natural History Museum
Review with checklist of Fabaceae in the herbarium of Iraq natural history museum Khansaa Rasheed Al-Joboury * Iraq Natural History Research Center and Museum, University of Baghdad, Baghdad, Iraq. GSC Biological and Pharmaceutical Sciences, 2021, 14(03), 137–142 Publication history: Received on 08 February 2021; revised on 10 March 2021; accepted on 12 March 2021 Article DOI: https://doi.org/10.30574/gscbps.2021.14.3.0074 Abstract This study aimed to make an inventory of leguminous plants for the purpose of identifying the plants that were collected over long periods and stored in the herbarium of Iraq Natural History Museum. It was found that the herbarium contains a large and varied number of plants from different parts of Iraq and in different and varied environments. It was collected and arranged according to a specific system in the herbarium to remain an important source for all graduate students and researchers to take advantage of these plants. Also, the flowering and fruiting periods of these plants in Iraq were recorded for different regions. Most of these plants begin to flower in the spring and thrive in fields and farms. Keywords: Fabaceae; Herbarium; Iraq; Natural; History; Museum 1. Introduction Leguminosae, Fabaceae or Papilionaceae, which was called as legume, pea, or bean Family, belong to the Order of Fabales [1]. The Fabaceae family have 727 genera also 19,325 species, which contents herbs, shrubs, trees, and climbers [2]. The distribution of fabaceae family was variety especially in cold mountainous regions for Europe, Asia and North America, It is also abundant in Central Asia and is characterized by great economic importance. -

State of New York City's Plants 2018
STATE OF NEW YORK CITY’S PLANTS 2018 Daniel Atha & Brian Boom © 2018 The New York Botanical Garden All rights reserved ISBN 978-0-89327-955-4 Center for Conservation Strategy The New York Botanical Garden 2900 Southern Boulevard Bronx, NY 10458 All photos NYBG staff Citation: Atha, D. and B. Boom. 2018. State of New York City’s Plants 2018. Center for Conservation Strategy. The New York Botanical Garden, Bronx, NY. 132 pp. STATE OF NEW YORK CITY’S PLANTS 2018 4 EXECUTIVE SUMMARY 6 INTRODUCTION 10 DOCUMENTING THE CITY’S PLANTS 10 The Flora of New York City 11 Rare Species 14 Focus on Specific Area 16 Botanical Spectacle: Summer Snow 18 CITIZEN SCIENCE 20 THREATS TO THE CITY’S PLANTS 24 NEW YORK STATE PROHIBITED AND REGULATED INVASIVE SPECIES FOUND IN NEW YORK CITY 26 LOOKING AHEAD 27 CONTRIBUTORS AND ACKNOWLEGMENTS 30 LITERATURE CITED 31 APPENDIX Checklist of the Spontaneous Vascular Plants of New York City 32 Ferns and Fern Allies 35 Gymnosperms 36 Nymphaeales and Magnoliids 37 Monocots 67 Dicots 3 EXECUTIVE SUMMARY This report, State of New York City’s Plants 2018, is the first rankings of rare, threatened, endangered, and extinct species of what is envisioned by the Center for Conservation Strategy known from New York City, and based on this compilation of The New York Botanical Garden as annual updates thirteen percent of the City’s flora is imperiled or extinct in New summarizing the status of the spontaneous plant species of the York City. five boroughs of New York City. This year’s report deals with the City’s vascular plants (ferns and fern allies, gymnosperms, We have begun the process of assessing conservation status and flowering plants), but in the future it is planned to phase in at the local level for all species. -

Cynoglossum L.: a Review on Phytochemistry and Received: 02-05-2016 Accepted: 03-06-2016 Chemotherapeutic Potential
Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry 2016; 5(4): 32-39 E-ISSN: 2278-4136 P-ISSN: 2349-8234 JPP 2016; 5(4): 32-39 Cynoglossum L.: A review on phytochemistry and Received: 02-05-2016 Accepted: 03-06-2016 chemotherapeutic potential Kalpana Joshi Devsthali Vidyapeeth College of Kalpana Joshi pharmacy, Rudrapur-263148, Uttarakhand, India. Abstract The genus Cynoglossum L. contains about 75 species found in hot and temperate regions of Asia, Africa Deepti Mehra Devsthali Vidyapeeth College of and Europe especially in Taiwan, Turkey, India, Kenya and China etc. The plants are mainly perennial pharmacy, Rudrapur-263148, with wide uniformity in external morphology which makes it most difficult taxonomical genus to study. Uttarakhand, India. The plants contains mainly pyrrolizidine alkaloids of many types and used as traditional medicines by tribals and vaids for cough, burns, wounds, ear infection, antibacterial and sometimes as veterinary Neeraj Kumar medicines. Some plants of this genus are scientifically validated for antioxidant, antihyperlipidaemic, Devsthali Vidyapeeth College of antidiabetic, antifertility, antitumor, anti-inflammatory, diuretic, analgesic and hepatoprotective activity. pharmacy, Rudrapur-263148, Uttarakhand, India. Keywords: Cynoglossum, pyrrozolidine, heliosupine, viridiflorine, heliotridine, echinatine Manoj Bisht Devsthali Vidyapeeth College of 1. Introduction pharmacy, Rudrapur-263148, The genus Cynoglossum L. represents about 75 known species distributed in Asia, Africa and Uttarakhand, India. Europe, 12 species in China [1] about 50 to 60 species in distributed widely in warmer and [2] [3] D. K. Sharma temperate regions of both hemispheres, 3 species in Taiwan , 8 species in Turkey but Devsthali Vidyapeeth College of recently revision in the plant list have increased the number of accepted species in this genus pharmacy, Rudrapur-263148, to over 86 species. -

Two New Genera in the Omphalodes Group (Cynoglosseae, Boraginaceae)
Nova Acta Científica Compostelana (Bioloxía),23 : 1-14 (2016) - ISSN 1130-9717 ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN Two new genera in the Omphalodes group (Cynoglosseae, Boraginaceae) Dous novos xéneros no grupo Omphalodes (Cynoglosseae, Boraginaceae) M. SERRANO1, R. CARBAJAL1, A. PEREIRA COUTINHO2, S. ORTIZ1 1 Department of Botany, Faculty of Pharmacy, University of Santiago de Compostela, 15782 Santiago de Compostela , Spain 2 CFE, Centre for Functional Ecology, Department of Life Sciences, University of Coimbra, 3000-456 Coimbra, Portugal *[email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected] *: Corresponding author (Recibido: 08/06/2015; Aceptado: 01/02/2016; Publicado on-line: 04/02/2016) Abstract Omphalodes (Boraginaceae, Cynoglosseae) molecular phylogenetic relationships are surveyed in the context of the tribe Cynoglosseae, being confirmed that genusOmphalodes is paraphyletic. Our work is focused both in the internal relationships among representatives of Omphalodes main subgroups (and including Omphalodes verna, the type species), and their relationships with other Cynoglosseae genera that have been related to the Omphalodes group. Our phylogenetic analysis of ITS and trnL-trnF molecular markers establish close relationships of the American Omphalodes with the genus Mimophytum, and also with Cynoglossum paniculatum and Myosotidium hortensia. The southwestern European annual Omphalodes species form a discrete group deserving taxonomic recognition. We describe two new genera to reduce the paraphyly in the genus Omphalodes, accommodating the European annual species in Iberodes and Cynoglossum paniculatum in Mapuchea. The pollen of the former taxon is described in detail for the first time. Keywords: Madrean-Tethyan, phylogeny, pollen, systematics, taxonomy Resumo Neste estudo analisamos as relacións filoxenéticas deOmphalodes (Boraginaceae, Cynoglosseae) no contexto da tribo Cynoglosseae, confirmándose como parafilético o xéneroOmphalodes . -

Functional Ecology Published by John Wiley & Sons Ltd on Behalf of British Ecological Society
Received: 22 June 2017 | Accepted: 14 February 2018 DOI: 10.1111/1365-2435.13085 RESEARCH ARTICLE Insular woody daisies (Argyranthemum, Asteraceae) are more resistant to drought- induced hydraulic failure than their herbaceous relatives Larissa C. Dória1 | Diego S. Podadera2 | Marcelino del Arco3 | Thibaud Chauvin4,5 | Erik Smets1 | Sylvain Delzon6 | Frederic Lens1 1Naturalis Biodiversity Center, Leiden University, Leiden, The Netherlands; 2Programa de Pós-Graduação em Ecologia, UNICAMP, Campinas, São Paulo, Brazil; 3Department of Plant Biology (Botany), La Laguna University, La Laguna, Tenerife, Spain; 4PIAF, INRA, University of Clermont Auvergne, Clermont-Ferrand, France; 5AGPF, INRA Orléans, Olivet Cedex, France and 6BIOGECO INRA, University of Bordeaux, Cestas, France Correspondence Frederic Lens Abstract Email: [email protected] 1. Insular woodiness refers to the evolutionary transition from herbaceousness to- Funding information wards derived woodiness on (sub)tropical islands and leads to island floras that have Conselho Nacional de Desenvolvimento a higher proportion of woody species compared to floras of nearby continents. Científico e Tecnológico, Grant/Award Number: 206433/2014-0; French National 2. Several hypotheses have tried to explain insular woodiness since Darwin’s original Agency for Research, Grant/Award Number: observations, but experimental evidence why plants became woody on islands is ANR-10-EQPX-16 and ANR-10-LABX-45; Alberta Mennega Stichting scarce at best. 3. Here, we combine experimental measurements of hydraulic failure in stems (as a Handling Editor: Rafael Oliveira proxy for drought stress resistance) with stem anatomical observations in the daisy lineage (Asteraceae), including insular woody Argyranthemum species from the Canary Islands and their herbaceous continental relatives. 4. Our results show that stems of insular woody daisies are more resistant to drought- induced hydraulic failure than the stems of their herbaceous counterparts. -

Atlas of the Flora of New England: Fabaceae
Angelo, R. and D.E. Boufford. 2013. Atlas of the flora of New England: Fabaceae. Phytoneuron 2013-2: 1–15 + map pages 1– 21. Published 9 January 2013. ISSN 2153 733X ATLAS OF THE FLORA OF NEW ENGLAND: FABACEAE RAY ANGELO1 and DAVID E. BOUFFORD2 Harvard University Herbaria 22 Divinity Avenue Cambridge, Massachusetts 02138-2020 [email protected] [email protected] ABSTRACT Dot maps are provided to depict the distribution at the county level of the taxa of Magnoliophyta: Fabaceae growing outside of cultivation in the six New England states of the northeastern United States. The maps treat 172 taxa (species, subspecies, varieties, and hybrids, but not forms) based primarily on specimens in the major herbaria of Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island, and Connecticut, with most data derived from the holdings of the New England Botanical Club Herbarium (NEBC). Brief synonymy (to account for names used in standard manuals and floras for the area and on herbarium specimens), habitat, chromosome information, and common names are also provided. KEY WORDS: flora, New England, atlas, distribution, Fabaceae This article is the eleventh in a series (Angelo & Boufford 1996, 1998, 2000, 2007, 2010, 2011a, 2011b, 2012a, 2012b, 2012c) that presents the distributions of the vascular flora of New England in the form of dot distribution maps at the county level (Figure 1). Seven more articles are planned. The atlas is posted on the internet at http://neatlas.org, where it will be updated as new information becomes available. This project encompasses all vascular plants (lycophytes, pteridophytes and spermatophytes) at the rank of species, subspecies, and variety growing independent of cultivation in the six New England states. -

Recerca I Territori V12 B (002)(1).Pdf
Butterfly and moths in l’Empordà and their response to global change Recerca i territori Volume 12 NUMBER 12 / SEPTEMBER 2020 Edition Graphic design Càtedra d’Ecosistemes Litorals Mediterranis Mostra Comunicació Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter Museu de la Mediterrània Printing Gràfiques Agustí Coordinadors of the volume Constantí Stefanescu, Tristan Lafranchis ISSN: 2013-5939 Dipòsit legal: GI 896-2020 “Recerca i Territori” Collection Coordinator Printed on recycled paper Cyclus print Xavier Quintana With the support of: Summary Foreword ......................................................................................................................................................................................................... 7 Xavier Quintana Butterflies of the Montgrí-Baix Ter region ................................................................................................................. 11 Tristan Lafranchis Moths of the Montgrí-Baix Ter region ............................................................................................................................31 Tristan Lafranchis The dispersion of Lepidoptera in the Montgrí-Baix Ter region ...........................................................51 Tristan Lafranchis Three decades of butterfly monitoring at El Cortalet ...................................................................................69 (Aiguamolls de l’Empordà Natural Park) Constantí Stefanescu Effects of abandonment and restoration in Mediterranean meadows .......................................87 -

Essential Oil Composition of Cladanthus Eriolepis (Coss. Ex Maire) Oberpr
Journal of Essential Oil Research ISSN: (Print) (Online) Journal homepage: https://www.tandfonline.com/loi/tjeo20 Essential oil composition of Cladanthus eriolepis (Coss. ex Maire) Oberpr. & Vogt, an endemic species to Morocco Souad El Hafidi, Khadija Bakhy, Mohammed Ouhssine, Joseph Casanova, Félix Tomi & Mathieu Paoli To cite this article: Souad El Hafidi, Khadija Bakhy, Mohammed Ouhssine, Joseph Casanova, Félix Tomi & Mathieu Paoli (2021): Essential oil composition of Cladanthuseriolepis (Coss. ex Maire) Oberpr. & Vogt, an endemic species to Morocco, Journal of Essential Oil Research, DOI: 10.1080/10412905.2021.1918276 To link to this article: https://doi.org/10.1080/10412905.2021.1918276 Published online: 28 Apr 2021. Submit your article to this journal Article views: 3 View related articles View Crossmark data Full Terms & Conditions of access and use can be found at https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=tjeo20 JOURNAL OF ESSENTIAL OIL RESEARCH https://doi.org/10.1080/10412905.2021.1918276 Essential oil composition of Cladanthus eriolepis (Coss. ex Maire) Oberpr. & Vogt, an endemic species to Morocco Souad El Hafidia, Khadija Bakhyb, Mohammed Ouhssinea, Joseph Casanovac, Félix Tomic and Mathieu Paolic aFaculty of Science, Department of Biology, Université Ibn Tofail, Kenitra, Morocco; bNational Institute of Agricultural Research (INRA), Research Unit on Aromatic and Medicinal Plant, Rabat, Morocco; cUniversité de Corse-CNRS, Ajaccio, France ABSTRACT ARTICLE HISTORY Cladanthus eriolepis (C. eriolepis) (Coss. ex Maire) Oberpr. & Vog. is endemic to High Atlas (Dades Received 10 January 2021 Gorge and Todgha Gorge), the Anti Atlas and Saharan Morocco. It is known under the vernacular Accepted 10 April 2021 names ‘Alougjim, gtaa-eddib, laatetecha’ and ‘Lamghizal’. -

Download E-Book (PDF)
African Journal of Biotechnology Volume 15 Number 25, 22 June 2016 ISSN 1684-5315 ABOUT AJB The African Journal of Biotechnology (AJB) (ISSN 1684-5315) is published weekly (one volume per year) by Academic Journals. African Journal of Biotechnology (AJB), a new broad-based journal, is an open access journal that was founded on two key tenets: To publish the most exciting research in all areas of applied biochemistry, industrial microbiology, molecular biology, genomics and proteomics, food and agricultural technologies, and metabolic engineering. Secondly, to provide the most rapid turn-around time possible for reviewing and publishing, and to disseminate the articles freely for teaching and reference purposes. All articles published in AJB are peer-reviewed. Contact Us Editorial Office: [email protected] Help Desk: [email protected] Website: http://www.academicjournals.org/journal/AJB Submit manuscript online http://ms.academicjournals.me/ Editor-in-Chief Associate Editors Prof. Dr. AE Aboulata George Nkem Ude, Ph.D Plant Breeder & Molecular Biologist Plant Path. Res. Inst., ARC, POBox 12619, Giza, Egypt Department of Natural Sciences 30 D, El-Karama St., Alf Maskan, P.O. Box 1567, Ain Shams, Cairo, Crawford Building, Rm 003A Egypt Bowie State University 14000 Jericho Park Road Bowie, MD 20715, USA Dr. S.K Das Department of Applied Chemistry and Biotechnology, University of Fukui, Japan Editor Prof. Okoh, A. I. Applied and Environmental Microbiology Research Group (AEMREG), N. John Tonukari, Ph.D Department of Biochemistry and Microbiology, Department of Biochemistry University of Fort Hare. Delta State University P/Bag X1314 Alice 5700, PMB 1 South Africa Abraka, Nigeria Dr. -

Taxonomic Revision of the Genus Scorpiurus L. (Fabaceae)
Research in Plant Biology 2018, 8: 42-50 doi: 10.25081/ripb.2018.v8.3750 http://updatepublishing.com/journal/index.php/ripb Regular Article Taxonomic revision of the genus Scorpiurus L. (Fabaceae) Esam M. Aqlan1,2*, Zaki A. Turki1, Faiza A. Shehata1 ISSN: 2231-5101 1Botany & Microbiology Department, Faculty of Science, Menoufia University, Shebein El-Koom, Egypt, 2Biology Department, Faculty of Science, Ibb University, Ibb, Yemen ABSTRACT The morphological and anatomical characteristics of different parts were utilized to reassess the taxonomic status in Received: August 23, 2018 Scorpiurus L. species naturally growing in Egypt. There were significant differences among the studied species of plants Accepted: October 14, 2018 and hence the results clearly showed two distinct species. Based on the studied morphological and anatomical differences Published: October 22, 2018 S. muricatus L. is differentiated into three different varieties. These are muricatus L., laevigatus (Sibth. & Sm.) Boiss. and subvillosus (L.) Fiori. An artificial key to both species and varieties are provided. *Corresponding author: [email protected] KEYWORDS: Scorpiurus, morphological, anatomy, SEM seed INTRODUCTION Domínguez and Galiano [2] recognized not only S. muricatus, S. subvillosus, S. sulcatus and S. vermiculatus, as full species, The genus Scorpiurus L. is one of the genera of the family but further identified distinct varieties within each of Fabaceae, belonging to the subfamily Faboideae Rudd., tribe them. Zielinski, [12] distinguished the genus into two Loteae DC., subtribe Scorpiurinae Rouy. It is distributed in species, S. muricatus and S. vermiculatus while Talaver and Mediterranean area from the Canary Islands and N W Africa Domínguez [13] distinguished the genus into four species through Portugal, Spain and Southern regions of Europe to S. -

Rubus Fruticosus and Verbascum Thapsus Medicinal Plants Collected from Dir (L) N.W.F.P
Antioxidant and anti-inflammatory study of Rubus fruticosus and Verbascum thapsus medicinal plants collected from Dir (L) N.W.F.P. Pakistan Muhammad Riaz, B. Pharm. Department of Pharmacognosy Faculty of Pharmacy, University of Karachi Karachi-75270, Pakistan 2012 Antioxidant and anti-inflammatory study of Rubus fruticosus and Verbascum thapsus medicinal plants collected from Dir (L) N.W.F.P. Pakistan THESIS SUBMITTED FOR THE FULFILMENT OF THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILLOSOPHY By Muhammad Riaz, B. Pharm. Supervised by Dr. Mansoor Ahmad, I.F. Meritorious Professor Department of Pharmacognosy Faculty of Pharmacy, University of Karachi Karachi-75270, Pakistan 2012 DIDICATED TO MY PARENTS i PUBLICATION FROM THESIS Riaz M , Ahmad M and Rahman N (2011). Antimicrobial screening of fruit, leaves, root and stem of Rubus fruticosus . J. Med. Plants Res ., 5(24): 5920-5924. ii CONTENTS i. Acknowledgements viii ii. Abstract ix iii. Khulasa xii 1. Introduction 01 I. Rubus fruticosus 03 II. Verbascum thapsus 07 2. Literature search i. Literature survey of Rubus fruticosus 13 ii. Therapeutic application of Rubus fruticosus 15 iii. Literature data for total phenols, anthocyanins and ascorbic acid 17 iv. Phytochemical literature survey of Rubus fruticosus 18 v. Structures of chemical constituents reported from R. fruticosus 23 vi. Literature survey of Verbascum thapsus 28 vii. Pharmacological literature survey of Verbascum thapsus 30 viii. Phytochemical literature survey of Verbascum thapsus 32 ix. Structures of chemical constituents reported from V. thapsus 38 3. Experimental 42 i. General/Materials 42 ii. Instruments 43 iii. Abbreviations 44 iv. Pharmacognostic evaluation/Standardization of drugs 45 v. Thin layer chromatography 48 vi.