Rapport Scientifique 2000-2003
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
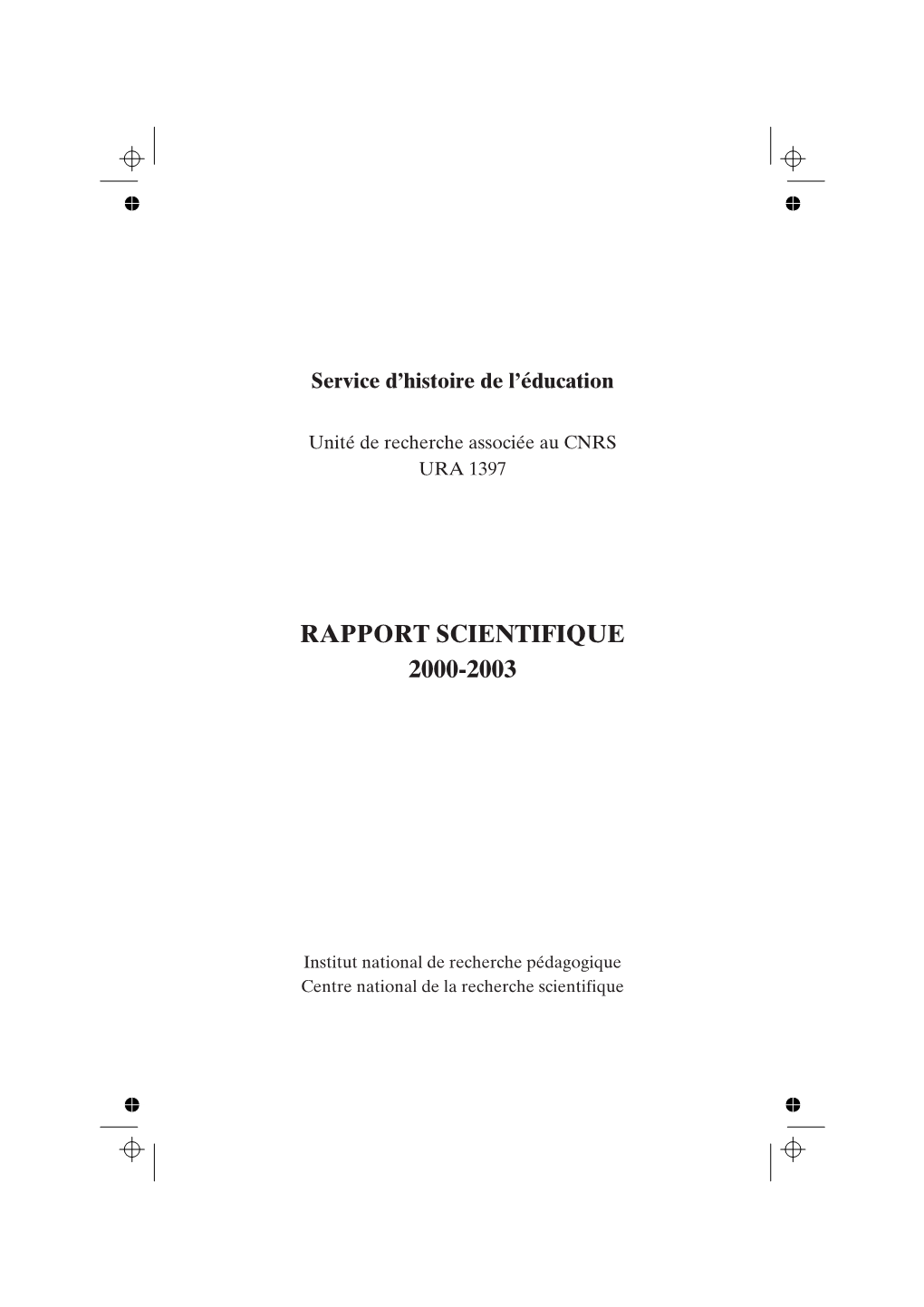
Load more
Recommended publications
-

Sexo, Amor Y Cine Por Salvador Sainz Introducción
Sexo, amor y cine por Salvador Sainz Introducción: En la última secuencia de El dormilón (The Sleeper, 1973), Woody Allen, desengañado por la evolución polí tica de una hipotética sociedad futura, le decí a escéptico a Diane Keaton: “Yo sólo creo en el sexo y en la muerte” . Evidentemente la desconcertante evolución social y polí tica de la última década del siglo XX parecen confirmar tal aseveración. Todos los principios é ticos del filósofo alemá n Hegel (1770-1831) que a lo largo de un siglo engendraron movimientos tan dispares como el anarquismo libertario, el comunismo autoritario y el fascismo se han desmoronado como un juego de naipes dejando un importante vací o ideológico que ha sumido en el estupor colectivo a nuestra desorientada generación. Si el siglo XIX fue el siglo de las esperanzas el XX ha sido el de los desengaños. Las creencias má s firmes y má s sólidas se han hundido en su propia rigidez. Por otra parte la serie interminable de crisis económica, polí tica y social de nuestra civilización parece no tener fin. Ante tanta decepción sólo dos principios han permanecido inalterables: el amor y la muerte. Eros y Tá natos, los polos opuestos de un mundo cada vez má s neurótico y vací o. De Tánatos tenemos sobrados ejemplos a cada cual má s siniestro: odio, intolerancia, guerras civiles, nacionalismo exacerbado, xenofobia, racismo, conservadurismo a ultranza, intransigencia, fanatismo… El Sé ptimo Arte ha captado esa evolución social con unas pelí culas cada vez má s violentas, con espectaculares efectos especiales que no nos dejan perder detalle de los aspectos má s sombrí os de nuestro entorno. -

Dynamics of Particulate Organic Matter Composition in Coastal Systems: Forcing of Spatio-Temporal Variability at Multi-Systems Scale
1 Progress in Oceanography Archimer March 2018, Volume 162, Pages 271-289 http://dx.doi.org/10.1016/j.pocean.2018.02.026 http://archimer.ifremer.fr http://archimer.ifremer.fr/doc/00433/54471/ © 2018 Elsevier Ltd. All rights reserved. Dynamics of particulate organic matter composition in coastal systems: forcing of spatio-temporal variability at multi-systems scale Liénart Camilla 1, *, Savoye Nicolas 1, David Valérie 1, Ramond Pierre 2, Rodriguez Tress Paco 1, Hanquiez Vincent 3, Marieu Vincent 3, Aubert Fabien 4, Aubin Sébastien 5, Bichon Sabrina 1, Boinet Christophe 5, Bourasseau Line 1, Bozec Yann 6, Bréret Martine 4, Breton Elsa 7, Caparros Jocelyne 8, Cariou Thierry 9, Claquin Pascal 10, Conan Pascal 8, Corre Anne-Marie 11, Costes Laurence 1, Crouvoisier Muriel 7, Del Amo Yolanda 1, Derriennic Hervé 3, Dindinaud François 1, Duran Robert 12, Durozier Maïa 11, Devesa Jérémy 13, Ferreira Sophie 14, Feunteun Eric 15, Garcia Nicole 16, Geslin Sandrine 5, Grossteffan Emilie 13, Gueux Aurore 8, Guillaudeau Julien 5, Guillou Gaël 4, Jolly Orianne 17, Lachaussée Nicolas 4, Lafont Michel 16, Lagadec Véronique 16, Lamoureux Jézabel 5, Lauga Béatrice 12, Lebreton Benoît 4, Lecuyer Eric 7, Lehodey Jean-Paul 17, Leroux Cédric 9, L'Helguen Stéphane 13, Macé Eric 6, Maria Eric 8, Mousseau Laure 11, Nowaczyk Antoine 1, Pineau Philippe 4, Petit Franck 11, Pujo-Pay Mireille 8, Raimbault Patrick 16, Rimmelin-Maury Peggy 13, Rouaud Vanessa 12, Sauriau Pierre-Guy 4, Sultan Emmanuelle 5, Susperregui Nicolas 12, 18 1 Univ. Bordeaux, CNRS, UMR 5805 EPOC, Station Marine d’Arcachon, 33120 Arcachon, France 2 Ifremer Centre Bretagne, DYNECO, Z.I. -

THE “SIGH—CALL 'Og'” of “Thorn” (“Þorn”)
THE “SIGH—CALL ‘O-g’” of “THorn” (“þorn”) The Latin letter “þ” is imagery of “c” in “time-OUT” with its F-A-C-E to the “wall.” [cf. Ezekiel 4:3, 41:25 / 2 Kings 20:2 / Isaiah 38:2 / Proverbs 24:31 / Ezekiel 12:12, 38:20] “And lest I should be exalted above measure through the abundance of the revelations, there was given to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan to buffet me, lest I should be exalted above MEASURE.” —2 Corinthians 12:7 [cf. Judges 8:7] “ 1 Then Pilate therefore took Jesus, and scourged him. 2 And the soldiers platted a crown of thorns, and put it on 3 his head, and they put on him a purple robe, And said, Hail, King of the Jews! and they smote him with their hands. 4 Pilate therefore went forth again, and saith unto them, Behold, I bring him forth to you, that ye may know that I find no fault in him. 5 Then came Jesus forth, wearing the crown of thorns, and the purple robe. And Pilate saith unto them, Behold the man!”—John 19:1-5 HIGH road = Place of LOW road = Place of Unfruitfulness Conception (mouth) You take the high road and I’ll take the low road Genesis 13:6-12 “ 6 And the land was not able to bear them, that they might dwell together: for their substance was great, so that they 7 could not dwell together. And there was a strife between the herdmen of Abram's cattle and the herdmen of Lot's 8 cattle: and the Canaanite and the Perizzite dwelled then in the land. -

Rapport Scientifique 2004-2005
Service d’histoire de l’éducation INRP - ENS RAPPORT SCIENTIFIQUE 2004 et 2005 Institut national de recherche pédagogique École normale supérieure Conception graphique, saisie et réalisation PAO : Arille Agbo et Anne-Marie Fabry, Service d'histoire de l'éducation © Institut national de recherche pédagogique, 2006 ISBN : 2-7342-1042-8 ISSN : 1765-5129 SOMMAIRE AVANT-PROPOS . 7 PREMIÈRE PARTIE : PRÉSENTATION DE L’UNITÉ . 9 I – Historique et missions . 11 II – Organisation et personnel . 12 III – Renseignements pratiques . 14 DEUXIÈME PARTIE : LES RECHERCHES . 17 I – L’HISTOIRE DES DISCIPLINES SCOLAIRES . 19 1. Les apprentissages élémentaires : lire, écrire, compter . 20 2. Histoire de l’enseignement du français . 25 3. Les humanités . 26 4. Histoire de l’enseignement du grec, en France et à l’étranger . 29 5. Aux origines du curriculum élémentaire . 30 6. Langues régionales et scolarisation . 32 7. Histoire de l’enseignement de l’histoire . 33 8. Histoire de l’enseignement des sciences . 36 a) L’enseignement mathématique à l’école primaire . 36 b) L’enseignement des sciences à l’école primaire . 37 c) Les sciences dans l’enseignement secondaire . 39 9. Histoire de l’enseignement du dessin . 39 II – L’ÉDITION SCOLAIRE ET ÉDUCATIVE . 40 1. Le programme Emmanuelle sur les manuels scolaires français . 41 2. La presse d’éducation et d’enseignement depuis le XVIIIe siècle . 43 4 / Rapport scientifique III – INSTITUTIONS ÉDUCATIVES, ÉCONOMIE ET SOCIÉTÉ . 44 1. Répertoire des collèges français, XVIe-XVIIIe siècles. 45 2. Le personnel enseignant de la faculté des arts de Paris aux XVIIe et XVIIIe siècles . 46 3. École et démocratie à l’époque moderne . -

NO TEMPO DA ANIMAÇÃO Movie-Se NO TEMPO DA ANIMAÇÃO
NO TEMPO DA ANIMAÇÃO MOVIE-SE NO TEMPO DA ANIMAÇÃO EDITADO POR GREG HILTY E ALONA PARDO 1a EDIÇÃO RIO DE JANEIRO CENTRO CULTURAL BANCO DO BRASIL 2013 PREFÁCIO 6 APARIÇÕES 42 PERSONAGENS 74 OBJETO, SONHO E IMAGEM NA ANIMAÇÃO 12 SUPER-HUMANOS 98 GREG HILTY FÁBU L AS 120 A CAIXA DE FERRAMENTAS DA FR AGMENTOS 150 TECNOLOGIA E DA TÉCNICA 20 A ANIMAÇÃO EM 100 OBJETOS ESTRUTURAS 168 PAUL WELLS VISÕES 186 FANTASMAS NA MÁQUINA 30 BIOGRAFIAS 194 VIVENCIANDO A ANIMAÇÃO ENGLISH VERSION 216 SUZANNE BUCHAN CRÉDITOS E AGRADECIMENTOS 260 PREFÁCIO Somos gratos, como sempre, aos artistas e cineastas que aceitaram Também gostaríamos de agradecer nossos parceiros no evento, generosamente participar dessa mostra ambiciosa, incluindo Francis Alÿs, notadamente a Assemble CIC. Seu projeto remoto em East London, Martin Arnold, Ralph Bakshi, Jirí Barta, Patrick Bokanowski, Christian Folly for a Flyover – apoiado pela Create 11 e inspirado pela Watch Me Boltanski, Robert Breer, Tim Burton, Cao Fei, Nathalie Djurberg, Harun Move – estende o compromisso da Barbican Art Gallery de trabalhar Farocki, Ari Folman, Terry Gilliam, igloo (Ruth Gibson e Bruno Martelli), além-muros. Nossa colaboração com a IdeasTap nos deu a oportunidade Animação é evocar a vida. William Kentridge, Caroline Leaf, Ruth Lingford, Frank e Caroline Mouris, de trabalhar com recém-graduados e animadores nascentes, e por isso Eadweard Muybridge Yuri Norstein, Julian Opie, os Irmãos Quay, Zbigniew Rybczynski, Bob somos gratos. Um muito obrigado ao Adam Mickiewicz Institute e ao Sabiston, Marjane Satrapi, Semiconductor, Jan Švankmajer, Jim Trainor, Polish Cultural Institute por seu apoio contínuo a nosso programa público Ryan Trecartin, Kara Walker, Tim Webb, Run Wrake e Zhou Xiaohu. -

Le Développement De L'enfant Page 10
La www.asmae.fr LettreN°76 - JUIN 2007 DOSSIER Le développement de l'enfant Page 10 Retour au Liban après plusieurs mois d'absence Pages 4-5 Encourager la coopéra- tion des ONG pour aider les enfants des rues Pages 8-9 S'investir avec © Céline Lopez Asmae en France Page 17 L’édito du Président Une situation financière saine permettant de continuer à développer notre présence Depuis plus de 25 ans, Asmae poursuit l’action de sa sur le terrain fondatrice, dans le respect 2006 aura vu un net fléchissement des dons que nous avons reçus, provenant de ses principes. des particuliers. Est-ce le contrecoup du tsunami, ou la moindre présence de sœur Emmanuelle dans les médias ou bien encore les sollicitations de toutes Respecter l’autre dans sa parts faisant appel à votre générosité ? Sans doute un peu de tout cela. différence • L’association travaille oujours est-il que nous avons mis en place des actions en direction des entreprises et systématiquement en partenariat Tfondations d’entreprise afin de solliciter d’elles, des subventions de projets ou des avec des associations locales. partenariats plus larges, accompagnant ainsi leur souhait de mieux exercer leur responsa- • Asmae est une association bilité sociale. laïque et apolitique. Un effort a également été fait pour accroître notre présence sur le territoire national, le « prototype » étant notre antenne lyonnaise, pleine de dynamisme, qui cherche toutes Accompagner les plus pauvres les occasions de faire connaître localement nos actions. vers l’autonomie Enfin, nous réfléchissons aussi au moyen d’élargir la base de nos donateurs particuliers, • S’acharner en priorité en établissant notamment un plan de communication adapté que nous mettrons en pour les enfants. -
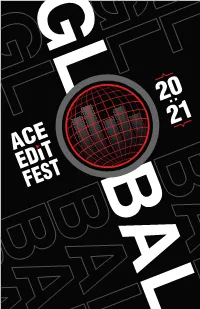
Open Editfest Program
20:21 EDITING E M a tt Marjorie Bruce Fran Make a big production less of a production. “Productions is the fi nal puzzle piece for making Premiere Pro an undeniable choice for any scale movie. Th e ability to share projects and organize media across them, combined with Premiere’s existing dynamic workfl ows, lets our entire team work and collaborate incredibly fast.” —Ben Insler, First Assistant Editor, MANK © 2021 Adobe. All rights reserved. Adobe, the Adobe logo, and Adobe Premiere are either registered trademarks or trademarks of Adobe in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Creativity for all. TABLE CONTENTS E :05 Welcome :06 Itinerary :12 Sponsors :14 ACE President Kevin Tent, ACE :15 SATURDAY | PANEL 1 Editing for Musicals :23 SATURDAY | PANEL 2 Inside the Cutting Room with Bobbie O’Steen A Conversation with Tom Cross, ACE :27 Saturday Breakout Room Speakers :39 SUNDAY | PANEL 1 From Assistant to Editor Mentoring the Next Generation :51 SUNDAY | PANEL 2 International Partnership Program Launch Strengthening the Art of Editing in the Global Film Community :59 Sunday Breakout Room Speakers :71 Production Credits :72 ACE Member Roster :80 EditFestGlobal.com :03 WELCOME EDITFEST 2021 The American Cinema Editors is an honorary society founded in 1950 by editors who wanted to create a forum to honor their profession. There were 108 editors at that first meeting. Today we number over 1,000 members, from all over the world and, like those who came before us, we wish to educate others about our craft, and our dedication to advancing the art and dignity of the editing profession. -

Fluid Seepage in Relation to Seabed Deformation on the Central Nile Deep-Sea Fan, Part 1: Evidence from Sidescan Sonar Data
1 Advances in Natural and Technological Hazards Research Achimer 2014, Volume 37 Pages 129-139 http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-00972-8_12 http://archimer.ifremer.fr http://archimer.ifremer.fr/doc/00226/33752/ © Springer Fluid Seepage in Relation to Seabed Deformation on the Central Nile Deep-Sea Fan, Part 1: Evidence from Sidescan Sonar Data Dano Alexandre 1, Praeg Daniel 2, Migeon Sebastien 1, Augustin Jean-Marie 3, Ceramicola Silvia 2, Ketzer Joao Marcelo 4, Augustin Adolfo Herbert 4, Ducassou Emmanuelle 5, Mascle Jean 6 1 Géoazur, UMR7329, UNS-UPMC-CNRS-OCA, Rue Albert Einstein, 06560, Valbonne, France 2 OGS (Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale), Borgo Grotta Gigante 42c, 34010, Trieste, Italy 3 IFREMER, Technopôle Brest-Iroise, Plouzané, France 4 Center of Excellence in Research and Innovation in Petroleum, Mineral Resources and Carbon Storage (CEPAC), Pontifical University of Rio Grande do Sul (PUCRS), Av. Ipiranga 6681, Prédio 96J, CEP 90619-900, Porto Alegre, RS, Brazil 5 Université Bordeaux 1, UMR5805 EPOC, Avenue des facultés, 33405, Talence, France 6 Géoazur, UMR7329, UNS-UPMC-CNRS-OCA, Porte de la Darse, Villefranche-sur-Mer, France * Corresponding author : Alexandre Dano, email address : [email protected] Abstract : The central Nile Deep-Sea Fan contains a broad area of seabed destabilisation in association with fluid seepage: slope-parallel sediment undulations are associated with multibeam high-backscatter patches (HBPs) related to authigenic carbonates. During the 2011 APINIL campaign, a deep-towed sidescan and profiling system (SAR) was used to acquire high-resolution data along three transects across water depths of 1,700-2,650 m. -

Bilan États-Unis - 2000
Bilan États-Unis - 2000 26/09/21 19:27:09 tél +33 (0)1 47 53 95 80 / fax +33 (0)1 47 05 96 55 / www.unifrance.org SIRET 784359069 00043 / NAF 8421Z / TVA FR 03784359069 tél +33 (0)1 47 53 95 80 / fax +33 (0)1 47 05 96 55 / www.unifrance.org SIRET 784359069 00043 / NAF 8421Z / TVA FR 03784359069 Données cinéma des films français - États-Unis Détails des sorties - 2000 Titre du film Recettes (€) Nombre de Nombre de Exportateurs Distributeurs spectateurs copies locaux 1 La Neuvième 24 908 958,3 4 343 289 1 665 Artisan Porte 5 Entertainment 2 Tout sur ma 6 511 394 1 289 385 0 Pathé Films Sony Pictures mère Classics 3 Dancer in the 3 940 529,69 840 000 111 TrustNordisk Fine Line Dark Features 4 Est-Ouest 2 636 610,95 590 756 71 TF1 Studio Sony Pictures Classics 5 La Fille sur le 1 841 079,53 401 978 48 Tamasa Paramount pont Distribution Classics 6 Place Vendôme 633 170,69 131 999 12 Tamasa Empire Pictures Distribution 7 Du rififi chez les 431 200 74 211 1 Rialto Pictures hommes 8 Vénus Beauté 429 307,15 87 199 11 Playtime Lot 47 Films (Institut) 9 Alice et Martin 415 882,33 92 764 14 STUDIOCANAL USA Films 10 Le Temps 413 498,15 94 542 9 The Bureau Kino Lorber retrouvé Sales 11 Kadosh 397 017,24 89 313 16 Kino Lorber 12 Harry, un ami 267 629,04 40 000 4 Celluloid Miramax Films qui vous veut Dreams du bien 13 La Bûche 254 592,26 38 000 5 Tamasa Empire Pictures Distribution 14 Une liaison 185 074 31 852 2 Le Pacte Fine Line pornographique Features 15 Le Vent nous 157 476,63 34 821 2 mk2 films New Yorker emportera Films 16 Beau travail 134 471 -
Afm Product Guide 2003
3DD ENTERTAINMENT 3DD Entertainment, 190 Camden High Street, London, UK NW1 8QP. Tel: 011.44.207.428.1800. Fax: 011 44 207 428 1818. e-mail: [email protected]. Website: www.3dd-entertainment.co.uk Company Type: Distributor At AFM: Dominic Saville (CEO), Charlotte Parton (Director of Sales), James Anderson (Sales Executive), Acquisition Executive: Dominic Saville (CEO) Office: Suite # 334, Tel: 310.458.6700, Mobile: 44 (0)7961 318 665 Film THE ICEMAN COMETH DRAMA Language: ENGLISH Director: JOHN FRANKENHEIMER Producer: ELY LANDAU Co-Production Partners: Cast:LEE MARVIN, JEFF BRIDGES, FREDERIC MARCH Delivery Status: COMPLETED Year of Production: 1973 Country of Origin: USA/UK Budget: NOT AVAILABLE Based on acclaimed playwright Eugene O'Neill's brilliant stage drama, the patrons of The Last Chance Saloon gather for an evening to contemplate their lost faith and dreams. Film A DELICATE BALANCE DRAMA Language: ENGLISH Director: TONY RICHARDSON Producer: ELY LANDAU Co-Production Partners: Cast: KATHARINE HEPBRUN, LEE REMICK, PAUL SCOFIELD Delivery Status: COMPLETED Year of Production: 1973 Country of Origin: USA Budget: NOT AVAILABLE Based on a play by Edward Albee, a dysfunctional couple discovers that they have more than they can handle when a family gathering turns chaotic. Film BUTLEY DRAMA Language: ENGLISH Director: HAROLD PINTER Producer: ELY LANDAU, OTTO PLASCHKES Co-Production Partners: Cast: ALAN BATES, JESSICA TANDY, MICHAEL BYRNE Delivery Status: COMPLETED Year of Production: 1973 Country of Origin: UK Budget: NOT AVAILABLE A self-loathing and misanthropic teacher's life takes a tragic turn when his lover betrays him and his ex-wife remarries, in the screen adaptation of Simon Gray's play. -
Télématisation De La Banque De Données Emmanuelle
UNIVERSITE CLAUDE BERNARD _ _ NFORMATION :OTHEQUES LYONI BISS m INFORMAHQUE DOCUMENTAIRE MEMOIRE DE STAGE LA TELEMATISATION DE LA BANQUE DE DONNEES EMMANUELLE Nom de Veleve: Caroline DUROSELLE Nom des directeurs : Alain CHOPPIN et Fabiola RODRIGUEZ Institut National de Recherche P6dagogique Service d'histoire de l'6ducation URACNRS 1397 1992 E.N.S.S.I.B. UNIVERSITE ECOLE NATIONALE SUPERIEURE CLAUDE BERNARD DES SQENCES DE L'INFORMATION ET DES BIBLIOTHEQUES LYONI DESS en INFORMATIQUE DOCUMENTAIRE MEMOIRE DE STAGE LATELEMATISATION DE LA BANQUE DE DONNEES EMMANUELLE Nom de Veieve: Caroline DUROSELLE Nom des directeurs : Alain CHOPPIN et Fabiola RODRIGUEZ Institut National de Recherche Pedagogique Service d'histoire de l'6ducation URACNRS 1397 1992 LA TELEMATISATION DE LA BANQUE DE DONNEES EMMANUELLE CAROLINE DUROSELLE RESUME La telematisation de la banque de donnees de recherche EMMANUELLE concue a 1'Institut national de la recherche pedagogique. Analyse des donnees et du serveur, realisation d'une maquette du service et conception des pages ecran a l'aide d'un logiciel de composition d lmages videotex. Instaliation sur le serveur et test. DESCRIPTEURS Banque de donnees ; documentation ; doanee ; infnrmation ; informatique documentaire ; logiciel; atructurc ; teehefehe ; recherche documentaire; str-Hcfare ; utilisateur ; videotex ; 'VIIIUJILX inLLMULLiI; eonservotion ;4coIe-; qcole ptimaire ; enseignement; histoire • FETE •' mQniipl ° ' 5 ABSTRACT Placing on-line the research database EMMANUELLE developed by the "Institut national de recherche pedagogique". Analysis of data and server, designing a working model of the service and designing user-database interface screens by utilising a videotex imaee composition programme. Putting on the server and testing. KEY WORDS Data bases ; information science ; data ; information ; data base research ; computer programmme ; structure ; user ; videotex ; interactive videotex ; conservation • school • primary school; teaching; history ; book; manual. -

La Santé Dans Les Zones Isolées : Un Enjeu Majeur Page 9 Comprendre L'adolescent Pour Mieux L'accompagner Page 4
La www.asmae.fr LettreN°79 - AVRIL 2008 Dossier La santé dans les zones isolées : un enjeu majeur Page 9 Comprendre l'adolescent pour mieux l'accompagner Page 4 Les chantiers de solidarité : un enrichissement mutuel Page 6 © Béatrice Galonnier Fil rouge de mission aux Philippines Page 8 L’édito du Président Envisageons l’avenir ensemble Depuis plus de 25 ans, Asmae poursuit l’action de sa Dans quelques mois sœur Emmanuelle fêtera son centième fondatrice, dans le respect anniversaire. Ce sera l’occasion pour nous de célébrer comme de ses principes. il se doit, cet événement exceptionnel en y associant tous ceux qui, à un moment ou un autre de leur vie, ont participé à son aventure Respecter l’autre dans sa humaine. différence • L’association travaille Les médias, auxquels rien n’échappe, multiplient, depuis quelques semaines déjà, leurs systématiquement en partenariat sollicitations, ce qui montre à quel point notre fondatrice reste populaire dans le coeur avec des associations locales. des français. En contrepoint, nous mesurons combien le grand public ignore que, depuis • Asmae est une association bien des années, notre association poursuit et développe les actions initiées par soeur laïque et apolitique. Emmanuelle au bénéfice des enfants défavorisés. Accompagner les plus pauvres Ce décalage a notamment pour effet de nous priver de certaines ressources financières et vers l’autonomie humaines qui nous seraient pourtant tellement utiles pour répondre encore mieux aux • S’acharner en priorité besoins qui nous sont exprimés partout où nous sommes présents, en France et à pour les enfants. l’étranger. • Développer des programmes Dans le même temps, nous constatons que quand nous parvenons à établir un contact, d’éducation et de santé que ce soit avec un particulier ou une organisation, bien souvent celui-ci se transforme en (accueil, soins, nourriture, un intérêt réel puis en un soutien actif à nos actions.