Compte Rendu Réunion CLE 20/12/07
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
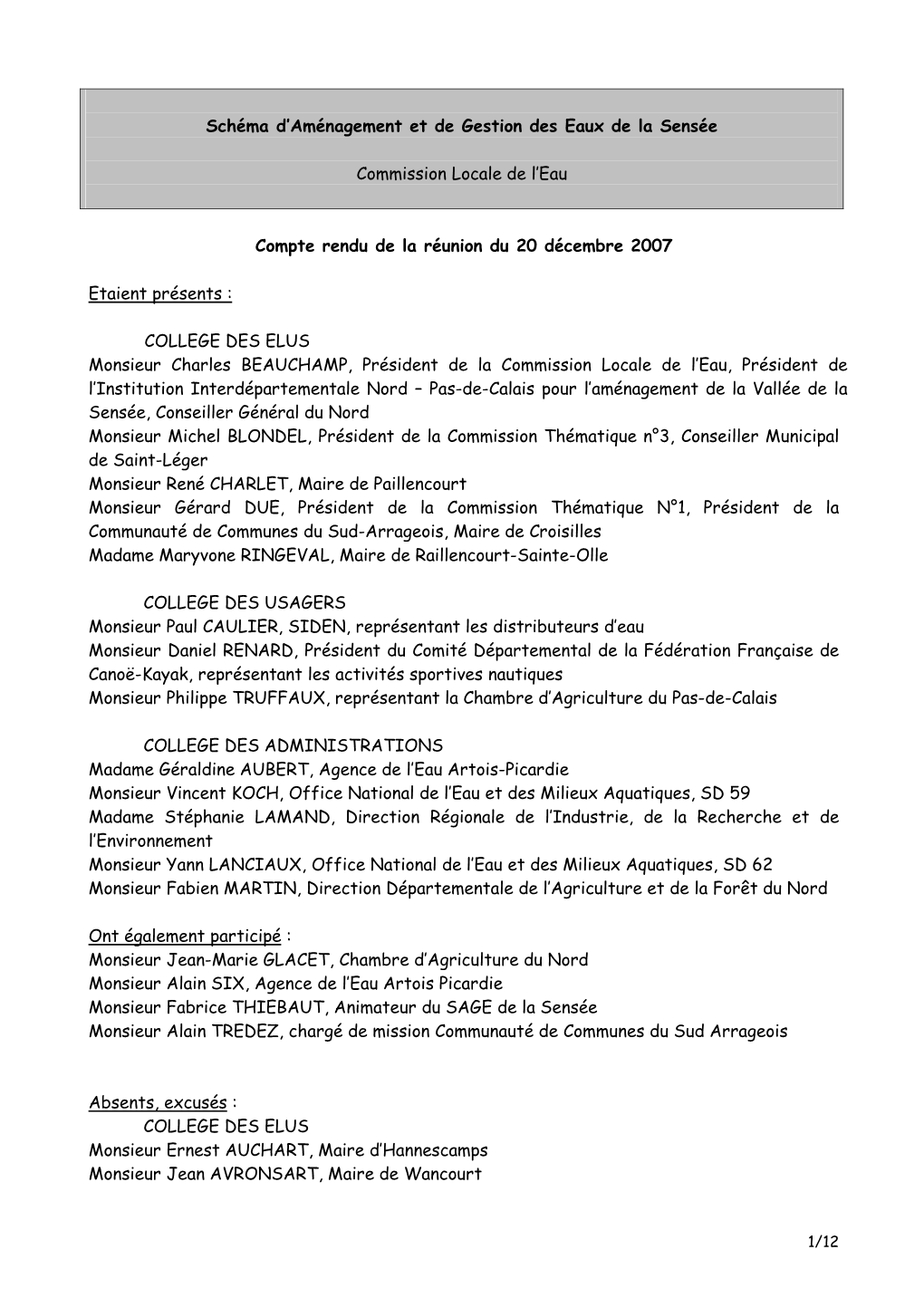
Load more
Recommended publications
-

Fh Ligne 532 Pelves Quiery Arras
Ligne 532 - Quiéry-la-Motte / Pelves / Arras - SENS ALLER Période Année Période scolaire Vacances lun lun - lun lun lun lun - lun lun lun lun lun lun A compter du mar mar - mar mar mar mar - mar mar mar mar mar mar jours de 04/04/2016 mer mer - mer mer mer mer - mer mer mer mer mer mer circulation jeu jeu - jeu jeu jeu jeu - jeu jeu jeu jeu jeu jeu 1321 Route Nationale ven ven - ven ven ven ven - ven ven ven ven ven ven 62117 BREBIERES sam sam sam - - sam - sam - sam sam sam sam sam 03 21 50 08 49 Commune Arrêts / Service 011/03 005/05 009/01 001/01 003/01 005/01 007/01 005/03 013/01 009/02 011/01 005/02 005/04 011/02 www.fouache.fr QUIERY-LA-MOTTE Eglise 13:17 06:50 06:50 07:57 06:55 08:01 QUIERY-LA-MOTTE Rue d'Izel 13:18 06:51 06:51 07:58 06:56 08:02 IZEL-LES-E. Rue d'Esquerchin 13:21 06:54 06:54 08:01 06:59 08:05 IZEL-LES-E. La Bascule 13:22 06:55 06:55 08:02 07:00 08:06 FRESNES-LES-M. Eglise 13:28 07:01 07:01 08:08 07:06 08:12 03 21 50 40 40 FRESNES-LES-M. Résidence les Lilas 13:29 07:02 07:02 08:09 07:07 08:13 NEUVIREUIL Eglise 13:33 07:06 07:10 08:13 07:11 08:17 NEUVIREUIL Résidence - Route Oppy N°50 13:34 07:07 07:11 08:14 07:12 08:18 OPPY Rue de Neuvireuil - N°22 13:35 07:08 07:12 08:15 07:13 08:19 OPPY Pl. -

Planning Des Messes Du 1Er Semestre 2021
Planning des messes du 1er semestre 2021 Date Notre Dame du Val de Scarpe St Vaast des vallées Scarpe et Sensée Vendredi 1° janvier 11h Vitry (Maison ND) Samedi 2 janvier 18h30 Pelves Dimanche 3 janvier 9h30 Brebières 11h Biache Samedi 9 janvier 18h30 Tortequesne Dimanche 10 janvier 11h Vitry 9h30 Feuchy Samedi 16 janvier 18h30 Fampoux Dimanche 17 janvier 9h30 Corbehem 11h Vis Samedi 23 janvier 18h30 Bellonne Dimanche 24 janvier 11h Sailly 9h30 Monchy Samedi 30 janvier 18h30 Fresnes Dimanche 31 janvier 11h Izel 9h30 Etaing Samedi 6 février 18h30 Athies Dimanche 7 février 9h30 Quiéry 11h Biache Dimanche Santé Samedi 13 février 18h30 Noyelles Dimanche 14 février 11h Brebières 9h30 Feuchy Mercredi 17 février 17h Brebières (enfants) 10h Feuchy (enfants) Cendres 18h30 Gavrelle Samedi 20 février 18h30 Boiry Dimanche 21 février 9h30 Vitry 11h Vis Samedi 27 février 18h30 Corbehem Dimanche 28 février 11h Bellonne 9h30 Monchy Samedi 6 mars 18h30 Roeux Dimanche 7 mars 9h30 Quiéry 11h Biache Samedi 13 mars 18h30 Haucourt Dimanche 14 mars 11h Vitry 9h30 Feuchy Samedi 20 mars 18h30 Gouy Dim 21 mars (CCFD) 9h30 Sailly – Prof de foi 2020 11h Vis J 25 mars Annonciation Samedi 27 mars 19h30 Noyelles 18h Etaing Dimanche 28 mars 11h Izel 9h30 Monchy Rameaux Jeudi saint 1° avril 20h Corbehem 18h30 Fampoux Vendredi saint : 15h possible dans chaque village. Vend saint 2 avril 18h30 Tortequesne 20h Samedi 3 avril 19h Vitry 21h Vis Veillée pascale Dimanche 4 avril 9h30 Brebières 11h Biache Pâques Samedi 10 avril 18h30 Bellonne Dimanche 11 avril 11h Sailly 9h30 -

Monchy Le Preux 85 90 90
90 85 85 95 VC N2 DE FAMPOUX A MONCHY LE PREUX 85 90 90 105 90 90 90 95 90 85 85 95 100 85 90 100 95 105 90 90 105 100 105 105 85 95 90 90 85 95 105 95 95 95 100 LES CINQUANTE 95 100 90 100 95 95 100 100 95 95 95 95 100 95 95 95 85 95 100 100 100 100 B 100 100 90 100 100 Vidange Chteau d’eau b b C C 300 B ALLEE DE LA GRECE C 200 AC C B LE GROS CAILLOU B 100 B b C 300 B b b C 300 b B 85 b C 200 ACb C C 200 AC C 100 C 95 286 B B C B B b C 300 B C 200 B 100 b C 200 ACb b b B B C B B C 300 B C 400 B B CC 300200 AC B C 200 AC C B b B C B 90 b C C B B b C 400 100 C 200 AC 100100 B 85 b b 100 b B C C 400 B C 300b C 200 B B C 200 AC B C C B 90 b b b 100 95 100 b b C 400 B B B C 200 AC b b 100 C 400 B C 300 B 100 C 200A AC C 300 B ALLEE DE FRANCE A b b 85 C 200 AC B B b D C 300 B B b C 300 B A C C 200 b C C B B b b A 90 100 C 200 AC b 100 C 400 b C 300 B 100 b C 200 B C 200 100 C B C 200 AC C C C B B b b B 100 b C 300 B O B C 500 B B A 100 C 200 AC D b b b b C 300 b b C 400 b C 200 AC B C B C 400 B C C C 400 B B B C 500 b C 200 AC ALLEE DU PORTUGAL 95 b b A B C 400 b B C 100 b C B C 200 AC B B B C 400 C 400 b b 100 b C 500 ALLEE DUb DANEMARK (Feuchy) b b B C 400 C 400 C 500C 200 B AC b C 200 b b B B C 200 B B B b LEGENDE C C 200 B b B b 100 C 200 C 200 AC B C 500 C C 400 B C B B b b C 200 AC b 90 : C 400 100 B C 500 C 200 AC C B 100 C 90 b 100 C 90 B B b B b B L D C C 500 B C 200 AC O ALLEE DU BENELUX 100 C 200 100 C 0 Bb b b 100 95 P C C C C 300 B B C 300 B C B C 400 B b 100 W C 200 AC 95 C 200 B C 300 B C B b Y b C b B C 300 C ALLEE D'ALLEMAGNE -
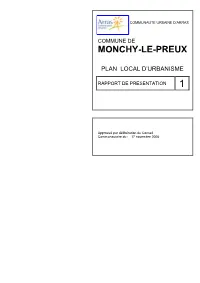
Monchy-Le-Preux
COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS COMMUNE DE MONCHY-LE-PREUX PLAN LOCAL D’URBANISME RAPPORT DE PRESENTATION 1 Approuvé par délibération du Conseil Communautaire du : 17 novembre 2006 COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS COMMUNE DE MONCHY-LE-PREUX – PAS-DE-CALAIS 2 PLAN LOCAL D’URBANISME – RAPPORT DE PRESENTATION SOMMAIRE INTRODUCTION 4 Présentation de la commune 5 1 - DIAGNOSTIC PROSPECTIF ET BESOINS REPERTORIES 8 1.01 - Le Schéma Directeur de l’Arrageois 9 1.02 - Démographie 12 1.03 - Habitat 20 1.04 - Activités Economiques 30 1.05 - Besoins en surfaces urbanisables 43 1.06 - Circulation et déplacements 44 1.07 - Equipements et services 49 1.08 - Protection de l’environnement 53 2- ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 56 2.01 - Le site et le milieu naturel 57 2.02 - Les paysages et l’environnement 61 2.03 - Les éléments d’histoire locale et le patrimoine 65 2.04 - La structure du bâti 70 2.05 - Les risques 73 2.06 - Données environnementales 76 COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS COMMUNE DE MONCHY-LE-PREUX – PAS-DE-CALAIS 3 PLAN LOCAL D’URBANISME – RAPPORT DE PRESENTATION 3 – JUSTIFICATION DES DISPOSITIONS DU P.L.U. 80 3.01 - Les objectifs de l’élaboration du P.L.U. de Monchy-le-Preux 81 3.02 - Le zonage du P.L.U. et la vocation des zones 84 3.03 - La réglementation du P.L.U. 90 3.04 - La réponse aux objectifs de développement Durable 104 3.05 - Les documents d’urbanisme supracommunaux 109 3.06 - Cohérence avec les documents d’urbanisme des communes contiguës 111 4 - LES INCIDENCES DU P.L.U. -

Rojet P Pretres Des Voie La De Eolien Parc Du 2
Parc Eolien de la Voie des Prêtres SAS Version de Novembre 2016 Complétée en Avril 2018 PROJET DU PARC EOLIEN DE LA VOIE DES PRETRES 2 Sous-dossier n°4 - Etude d’impact Parc Eolien de la Voie des Prêtres SAS 8 rue Auber 75009 Paris SAFEGE, CONCEPTEUR DE SOLUTIONS D'AMENAGEMENT DURABLE PROJET DU PARC EOLIEN DE LA VOIE DES PRETRES 2 SOUS-DOSSIER N°4 – ETUDE D’IMPACT 2.3.2 Diagnostic écologique et évaluation du site .................................................... 51 SOMMAIRE 2.4 Environnement humain ............................................................................ 59 2.4.1 Population et habitat ................................................................................... 59 1. Présentation générale du projet ...... 1 2.4.2 Occupation des sols aux abords .................................................................... 63 1.1 Situation du projet ..................................................................................... 1 2.4.3 Activités économiques et fréquentation du site ............................................... 65 1.2 Présentation du projet ............................................................................... 7 2.4.4 Patrimoine culturel et archéologique .............................................................. 70 1.2.1 Descriptif général du projet ............................................................................ 7 2.4.5 Axes de communication, trafic, autres infrastructures et réseaux ...................... 73 1.2.2 Caractéristiques des éoliennes prévues ........................................................... -

Cahier Des Charges De La Garde Ambulanciere
CAHIER DES CHARGES DE LA GARDE AMBULANCIERE DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS SOMMAIRE PREAMBULE ............................................................................................................................. 2 ARTICLE 1 : LES PRINCIPES DE LA GARDE ......................................................................... 3 ARTICLE 2 : LA SECTORISATION ........................................................................................... 4 2.1. Les secteurs de garde ..................................................................................................... 4 2.2. Les lignes de garde affectées aux secteurs de garde .................................................... 4 2.3. Les locaux de garde ........................................................................................................ 5 ARTICLE 3 : L’ORGANISATION DE LA GARDE ...................................................................... 5 3.1. Elaboration du tableau de garde semestriel ................................................................... 5 3.2. Principe de permutation de garde ................................................................................... 6 3.3. Recours à la garde d’un autre secteur ............................................................................ 7 ARTICLE 4 : LES VEHICULES AFFECTES A LA GARDE....................................................... 7 ARTICLE 5 : L'EQUIPAGE AMBULANCIER ............................................................................. 7 5.1 L’équipage ....................................................................................................................... -

Artois La Clé Des Champs
Adinfer 13 Monchy 0 10 7 Pommier 36 au bois Douchy Ayette les Ayette St Amand Bienvillers au Bois Hannescamps Ablainzevelle 315 Foncquevillers Souastre 3 Bucquoy Gommecourt 4 13 Coigneux Rayencourt 18 24 2 Hébuterne 6 Sailly Artois La clé des champs Evasion dans la plaine du sud Artois où se succèdent de vastes espaces cultivés et de petits villages blottis autour de leur église. Départ Distance Temps moyen rue du Faubourg 39 kms 3h30 62111 Monchy-au-Bois 200 m Curiosités 100 m Coigneux : les sources de l’Authie 0 m 0 km 5 km 10 km 15 km 20 km 25 km 30 km 35 km 39 km Adinfer 13 Monchy 0 10 7 Pommier 36 au bois Douchy Ayette les Ayette St Amand Bienvillers au Bois Hannescamps Ablainzevelle 315 Foncquevillers Souastre 3 Bucquoy Gommecourt 4 13 Coigneux Rayencourt 18 24 2 Sailly Hébuterne Office de tourisme > Pas-en-Artois : 03.21.60.15.02 - Arras : 03.21.51.26.95 Noyelette 2 Montenescourt 23 Lattre St Quentin Wanquetin Warlus 16 Hauteville Berneville 28 Fosseux Simencourt Gouy 6 Beaumetz en Artois 11 les loges Monchiet 21 Basseux 1 5 D Bailleulval 0 Bailleulmont Artois 7 Le dessus des loges A la découverte d’une région marquée par l’exploitation de la craie, extraite “des loges” (carrières souterraines) pour la construction et de carrières ouvertes pour l’agriculture. Départ Distance Temps moyen parking de la poste 32 kms 3h00 62123 Beaumetz les Loges Curiosités 200 m Prenez le temps de découvrir les chapelles et églises qui jalonnent ce parcours, les chateaux de 100 m Fosseux, Hauteville, Gouy en Artois et Beaumetz 0 m les Loges 0 km 5 km 10 km 15 km 20 km 25 km 32 km Noyelette 2 Montenescourt 23 Lattre St Quentin Wanquetin Warlus 16 Hauteville Berneville 28 Fosseux Simencourt Gouy 6 Beaumetz en Artois 11 les loges Monchiet 21 Basseux 1 5 D Bailleulval 0 Bailleulmont Office de tourisme > Arras : 03.21.51.26.95 200 m 100 m 0 m 0 km 5 km 10 km 15 km 20 km 25 km 32 km 8 Artois Entre Scarpe et Sensée Les 2 cours100 md’eau, qui ont sculpté cette partie du Pas-de-Calais, encadrent une plaine typique de l’Artois. -

2021-0000002
LETTRE CIRCULAIRE n° 2021-0000002 Montreuil, le 30/04/2021 DRCPM OBJET Sous-direction production, Modification du champ d'application du versement transport (art. L. gestion des comptes, 2333-64 et s. du Code Général des Collectivités Territoriales) fiabilisation Texte(s) à annoter : VLU-grands comptes et VT LCIRC-2019-0000022 ; LCIRC-2016-0000020 Affaire suivie par : BLAYE DUBOIS Nadine, Suite à l’entrée dans le ressort territorial du SITAC (9306209) des communes WINTGENS Claire de PEUPLINGUES (62654), ESCALLES (62307), SAINT-TRICAT (62769), BONNINGUES-LES-CALAIS (62156) et PIHEN-LES-GUINES (62657), ces communes sont exclues du périmètre du versement mobilité additionnel (VMa) auprès du Syndicat des Hauts-de-France Mobilités (9315901) à compter du 1er mai 2021. Par une délibération du 12 février 2020, le Comité Syndical du SITAC (9306209) a décidé l’application du versement transport à ces communes avec des taux progressifs à compter du 01/05/2021 avec un taux de 0,80 % pour atteindre 2% en 2025. L’application de la délibération entraîne la création de l’identifiant n° 9306223 au 1er mai 2021. Suite à l’entrée dans le ressort territorial du SITAC (9306209) des communes de PEUPLINGUES (62654), ESCALLES (62307), SAINT-TRICAT (62769), BONNINGUES-LES-CALAIS (62156) et PIHEN-LES-GUINES (62657), ces communes sont exclues du périmètre de la taxe mobilité additionnelle (VMa) auprès du Syndicat Mixte Hauts-de-France Mobilités (9315901) à compter du 1er mai 2021. Les informations relatives au champ d’application, au taux, au recouvrement et au reversement du VMa du Syndicat Mixte Hauts De France Mobilités, sont regroupées dans le tableau ci-joint (annexe 1). -

Recueil Des Actes Administratifs
PRÉFET DU PAS-DE-CALAIS RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS RECUEIL SPECIAL n° 110 du 30 novembre 2017 Le Recueil des Actes Administratifs sous sa forme intégrale est consultable en Préfecture, dans les Sous-Préfectures, ainsi que sur le site Internet de la Préfecture (www.pas-de-calais.gouv.fr) rue Ferdinand BUISSON - 62020 ARRAS CEDEX 9 tél. 03.21.21.20.00 fax 03.21.55.30.30 SOUS PRÉFECTURE DE BOULOGNE SUR MER.................................................................3 Arrêté accordant la médaille d’honneur agricole a l’occasion de la promotion du 14 juillet 2017.......................................3 Arrêté portant attribution de la médaille de la famille promotion 2017................................................................................9 Arrêté accordant la médaille d'honneur régionale, départementale et communale..............................................................12 DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER.............................43 Arrêté de poursuite temporaire d’activité agricole pour madame marie-france blanpain....................................................43 Arrêté de poursuite temporaire d’activité agricole pour monsieur yves demailly...............................................................44 Arrêté de poursuite temporaire d’activité agricole pour monsieur philippe huret...............................................................44 Arrêté de poursuite temporaire d’activité agricole pour monsieur michel manidren...........................................................44 -

Planning Des Messes Du 1° Semestre 2021 Durant Le Confinement : Messes Du Samedi À 16H30
Planning des messes du 1° semestre 2021 Durant le confinement : messes du samedi à 16h30. Date Notre Dame du Val de Scarpe St Vaast des vallées NDVS Scarpe et Sensée - SVSS Vendredi 1° janvier 11h Vitry (Maison ND) Samedi 2 janvier 18h30 Dury Dimanche 3 janvier 9h30 Brebières 11h Biache Samedi 9 janvier 18h30 Tortequesne Dimanche 10 janvier 11h Vitry + Bapt 9h30 Feuchy Samedi 16 janvier 16h30 Fampoux Dimanche 17 janvier 9h30 Corbehem 11h Vis Samedi 23 janvier 16h30 Bellonne Dimanche 24 janvier 11h Sailly + Bapt 9h30 Monchy Samedi 30 janvier 18h30 Fresnes Dimanche 31 janvier 11h Izel 9h30 Etaing Samedi 6 février 16h30 Athies Dimanche 7 février 9h30 Quiéry 11h Biache Dimanche Santé Samedi 13 février 16h30 Noyelles Dimanche 14 février 11h Brebières + Bapt 9h30 Feuchy Mercredi 17 février 16h30 Brebières (enfants) 10h Feuchy (enfants) Cendres 16h30 Gavrelle Samedi 20 février 16h30 Boiry Dimanche 21 février 9h30 Vitry 11h Etaing Samedi 27 février 16h30 Corbehem Dimanche 28 février 11h Bellonne + Bapt Brebières 9h30 Monchy Samedi 6 mars 16h30 Roeux Dimanche 7 mars 9h30 Quiéry 11h Biache Samedi 13 mars 16h30 Haucourt Dimanche 14 mars 11h Vitry + Bapt 9h30 Feuchy Samedi 20 mars 16h30 Gouy – Prof de foi 2020 Dim 21 mars (CCFD) 9h30 Sailly – Prof de foi 2020 11h Etaing J 25 mars Annonciation Samedi 27 mars 16h30 Noyelles 16h30 Dury Dimanche 28 mars 11h Izel + Bapt 9h30 Monchy Rameaux Jeudi saint 1° avril 20h Corbehem 18h30 Fampoux Vendredi saint : 15h possible dans chaque village. Vend saint 2 avril 18h30 Tortequesne 20h Samedi 3 avril 19h Vitry -

Rapportées Au Format A4
PARC EOLIEN de la SENSEE Communes de Dury, Etaing et Recourt Enquête publique n°E21000020/59 Du 19 avril au 18 mai 2021 Commissaire-Enquêteur : M. Maurice NAYE ENQUETE PUBLIQUE n° E21000020/59 Exploitation d’un parc Eolien composé de 6 aérogénérateurs sur les communes de Dury, Etaing et Recourt Thème : Autorisation d’exploiter d’un parc de 6 aérogénérateurs sur les communes de Etaing, Dury et Récourt. PREAMBULE : CONTEXTE DE L’ENQUETE ; CHAPITRE 1 – GENERALITES CONCERNANT L’OBJET DE L’ENQUETE .......... 5 1.1 – Identité et présentation des acteurs du projet ............................................5 1.2 – Localisation de l’installation et description du projet ..................................8 1.3 – Les variantes étudiées .............................................................................21 1.4 – Les enjeux 1.4-1 – Bruit et environnement sonore .....................................................25 1.4-2 – Paysage et Patrimoine .................................................................27 1.4-3 – Ecologie ........................................................................................29 1.5 – Les impacts .............................................................................................31 1.5-1 – Acoustique ....................................................................................31 1.5-2 – Paysage ......................................................................................31 1.5-3 – Ecologie ........................................................................................32 -

18 Dossier L’Écho Du Pas-De-Calais No 209 – Juin 2021
18 Dossier L’Écho du Pas-de-Calais no 209 – Juin 2021 Liste des cantons du Pas-de-Calais Canton d’Aire-sur-la-Lys : Aire-sur-la- Amplier, Aubigny-en-Artois, Avesnes-le- Capelle-lès-Boulogne, Conteville-lès-Bou- Canton de Calais-3 : Partie de la commune ris, Saint-Venant, Westrehem. Lys, Blessy, Estrée-Blanche, Guarbecque, Comte, Bailleul-aux-Cornailles, Bailleulmont, logne, Pernes-lès-Boulogne, Pittefaux, de Calais non incluse dans les cantons de Ca- Canton de Longuenesse : Arques, Blen- Isbergues, Lambres, Liettres, Ligny-lès-Aire, Bailleulval, Barly, Basseux, Bavincourt, Beau- Wimereux, Wimille. lais-1 et de Calais-2. decques, Campagne-lès-Wardrecques, Hal- Linghem, Mazinghem, Quernes, Rely, Rom- dricourt, Beaufort-Blavincourt, Berlencourt- La partie de la commune de Boulogne-sur- Canton de Carvin : Carvin, Courrières, lines, Helfaut, Longuenesse, Wizernes. bly, Roquetoire, Saint-Hilaire-Cottes, Witter- le-Cauroy, Berles-au-Bois, Berles-Monchel, Mer située au nord d’une ligne définie par Libercourt. Canton de Lumbres : Acquin-Westbé- nesse, Wittes. Berneville, Béthonsart, Bienvillers-au-Bois, l’axe des voies et limites suivantes : depuis Canton de Desvres : Alincthun, Amble- court, Affringues, Aix-en-Ergny, Alette, Canton d’Arras-1 : Acq, Anzin-Saint-Aubin, Blairville, Boiry-Saint-Martin, Boiry-Sainte- le littoral, jetée Nord-Est, quai des Paque- teuse, Audembert, Audinghen, Audresselles, Alquines, Audrehem, Avesnes, Bayenghem- Beaumetz-lès-Loges, Dainville, Écurie, Étrun, Rictrude, Cambligneul, Camblain-l’Abbé, bots, quai Léon-Gambetta, boulevard Fran- Bazinghen, Bellebrune, Belle-et-Houllefort, lès-Seninghem, Bécourt, Beussent, Bezin- Marœuil, Mont-Saint-Éloi, Neuville-Saint- Canettemont, Capelle-Fermont, La Cauchie, çois-Mitterrand, boulevard Daunou, rue de Beuvrequen, Bournonville, Brunembert, Car- ghem, Bimont, Bléquin, Boisdinghem, Bon- Vaast, Roclincourt, Sainte-Catherine, Wailly.