Banville. Calvados
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
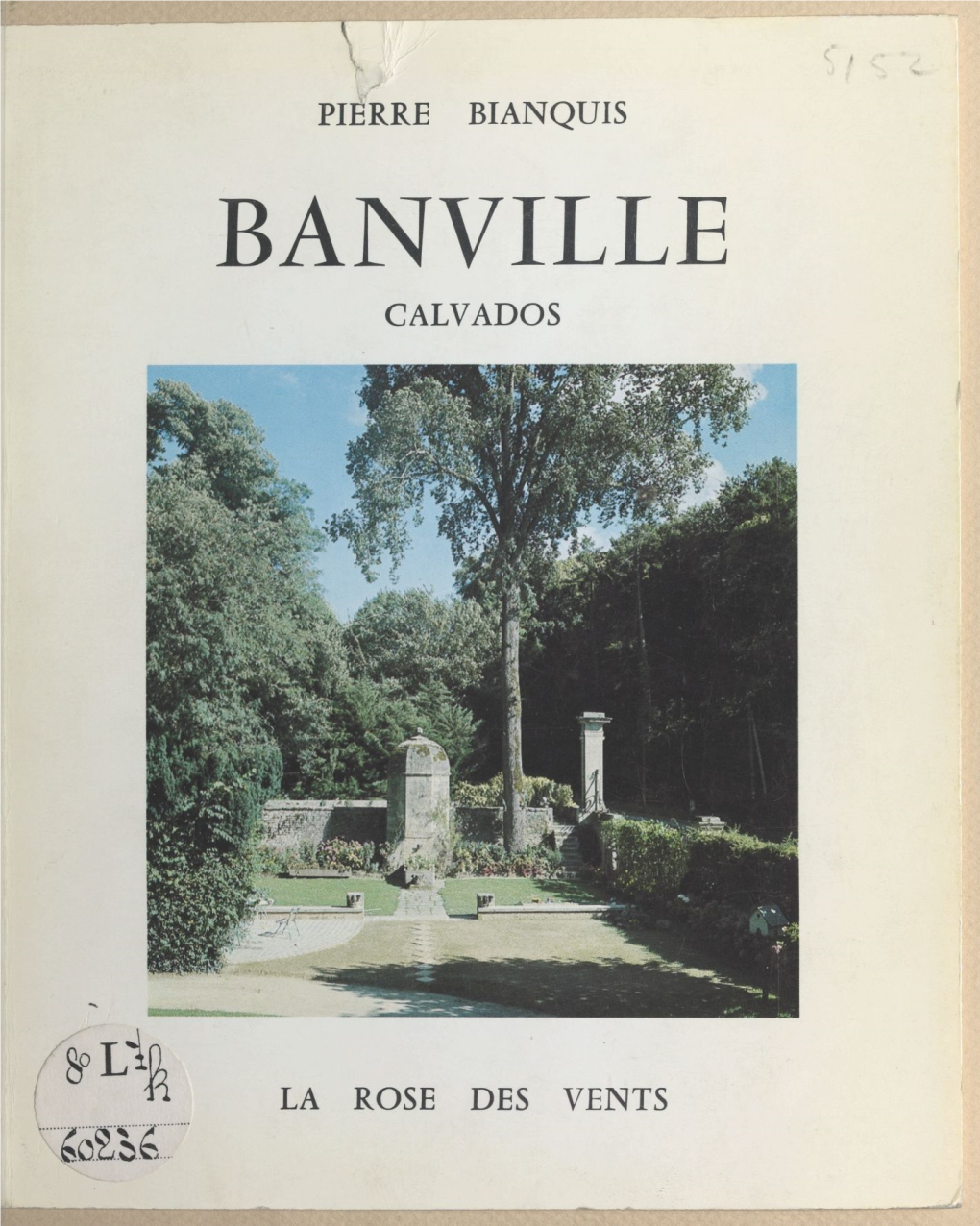
Load more
Recommended publications
-

Au Cœur De Vos Projets
AU CŒUR DE VOS PROJETS 2018 CARTE DU PATRIMOINE LOCATIF DE CALVADOS HABITAT AU 31/12/2016 467 Honfleur 102 18 811 LOGEMENTS LOCATIFS DANS 196 COMMUNES Grandcamp-Maisy La 2 Vierville- 1 2 -sur-Mer Rivière-Saint-Sauveur Géfosse-Fontenay 17 Équemauville 4 1 Villerville 1 12 Colleville- Cardonville 20 303 La Cambe -sur-Mer 1 Aure-sur-Mer 20 Trouville-sur-Mer Osmanville Port-en- 14 39 -Bessin-Huppain 18 44 1 1 Arromanches- Bernières- Deauville 151 Longues-sur-Mer -les-Bains Asnelles Genneville Formigny-la-Bataille 1 -sur-Mer Saint-Aubin- Touques 2 Graye-sur-Mer 121 -sur-Mer Maisons 6 51 2 2 Courseulles- 23 Langrune-sur-Mer 13 107 14 Ryes -sur-Mer Mosles Vaux-sur-Aure 1 3 Luc-sur-Mer Blonville- Isigny-sur-Mer Trévières Banville Tour-en- 55 Lion-sur-Mer -sur-Mer 4 -Bessin 6 74 51 Canapville 1 Reviers 39 Villers-sur-Mer 22 48 Saint-Vigor- Douvres- 14 Blay 1671 -le-Grand 40 Creully-sur-Seulles -la-Délivrande 2 Houlgate 1 15 BAYEUX 1 Cresserons Hermanville- 101 121 Esquay-sur-Seulles Fontaine-Henry -sur-Mer 94 481 1 8 Basly Ouistreham Cabourg 1 4 Merville- Dives-sur-Mer 61 Le 1 Saint-Martin- Ponts-sur-Seulles Franceville- Breuil-en-Bessin Ranchy 1 2 125 Lison 4 Campigny -des-Entrées 1 -Plage Branville Cartigny-l'Épinay Moulin-en-Bessin 8 Sallenelles PONT-L'ÉVÊQUE 5 Le 2 Mathieu 8 Bonneville-la-Louvet Molay-Littry Bénouville 28 1 Carcagny 96 Le 23 Amfreville 2 4 Mesnil-sur-Blangy Sainte-Marguerite-d'Elle 17 Blainville- Cambes- -sur-Orne 2 Bréville-les-Monts en-Plaine Ranville 28 42 4 28 Bavent Dozulé 15 2361 Saint-Paul- Audrieu Hérouvillette 14 -du-Vernay -
Normandy ~ Honfleur
SMALL GROUP Ma xi mum of 28 Travele rs LAND NO SINGLE JO URNEY SUPPLEMENT for Solo Travelers No rmandy ~ Honfleur HONORING D/DAY INCLUDED FEATURES Two Full Days of Exploration ACCOMMODATIONS ITINERARY Inspiring Moments (With baggage handling.) Day 1 Depart gateway city A >Contemplate the extraordinary bravery – Seven nights in Honfleur, France, at A Day 2 Arrive in Paris | Transfer of the Allied landing forces as you walk the first-class Mercure Honfleur Hotel. to Honfleur along the beaches of Normandy. EXTENSIVE MEAL PROGRAM Day 3 Honfleur >Immerse yourself in wartime history – Seven breakfasts, two lunches and Day 4 Mont St.-Michel with riveting details from expert guides. three dinners, including Welcome Day 5 Caen | Utah Beach | Sainte- and Farewell Dinners; tea or coffee Mère- Église >Explore the impact of World War II at with all meals, plus wine with dinner. Day 6 Honfleur the Caen Memorial Museum. – Sample authentic regional specialties Day 7 Arromanches | Omaha Beach | > during meals at local restaurants. Normandy American Cemetery | Marvel at stunning Mont St.-Michel, Pointe du Hoc a UNESCO World Heritage site , YOUR ONE-OF-A-KIND JOURNEY Day 8 Bayeux rising majestically over the tidal waters. – Discovery excursions highlight the local culture, heritage and history. Day 9 Transfer to Paris airport and >Delight in the wonderful local color depart for gateway city A – Expert-led Enrichment programs and delicious cuisine along Honfleur’s A enhance your insight into the region. Flights and transfers included for AHI FlexAir participants. picturesque harbor. – Free time to pursue your own interests. Note: Itinerary may change due to local conditions. -

Chronology of the Martin and Guérin Families***
CHRONOLOGY OF THE MARTIN AND GUÉRIN FAMILIES*** 1777 1849 April 16, 1777 - The birth of Pierre-François Martin in Athis-de- father of Louis Martin. His baptismal godfather was his maternal uncle, François Bohard. July 6, 1789 - The birth of Isidore Guérin, Sr. in St. Martin- father of Zélie Guérin Martin. January 12, 1800 - The birth of Marie-Anne-Fanie Boureau in Blois (Loir et Cher). She was the mother of Louis Martin. July 11, 1805 - The birth of Louise-Jeanne Macé in Pré- en-Pail (Mayenne). She was the mother of Marie-Louise Guérin (Élise) known in religion as Sister Marie-Dosithée, Zélie Guérin Martin and Isidore Guérin. April 4, 1818 - Pierre-François Martin and Marie-Anne- Fanie Boureau were married in a civil ceremony in Lyon. April 7, 1818 - Pierre-François Martin and Marie-Anne- Fanie Boureau were married in Lyon in the Church of Saint-Martin- Abbé Bourganel. They lived at 4 rue Vaubecourt. They were the parents of Louis Martin. July 29, 1819 - The birth of Pierre Martin in Nantes. He was the oldest brother of Louis Martin. He died in a shipwreck when still very young. September 18, 1820 - The birth of Marie-Anne Martin in Nantes. She was the oldest sister of Louis Martin. August 22, 1823 - The birth of Louis-Joseph-Aloys- Stanislaus Martin on the rue Servandoni in Bordeaux (Gironde). He was the son of Pierre-François Martin and Marie- Anne-Fanie Boureau. He was the brother of Pierre, Marie-Anne, Anne-Françoise- Fanny and Anne Sophie Martin. He was 1 the husband of Zélie Guérin Martin and the father of Marie, Pauline, Léonie, Céline and Thérèse (St. -
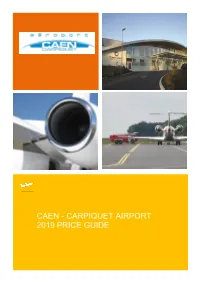
Caen - Carpiquet Airport 2019 Price Guide
1-1- CAEN - CARPIQUET AIRPORT 2019 PRICE GUIDE Table of Contents 1-GENERAL INFORMATION 5 1-1 Airport Contacts 5 2-TERMS AND CONDITIONS 6 2-1 General Terms of Payment 6 2-1-1 Means of Payment 6 2-1-2 Invoicing Charges 7 2-1-3 Payment term 7 2-1-4 Overdue payment 7 2-1-5 Claims 8 2-1-6 Value Added Tax (VAT) 8 2-2 Prices and Conditions of Application 9 2-3 Opening a Customer Account (payment as it falls due) 9 3- MAIN FEES 10 3-1 General Principle for applying EEA and international tariffs 10 3-2 Landing fees 10 3-2-1 “Daily rate” for aircraft up to 6 tonnes 11 3-2-2 Landing fee rates 12-13 3-2-3 Reductions 14 3-2-4 Exemptions 14 3-2-5 Landing fees for aircraft from 0 to 6 tonnes 14 Caen – Carpiquet Airport 2018 Price Guide 2 3-3 Ground lighting fees 15 3-3-1 Rates per movement 15 3-3-2 Special conditions 15 3-4 Parking fees 16 3-4-1 Prices 16 3-4-2 Special conditions 16 3-5 Passenger fees 16 3-5-1 Prices 17 3-5-2 General exemptions 17 3-6 RPM Charge 17 3-6-1 Price 17 3-6-2 General exemptions 18 3-7 Fee for aviation fuel distribution facilities 18 3-7-1 Prices 18 4-AIRPORT GROUND HANDLING SERVICES 19 4-1 General principles 19 4-2 Operation definitions 20 4-3 Special conditions 20 4-4 Flight cancellation fee 20 4-5 Prices for E.E.A. -

DEPARTEMENT DU CALVADOS Enquête Publique Relative Au
DEPARTEMENT DU CALVADOS Enquête publique relative au Projet de REVISION GENERALE du PLA N LOCAL D’URBANISME de la Commune de CRESSERONS N° du dossier : E17000099/14 Déroulement du 04 décembre 2017 au 12 janvier 2018 Rapport du Commissaire enquêteur Commissaire-enquêteur : Destinataires : Alain MANSILLON Mairie de CRESSERONS Tribunal Administratif de Caen SOMMAIRE Rapport d’enquête PREAMBULE p3 I-OBJET DE L’ENQUETE p5 II-ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE p8 II.1 – Chronologie de l’enquête p8 II.2 – Composition du dossier mis à disposition du public p9 II.3 – Formalités d’affichage et de publicité p9 II.4 – Personnes consultées (PPA) p10 II.5 – Echanges du Commissaire enquêteur p10 III – OBSERVATIONS DU PUBLIC p11 IV - OBSERVATIONS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES p14 V –OBSERVATIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR P15 VI - REPONSES DE LA MUNICIPALITE AU PV DE SYNTHESE p16 VI.1 – Réponses aux questions du public p16 VI.2 – Réponses aux PPA p23 VI.3 – Observations de la société SEPHIE p30 VI.4 – Questions du commissaire enquêteur p30 VII – COMMENTAIRES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR p31 ANNEXES et PIECES JOINTES p37 Document séparé : avis motivé du commissaire enquêteur E17000099/14 – Révision PLU Cresserons – Rapport Page 2 sur 37 PREAMBULE Je soussigné Alain Mansillon, désigné pour remplir les fonctions de commissaire enquêteur par décision du 26 octobre 2017 de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Caen (dossier n°E17000099/14) dans le cadre de l’enquête publique ayant pour objet la révision générale du Plan Local d’Urbanisme -

Aéroport Caen Carpiquet
AÉROPORT CAEN CARPIQUET Route de Caumont 14650 Carpiquet SECTEUR D’ACTIVITÉ / BUSINESS T 02 31 71 20 10, F 02 31 26 01 92 ........................................................... > Délégant : Caen la Mer EFFECTIFS 44 > Délégataire : SAS Aéroport Caen Normandie société de la CCI Caen Normandie, gestion confiée par délégation de service public STAFF 44 > Delegator : Urban community Caen la mer > Delegate : SAS Aéroport Caen Normandie, society of Caen Normandy Chamber of Commerce and Industry CONTACT > Lignes régulières : LYON 3 vols par jour + correspondances vers + de 15 villes de France et d’Europe : Bordeaux, Milan, Nice, Prague, Rome, Strasbourg, … avec Michel Collin Air France Hop et 2 vols avec Volotea Président de la SAS Aéroport Caen Normandie MARSEILLE jusqu’à 10 vols par semaine avec Air France Hop et Volotea Chairman of Caen Normandy Airport TOULOUSE jusqu’à 4 vols par semaine avec Volotea (SAS) > Lignes saisonnières régulières d’avril à début novembre Maryline Haize-Hagron AJACCIO jusqu’à 6 vols par semaine avec Air France Hop et Volotea Directrice de l'Aéroport BASTIA jusqu’à 3 vols par semaine avec Volotea Airport Manager CALVI le samedi de juin à fin septembre avec Air France Hop Fanny Molin FIGARI jusqu’à 3 vols par semaine avec Air France Hop et Volotea Chef d’escale NICE le samedi d’avril à septembre avec Air France Hop Responsable du Système de Gestion de la Sécurité (RSGS) Station Manager > Regular flights : Head of Security System Management LYON 3 flights per day + connecting flights to 15 towns in France & in Europ -

Acqueville Bucéels Culey-Le-Patry Grainville-Sur-Odon Agy Cabourg
Communes du ressort du tribunal d'instance de CAEN* Acqueville Bucéels Culey-le-Patry Grainville-sur-Odon Agy Cabourg Cussy Grandcamp-Maisy Amayé-sur-Orne Caen Cuverville Graye-sur-Mer Amayé-sur-Seulles Cagny Damblainville Grentheville Amfreville Cahagnolles Démouville Grimbosq Angoville Cairon Deux-Jumeaux Guéron Anisy Cambes-en-Plaine Donnay Hermanville-sur-Mer Arganchy Campigny Douvres-la-Délivrande Hérouville-Saint-Clair Argences Canchy Ducy-Sainte-Marguerite Hérouvillette Arromanches-les-Bains Canteloup Ellon Hom (Le) Asnelles Carcagny Émiéville Hottot-les-Bagues Asnières-en-Bessin Cardonville Englesqueville-la-Percée Hubert-Folie Aubigny Carpiquet Épaney Ifs Audrieu Cartigny-l'Épinay Épinay-sur-Odon Isigny-sur-Mer Aure sur Mer Castillon Épron Janville Aurseulles Caumont-sur-Aure Eraines Jort Authie Cauvicourt Ernes Juaye-Mondaye Avenay Cauville Escoville Juvigny-sur-Seulles Balleroy-sur-Drôme Cesny-aux-Vignes Espins La Bazoque Banneville-la-Campagne Cesny-Bois-Halbout Esquay-Notre-Dame La Caine Banville Chouain Esquay-sur-Seulles La Cambe Barbery Cintheaux Esson La Folie Barbeville Clécy Estrées-la-Campagne La Hoguette Baron-sur-Odon Cléville Éterville La Pommeraye Barou-en-Auge Colleville-Montgomery Étréham La Villette Basly Colleville-sur-Mer Évrecy Laize-Clinchamps Bavent Colombelles Falaise Landes-sur-Ajon Bayeux Colombières Feuguerolles-Bully Langrune-sur-Mer Bazenville Colombiers-sur-Seulles Fleury-sur-Orne Le Bô Beaumais Colomby-Anguerny Fontaine-Étoupefour Le Breuil-en-Bessin Bellengreville Combray Fontaine-Henry Le Bû-sur-Rouvres -

Commune 14600 Ablon 14220 Acqueville 14710 Aignerville 14310
Commune 14600 Ablon 14220 Acqueville 14710 Aignerville 14310 Amayé-sur-Seulles 14480 Amblie 14860 Amfreville 14240 Anctoville 14430 Angerville 14220 Angoville 14610 Anguerny 14610 Anisy 14400 Arganchy 14117 Arromanches-les-Bains 14960 Asnelles 14700 Aubigny 14250 Audrieu 14260 Aunay-sur-Odon 14140 Auquainville 14140 Autels-Saint-Bazile 14140 Authieux-Papion 14130 Authieux-sur-Calonne 14340 Auvillars 14940 Banneville-la-Campagne 14260 Banneville-sur-AJon 14480 Banville 14400 Barbeville 14600 Barneville-la-Bertran 14620 Barou-en-Auge 14610 Basly 14670 Basseneville 14260 Bauquay 14860 Bavent 14480 Bazenville 14340 Beaufour-Druval 14950 Beaumont-en-Auge 14370 Bellengreville 14140 Bellou 14910 Benerville-sur-Mer 14350 Bény-Bocage 14440 Bény-sur-Mer 14170 Bernières-d'Ailly 14112 Biéville-Beuville 14270 Biéville-Quétiéville 14260 Bigne 14370 Billy 14370 Bissières 14130 Blangy-le-Château 14400 Blay 14910 Blonville-sur-Mer 14690 Bô 14340 Boissière 14340 Bonnebosq 14260 Bonnemaison 14800 Bonneville-sur-Touques 14700 Bonnœil 14420 Bons-Tassilly 14210 Bougy 14220 Boulon 14430 Bourgeauville 14540 Bourguébus 14430 Branville 14740 Bretteville-l'Orgueilleuse 14190 Bretteville-le-Rabet 14170 Bretteville-sur-Dives 14760 Bretteville-sur-Odon 14130 Breuil-en-Auge 14330 Breuil-en-Bessin 14130 Brévedent 14140 Brévière 14860 Bréville-les-Monts 14250 Brouay 14160 Brucourt 14190 Bû-sur-Rouvres 14250 Bucéels 14350 Bures-les-Monts 14630 Cagny 14240 Cahagnes 14490 Cahagnolles 14210 Caine 14230 Cambe 14610 Cambes-en-Plaine 14500 Campagnolles 14260 Campandré-Valcongrain -

Rapport D'enquête Publique Sur La Déclaration D'utilité
SEJOURNE Hubert Dossier n° E 1400092/14 Commissaire enquêteur Décision du 12/09/2014 4 rue de Feniton Département du Calvados 14111 LOUVIGNY [email protected] Tel 0685947112 Rapport d’Enquête Publique sur la déclaration d’utilité publique concernant le projet d’aménagement de la route départementale N° 126 et son raccordement à la route départementale N° 170 sur le territoire des communes d’Authie et Rosel 1 Enquête conduite du 20 Novembre 2014 au 22 Décembre 2014 inclus Destinataires : Préfecture du Calvados Conseil général du Calvados Tribunal administratif de Caen Identification du demandeur : La déclaration d’utilité publique est sollicitée par le Conseil Général du Calvados, Maître d’ouvrage de l’opération. Le bureau d’étude EGIS France a été mandaté par la Collectivité Publique pour réaliser les études nécessaires à la réalisation de ce projet, y compris l’étude d’impact sur l’environnement. Sommaire du rapport I Objet de l’enquête Page 3 II Textes législatifs Page 3 III Organisation de l’enquête Page 5 IV Etude du dossier Page 7 V Visite des lieux et rencontres Page 9 VI Déroulement de l’enquête Page 9 VII Analyse et observations du public Page 10 VIII Procès-verbal de synthèse Page 10 IX Pièces annexes au rapport Pages 17 à 40 2 I Objet de l’Enquête La présente enquête publique concerne le projet d’aménagement de la route départementale 126 entre la RD 220 et le bourg de ROSEL ainsi que son raccordement à la RD 170 entre ROSEL et CAIRON. Elle porte sur les travaux d’aménagement nécessaires pour moderniser cette voie au regard des normes actuelles. -

Presentation for 1 - Overview of Ports of Normandy What Is Ports of Normandy ?
Presentation for 1 - Overview of Ports of Normandy What is Ports of Normandy ? Ports of Normandy is a public entity jointly created by : - Normandy Region - Calvados, Manche, Seine-Maritime Departments, - Caen, Cherbourg, Dieppe conurbations Ports of Normandy is the owner of the ports of Caen-Ouistreham, Cherbourg and Dieppe since 1st January 2019 As owner and port authority, Ports de Normandy has the role of managing and developing the port property • Guaranteeing safe access for shipping • Defining a sustainable development policy • Delegating authority Caen-Ouistreham, Cherbourg and Dieppe Caen – Ouistreham Cherbourg Dieppe Cross-channel: 1st Route to England, west Historic cross-Channel port, Cherbourg offers At the heart of a dynamic economic of the Dover Strait 4 routes to England and Ireland. 1st French region, the Port of Dieppe has a natural port to Ireland. and daily connection to England. Multi-purpose regional hinterland port (Cereals, scrap metal, agri-food…) “Port in the heart of the Channel", a logistics & industrial hub in the Channel with rare Organized in terminals along a 15 km long nautical features: deepwater port, accessible canal linking Caen to the sea H 24, able to accommodate vessels with a draught of 14 m Accessibility Several wide roads (motorway and dual carriage way) without congestion Distance from Cherbourg to KM (about) (by road) Paris 350 Belgian border 550 German border 850 Spain border 900 Italian border 1,000 Railway junction for reaching Paris, East and Centre of France Ports of Normandy Cross-Channel -

4 Caen Cresserons Bény-Sur-Mer
LIGNE CAEN CRESSERONS 4 BÉNY-SUR-MER HORAIRES VALABLES DU 02 SEPTEMBRE 2021 AU 06 JUILLET 2022 INCLUS* *Horaires susceptibles d’être modifiés au 19 décembre 2021. Car en coordination avec les trains lun au ven en provenance de PARIS sam lun au ven Autres correspondances NOMAD sam Lundi Lundi Lundi Lundi Lundi Lundi Lundi Lundi au Mercredi au au Lundi Lundi au Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi au au au samedi vendredi au au vendredi samedi vendredi vendredi au samedi samedi vendredi samedi Période de validité TA PS PS TA PS TA TA PS PS PS PS PS PS TA PS TA TA TA CAEN / Gare Routière 10:00 12:25 13:30 13:45 13:55 17:02 17:45 19:20 CAEN / Place Courtonne 10:10 12:28 12:35 12:35 13:40 13:55 14:05 15:55 16:05 17:12 17:20 17:40 17:55 18:15 18:20 18:50 19:28 CAEN / Vaugueux 10:11 12:29 12:36 12:36 13:41 13:56 14:06 15:56 16:06 17:13 17:21 17:41 17:57 18:16 18:21 18:51 19:29 CAEN / Délivrande 10:13 12:31 12:38 12:38 13:43 13:58 14:08 15:58 16:08 17:17 17:25 17:43 17:59 18:18 18:23 18:53 19:31 CAEN / Édimbourg 10:14 12:32 12:39 12:39 13:44 13:59 14:09 15:59 16:09 17:18 17:26 17:44 18:01 18:19 18:24 18:54 19:32 CAEN / Lycée Laplace 10:15 12:33 12:40 12:40 13:45 14:00 14:10 16:00 16:10 17:19 17:27 17:45 18:03 18:20 18:25 18:55 19:33 CAEN / Calvaire Saint Pierre (Lycée Victor Hugo) I I 12:44 I I I I I I 17:25 17:33 I I I I I I CAEN / Péricentre (Collège Lechanteur) 10:17 12:35 12:48 12:42 13:47 14:02 14:12 16:02 16:12 16:45 17:29 17:37 17:47 18:05 18:22 18:27 18:57 19:35 CAEN / Mont Coco 10:19 12:37 12:50 12:44 13:49 14:04 14:14 16:04 16:14 16:47 17:31 -

Délimitation Des Zones Du Quatrième Programme D'action De La Directive
DélimitationDélimitation desdes zoneszones dudu quatrièmequatrième programmeprogramme d'actiond'action dede lala directivedirective nitratesnitrates dudu départementdépartement dudu CalvadosCalvados BRETTEVILLE L'ORGUEILLEUSE ANGUERNY ESQUAY SUR SEULLES CAIRON BENOUVILLE ANISY MARTRAGNY LASSON AMBLIE BIEVILLE BEUVILLE AMFREVILLE SAINT VIGOR LE GRAND BASLY RUCQUEVILLE ROSEL BANVILLE BLAINVILLE SUR ORNE BREVILLE LES MONTS BERNIERES SUR MER SAINT GABRIEL BRECY ROTS BENY SUR MER CAMBES EN PLAINE HEROUVILLETTE COLOMBY SUR THAON SAINT VIGOR VAUX SUR SEULLES SAINT MANVIEU NORREY COLOMBIERS SUR SEULLES COLLEVILLE MONTGOMERY RANVILLE CRESSERONS SECQUEVILLE EN BESSIN COURSEULLES SUR MER EPRON DOUVRES LA DELIVRANDE SAINT GABRIEL THAON FONTAINE HENRY HERMANVILLE SUR MER LANGRUNE SUR MER VILLONS LES BUISSONS GRAYE SUR MER HEROUVILLE SAINT CLAIR RIVE DROITE DE L'ORNE LION SUR MER LE FRESNE CAMILLY OUISTREHAM LUC SUR MER MUE REVIERS PERIERS SUR LE DAN MATHIEU SAINTE CROIX SUR MER SAINT AUBIN D'ARQUENAY PLUMETOT SAINT CONTEST ISIGNY SUR MER COTE DE NACRE OUEST SAINT AUBIN SUR MER NEUILLY LA FORET DAN-Canal ISIGNY COTE DE NACRE CENTRE BayeuxBayeux BARBEVILLE BARBEVILLE COTTUN CUSSY RANCHY CaenCaen RIBEL ARGANCHY JUAYE MONDAYE SAINT PAUL DU VERNAY SUBLES LisieuxLisieux TRUNGY CAEN-PRAIRIE BRETTEVILLE SUR ODON PREBENDE CAEN CARPIQUET BANNEVILLE SUR AJON ETERVILLE EVRECY FEUGUEROLLES BULLY MAISONCELLES SUR AJON FLEURY SUR ORNE SAINTE HONORINE DU FAY FONTAINE ETOUPEFOUR VACOGNES NEUILLY IFS LOUVIGNY MALTOT SAINT ANDRE SUR ORNE SAINT MARTIN DE FONTENAY VERSON