Vincent Lebbe Et Son Héritage
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

A Chinese Christian: the Transformation of 20 Century
Ip Ka-kei, Benedict Keith,〈A Chinese Christian: the Transformation of 20th Century Catholic Church in John C. H. Wu’s Perspective〉 A Chinese Christian: the Transformation of 20th Century Catholic Church in John C. H. 1 Wu’s Perspective Ip Ka-kei, Benedict Keith 2 一位中國基督徒 ── 從吳經熊先生的觀點 看 20 世紀天主教教會的轉變 葉家祺 [ABSTRACT] John Ching Hsiung Wu ( 吳經熊, 1899-1986), undoubtedly was a prominent figure in the field of Law, Philosophy, translation and Christianity in 20th Century China. His experience, writings and understanding of the Catholic faith since his encounter of St. Thérèse of Lisieux open a way for Chinese to connect the faith with Chinese culture. With his East-West knowledge, his literature presents in the Chinese classics an elegant manner. Many books were translated, including the psalms and the New Testament, which are surprisingly outstanding in terms of presenting Christianity in a true Chinese manner. His way of being a “Chinese Christian” serves as a 1 This article would not be possibly completed without the help of Fr. Matthias Christian, SVD, who generously shared his materials with me at all times. 2 Master of Religious Studies (Specialized in History and Adaptation of Christianity in China and Asia), University of Saint Joseph, Macau. Associate Editor of “O Clarim” (號角報), Catholic Diocese of Macau 《天主教研究學報》〈現代歷史中的基督宗教〉 第五期 2014 年 model for both preserving traditional Chinese values and philosophy, yet interweaving it with the Christian faith. After he returned and settled in Taiwan in 1966, he dedicated his life to realizing his idea of a “Cultural Renaissance” (文化復興), in which he envisioned it as the ultimate goal to achieve in order to transform Eastern and Western Society. -

E Virgin Mary and Catholic Identities in Chinese History
e Virgin Mary and Catholic Identities in Chinese History Jeremy Clarke, SJ Hong Kong University Press e University of Hong Kong Pokfulam Road Hong Kong www.hkupress.org © Hong Kong University Press 2013 ISBN 978-988-8139-99-6 (Hardback) All rights reserved. No portion of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording, or any information storage or retrieval system, without permission in writing from the publisher. British Library Cataloguing-in-Publication Data A catalogue record for this book is available from the British Library. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Printed and bound by Goodrich Int’l Printing Co., Ltd. in Hong Kong, China Contents List of illustrations ix Acknowledgements xi Introduction: Chinese Catholic identities in the modern period 1 Part 1 Images of Mary in China before 1842 1. Chinese Christian art during the pre-modern period 15 Katerina Ilioni of Yangzhou 21 Madonna and Guanyin 24 Marian images during the late Ming dynasty 31 e Madonna in Master Cheng’s Ink Garden 37 Marian sodalities 40 João da Rocha and the rosary 42 Part 2 e Chinese Catholic Church since 1842 2. Aer the treaties 51 French Marian devotions 57 e eects of the Chinese Rites Controversy 60 A sense of cultural superiority 69 e inuence of Marian events in Europe 74 3. Our Lady of Donglu 83 Visual inuences on the Donglu portrait 89 Photographs of Cixi 95 Liu Bizhen’s painting 100 4. e rise and fall of the French protectorate 111 Benedict XV and Maximum Illud 118 viii Contents Shanghai Plenary Council, 1924 125 Synodal Commission 132 Part 3 Images of Mary in the early twentieth century 5. -
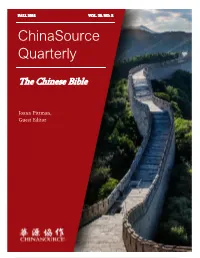
Chinasource Quarterly
FALL 2018 VOL. 20, NO. 3 ChinaSource Quarterly The Chinese Bible Joann Pittman, Guest Editor About ChinaSource For the past 20 years, ChinaSource has been a trusted platform facilitating the flow of critical knowledge and leading-edge research among the Christian communities inside China and around the world and engaging them in collaborating to serve the Chinese church and society. As China continues to grow and change, the church in China is doing the same. With over 100 years of collective China-ministry experience, the ChinaSource team is strategically positioned to help bring knowledge, clarity, and insight to groups engaging with China. Content ChinaSource’s content is aimed at providing reliable, balanced, and relevant information to those who serve China. All of ChinaSource’s content resources can be found on the website: www.chinasource.org Partnerships ChinaSource’s partnerships are aimed at playing a catalytic role in bringing together the right people, asking the right questions, and influencing Christian thinking about China. We partner with individuals, organizations, churches, and interested groups who share our vision to see China's Christians engage the society inside and outside of China as they contribute to and influence the global church conversation for the advancement of God’s Kingdom. Training/Consulting Under the ChinaSource Institute, ChinaSource provides its training/consulting services packaged in a variety of products and services that are easily accessible to a wide audience. A full list of our offering can be found on our website: www.chinasource.org Engagement ChinaSource is committed to actively engaging with China in order to better connect and amplify the voice of Christians in China. -

Global Chinese Art Auction Mar
G L O B A L C H I N E S E A R T A U C T I O N MA R K E T R E P O R T 2 0 1 5 Table of Contents Foreword . 4 About artnet . 5 About the China Association of Auctioneers (CAA) . 6 Key Findings . 7 1 The Chinese Art Market in 2015 . 11 1 .1 Market Overview . 12 1 .2 Mainland China Market . 13 1 .3 Overseas Market . 16 1 .4 Market Structure . 19 2 Lot Composition and Price Distribution . 21 2 .1 Performance by Sector . 22 2 .2 Performance by Price Segments . 26 Appendix 1: 2015 List of Global Chinese Antiques and Art Auction Houses . 29 Appendix 2: 2015 List of Lots Sold for Over 10 Million RMB . 70 Notes . 127 Contact . 130 4 Global Chinese Art Auction Market Report 2015 Foreword artnet and the China Association of Auctioneers (CAA) Over the past 10 years, the Chinese art market has seen are pleased to present the fourth edition of the Global both tremendous growth and volatilities, reaching a size Chinese Art Auction Market Report, offering together an large enough to majorly impact the global auction market . in-depth look at the market for Chinese art in 2015 . At the same time, the overseas sales of Chinese art has also more than quadrupled since 2009, with an unexpect- In a continued effort to present the most accurate repre- edly strong growth in 2015 even as the mainland market sentation of the auction market in China, artnet has again went through a cooling period . -

Chinesischer Diplomat Biographie Beltchenko
Report Title - p. 1 of 33 Report Title Bayanty (um 1732) : Chinesischer Diplomat Biographie 1732 Deysin und Bayanty besuchen die Ermitage in St. Petersburg. [ChiRus8] Beltchenko, Andrew T. = Bel'chenko, Andrei Terent'evich = Belchenko, Andrey Terentyevich (Kozlova 1873-1958) : Russischer Diplomat Biographie 1899-1900 Andrew T. Beltchenko ist Student Interpreter der russischen Gesandtschaft in Beijing. [Belt1] 1901 Andrew T. Beltchenko ist Konsul des russischen Konsulats in Fuzhou. [Belt1] 1902-1903 Andrew T. Beltchenko ist Vize-Konsul des russischen Konsulats in Hankou. [FFC1] 1903 Andrew T. Beltchenko ist Assistant Secretary der russischen Gesandtschaft in Beijing. [Belt1] 1906 Andrew T. Beltchenko wird Konsul des russischen Konsulats in Niuchang (Mandschurei). [Belt1] 1910 Andrew T. Beltchenko ist Konsul des russischen Konsulats in Fuzhou. [Belt1] 1912 Andrew T. Beltchenko wird Konsul des russischen Konsulats in Guangzhou (Guangdong). [Belt1] 1914-1920 Andrew T. Beltchenko ist Generalkonsul des russischen Konsulats in Hankou. [FFC1] Bibliographie : erwähnt in 2014 Andrei Terent'evich Bel'chenko Papers, 1898-1962 : http://www.oac.cdlib.org/findaid/ark:/13030/tf7779n8ts/entire_text/. Bogomolov, Dimitri (um 1938) : Russischer Diplomat Biographie 1935 ca.-ca. Dimitri Bogomolov ist Botschafter in China. [Int] 1938 1937-1938 Vertrag zwischen Sowjetunion / Russland und China in Tianjin, unterschrieben von Wang Chonghui und Dimitri Bogomolov. Bestätigung 1938 vom Supreme National Defense Council unter Chiang Kai-shek. [ChiRus6:S. 20] Borodin, Mikhail = Borodin, Michael = Borodin, Mikhail Marcovich (Russland 1884-1951) : Sovietischer Ratgeber der Guomindang Biographie 1923 Mikhail Borodin kommt in Guangzhou an und wird von Sun Yatsen als Berater der Guomindang eingestellt. [ChiRus3:S. 126] 1924-1927 Mikhail Borodin ist Ratgeber der Guomindang. -

Mercado E Sistema Tributário Chinês: Análise Acerca Da Constituição De Uma Potência
MERCADO E SISTEMA TRIBUTÁRIO CHINÊS: ANÁLISE ACERCA DA CONSTITUIÇÃO DE UMA POTÊNCIA Cláudio Tessari é Mestre em Direito pelo Centro Universitário Ritter dos Reis – UniRitter Laureate International Universities. Pós-graduado em Gestão de Tributos e Planejamento Tributário Estratégico pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS. Professor livre docente dos cursos de: Pós-graduação em Direito Tributário do Centro Universitário Ritter dos Reis – UniRitter Laureate International Universities; Pós-gradução em Direito Tributário da PUCRS-IET; Pós- graduação da Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia da PUCRS; Pós-graduação em Direito de Família e Sucessões da PUCRS; Pós-graduação em Direito e Gestão Tributária da Universidade do Vale do Rio dos Sinos – Unisinos; Pós-graduação em Direito de Família Contemporâneo e Mediação da Faculdade de Desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul – FADERGS; Pós-graduação em Direito de Família e MBA em Direito de Empresa com ênfase em Direito Tributário do Instituto de Desenvolvimento Cultural – IDC. Sócio do Instituto de Estudos Tributários – IET. Sócio do Instituto Brasileiro de Direito de Família – IBDFAM e membro da Comissão de Estudos Multidisciplinares. Sócio da Bernardon, Gerent & Tessari Advogados Tributaristas Associados S.S. Advogado Tributarista. Área do Direito: Direito Tributário, Direito Empresarial, Direito Comercial Internacional. Sumário: 1.Considerações iniciais. 2. O Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT) e a Organização Mundial do Comércio (OMC); 3. O que é dumping, o que significam as medidas antidumping, e a finalidade de proteger, de forma expressa (art. 3º, item 4 do WTO), os empregos e salários nas indústrias do país importador; 4. O Decreto n. -

Fudan University, Shanghai Jiaotong University, and East China Normal University: Background and Context
CHAPTER 4 Fudan University, Shanghai Jiaotong University, and East China Normal University: Background and Context Over the last two decades, a liberal arts education curriculum has been imple- mented in some top Chinese institutions of higher education to broaden students’ learning experience, with the aim of cultivating critical thinking, creativity, moral reasoning and innovation skills. This reform reflects a shift in education away from specialization toward liberal arts education, a shift from training experts in specialized disciplines to educating students so as to “develop understandings of a breadth of topics, enhance their critical think- ing abilities, and become well-rounded, educated citizens” (Bourke, Bray, and Horton 2009, 221). This chapter explores liberal arts education in three well-known universi- ties—Fudan University, Shanghai Jiaotong University, and East China Normal University in Shanghai—by discussing each school with respect to its cur- riculum development and liberal arts core curriculum modules. It begins by examining some key dimensions of each university: historical background, educational initiatives, and the present implementation of a liberal arts cur- riculum. The process of how a liberal arts curriculum came into being at each university and how it differs from the old curriculum is analyzed and exam- ined. These portraits of the three universities provide a foundation for the development of the main themes of this book in the following chapters. Fudan University Fudan University is unique among the three institutions as the only university founded by the private sector prior to 1949, when the Chinese Communist Party took power in China. It is affiliated with the Society of Jesus, a Roman Catholic religious order founded in 1540. -

Chinese Theological Review 1999
Chinese Theological Review [Vol. 13, 1998] This page was generated automatically upon download from the Globethics.net Library. More information on Globethics.net see https://www.globethics.net. Data and content policy of Globethics.net Library repository see https:// repository.globethics.net/pages/policy Item Type Journal volume Publisher Foundation for Theological Education in South East Asia (FTESEA) Rights With permission of the license/copyright holder Download date 04/10/2021 17:33:38 Link to Item http://hdl.handle.net/20.500.12424/165439 Chinese Theological Review: Volume 13 Table of Contents Table of Contents ........................................................................................................................................... 1 From the Editor .............................................................................................................................................. 2 Chinese Traditional Culture and its Influence On Chinese Theological Reflection - Wang Weifan............. 4 Imago Dei and Yin-Yang Philosophy: A Theological Reflection on the Relationship between Man and Woman - Wang Jianguo ............................................................................................................................... 11 The Church's Approach to Intellectuals - Chen Zemin................................................................................. 22 The Chinese Church in a Transitional Society - Chen Xida......................................................................... 30 Spiritual -

Modern Daoism 149 New Texts and Gods 150 Ritual Masters 152 Complete Perfection 154 Imperial Adaptations 157 an Expanded Pantheon 161
Contents Illustrations v Map of China vii Dynastic Chart viii Pronunciation Guide x Background to Daoism 1 Shang Ancestors and Divination 2 The Yijing 4 Ancient Philosophical Schools 8 Confucianism 10 Part I: Foundations 15 The Daoism That Can’t Be Told 16 The Text of the Daode Jing 17 The Dao 20 Creation and Decline 22 The Sage 23 Interpreting the Daode Jing 25 Lord Lao 28 Ritual Application 30 At Ease in Perfect Happiness 35 The Zhuangzi 36 The World of ZHuang ZHou 38 The Ideal Life 41 Poetic Adaptations 43 The Zen Connection 46 From Health to Immortality 50 i Body Energetics 51 Qi Cultivation 52 Healing Exercises 54 Magical Practitioners and Immortals 59 Major Schools of the Middle Ages 64 Celestial Masters 65 Highest Clarity 66 Numinous Treasure 68 The Theocracy 70 The Three Caverns 71 State Religion 74 Cosmos, Gods, and Governance 80 Yin and Yang 81 The Five Phases 82 The Chinese Calendar 85 Deities, Demons, and Divine Rulers 87 The Ideal of Great Peace 92 Cosmic Cycles 94 Part II: Development 96 Ethics and the Community 97 The Celestial Connection 98 Millenarian Structures 100 Self-Cultivation Groups 103 Lay Organizations 105 The Monastic Life 108 Creation and the Pantheon 114 Creation 115 Spells, Charts, and Talismans 118 Heavens and Hells 122 ii Gods, Ancestors, and Immortals 125 Religious Practices 130 Longevity Techniques 131 Breath and Sex 134 Forms of Meditation 136 Body Transformation 140 Ritual Activation 143 Part III: Modernity 148 Modern Daoism 149 New Texts and Gods 150 Ritual Masters 152 Complete Perfection 154 Imperial -

Between Admiration and Transformation 061008
Between admiration and transformation : paths of Western education into early twentieth century China Schulte, Barbara Published in: COMPARATIV. Zeitschrift für Globalgeschichte und Vergleichende Gesellschaftsforschung 2012 Link to publication Citation for published version (APA): Schulte, B. (2012). Between admiration and transformation : paths of Western education into early twentieth century China. COMPARATIV. Zeitschrift für Globalgeschichte und Vergleichende Gesellschaftsforschung, 22(1), 49-75. Total number of authors: 1 General rights Unless other specific re-use rights are stated the following general rights apply: Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research. • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal Read more about Creative commons licenses: https://creativecommons.org/licenses/ Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. LUND UNIVERSITY PO Box 117 221 00 Lund +46 46-222 00 00 Final version -

Soe Summer Camp
复旦大学经济学院 SCHOOL OF ECONOMICS FUDAN UNIVERSITY ABOUT US THE SCHOOL OF ECONOMICS Fudan University was established in Shanghai in 1905, The School of Economics (SOE) was established in first known as “Fudan Public School”. Mr. Ma Xiangbo, 1922. As one of the top institutions of economic edu- the founder, was a renowned educator at the time, who cation and research in China, SOE commits to educat- was hoping to strengthen China through education. Dr. ing leaders who will make a difference in China and Sun Yat-Sen, the founding father of China, acted as the the world. Our distinguished alumni include Dr. Min director of the board of trustees. Since her establish- Zhu, Vice President of IMF, Dr. Shangjin Wei, Chief ment, Fudan was regarded as a symbol of Chinese Economist of the Asian Development Bank, Mr. seeking enlightenment from Western world. Along the Guorong Ding, Chairman of Shenyin Wangguo Securi- past 110 years, Fudan has been distinguished as the ties Co. Ltd., and many others. Currently, we have leading globally-focused, research driven university in 1,206 undergraduate students and 1,141 graduate China. This recognition is reflected by the fact that Fudan students. Our students are from every Chinese prov- has consistently been ranked among the top three uni- ince and all over the world. They major in five fields versities in China and 51st worldwide according to 2015 including Economics, Finance, Public Finance and QS World University Rankings. Today, Fudan continues Taxation, Insurance, and Regional Studies. her pursuit of excellence and commits to powerful re- search and education. -

Assessing Jesuit Intellectual Apostolate in Modern Shanghai (1847–1949)
religions Article Assessing Jesuit Intellectual Apostolate in Modern Shanghai (1847–1949) Wei Mo 1,2 1 History Department, Fudan University, Shanghai 200433,China; [email protected] 2 Department of Foreign Studies, Shanghai Maritime University, Shanghai 201306, China; [email protected] Abstract: The various endeavors led by Jesuits under the auspices to the Plan Scientifique du Kiang-Nan (Scientific Plan for the Jiangnan region) constituted a defining moment in the history of their mission in modern China. The Jesuits aimed to found a scientific capital that would also constitute the base of their East Asian mission, a project that led to a far-reaching engagement in education and sciences. The multiple projects they undertook were located within the framework of Western knowledge. The traditional Jesuit strategy adapted itself to a new context by encouraging a constructive and fruitful interaction between religion and science. Jesuit intellectual apostolate included not only research but also the dissemination of technologies and knowledge central to the rise of modernity in China. The entry into this country of well-educated, deeply zealous Jesuit missionaries along with their observations on the social and political changes taking place decisively contributed to the modernization of Shanghai and to the emergence of multi-perspective narratives about the destiny of the city. Assessing the Jiangnan-based Jesuits’ continuous efforts as well as the challenges and contradictions they met with help us to integrate the seemingly conflicting ethos of Christian mission and scientific quest into a reframed perspective of global history. Citation: Mo, Wei. 2021. Assessing Keywords: intellectual apostolate; French Jesuits; Zi-ka-wei; Plan Scientifique du Kiang-Nan Jesuit Intellectual Apostolate in Modern Shanghai (1847–1949).