Ligne-Claire.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Belgique Francophone, Terre De B.D
Belgique francophone, terre de B.D. François Pierlot Frantseseko lektorea / Lector de francés Laburpena Komikien historia Suitzan hasi zen 1827an, Rodolphe Töpffer-ek “litera- tura iruditan” deiturikoa sortu zuenean. Printzipioa sinplea da: istorio bat kontatzen du marrazki bidez, eta istorioa azaltzeko testuak eransten ditu. Hogei urte geroago, Wilhelm Bush alemaniarrak Max und Moritz sortu zuen, marrazkietan dinamismo handia zuen umorezko komikia. Gero, batez ere egunkarietan agertzen hasi ziren komikiak. Eguneroko prentsak ere gero eta arrakasta handiagoa zuenez, komikiak Europa osora za- baldu ziren. Egunkarientzat oso garrantzitsua zen komiki onak izatea, irakur- le asko erakartzen zituztelako. Erresuma Batuan ere arrakasta izan zuten ko- mikiek. AEBtik, bestalde, koloretako argitalpenak iristen hasi ziren, testuen ordez bunbuiloak zituztenak. Belgikan, 1929an hasi ziren komikiak argitaratzen, Le petit vingtième haurrentzako egunkarian. Apaiz oso kontserbadore bat zen erredakzioburua, eta umeei komunisten alderako gorrotoa barneratzeko pertsonaia asmatzeko eskatu zion Hergé marrazkilari gazteari. Horrela sortu zen Tintin. Lehenengo aleak Tintin sobieten herrialdean zuen izenburua. Hergék bere pertsonaiaren «gobernua» hartu baino lehen, ideologiaz beteriko beste bi abentura ere izan ziren (Tintin Kongon eta Tintin Amerikan). Tintinekin hasitako goraldiaren ondoren, beste marrazki-aldizkari bel- gikar batzuk sortu ziren; besteak beste, Bravo! agerkaria. Komiki belgikarrak 1940ko hamarkadatik aurrera nagusitu ziren mundu frantsestunean, bi agerkari zirela bitarte: Le Journal Tintin eta Le Journal de Spirou, hurrenez hurren, Hergé eta Franquin marrazkilari zirela. Bi astekariek talentu gazteak hartu zituzten, aukera bat emateko. Komikien ibilbidea finka- tu zuten, klasizismo mota bat ezarrita. Journal de Spirou izenekoa 1938an sortu zuen Dupuis argitaletxeak, eta umorea landu zuen. Pertsonaiek oso jatorrak dirudite, grafismo biribilari esker (horregatik aipatzen da “sudur lodiaren” estiloa). -

Bruxelles, Capitale De La Bande Dessinée Dossier Thématique 1
bruxelles, capitale de la bande dessinée dossier thématique 1. BRUXELLES ET LA BANDE DESSINÉE a. Naissance de la BD à Bruxelles b. Du héros de BD à la vedette de cinéma 2. LA BANDE DESSINÉE, PATRIMOINE DE BRUXELLES a. Publications BD b. Les fresques BD c. Les bâtiments et statues incontournables d. Les musées, expositions et galeries 3. LES ACTIVITÉS ET ÉVÈNEMENTS BD RÉCURRENTS a. Fête de la BD b. Les différents rendez-vous BD à Bruxelles c. Visites guidées 4. SHOPPING BD a. Adresses b. Librairies 5. RESTAURANTS BD 6. HÔTELS BD 7. CONTACTS UTILES www.visitbrussels.be/comics BRUXELLES EST LA CAPITALE DE LA BANDE DESSINEE ! DANS CHAQUE QUARTIER, AU DÉTOUR DES RUES ET RUELLES BRUXELLOISES, LA BANDE DESSINÉE EST PAR- TOUT. ELLE EST UNE FIERTÉ NATIONALE ET CELA SE RES- SENT PARTICULIÈREMENT DANS NOTRE CAPITALE. EN EFFET, LES AUTEURS BRUXELLOIS AYANT CONTRIBUÉ À L’ESSOR DU 9ÈME ART SONT NOMBREUX. VOUS L’APPRENDREZ EN VISITANT UN CENTRE ENTIÈREMENT DÉDIÉ À LA BANDE DESSINÉE, EN VOUS BALADANT AU CŒUR D’UN « VILLAGE BD » OU ENCORE EN RENCON- TRANT DES FIGURINES MONUMENTALES ISSUES DE PLUSIEURS ALBUMS D’AUTEURS BELGES… LA BANDE DESSINÉE EST UN ART À PART ENTIÈRE DONT LES BRUX- ELLOIS SONT PARTICULIÈREMENT FRIANDS. www.visitbrussels.be/comics 1. BRUXELLES ET LA BANDE DESSINEE A. NAISSANCE DE LA BD À BRUXELLES Raconter des histoires à travers une succession d’images a toujours existé aux quatre coins du monde. Cependant, les spéciali- stes s’accordent à dire que la Belgique est incontournable dans le milieu de ce que l’on appelle aujourd’hui la bande dessinée. -

Hergé and Tintin
Hergé and Tintin PDF generated using the open source mwlib toolkit. See http://code.pediapress.com/ for more information. PDF generated at: Fri, 20 Jan 2012 15:32:26 UTC Contents Articles Hergé 1 Hergé 1 The Adventures of Tintin 11 The Adventures of Tintin 11 Tintin in the Land of the Soviets 30 Tintin in the Congo 37 Tintin in America 44 Cigars of the Pharaoh 47 The Blue Lotus 53 The Broken Ear 58 The Black Island 63 King Ottokar's Sceptre 68 The Crab with the Golden Claws 73 The Shooting Star 76 The Secret of the Unicorn 80 Red Rackham's Treasure 85 The Seven Crystal Balls 90 Prisoners of the Sun 94 Land of Black Gold 97 Destination Moon 102 Explorers on the Moon 105 The Calculus Affair 110 The Red Sea Sharks 114 Tintin in Tibet 118 The Castafiore Emerald 124 Flight 714 126 Tintin and the Picaros 129 Tintin and Alph-Art 132 Publications of Tintin 137 Le Petit Vingtième 137 Le Soir 140 Tintin magazine 141 Casterman 146 Methuen Publishing 147 Tintin characters 150 List of characters 150 Captain Haddock 170 Professor Calculus 173 Thomson and Thompson 177 Rastapopoulos 180 Bianca Castafiore 182 Chang Chong-Chen 184 Nestor 187 Locations in Tintin 188 Settings in The Adventures of Tintin 188 Borduria 192 Bordurian 194 Marlinspike Hall 196 San Theodoros 198 Syldavia 202 Syldavian 207 Tintin in other media 212 Tintin books, films, and media 212 Tintin on postage stamps 216 Tintin coins 217 Books featuring Tintin 218 Tintin's Travel Diaries 218 Tintin television series 219 Hergé's Adventures of Tintin 219 The Adventures of Tintin 222 Tintin films -

Blake & Mortimer: the Septimus Wave Free
FREE BLAKE & MORTIMER: THE SEPTIMUS WAVE PDF Jean Dufaux,Antoine Aubin,Etienne Shreder | 72 pages | 07 Jun 2015 | CINEBOOK LTD | 9781849182423 | English | Ashford, United Kingdom BLAKE MORTIMER SEPTIMUS PDF Blake and Mortimer is a Belgian comics series created by the Belgian writer and comics artist Edgar P. It was one of the first series to appear in the Franco-Belgian comics magazine Tintin inand was subsequently published in book form by Les Editions du Lombard. The main antagonist is their sworn enemy, Colonel Olrik, who has appeared in almost every book. Their confrontations take them into the realms of detective investigation and science-fictiondealing with such themes as time travel, Atlantis and espionage. Since the death of Jacobs, new books have been published by two separate teams of artists and writers. A television series based upon the series was produced inentitled Blake and Mortimer. The books by Jacobs himself are generally set in the very period of their writing, but those authored by others after his Blake & Mortimer: The Septimus Wave are set mostly in the s and s. When Tintin magazine was launched on 26 Septemberit included the story, Le secret de l'Espadon The Secret of the Swordfish which introduced the characters of Captain Francis Blake of the British Intelligence Service, his friend Professor Philip Mortimer, a leading physicist, and their sworn enemy Colonel Olrik. After Jacobs' death inBob de Moor completed his unfinished last story. Fromthe Jacobs estatecentred on the still-operating Jacobs Studios, republished all of Jacobs' works. The series was still firmly set in the s and included many new regular supporting characters, most notably Blake's colleagues in the security services. -
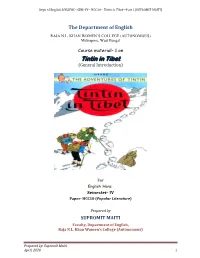
Tintin in Tibet—Part 1(SUPROMIT MAITI)
Dept. of English, RNLKWC--SEM- IV-- HCC10-- Tintin in Tibet—Part 1(SUPROMIT MAITI) The Department of English RAJA N.L. KHAN WOMEN’S COLLEGE (AUTONOMOUS) Midnapore, West Bengal Course material- 1 on Tintin in Tibet (General Introduction) For English Hons. Semester- IV Paper- HCC10 (Popular Literature) Prepared by SUPROMIT MAITI Faculty, Department of English, Raja N.L. Khan Women’s College (Autonomous) Prepared by: Supromit Maiti. April, 2020. 1 Dept. of English, RNLKWC--SEM- IV-- HCC10-- Tintin in Tibet—Part 1(SUPROMIT MAITI) Tintin in Tibet Tintin, the young, dashing and flamboyant Belgian reporter has been a familiar figure across the globe since decades now. With his passion for unveiling the truth, Tintin has become a global sensation for his intense desire to solve mysteries, his love for adventure, his unscathed honesty and his love for his friends and companions. Conceived as a character drawn to entice a readership comprising primarily of children, Tintin and his escapades charmed the young-adult and the adult readers too. A childhood hero for many, Tintin, through his numerous adventures, had travelled to places around the world, thus exposing the readers to a varied range of cultures and rituals that makes the narratives all the more interesting. Immensely favoured by readers of all age, it was only a matter of time that Tintin’s antics would feature prominently in any course of popular literature. And here we are, in a post-colonial country, reading Tintin in Tibet in a class of under-graduate students, and I guess, enjoying it? Meet Herge, the creator! The Belgian cartoonist Georges Prosper Remi won accolades under his pen name Herge, and one could wonder whether Herge had any idea that his pen name would go on to be immortalized when he used it to claim his comics. -

Traumatic Analepsis and Ligne Claire in GB Tran's
Earle, H E H 2014 Traumatic Analepsis and Ligne Claire in GB Tran’s THE COMICS GRID Vietnamerica. The Comics Grid: Journal of Comics Scholarship, 4(1): 9, Journal of comics scholarship pp. 1-4, DOI: http://dx.doi.org/10.5334/cg.at RESEARCH Traumatic Analepsis and Ligne Claire in GB Tran’s Vietnamerica Harriet E H Earle* The use of analepsis in representations of traumatic experience is not a new phenomenon in traumatic art in general or comics in particular. However, in GB Tran’s family narrative of the Vietnam War, Vietnamerica (2011), this trope is used in a particular fashion. While discussing his father’s imprisonment at the hands of the Vietnamese Government, Tran uses heavy black art before ‘flashing back’ into his father’s past, all of which is drawn in a style highly reminiscent of Ligne Claire. The high contrast of Tran’s two artistic styles is especially interesting when we consider that he is trying to recreate a traumatic experience told in analepsis and also when we remember the French occupation of Vietnam and, invariably, the influence of French art on Tran’s father. Why does Tran use this iconic style for the flashback? How does this shift in style affect the narrative? How does it assist in the representation of the traumatic experience within the text? Keywords: Comics; Vietnam War; Trauma; Freud; GB Tran GB Tran’s family graphic narrative Vietnamerica (2011) (Miller 2007: 18). However, the style is synonymous with recounts the multi-generational story of his family his- the Franco-Belgian bandes-dessinée tradition and more tory, starting with his grandparents’ (specifically grand- specifically Belgian comics artist Hergé. -

La Ligne Claire De Le Corbusier. Time, Space, and Sequential Narratives
DOI: http://dx.doi.org/10.4995/LC2015.2015.814 La Ligne Claire de Le Corbusier. Time, Space, and Sequential Narratives L.M. Lus Arana Profesor Ayudante Doctor. Área de Composición Arquitectónica. Escuela de Ingeniería y Arquitectura, Universidad de Zaragoza Abstract: In 1921, issue 11-12 of L’Esprit Nouveau featured an article entitled “Toepffer, précurseur du cinema” where Le Corbusier, signing as ‘De Fayet’, vindicated the figure of Rodolphe Töpffer (1799-1846), a Swiss a pioneer of comics, as a key element in the development of cinema. Marginal as it may seem, this reference unveils a deeper relationship between Jeanneret and Töpffer’s work which started in his childhood, and would have a key role in the development of some of Le Corbusier’s trademark obsessions: travel, drawing, and cinematic narratives. In this context, “La Ligne Claire de Le Corbusier” proposes a close examination of the presence of graphic narrative and its aesthetics in Le Corbusier's early work in relation to its evolution from a sequential promenade architecturale to multispatial enjambment. The paper explores themes such as narrative and the inclusion of time in le Corbusier's Purist paintings, or his evolution from a painterly approach to drawing to an idealized, linear and synthetic rendering style. Keywords: Sequence; Enjambment; Purism; Avant-Garde; Töpffer ; Bande Dessinée. 1. Introduction: Le Corbusier, the Arts, and the Media In November 1921, issue 11-12 of L’Esprit Nouveau featured an article entitled “Toepffer, précurseur du cinema”1. Signed by De Fayet, a penname shared by Amédée Ozenfant and Charles-Edouard Jeanneret, it vindicated the figure of Rodolphe Töpffer, and was accompanied by a selection of comic strips from Monsieur Pencil (created in 1831 and published in 1840), and Le Docteur Festus (1831/1846). -

The African Telatelist
The African Telatelist Newsletter 216 of the African Telately Association – June 2016. ___________________________________________________________________________ TIN TIN (Character) - (W.Stobrawe) Tintin (French pronunciation: [tɛt̃ ɛ])̃ is a fictional character in The Adventures of Tintin, the comics series by Belgian cartoonist Hergé. Unlike more colourful characters that he encounters, Tintin's personality is neutral, which allows the reader to not merely follow the adventures but assume Tintin's position within the story. Combined with Hergé's signature ligne claire ("clear line") style, this helps the reader "safely enter a sensually Tintin is the eponymous protagonist of the stimulating world." series; a reporter and adventurer who travels around the world with his dog Snowy. The character was created in 1929 and introduced in Le Petit Vingtième, a weekly youth supplement to the Belgian newspaper Le Vingtième Siècle. He appears as a young Tintin's creator died in 1983, yet his creation man, around 14 to 19 years old with a round remains a popular literary figure, even face and quiff hairstyle. Tintin has a sharp featured in a 2011 Hollywood movie. Tintin intellect, can defend himself, and is honest, has been criticised for his controversial decent, compassionate, and kind. Through attitudes to race and other factors, been his investigative reporting, quick-thinking, honoured by others for his "tremendous and all-around good nature, Tintin is always spirit", and has prompted a few to devote able to solve the mystery and complete the their careers to his study. General Charles adventure. de Gaulle "considered Tintin his only international rival." -3- Origins Hergé biographer Pierre Assouline noted that "Tintin had a prehistory", being influenced by a variety of sources that Hergé had encountered throughout his life. -

Huberty Breyne Auction
HUBERTY BREYNE AUCTION VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES PLANCHES ORIGINALES DE BANDE DESSINÉE Samedi 15 décembre 2018 à 14h 33 Place du Châtelain 1050 Bruxelles www.hubertybreyne.com PROGRAMME DES VENTES VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES PLANCHES ORIGINALES DE BANDE DESSINÉE Samedi 15 décembre 2018 à 14h EXPOSITIONS PUBLIQUES 33 Place du Châtelain 1050 Bruxelles Paris La Salle Mardi 4 décembre de 11h à 19h30 20 rue Drouot Mercredi 5 décembre de 11h à 18h 75009 Paris – FRANCE Bruxelles Jeudi 13 décembre de 14h à 20h Huberty & Breyne Gallery Vendredi 14 décembre de 11h à 19h 33 Place du Châtelain Samedi 15 décembre de 10h30 à 12h 1050 Bruxelles – BELGIQUE Cocktail jeudi 13 décembre à partir de 18h Commissaire-priseur EXPERTS Maître Catherine DESSAIN Alain HUBERTY Huissier de justice +32 (0)478 31 92 82 VENTES AUX ENCHÈRES Maître Caroline DEMEY [email protected] Textes SAMEDI 15 DÉCEMBRE À 14H Marc BREYNE CATALOGUE DISPONIBLE SUR : Alexandre BUCHET hubertybreyne.com – Planches originales de Bande Dessinée +32 (0)473 75 17 11 Marc-Antoine d’ESCAYRAC drouotonline.com [email protected] auction.fr lot 1 à 408 Jean GLOGOWSKI DIMANCHE 16 DÉCEMBRE À 13H ENCHÉRIR : Design Graphique – Venez nous rencontrer en salle – Albums et originaux de Bande Dessinée – Laissez-nous un ordre d’achat ou une POUR TOUT Charles lot 501 à 1001 NÉMOZ-GUILLOT demande de ligne téléphonique (p. 176). RENSEIGNEMENT – Enchérissez online en vous inscrivant sur catalogue sur demande Crédits Photographique drouotlive.com Renaud SCHROBILTGEN Responsable de la vente Marie-Caroline BRONZINI Images +32 (0)2 893 90 30 inscription Sebastià OROBITG BORRÀS Inscription jusqu'à 13h le jour de la vente. -

03Jokowi Comic Article FINAL
Public Relations Journal Special Issue: Public Relations Practices in Asia (August 2017) © 2017 Institute for Public Relations Strategic political communication through storytelling: A case study of the “Democreative Tales of Jokowi’s Blusukan” comics Deborah N. Simorangkir Department of Communication and Public Relations Faculty of Business Administration and Humanities Swiss German University EduTown BSD City, Tangerang 15339, Banten, Indonesia [email protected] Sigit Pamungkas Department of Communications Faculty of Social and Political Sciences Universitas Pelita Harapan Jl. MH. Thamrin Boulevard, Lippo Karawaci, Tangerang 15811, Banten, Indonesia [email protected] Abstract The 2014 Indonesian presidential election attracted massive interest of Indonesians around the world, who more than ever before, became very active in campaigning for the two candidates: Prabowo Subianto and Joko Widodo (commonly referred to as Jokowi). Strategies used by their supporters ranged from the use of smear campaign to the use of creative art. One form of creative art used by the volunteer supporters of Jokowi included Tintin-style (from the comics by Hergé) posters and other print materials depicting Jokowi. These comics have gone viral through social media. The collection of these posters were later officially published as a book titled “Demokreatif Kisah Blusukan Jokowi” (“Democreative Tales of Jokowi’s Blusukan”- blusukan can be roughly translated into impromptu visits to meet the people). Through the art of storytelling, Jokowi is successfully portrayed as the people’s leader, who is humble and down-to- earth, representing the proletarian. After being elected president, this storytelling strategy continues as the comics are still produced, but now portraying both Jokowi and Vice-President Jusuf Kalla. -

Tintin Comics
European journal of American studies 12-4 | 2017 Special Issue: Sound and Vision: Intermediality and American Music Jazz Between the Lines: Sound Notation, Dances, and Stereotypes in Hergé’s Early Tintin Comics Lukas Etter Electronic version URL: https://journals.openedition.org/ejas/12402 DOI: 10.4000/ejas.12402 ISSN: 1991-9336 Publisher European Association for American Studies Electronic reference Lukas Etter, “Jazz Between the Lines: Sound Notation, Dances, and Stereotypes in Hergé’s Early Tintin Comics ”, European journal of American studies [Online], 12-4 | 2017, Online since 28 December 2017, connection on 08 July 2021. URL: http://journals.openedition.org/ejas/12402 ; DOI: https://doi.org/ 10.4000/ejas.12402 This text was automatically generated on 8 July 2021. Creative Commons License Jazz Between the Lines: Sound Notation, Dances, and Stereotypes in Hergé’s Ea... 1 Jazz Between the Lines: Sound Notation, Dances, and Stereotypes in Hergé’s Early Tintin Comics1 Lukas Etter 1 Comics’—or, more broadly, graphic narratives’—relationship with jazz has been long- standing and complex. Artists and critics frequently use musical metaphors, particularly those related to improvisation, in their analyses of specific comics pages. As early as 1924, Gilbert Seldes drew a connection between jazz and comics in his assessment of what he termed the modern “lively arts,” and Art Spiegelman and Philipp Johnston recently teamed up to revisit this connection in their comics-and-jazz projection performance titled Wordless! (2014; see also Bremgartner). Historical jazz scenes, such as that of Berlin nightlife in the 1930s or New York in the 1950s form an important thematic pool for contemporary graphic narratives (e.g., Lutes, Parisi; cf. -

The Sarcophagi of the Sixth Continent, Part 1 V. 9 Pdf, Epub, Ebook
THE ADVENTURES OF BLAKE AND MORTIMER: THE SARCOPHAGI OF THE SIXTH CONTINENT, PART 1 V. 9 PDF, EPUB, EBOOK Yves Sente,Andre Juillard | 64 pages | 16 Apr 2011 | CINEBOOK LTD | 9781849180672 | English | Ashford, United Kingdom The Adventures of Blake and Mortimer: The Sarcophagi of the Sixth Continent, Part 1 v. 9 PDF Book Davis director, Rod Dean. The cameos are often a tribute to their creator, Edgar P. Science Fiction. Benson, David Honeychurch Prof. Belgian comic series. It was first published in Tintin magazine between 6 August and 3 November and later appeared in book form in Great by recreating the universal expo. II p military coup in Greece 12 years later, i. Open Preview See a Problem? This comic takes place in and is currently a sequel to the Voronov Plot ther Another entry on my plan to re-read the Post Edgar P. Although the series is no doubt for reasons of euphony called Blake and Mortimer , it is Professor Mortimer who is often the main protagonist. This process takes no more than a few hours and we'll send you an email once approved. Ich mochte den Anfang sehr gerne, aber trotz der sympathischen Zeichnungen fiel es mir schwer, die Story bis zum Ende mit Interesse zu verfolgen. Anyhow this first episode tells us the much wanted part of how Blake met Mortimer in the first place and it is a very neat affair very well scripted in the Colonial past of the British empire were Mortimer visits his parents and meets Blake and both young men have an instant report.