2.5.1.2. Reglement D'urbanisme D'aubaine 2.5
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Mobigo Lr117 Dijon-Bligny Sur Ouche-Saulieu
TRANSCO DEVIENT Période scolaire Période vacances Lundi, Lundi, Lundi mardi, Mercredi Lundi mardi, Lundi à vendredi Samedi Dimanche Lundi à vendredi Samedi Dimanche DIJON BLIGNY-SUR-OUCHE à vendredi jeudi, à vendredi jeudi, vendredi vendredi N° services 0042 0032 0146 0082 0156 0102 0062 0042 0082 0072 0092 0082 0112 0072 0082 0092 DIJON BLIGNY-SUR-OUCHE Note à consulter (1) (2) (2) (1) DIJON Collège Rameau 12:05 16:45 DIJON HORAIRES VALABLES A PARTIR DU 1 ER SEPTEMBRE 2018 DIJON Clomiers (Montchapet) 11:15 12:15 17:10 18:15 18:30 PLOMBIÈRES DIJON Gare de Dijon-Ville (Tram) 07:20 11:30 12:30 17:30 18:30 07:20 12:30 18:30 13:20 12:30 18:30 12:30 13:20 DIJON CHS La Chartreuse 11:33 12:12 12:33 16:52 17:35 18:35 12:33 18:35 13:23 12:33 18:35 18:35 12:33 13:23 LIGNE 47 DEVIENT LR 117 VELARS-SUR-OUCHE PLOMBIÈRES Poste 11:37 12:15 12:37 16:55 17:40 18:40 12:37 18:40 13:27 12:37 18:40 18:40 12:37 13:27 FLEUREY-SUR-OUCHE VELARS-SUR-OUCHE La Verrerie 11:43 12:27 17:07 18:49 A 13:37 18:49 A 18:49 A 13:37 VELARS-SUR-OUCHE Centre 11:45 12:30 17:10 18:51 A 13:39 18:51 A 18:51 A 13:39 SAINTE-MARIE-SUR-OUCHE VELARS-SUR-OUCHE Écluse 11:47 12:33 17:13 13:41 13:41 GISSEY-SUR-OUCHE FLEUREY-SUR-OUCHE Échangeur 11:52 12:37 12:48 17:17 17:49 18:49 12:48 18:53 13:45 12:48 18:59 18:53 12:48 13:45 FLEUREY-SUR-OUCHE Centre 11:54 A 12:41 A 12:51 A 17:19 A 17:51 A 18:51 A 12:51 A 18:55 A 13:47 A 12:51 A 18:55 A 18:55 A 12:51 A 13:47 A BARBIREY-SUR-OUCHE FLEUREY-SUR-OUCHE Cimetière 11:56 A 12:43 A 12:53 A 17:21 A 17:53 A 18:53 A 12:53 A 18:57 A 13:49 A 12:53 A 18:57 -

Enquete Publique
DEPARTEMENT DE LA COTE D’OR PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE AU SOL SUR LE TERRITOIRE DES COMMUNES D’AUBAINE ET DE BESSEY EN CHAUME ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE : AUX DEUX DEMANDES DE PERMIS DE CONSTRUIRE D’UNE CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE PRESENTEES PAR LA SOCIETE « SAS CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE du COL de BESSEY » RAPPORT et CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR Enquête du lundi 2 septembre 2019, 10h au lundi 7 octobre 2019, 19h Commissaire enquêteur: Gilles GIACOMEL E Enquête Publique Dossier N° E19000091/21 Enquête Publique Projet de Centrale Solaire Photovoltaïque sur les communes de Bessey en Chaume et Aubaine (21) - 1 - SIGLES APRR : Autoroutes Paris-Rhin-Rhône, AEI : Aire d’Etude Immédiate, BASIAS : Base nationale des Anciens sites industriels et activités de service CCPABO : Communauté de communes de Pouilly en Auxois et Bligny sur Ouche CDPENAF : Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers CO2 : Le dioxyde de carbone est l'appellation chimique du gaz carbonique. C’est le principal gaz à effet de serre à l'état naturel, avec la vapeur d'eau. Sa durée de vie dans l'atmosphère est d'environ 100 ans. CRE : Commission de Régulation de l’Energie DREAL : Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement MWc: Méga Watt crête MRAe : Mission Régionale d’Autorité environnementale NATURA 2000 : Le réseau Natura 2000 rassemble des sites naturels ou semi-naturels de l'Union européenne ayant une grande valeur patrimoniale, par la faune et la flore exceptionnelle qu'ils contiennent. RNU -

Fiche Mobigo Lr48 118-2018-Rsp
DEVIENT Période scolaire Période vacances TRANSCO Lundi, Lundi à mardi, Lundi à vendredi DIJON SAULIEU vendredi Mercredi jeudi, Samedi Dimanche Lundi à vendredi Samedi Dimanche vendredi N° services 0042 0072 0062 0082 0132 0102 0122 0072 0092 0042 0112 0082 0132 0072 0092 DIJON POUILLY-EN-AUXOIS DIJON Note à consulter (1) DIJON Clomiers (Montchapet) 16:05 SAULIEU / ARNAY-LE-DUC LACANCHE ER DIJON Gare de Dijon-Ville (Tram) 07:007:00 12:30 16:30 17:30 18:30 12:30 13:20 07:00 16:30 17:30 12:30 13:20 HORAIRES VALABLES A PARTIR DU 1 SEPTEMBRE 2018 VELARS-SUR-OUCHE DIJON CHS La Chartreuse I 12:35 16:37 17:35 18:37 12:35 13:23 16:37 17:35 12:35 13:23 FLEUREY-SUR-OUCHE VELARS-SUR-OUCHE La Verrerie I 16:50 17:45 13:35 16:50 17:45 13:35 SAINTE-MARIE-SUR-OUCHE VELARS-SUR-OUCHE Centre I 16:53 17:47 13:37 16:53 17:47 13:37 LIGNE 48 DEVIENT LR 118 AGEY VELARS-SUR-OUCHE Écluse I 16:54 13:39 16:54 I 13:39 REMILLY-EN-MONTAGNE FLEUREY-SUR-OUCHE Échangeur I 16:58 13:42 16:58 I 13:42 SOMBERNON FLEUREY-SUR-OUCHE Reine de Dijon I 16:59 16:59 I I 17:01 17:54 18:54 12:49 13:53 A 17:01 17:54 ÉCHANNAY SAINTE-MARIE-SUR-OUCHE Pont de Pany Gare 12:49 12:49 13:53 A SAINTE-MARIE-SUR-OUCHE Pont de Pany Centre I 12:51 17:02 17:56 18:56 12:51 13:54 A 17:02 17:56 12:51 13:54 A MONTOILLOT SAINTE-MARIE-SUR-OUCHE Noyer des Vignes I 12:52 17:04 17:57 18:58 12:52 17:04 17:57 12:52 COMMARIN AGEY Église I 12:55 17:07 18:00 19:01 12:55 17:07 18:00 12:55 VANDENESSE-EN-AUXOIS REMILLY-EN-MONTAGNE Centre I 13:00 17:11 18:05 19:04 13:00 17:11 18:05 13:00 POUILLY-EN-AUXOIS REMILLY-EN-MONTAGNE -
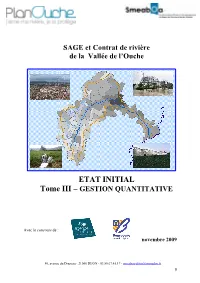
ETAT INITIAL Tome III – GESTION QUANTITATIVE
SAGE et Contrat de rivière de la Vallée de l’Ouche ETAT INITIAL Tome III – GESTION QUANTITATIVE Avec le concours de : novembre 2009 40, avenue du Drapeau - 21000 DIJON - 03.80.67.45.17 - smeaboa [email protected] 0 0 GESTION QUANTITATIVE 1 Sommaire I. Hydraulique – hydrologie............................................................................................................. 1 I.1. Eaux de surface.............................................................................................................................. 1 I.1.1. Cours d’eau......................................................................................................................... 1 I.1.2. Masses d’eau artificielles ................................................................................................... 9 I.1.3. Ruissellement pluvial ....................................................................................................... 11 I.2. Masses d’eau souterraines............................................................................................................ 15 I.2.1. Evaluation des transferts entre les masses d’eau .............................................................. 15 I.2.2. Nappe Dijon sud (6329A) ................................................................................................ 18 II. Inondations .................................................................................................................................. 19 III. Exploitation de la ressource en Eau..................................................................................... -

CC Pouilly-En-Auxois / Bligny-Sur-Ouche
Communauté de Communes Pouilly-en-Auxois Bligny-sur-Ouche EDITO Une dynamique bien enclenchée De formation récente, née en 2017 de la fusion de la Communauté de Communes de l’Auxois sud et de la Communauté de Communes du Canton de Bligny-sur-Ouche, la Communauté de Communes de Pouilly- en-Auxois / Bligny-sur-Ouche porte la volonté d’allier développement économique et transition écologique, consciente que son identité rurale REPèREs est une de ses premières richesses. Communauté de Communes Cet objectif ambitieux nous amène à concevoir nos projets de façon Pouilly-en-Auxois Bligny-sur-Ouche transversale avec des actions à caractère spécifiquement écologique et énergétique ainsi que des actions de développement économique 47 communes et d’aménagement du territoire toutes intégrées dans notre démarche de Territoire à Energie positive. 497 km2 Pour produire localement plus d’énergie que nous n’en consommons, nous avons mis en œuvre un programme important qui invite à relever 9 016 habitants quatre défis : la réduction des consommations d’énergie, la diminution Engagé depuis 2013 de la précarité énergétique, le développement des énergies renouvelables dans la démarche TEPos et la préservation de notre capital naturel. Sur le terrain, les premiers résultats sont bien visibles avec des réalisations situé aux portes de Beaune et proche concrètes qui témoignent de la réappropriation des questions d’énergie de Dijon, à la croisée des grands itinéraires par l’ensemble des citoyens, élus et acteurs socio-économiques. autoroutiers (A6, A 31, A38), notre territoire est à forte dominante rurale : forêt, La dynamique est lancée, rien ne pourra plus l’arrêter. -
Ll’’Eeccoollee Eelleemmeennttaaiirree Qquuiittttee Ppoonntt--Ddee--Ppaannyy
JOURNAL D’INFORMATIONS ET DE COMMUNICATION AU SERVICE DES HABITANTS DE LA COMMUNE DE SAINTE-MARIE-SUR-OUCHE PONT-DE-PANY PUBLICATION GRATUITE AVRIL - MAI - JUIN 2012 NUMERO 17 LL’’EECCOOLLEE EELLEEMMEENNTTAAIIRREE QQUUIITTTTEE PPOONNTT--DDEE--PPAANNYY PPRROOGGRRAAMMMMEE 1144 JJUUIILLLLEETT CCOOMMPPTTEESS RREENNDDUUSS D’’ECOLE,, MUNIICIPAUX & COMMUNAUTAIRES D’ECOLE, MUNICIIPAUX & COMMUNAUTAIIRES L’AGENDA CCAALLEENNDDRRIIEERR DDEESS MMAANNIIFFEESSTTAATTIIOONNSS Point Information Tourisme Dimanche 29: Cérémonie de la Dimanche 9 : Vide greniers ouvert du 20/06 au 16/09 à bataille du Leuzeu à Urcy (Org. : DUC) et fête patronale à l’ancienne gare de Velars-sur- Fête du barrage Sombernon Ouche. de Grosbois en Montagne Jeudi 13 : Conseil de Du 23 juin au 31 août : Communauté de la CCVO à Exposition H. Vincenot « Sous AOÛT 20h30 l’œil du peintre du bonheur » à Dimanche 5 : Fête patronale de Samedi 15 : Sortie nature et Bligny-sur-Ouche. Remilly-en-Montagne patrimoine à Mâlain et Prâlon Du Vendredi 6 juillet au Lundi 3 Vide greniers à (Org : ALES) setembre : vacances scolaires. Barbirey-sur-Ouche Samedi 15 et dimanche 16 : Jeudi 9 : Soirée train et JUILLET Visite commentée de l’église du dégustation à Bligny-sur-Ouche site de Notre Dame d’Étang à Du Vendredi 6 au Samedi 7 : (dans le cadre du centenaire de Velars-sur-Ouche et expo Stage de théâtre enfants (Org : H. Vincenot) photos dans le cadre des Asso MOZAÏK) Mercredi 15 : Vide-greniers à journées du patrimoine Mardi 10 : Conseil de Grenant-les-Sombernon (Org : Journées du Communauté de la CCVO à STELLA) patrimoine à la salle des fêtes Fleurey-sur-Ouche 26 Dimanche: Randonnée d’Agey Passage du jury pique-nique « Dans les pas de des villages fleuris Vincenot » à Bligny-sur-Ouche Dimanche 16 : Lectures au château à Velars-sur-Ouche Mardi 28 : Réunion du bureau Vendredi 13 : Feu d’artifice au (dans le cadre du centenaire de de la CCVO à 20h30 dessus de la gare à SAINTE- H. -

Monumental Lavoirs and Fontaines in France Rita Boogaart
Monumental lavoirs and fontaines in France Rita Boogaart An article for the Folly Fellowship, started as a by-product of our folly hunts in France for Journals 9, 10 and 15: Follies in France I-III An excerpt of this article was published in FiF III, pages 256-270. 1 Monumental lavoirs and fontaines in France Rita Boogaart CONTENTS LAVOIRS AND FONTAINES 3 SOURCES 5 FRENCH LAUNDRY 6 DIFFERENT TYPES OF LAVOIRS 11 COMBINED FUNCTIONS 13 Fontaine-lavoir 13 Égayoir 13 Mairie-lavoir 14 Lavoir-mairie-école 15 Château d’eau 16 With Éolienne 16 Bains, douches, piscine 17 PRIVATE LAVOIRS 18 MAYORS WITH AMBITIONS 21 PECULIAR LOCALITIES and LOCAL PECULIARITIES 23 CLASSICAL INSPIRATION 25 Windows 26 Ornaments 28 Arches 31 Colonnades 31 Combinations 33 Crescents 34 Circular examples 35 Facades 37 Arcades 38 Serlian fronts 40 Impluviums 41 OTHER STYLES 42 PETIT PATRIMOINE, RESTORATION 45 NEW FUNCTIONS 46 FONTAINES 49 Fontaines in combination with washplaces. 49 Ornamental fontaines 53 EXTRAS (information plaques) 64 2 Monumental lavoirs and fontaines in France Rita Boogaart An abbreviated version of this article appeared in Journal 15, Follies in France III. We had to shorten it because a full version complete with pictures would have filled an entire journal of the usual size. Here on the internet we have enough space to elaborate on this area of expertise that not only is very close to, but sometimes even crosses the borders of the realm of follydom. Thanks for your patience! Most of the accompanying photographs are our own. For some photos we have received special per- mission from a number of people and institutions, for which we are grateful. -

Ouche Et Montagne Guide Touristique
Ouche et Montagne Guide touristique Randonnée Autour de l’eau Découvertes Patrimoine Sports & Loisirs Art & Artisanat Restauration Hébergement Infos Ouche et Montagne L’OFFICE DE TOURISME OUCHE ET MONTAGNE se trouve à Pont-de-Pany, 250 rue de Bourgogne et vous accueille les lundis, mercredis, vendredis, samedis et dimanches de 10h à 12h30 & de 13h30 à 18h durant les mois de juillet et août. En mai, juin et septembre, il est ouvert du vendredi au dimanche. En plus de vous fournir en documentation touristique sur le territoire ouche et montagne, vous y trouvez des informations sur nos territoires et départements voisins ainsi que sur toute la Bourgogne Franche-Comté ! Des services vous sont également proposés ! EN LOCATION EN VENTE Vélos Boissons fraiches, Ancey Cartes postales et timbres, Sacs à sentier « parcours de Vendredi 5 juillet Guides du routard la cueillette magique » à Mâlain Vendredi 2 aoûtGissey-sur-Ouche « Canal de Bourgogne » 17h/22h Il est possible de réserver des vélos directement sur le site internet www.velibourgogne.fr en sélectionnant la véli’station Pont-de-Pany afin de les récupérer ensuite à l’office de tourisme ouche et montagne. Il vous est également possible d’en louer directement à l’office de tourisme sous réserve des disponibilités. Les vélos sont en location à l’heure, à la demi- journée et à la journée. Les vélos disponibles sont pour femmes, hommes et enfants. Des casques vous seront également fournis ainsi qu’une trousse à outils et des antivols. Les tailles sont disponibles Soirs sur www.velibourgogne.fr de Marché | Activités | Artisanat | Savoir-faire | Producteurs locaux | Concert Vente de produits à consommer sur place détail en page 30 p. -

21-14 Pont De Pany Pouilly-En-Auxois
de Pont-de-Pany à Pouilly-en-Auxois sur les berges du Canal de Bourgogne de Pont-de-Pany à Pouilly-en-Auxois sur les berges du Canal de Bourgogne 40,5 km www.lorvelo.fr 1 de Pont de Pany à Pouilly-en-Auxois sur les berges du canal de Bourgogne 40,5 km Informations générales télécharger la trace gpx Départ : Pont de Pany ( 48,29797 - 4,81424) Arrivée : Pouilly-en-Auxois (47,26765 - 4,53994) Longueur : km AR (Googlemap+-0,25km) Points d’intérêt sur le Villes et villages traversés: parcours Pont-de-Pany (km 0), Gissey-sur-Ouche (km 7,0), Saint-Victor-sur-Ouche (km 11,5), -Pont-de-Pany Veuvey-sur-Ouche (km 18,0), Le Pont d’Ouche (km 21,5), Crugney-sur-Ouche( km -le Pont d’Ouche 24,5), Vandenesse-en-Auxois ( km 31,5), -Pouilly-en-Auxois Pouilly-en-Auxois ( km 40,5) ! www.lorvelo.fr page 2 Pont-de-Pany (km 0) de Pont de Pany à Pouilly-en-Auxois sur les berges du canal de Bourgogne 40,5 km ! www.lorvelo.fr page 3 Gissey-sur-Ouche (km 7,0) de Pont de Pany à Pouilly-en-Auxois sur les berges du canal de Bourgogne 40,5 km ! www.lorvelo.fr page 4 Saint Victor-sur-Ouche (km 11,5) de Pont de Pany à Pouilly-en-Auxois sur les berges du canal de Bourgogne 40,5 km ! www.lorvelo.fr page 5 Veuvey-sur-Ouche (km 18,0) de Pont de Pany à Pouilly-en-Auxois sur les berges du canal de Bourgogne 40,5 km ! www.lorvelo.fr page 6 Le Pont d’Ouche (km 21,5) de Pont de Pany à Pouilly-en-Auxois sur les berges du canal de Bourgogne 40,5 km ! www.lorvelo.fr page 7 Le Pont d’Ouche (km 21,5) de Pont de Pany à Pouilly-en-Auxois sur les berges du canal de Bourgogne 40,5 km ! -

Reglement Interieur Des Accueils De Loisirs
RÈGLEMENT INTÉRIEUR ACCUEILS PÉRISCOLAIRES & EXTRASCOLAIRES (3-11 ans) 2 2021/2022 Communauté de Communes Ouche et Montagne 5, place de la Poste – Pont-de-Pany 21410 SAINTE-MARIE-SUR-OUCHE [email protected] – www.ouche-montagne.fr AGEY - ANCEY - ARCEY – AUBIGNY-LES-SOMBERNON - BARBIREY-SUR-OUCHE – BAULME-LA-ROCHE – BLAISY-BAS – BLAISY-HAUT – BUSSY-LA-PESLE – DREE – ECHANNAY - FLEUREY-SUR-OUCHE - GERGUEIL - GISSEY-SUR-OUCHE - GRENANT-LES- SOMBERNON – GROSBOIS-EN-MONTAGNE - LANTENAY - MALAIN – MESMONT – MONTOILLOT - PASQUES – PRALON - REMILLY-EN-MONTAGNE - SAINT-ANTHOT - SAINT-JEAN-DE-BŒUF - SAINTE-MARIE-SUR-OUCHE - SAINT-VICTOR-SUR-OUCHE – SAVIGNY-SOUS-MALAIN – SOMBERNON - VELARS-SUR-OUCHE – VERREY-SOUS-DREE – VIELMOULIN ACCUEILS PÉRISCOLAIRES (matins, midis, soirs & mercredis) EXTRASCOLAIRES (3-11ans) (petites & grandes vacances) SOMMAIRE 1- CONDITIONS GÉNÉRALES page 3 2- PRÉSENTATION DES ACCUEILS PÉRISCOLAIRES 3-11 ans page 4 3 – PRÉSENTATION DE L’ACCUEIL DES MERCREDIS 3-11 ans page 5 (en période scolaire) 4- PRÉSENTATION DE L’ACCUEIL EXTRASCOLAIRE 3-11 ans page 5 (en période de vacances scolaires) 5- MODALITÉS D’INSCRIPTION AU SERVICE ET DE RÉSERVATION page 6 D’ACCUEIL 6- FACTURATION page 9 7- DROITS ET DEVOIRS DE CHACUN page 14 8- SÉCURITÉ/SANTÉ page 15 2 Règlement intérieur accueils périscolaires & extrascolaires 1. CONDITIONS GÉNÉRALES Les accueils périscolaires (accueils matin / midi / soir) d’Ancey-Lantenay, Blaisy-Bas, Fleurey-sur-Ouche, Gissey-sur-Ouche, Mâlain (incluant l’accueil des mercredis), Sainte- Marie-sur-Ouche, Sombernon et Velars-sur-Ouche, ainsi que l’accueil extrascolaire de Sombernon sont gérés par la Communauté de Communes Ouche et Montagne (CCOM), dont le siège se situe 5 place de la Poste à Pont-de-Pany, 21410 SAINTE-MARIE-SUR-OUCHE. -

La Haute Vallée De L'ouche
UNITÉ PAYSAGÈRE 13 LA HAUTE VALLÉE DE L’OUCHE La haute vallée de l’Ouche Cette vallée verte, étroite et encaissée, empruntée par le Canal de Bourgogne, est le lit amont de la rivière qui traverse ensuite Dijon vers la Saône. DONNÉES Superficie : 121,6 km2 Altitude maximale : 609 m Altitude minimale : 275 m Population estimée : 6 705 habitants (source 2006) Densité estimée : 55,1 habitants/ km2 ATLAS DÉPARTEMENTAL DES PAYSAGES • CÔTE D’OR • 2010 231 UNITÉ PAYSAGÈRE 13 LA HAUTE VALLÉE DE L’OUCHE ASPECTS paYSAGE LOCALISATION LÉGENDE Source : IGN 232 ATLAS DÉPARTEMENTAL DES PAYSAGES • CÔTE D’OR • 2010 UNITÉ PAYSAGÈRE 13 LA HAUTE VALLÉE DE L’OUCHE AMBIANCES ET PERCEPTIONS La vallée de l’Ouche dans sa partie amont s’offre comme un paysage fermé, secret, un peu mysté- rieux. [1] Elle propose aussi de la fraîcheur et des fonds humides et ombragés. [2] & [3] L’effet de couloir étroit est accentué par des rebords abrupts qui cadrent les perceptions, bloquent la vue et dirigent le regard dans l’axe de la vallée. [1] 1 Limites et articUlations Les limites de l’unité épousent celles du bassin versant principal de l’Ouche dans sa partie amont, depuis la tête de bassin versant autour des sources de la rivière près de Lusigny-sur-Ouche, jusqu’au resserrement et à l’inflexion de la vallée vers l’Est avant Dijon au niveau de Pont-de-Pany. Cette vallée borde l’extrémité Ouest du massif des Hautes Côtes dont elle assure la transition avec les paysages plus collinaires de l’Auxois et de l’Arnay. -

CC De Pouilly En Auxois/Bligny Sur Ouche (Siren : 200071207)
Groupement Mise à jour le 01/07/2021 CC de Pouilly en Auxois/Bligny sur Ouche (Siren : 200071207) FICHE SIGNALETIQUE BANATIC Données générales Nature juridique Communauté de communes (CC) Commune siège Pouilly-en-Auxois Arrondissement Beaune Département Côte-d'Or Interdépartemental non Date de création Date de création 15/12/2016 Date d'effet 01/01/2017 Organe délibérant Mode de répartition des sièges Répartition de droit commun Nom du président M. Yves COURTOT Coordonnées du siège Complément d'adresse du siège MAISON DE PAYS Numéro et libellé dans la voie Le Seuil Distribution spéciale Code postal - Ville 21320 POUILLY EN AUXOIS Téléphone 03 80 90 80 44 Fax 03 80 90 73 79 Courriel [email protected] Site internet Profil financier Mode de financement Fiscalité additionnelle sans fiscalité professionnelle de zone et sans fiscalité professionnelle sur les éoliennes Bonification de la DGF non Dotation de solidarité communautaire (DSC) non Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) non Autre taxe non Redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM) non Autre redevance non 1/4 Groupement Mise à jour le 01/07/2021 Population Population totale regroupée 8 886 Densité moyenne 17,84 Périmètre Nombre total de communes membres : 47 Dept Commune (N° SIREN) Population 21 Antheuil (212100143) 61 21 Arconcey (212100200) 231 21 Aubaine (212100309) 94 21 Auxant (212100366) 79 21 Bellenot-sous-Pouilly (212100622) 230 21 Bessey-en-Chaume (212100655) 140 21 Bessey-la-Cour (212100663) 55 21 Beurey-Bauguay (212100689) 112 21 Blancey (212100820)