Jusqu'au Dernier Jour
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Sholem Schwarzbard: Biography of a Jewish Assassin
Sholem Schwarzbard: Biography of a Jewish Assassin The Harvard community has made this article openly available. Please share how this access benefits you. Your story matters Citation Johnson, Kelly. 2012. Sholem Schwarzbard: Biography of a Jewish Assassin. Doctoral dissertation, Harvard University. Citable link http://nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:9830349 Terms of Use This article was downloaded from Harvard University’s DASH repository, and is made available under the terms and conditions applicable to Other Posted Material, as set forth at http:// nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:dash.current.terms-of- use#LAA © 2012 Kelly Scott Johnson All rights reserved Professor Ruth R. Wisse Kelly Scott Johnson Sholem Schwarzbard: Biography of a Jewish Assassin Abstract The thesis represents the first complete academic biography of a Jewish clockmaker, warrior poet and Anarchist named Sholem Schwarzbard. Schwarzbard's experience was both typical and unique for a Jewish man of his era. It included four immigrations, two revolutions, numerous pogroms, a world war and, far less commonly, an assassination. The latter gained him fleeting international fame in 1926, when he killed the Ukrainian nationalist leader Symon Petliura in Paris in retribution for pogroms perpetrated during the Russian Civil War (1917-20). After a contentious trial, a French jury was sufficiently convinced both of Schwarzbard's sincerity as an avenger, and of Petliura's responsibility for the actions of his armies, to acquit him on all counts. Mostly forgotten by the rest of the world, the assassin has remained a divisive figure in Jewish-Ukrainian relations, leading to distorted and reductive descriptions his life. -

Tell the Truth Shame the Devil
TELL THE TRUTH & SHAME THE DEVIL As told to the author by a little old man in a plaid shirt DEDICATION: For Germany. For Germans who still want to be German. For Humanity. TELL THE TRUTH & SHAME THE DEVIL ISBN 978-1-937787-29-5 By GERARD MENUHIN Copyright 2015 by GERARD MENUHIN and THE BARNES REVIEW Published by: THE BARNES REVIEW, P.O. Box 15877, Washington, D.C. 20003 Ordering more copies: Order more copies of Tell the Truth & Shame the Devil (softcover, 455 pages, $35 plus $5 S&H in the U.S.) from THE BARNES REVIEW, P.O. Box 15877, Washington, D.C. 20003. TBR subscribers may take 10% off the list price. Call 1-877-773-9077 toll free Mon.-Thu. 9-5 to charge copies. See more books at www.barnesreview.com. Subscriptions: A subscription to THE BARNES REVIEW historical magazine is $46 for one year (six is- sues) and $78 for two years (12 issues) inside the U.S. Outside the U.S: Canada/Mex- ico: $65 per year. All other nations: $80 per year sent via air mail. Send payment with request to TBR, P.O. Box 15877, Washington, D.C. 20003. Call 1-877-773-9077 toll free to charge to major credit cards. Order online at www.barnesreview.com. See a special subscription offer at the back of this volume or call toll free number above and ask for best current subscription offer. Reproduction Policy: Portions of this publication may be reproduced with prior permission in critical reviews and other papers provided credit is given to author, book title is listed and full contact in- formation are given for publisher. -

Unholy Alliances? Nationalist Exiles, Minorities and Anti-Fascism in Interwar Europe
Unholy Alliances? Nationalist Exiles, Minorities and Anti-Fascism in Interwar Europe XOSÉ M. NÚÑEZ SEIXAS Ethno-nationalist exiles in the interwar period were a unique species. While some of them relied on their own diasporic networks and waited for a chance, others established agitation platforms and regarded themselves as an alternative International of the ‘oppressed peoples’. Most of these alliances ended in failure, as it proved extremely difficult to reconcile the demands stemming from divergent national claims, such as those of autonomist factions versus irredentist or pro-independence groups, or those of national minorities seeking reintegration into their motherland as opposed to groups seeking independence. This article explores the relationship between minority nationalist exiles and anti-fascism by focusing on three issues: the emergence and evolution of ‘international alliances’ of minority activists in interwar Europe; contacts and ideological exchanges between ethno-nationalist exiles and liberal and anti-fascist segments of European public opinion and, finally, the emergence of a transnational anti-fascist nationality theory. In the aftermath of the First World War state borders in east-central Europe were redrawn at the Paris Peace Conference. The armed conflicts that subsequently broke out between various successor states, along with the progression of the Russian Civil War, forced dozens of ethno-nationalist activists into exile. Those belonging to national and ethnic minorities could easily find refuge in their respective ‘motherlands’, from Weimar Germany to post-Trianon Hungary. They created networks of political and cultural associations that served as the bases for stirring up irredentism, with official state support and often also with the collaboration of large portions of the homeland’s revisionist and nationalist parties. -

Unholy Alliances? Nationalist Exiles, Minorities and Anti-Fascism in Interwar Europe
Unholy Alliances? Nationalist Exiles, Minorities and Anti-Fascism in Interwar Europe XOSÉ M. NÚÑEZ SEIXAS Ethno-nationalist exiles in the interwar period were a unique species. While some of them relied on their own diasporic networks and waited for a chance, others established agitation platforms and regarded themselves as an alternative International of the ‘oppressed peoples’. Most of these alliances ended in failure, as it proved extremely difficult to reconcile the demands stemming from divergent national claims, such as those of autonomist factions versus irredentist or pro-independence groups, or those of national minorities seeking reintegration into their motherland as opposed to groups seeking independence. This article explores the relationship between minority nationalist exiles and anti-fascism by focusing on three issues: the emergence and evolution of ‘international alliances’ of minority activists in interwar Europe; contacts and ideological exchanges between ethno-nationalist exiles and liberal and anti-fascist segments of European public opinion and, finally, the emergence of a transnational anti-fascist nationality theory. In the aftermath of the First World War state borders in east-central Europe were redrawn at the Paris Peace Conference. The armed conflicts that subsequently broke out between various successor states, along with the progression of the Russian Civil War, forced dozens of ethno-nationalist activists into exile. Those belonging to national and ethnic minorities could easily find refuge in their respective ‘motherlands’, from Weimar Germany to post-Trianon Hungary. They created networks of political and cultural associations that served as the bases for stirring up irredentism, with official state support and often also with the collaboration of large portions of the homeland’s revisionist and nationalist parties. -

DES HOMMES LIBRES Histoires Extraordinaires De L'histoire De La L.I.C.R.A
Conception Jean Chouët Photo de la 4 de couverture : Thierry Martinot © Editions Bibliophane, 1987 JEAN PIERRE ALLALI / HAIM MUSICANT DES HOMMES LIBRES histoires extraordinaires de l'histoire de la L.I.C.R.A. préface de PIERRE BLOCH EDITION BIBLIOPHANE 26 RUE DES ROSIERS 75004 PARIS 48878220 Pour Michèle Pour Nelly PRÉFACE La L.I.C.A. devenue L.I.C.R.A., fête cette année son soixan- tième anniversaire. Mes amis Haim Musicant et Jean-Pierre Allali, ont pris l'heureuse initiative d'écrire et de publier cet ouvrage. Il tombe à point. Il rappellera aux jeunes l'histoire, les combats, les luttes des militants de la L.I.C.A. et de la L.I.C.R.A. qui sont fidèles au souvenir des anciens. Un fait divers meurtrier est à l'origine de la L.I.C.A. Les anciens, peu nombreux hélas, se souviennent avec émotion de cette séance de la cour d'assises à Paris où Samuel Schwarzbard était défendu par le célèbre avocat Henry Torrès. A l'époque, c'était le 26 octobre 1927, après le meurtre de l'organisateur des pogromes en Russie blanche, Henry Torrès, par sa magni- fique plaidoirie fit acquitter le justicier au milieu des applaudis- sements de la salle. C'est quelques mois plus tard, en février 1928 que Bernard Lecache déposa les statuts d'une association régie par la loi de 1901; la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémi- tisme était née. Bernard Lecache, le fondateur, en était le premier président. Il le restera jusqu'à sa mort en 1968. -
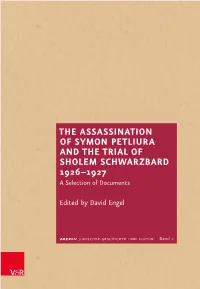
The Assassination of Symon Petliura and the Trial of Scholem Schwarzbard 1926–1927 a Selection of Documents
THE ASSASSINATION OF SYMON PETLIURA AND THE TRIAL OF SHOLEM SCHWARZBARD 1926–1927 A Selection of Documents Edited by David Engel The Assassination of Symon Petliura and the Trial of Sholem Schwarzbard 1926–1927 Schwarzbard of Sholem the Trial and Petliura of Symon Assassination The archiv jüdischer geschichte und kultur Band 2 David Engel 978-3-525-30195-1_Eber.indd 1 19.09.2018 14:52:56 Archiv jüdischer Geschichte und Kultur Archive of Jewish History and Culture Band/Volume 2 Im Auftrag der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig On behalf of the Saxonian Academy of Sciences and Humanities at Leipzig herausgegeben/edited von/by Dan Diner Redaktion/editorial staff Frauke von Rohden Stefan Hofmann Markus Kirchhoff Ulrike Kramme Vandenhoeck & Ruprecht The Assassination of Symon Petliura and the Trial of Scholem Schwarzbard 1926–1927 A Selection of Documents Selected, translated, annotated, and introduced by David Engel The “Archive of Jewish History and Culture” is part of the research project “European Traditions – Encyclopedia of Jewish Cultures” at the Saxonian Academy of Sciences and Humanities at Leipzig. It is sponsored by the Academy program of the Federal Republic of Germany and the Free State of Saxony. The Academy program is coordinated by the Union of the German Academies of Sciences and Humanities. Bibliographic information published by the Deutsche Nationalbibliothek The Deutsche Nationalbibliothek lists this publication in the Deutsche Nationalbibliografie; detailed bibliographic data available online: https://dnb.de © 2016, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Theaterstraße 13, D37073 Göttingen Typesetting: Dörlemann Satz, Lemförde Vandenhoeck & Ruprecht Verlage | www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com ISSN 2566-6673 ISBN (Print) 978-3-525-31027-4 ISBN (PDF) 978-3-666-31027-0 https://doi.org/10.13109/9783666310270 This publication is licensed under a Creative Commons Attribution – Non Commercial – No Derivatives 4.0 International license, at DOI 10.13109/9783666310270. -

Holocaust Denial
Holocaust Denial Holocaust Denial The Politics of Perfidy Edited by Robert Solomon Wistrich Co-published by The Hebrew University Magnes Press (Jerusalem) and De Gruyter (Berlin/Boston) for the Vidal Sassoon International Center for the Study of Antisemitism DE GRUYTER MAGNES An electronic version of this book is freely available, thanks to the support of libra- ries working with Knowledge Unlatched. KU is a collaborative initiative designed to make high quality books Open Access. More information about the initiative can be found at www.knowledgeunlatched.org We would like to acknowledge the support of the Fondation pour la Mémoire de la Shoah in Paris which made possible the publication of this volume. Editorial Manager: Alifa Saadya An electronic version of this book is freely available, thanks to the support of libra- ries working with Knowledge Unlatched. KU is a collaborative initiative designed to make high quality books Open Access. More information about the initiative can be found at www.knowledgeunlatched.org ISBN 978-3-11-021808-4 e-ISBN (PDF) 978-3-11-021809-1 e-ISBN (EPUB) 978-3-11-021806-2 ISSN 0179-0986 e-ISSN 0179-3256 This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License, as of February 23, 2017. For details go to http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/. ISBNLibrary 978-3-11-028814-8 of Congress Cataloging-in-Publication Data e-ISBNA CIP catalog 978-3-11-028821-9 record for this book has been applied for at the Library of Congress. Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek LibraryDie Deutsche of Congress Nationalbibliothek Cataloging-in-Publication verzeichnet diese Data Publikation in der Deutschen Nationalbibliogra- ISBN 978-3-11-021808-4 Afie; CIP detaillierte catalog record bibliografische for this book Daten has sindbeen im applied Internet for über at the Library of Congress. -

Holocaust Denial
Holocaust Denial Holocaust Denial The Politics of Perfidy Edited by Robert Solomon Wistrich Co-published by The Hebrew University Magnes Press (Jerusalem) and De Gruyter (Berlin/Boston) for the Vidal Sassoon International Center for the Study of Antisemitism DE GRUYTER MAGNES An electronic version of this book is freely available, thanks to the support of libra- ries working with Knowledge Unlatched. KU is a collaborative initiative designed to make high quality books Open Access. More information about the initiative can be found at www.knowledgeunlatched.org We would like to acknowledge the support of the Fondation pour la Mémoire de la Shoah in Paris which made possible the publication of this volume. Editorial Manager: Alifa Saadya An electronic version of this book is freely available, thanks to the support of libra- ries working with Knowledge Unlatched. KU is a collaborative initiative designed to make high quality books Open Access. More information about the initiative can be found at www.knowledgeunlatched.org ISBN 978-3-11-021808-4 e-ISBN (PDF) 978-3-11-021809-1 e-ISBN (EPUB) 978-3-11-021806-2 ISSN 0179-0986 e-ISSN 0179-3256 This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License, as of February 23, 2017. For details go to http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/. ISBNLibrary 978-3-11-028814-8 of Congress Cataloging-in-Publication Data e-ISBNA CIP catalog 978-3-11-028821-9 record for this book has been applied for at the Library of Congress. Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek LibraryDie Deutsche of Congress Nationalbibliothek Cataloging-in-Publication verzeichnet diese Data Publikation in der Deutschen Nationalbibliogra- ISBN 978-3-11-021808-4 Afie; CIP detaillierte catalog record bibliografische for this book Daten has sindbeen im applied Internet for über at the Library of Congress. -

REVIEW of the YEAR 5696* I While Much of the Attention of The
REVIEW OF THE YEAR 5696* BY HARRY SCHNEIDERMAN I THE UNITED STATES While much of the attention of the American Jewish community continued to be centered upon events affecting their brethren in Germany, tragic occurrences in Poland and in Palestine also gave American Jews cause for great concern during the period under review. REACTION TO BERLIN RIOTS Almost at the beginning of the period, a wave of anti- Jewish riots and acts of brutality against Jews was reported from Berlin. These occurrences could not be denied by the Nazi government. Their incidence was authenticated by eye-witnesses, including Varian Fry, editor of The Living Age, who gave a vivid description of them to the Associated Press. Public opinion in the United States was aroused, and leading newspapers denounced the Nazi government as responsible for the conditions which had led to the riots. Senators David I. Walsh (Mass.), Millard E. Tydings (Md.), J. Hamilton Lewis (111.), and Pat McCarran (Nev.), gave public expression to their sense of outrage. Dr. Ivan Lee Holt, president of the Federal Council of the Churches of Christ in America, also issued a statement deploring "the barbaric treatment of Christians and Jews in Germany." On July 24, 1935, Senator William H. King (Utah) urged that an investigation of Nazi persecution of Jews and Catholics be made to ascertain if the United States would be warranted in severing diplomatic relations with Germany. *The period covered by this review is from July 1, 1935, to June 30. 1936. It is based on reports in the Jewish and general press of the United States and a number of foreign countries. -

Aux Origines De La Ligue Internationale Contre Le Racisme Et L
Emmanuel Debono, « Les origines de la Ligue internationales contre le racisme et l’antisémitisme », Histoire@Politique. Politique, culture et société, N°2, septembre-octobre 2007, mis en ligne le 18.10.2007 sur www.histoire-politique.fr. Les origines de la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (LICRA) Emmanuel Debono Il n’est guère étonnant de constater que certains détracteurs de l’actuelle LICRA appartenant à l’extrême droite reprennent à leur compte les attaques fantasmagoriques de leurs aînés des années 1930, voulant absolument voir dans la première organisation antiraciste française l’émanation d’un complot judéo-bolchevique, et en son président fondateur, Bernard Lecache1, un agent étranger appointé par Moscou. La LICRA n’a jamais fait mystère de ses origines. Le soutien apporté en 1927 à l’assassin juif d’un dirigeant ukrainien réfugié à Paris, qui se serait rendu coupable de massacres antijuifs, par un certain nombre de personnalités, constitue l’événement fondateur et, pourrait-on dire, inspirateur – en sa dimension justicière – de son combat. La thèse d’un crime politique commandité par le régime soviétique trouva à l’époque, comme elle trouve aujourd’hui encore en certains milieux, à s’opposer à cette version officielle, jetant l’opprobre sur la Ligue internationale contre les pogromes, née à la suite du procès de l’assassin Schwartzbard, et sur l’organisation qui lui succéda en 1929, la Ligue internationale contre l’antisémitisme (LICA)2. Comme souvent, les amalgames malveillants ne se constituent pas ex nihilo : ils entretiennent un lien, fut-il ténu, à la réalité qui permet à l’agression de porter, à la manière d’une caricature qui force et déforme certains traits d’un visage, mais conserve malgré tout un rapport à la vérité.