Fiches De Poste
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2016 2017 INTÉGRANT LE RAPPORT FINANCIER ANNUEL Ipad 9:45 AM 100%
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2016 2017 INTÉGRANT LE RAPPORT FINANCIER ANNUEL iPad 9:45 AM 100% Le Document de référence peut être consulté et téléchargé sur lesite www.soitec.com 2016 2017 DOCUMENT DE RÉFÉRENCE INTÉGRANT LE RAPPORT FINANCIER ANNUEL Le présent Document de Référence a été déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF ») le 4 juillet 2017, conformément à l’article 212-13 IV de son Règlement général. Il pourra être utilisé à l’appui d’une opération financière s’il est complété par une note d’opération visée par l’Autorité des marchés financiers. Ce document a été établi par l’émetteur et engage la responsabilité de ses signataires. Des exemplaires du présent Document de Référence sont disponibles sans frais auprès de : ● Soitec – Parc Technologique des Fontaines – Chemin des Franques – 38190 Bernin – France ; ● sur le site internet de Soitec (www.soitec.com) et sur le site internet de l’Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org). SOITEC DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 20162017 1 1 PERSONNES RESPONSABLES 98 PROPRIÉTÉS IMMOBILIÈRES, USINESETÉQUIPEMENTS 48 SOMMAIRE 1.1. Responsable du Document de Référence 9 1.2. Attestation du responsable duDocumentdeRéférence 9 8.1. Immobilisations corporelles importantes ouplanifi ées 48 La numérotation des paragraphes ci-dessous 8.2. Contraintes environnementales pouvant infl uencer correspond au schéma tel que défini dans l’Annexe I l’utilisation faite par la Société desesimmobilisations 48 du Règlement CE N° 809/2004 du 29 avril 2004. 2 CONTRÔLEURS LÉGAUX DES COMPTES 10 9 EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIÈRE 3 INFORMATIONS ET DU RÉSULTAT 49 FINANCIÈRESSÉLECTIONNÉES 11 9.1. -

Foreign Audit Firms Having Made Notification to the FSA
Foreign Audit Firms having made notification to the FSA As at Jul 30, 2021 Original Notification Date No. (Updating date) Name Address Aug 7, 2008 1 KPMG Audit S.à.r.l. 9 allée Scheffer, L-2520, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (Jun 3, 2010) Aug 7, 2008 2 KPMG AG Wirtschaftspruefungsgesellschaft Klingelhoeferstrasse 18, 10785 Berlin, Germany (Feb 5, 2019) Aug 7, 2008 27th Floor,Gangnam Finance Center, 152, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, Korea 3 KPMG Samjong Accounting Corp. (Jun 10, 2020) 06236 Aug 7, 2008 PricewaterhouseCoopers GmbH 4 Friedrich-Ebert-Anlage 25-37,60327 Frankhurt,Germany (Jul 12, 2019) Wirtschaftsprűfungsgesellschaft Aug 20, 2008 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret 5 Strandvejen 44, 2900 Hellerup, Denmark (Jan 10, 2020) Revisionspartnerselskab Oct 1, 2008 6 KPMG LLP(UK) 15 Canada Square, Canary Wharf, London, E14 5GL, UK (May 21, 2021) Oct 1, 2008 Tower Three, International Towers Sydney, 300 Barangaroo Avenue, Sydney, 7 KPMG Australia (Jul 1, 2021) NSW, 2000, Australia Foreign Audit Firms having made notification to the FSA As at Jul 30, 2021 Original Notification Date No. (Updating date) Name Address Oct 3, 2008 8 PricewaterhouseCoopers, Hong Kong 22/F, Princes' Building, Central, Hong Kong (May 28, 2021) Oct 3, 2008 9 PricewaterhouseCoopers LLP Suite 2600 PwC Tower,18 York Street,Toronto,Ontario,Canada,M5J 0B2 (Jul 13, 2020) Nov 5, 2008 10 Deloitte LLP 1 New Street Square London EC4A 3HQ United Kingdom (Jun 29, 2021) Dec 3, 2008 11 KPMG AG Badenerstrasse 172, PO Box 8036,Zurich, Switzerland (Jul 1, 2021) Dec 3, 2008 1st Floor, Lodha Excelus, Apollo Mills Compound, N M Joshi Marg, Mahalaxmi 12 KPMG Assurance and Consulting Services LLC (Jul 31, 2020) Mumbai-400 011, India Dec 3, 2008 13 KPMG LLP 16 Raffles Quay #22-00 Hong Leong Building Singapore 048581 (Jun 30, 2021) Foreign Audit Firms having made notification to the FSA As at Jul 30, 2021 Original Notification Date No. -

Registration Document
Believe a French société par actions simplifiée1 (simplified joint-stock company) with share capital of €402,344.21 Registered office: 24 rue Toulouse Lautrec, 75017 Paris Paris Trade and Companies Register (RCS) No. 481 625 853 REGISTRATION DOCUMENT The registration document was approved on 7 May 2021 by the Autorité des Marchés Financiers (AMF) in its capacity as the competent authority under Regulation (EU) 2017/1129. The AMF has approved this document after verifying that the information it contains is complete, consistent and comprehensible. The registration document carries the following approval number: I. 21-018. This approval must not be considered to be a favourable opinion on the issuer described in the registration document. The registration document may be used for the purposes of an offer to the public of securities or admission of securities to trading on a regulated market if it is completed by a securities note and, if applicable, a summary and the supplements thereto. The entire document was approved by the AMF pursuant to Regulation (EU) 2017/1129. It shall be valid until 7 May 2022 and, during this period but no later than at the same time as the securities note and under the conditions of Articles 10 and 23 of Regulation (EU) 2017/1129, it shall be completed by a supplement in the event of new material facts, errors or substantial inaccuracies. DISCLAIMER By accepting this document, you acknowledge, and agree to be bound by, the following statements. This document is a translation of Believe’s document d’enregistrement dated 7 May 2021 (the “Registration Document”). -

REFERENCE DOCUMENT 2016 2017 INCLUDING the ANNUAL FINANCIAL REPORT Ipad 9:45 AM 100%
REFERENCE DOCUMENT 2016 2017 INCLUDING THE ANNUAL FINANCIAL REPORT iPad 9:45 AM 100% The Reference Document may be viewed and downloaded at the website www.soitec.com 2016 2017 REFERENCE DOCUMENT INCLUDING THE ANNUAL FINANCIAL REPORT The Company’s business operations and financial position is described in the French version of the Company’s Document de Référence 2016-2017 registered by the Autorité des marchés financiers (the “AMF”) (the “Document de Référence”) under visa no. D.17-0720 dated July 4, 2017. Copies of the French language Document de Référence are available through the Company and may also be consulted on the AMF’s website (www.amf-france.org) and on the Company’s website (www.soitec.com). Your attention is drawn to the risk factors described in Chapter 4 of the Document de Référence in French language. In the event of a discrepancy between this document and the Document de Référence in French language, the Document de Référence in French language shall prevail. The translation contained in this document has not been independently verified and is provided solely for the convenience of English-speaking users. No representation, warranty or undertaking, express or implied, is made as to, and you may not rely on, the fairness, accuracy, completeness or correctness of the information and opinions contained in this document compared to the Document de Référence in French language. Neither the Company, nor its shareholders or any of their respective subsidiaries, advisors or representatives, accept any responsibility or liability whatsoever for any loss arising from the use of this document or its contents or in connection whatsoever with this document. -

2018 Registration Document Universal Registration
2018 • • • • • • • • • Registration document including the Annual Financial Report TABLE OF CONTENTS Profile 2 1 5 Persons responsible for the Registration Risks and risk management 135 Document and financial audit 7 5.1 Risk factors 136 1.1 Person responsible for the Registration Document 8 5.2 Risk management and internal control system 150 1.2 Statement by the person responsible for the Registration Document 8 5.3 Insurance policy 157 1.3 Persons responsible for the financial audit 9 1.4 Person responsible for the Group’s legal affairs 9 1.5 Person responsible for the communication of financial information 9 6 Assets, financial position and results 159 2 6.1 Consolidated financial statements 160 6.2 Statutory Auditors’ Report on the Consolidated Financial General information on Vallourec Statements 231 and its capital 11 6.3 Parent company financial statements 234 2.1 General information on Vallourec 12 6.4 Statutory Auditors’ Report on the Financial Statements 249 2.2 General information on share capital 14 2.3 Distribution of share capital and voting rights 21 2.4 Market for Vallourec’s shares 25 7 2.5 Dividend policy 26 2.6 Financial disclosure policy 26 Corporate governance 253 7.1 Composition and operation of the Management and Supervisory Boards 254 7.2 Compensation and benefits 286 3 7.3 Executive management interests and employee profit sharing 301 Presentation of Vallourec and its Group 29 7.4 Supervisory Board Report on 2018 compensation for corporate officers 308 3.1 History and development of Vallourec and its Group 30 7.5 -

MERSEN 2018 Reference Document
2018 REFERENCE DOCUMENT MERSEN 2018 Reference Document page 1 Group Profile 3 2 Corporate governance report 19 3 Management report 75 4 Social responsibility and sustainable development 99 5 Information about the share capital and share ownership 131 6 Consolidated financial statements 151 7 Parent company financial statements 209 8 Additional information 239 This document is a free translation into English for convenience purposes only of the French reference document fi led with the Autorité des Marchés Financiers on March 12, 2019. 2018 REFERENCE DOCUMENT | MERSEN 1 2 MERSEN | 2018 REFERENCE DOCUMENT 1 GROUP PROFILE 2018 HIGHLIGHTS 5 2018 KEY FIGURES 6 GROUP BUSINESS MODEL 8 2018 REFERENCE DOCUMENT | MERSEN 3 GROUP PROFILE 1 4 MERSEN | 2018 REFERENCE DOCUMENT GROUP PROFILE 2018 Highlights 1 2018 HIGHLIGHTS 2018 was another very strong year for Mersen. Strong sales in 2018 drove Mersen’s operating margin before Combining robust markets with seamless execution, the Group’s non-recurring items up 120 points year-on-year to 10.4%, for an successful growth strategy saw it exceed the fi nancial objectives EBITDA margin of 15%. This increase was primarily due to a set at the beginning of the year. positive volume/mix effect. Higher prices and the positive impact of our competitiveness plan also offset the increase in payroll and Against an upbeat economic backdrop, the Group enjoyed like- raw materials costs. for-like growth of 10% ─ a remarkable performance across the year, across all regions and across all end-markets. The Group’s 2018 saw exceptional growth of 48% in net income. In addition performance illustrates its capacity to harness expanding markets to the increase in operating income before non-recurring items, wherever they are, and markets that are particularly buoyant, the Group signifi cantly reduced its non-recurring expenses and such as solar energy, semiconductor and green transportation. -

Offering Circular (The “Document”) and You Are Therefore Advised to Read This Carefully Before Reading, Accessing Or Making Any Other Use of the Attached Document
IMPORTANT: You must read the following disclaimer before continuing. The following disclaimer applies to the attached offering circular (the “document”) and you are therefore advised to read this carefully before reading, accessing or making any other use of the attached document. In accessing the document, you agree to be bound by the following terms and conditions, including any modifications to them from time to time, each time you receive any information from us as a result of such access. You acknowledge that this electronic transmission and the delivery of the attached document is confidential and intended only for you and you agree you will not forward, reproduce, copy, download or publish this electronic transmission or the attached document (electronically or otherwise) to any other person. THE SECURITIES REFERENCED IN THIS DOCUMENT MAY ONLY BE OFFERED AND SOLD IN “OFFSHORE TRANSACTIONS” AS DEFINED IN, AND IN ACCORDANCE WITH, REGULATION S UNDER THE US SECURITIES ACT OF 1933 (THE “SECURITIES ACT”) OR WITHIN THE UNITED STATES TO QUALIFIED INSTITUTIONAL BUYERS (“QIBs”) AS DEFINED IN RULE 144A UNDER THE SECURITIES ACT (“RULE 144A”). ANY FORWARDING, REDISTRIBUTION OR REPRODUCTION OF THIS DOCUMENT IN WHOLE OR IN PART IS UNAUTHORIZED. FAILURE TO COMPLY WITH THIS NOTICE MAY RESULT IN A VIOLATION OF THE SECURITIES ACT OR THE APPLICABLE LAWS OF OTHER JURISDICTIONS. NOTHING IN THIS ELECTRONIC TRANSMISSION CONSTITUTES AN OFFER OF SECURITIES FOR SALE IN THE UNITED STATES OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE IT IS UNLAWFUL TO DO SO. THE SECURITIES -

Caisse-Federale-3G-20161231.Pdf
2015 REGISTRATION DOCUMENT CM11 Group This registration document was filed with the French Financial Markets Authority ( Autorité des marchés financiers - AMF) on April 29, 2016 pursuant to Article 212-13 of the AMF's General Regulation. It may be used in support of a financial transaction only if accompanied by an offering memorandum ( note d’opération ) approved by the AMF. The registration document was prepared by the issuer and is binding on its signatories. 2 INTRODUCTION As it extends its investor base and establishes itself in several markets, Banque Fédérative du Crédit Mutuel (“BFCM”) has decided to prepare a document to present the Group as a whole to meet the specific requirements of certain markets. With an aim to provide the same level of information for all of the Group’s investors in Europe, North America and the Asia Pacific region, BFCM decided, for increased clarity and transparency, to issue this registration document (the “Registration Document”) including all the financial information of the CM11 Group and the BFCM Group, which will be used for all of BFCM’s refinancing programs (Euro Medium Term Notes Program ; U.S. Medium Term Notes Program ; Euro Commercial Paper ; negotiable debt securities). This Registration Document also serves as BFCM’s annual financial report. The CM11 Group (previously called the CM11-CIC Group ) The banking group that operates under the name CM11 Group (and also referred to as the “Group”) 1 includes a mutual banking division (also called the regulatory scope or cooperative sector) and the BFCM Group (also called the “shareholder-owned division”), which are complementary and interconnected units. -
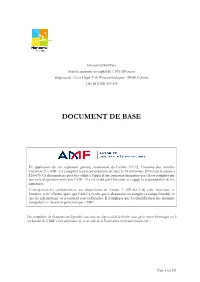
Document De Base
Horizontal Software Société anonyme au capital de 1 101 326 euros Siège social : 2 rue Hegel ZAC Euratechnologies - 59160 Lomme Lille RCS 520 319 245 DOCUMENT DE BASE En application de son règlement général, notamment de l’article 212-23, l’Autorité des marchés financiers (l’ « AMF ») a enregistré le présent document de base le 15 novembre 2016 sous le numéro I.16-076. Ce document ne peut être utilisé à l’appui d’une opération financière que s’il est complété par une note d’opération visée par l’AMF. Il a été établi par l’émetteur et engage la responsabilité de ses signataires. L’enregistrement, conformément aux dispositions de l’article L. 621-8-1-I du code monétaire et financier, a été effectué après que l’AMF a vérifié que le document est complet et compréhensible et que les informations qu’il contient sont cohérentes. Il n’implique pas l’authentification des éléments comptables et financiers présentés par l’AMF. Des exemplaires du document sont disponibles sans frais au siège social de la Société, ainsi qu’en version électronique sur le site Internet de l’AMF (www.amf-france.org) et sur celui de la Société (www.horizontalsoftware.com). Page 1 sur 231 SOMMAIRE SOMMAIRE 2 PREAMBULE 8 1. PERSONNES RESPONSABLES 10 1.1 Responsable du document de base 10 1.2 Attestation de la personne responsable 10 1.3 Responsable de l’information financière 10 2. CONTROLEURS LEGAUX DES COMPTES 11 2.1 Commissaire aux comptes titulaire 11 2.2 Commissaire aux comptes suppléant 11 2.3 Commissaires aux comptes ayant démissionné 11 2.4 Commissaires aux comptes précédents 11 3. -
![Third Supplement Dated [ ] April 2008 to the 15 June 2007](https://docslib.b-cdn.net/cover/5183/third-supplement-dated-april-2008-to-the-15-june-2007-13145183.webp)
Third Supplement Dated [ ] April 2008 to the 15 June 2007
FOURTH SUPPLEMENT DATED 03 MARCH 2021 TO THE 18 JUNE 2020 BASE PROSPECTUS RENAULT (incorporated as a société anonyme in France) €7,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme This prospectus supplement (the “Fourth Supplement”) is supplemental and must be read in conjunction with the Base Prospectus dated 18 June 2020 (the “Base Prospectus”), as supplemented by the First Supplement dated 31 July 2020, which was granted approval No. 20-377 on 31 July 2020, the Second Supplement dated 18 September 2020, which was granted approval No. 20-465 on 18 September 2020 and the Third Supplement dated 13 November 2020, which was granted approval No. 20- 554 on 13 November 2020, each prepared by Renault (“Renault” or the “Issuer”) with respect to its €7,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme (the “Programme”). The Base Prospectus constitutes a base prospectus for the purposes of Article 8 of the Prospectus Regulation. "Prospectus Regulation" means Regulation (EU) 2017/1129 of 14 June 2017. The Base Prospectus received approval no. 20-263 on 18 June 2020 from the Autorité des marchés financiers (the "AMF"). Unless the context otherwise requires, terms defined in the Base Prospectus have the same meaning when used in this Third Supplement. Application has been made for approval of this Third Supplement to the AMF in its capacity as competent authority under the Prospectus Regulation. This Fourth Supplement has been prepared in accordance with Article 23 of the Prospectus Regulation for the purposes of (i) incorporating by reference (a) some sections -

1 174-178, Quai De Jemmapes
174-178, quai de Jemmapes - 75010 Paris - France Paris trade and company register: 394 149 496 www.parrot.com This document is a free translation of the French language reference document that was filed with the French securities regulator (Autorité des marchés financiers, AMF) on May 10, 2016 under number D.16-0472, in accordance with Article 212-13 of the AMF's general regulations. This English version has not been approved by the AMF. This translation has been prepared solely for the information and convenience of English speaking readers. No assurances are given as to the accuracy or completeness of this translation, and Parrot assumes no responsibility with respect to this translation or any misstatement or omission that may be contained therein. In the event of any ambiguity or discrepancy between this translation and the French reference document, the French reference document shall prevail. The French document is available on the AMF site (www.amf-france.org) and the Parrot site (www.parrot.com). The English document is only available on the Parrot site. A copy of this document may also be obtained free of charge by calling +33 1 48 03 60 60 or sending a letter to Parrot, Investor Relations, 174 quai de Jemmapes, 75010 Paris, France. 1 NOTE TO READERS ..............................................................................................................................................................................8 HISTORICAL FINANCIAL INFORMATION ............................................................................................................................................8