Baies... 8. Buisson-Ardent Gui Houx
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

WRA Species Report
Family: Rosaceae Taxon: Pyracantha koidzumii Synonym: Cotoneaster koidzumii Hayata (basionym) Common Name Formosa firethorn tan wan huo ji Questionaire : current 20090513 Assessor: Chuck Chimera Designation: H(HPWRA) Status: Assessor Approved Data Entry Person: Chuck Chimera WRA Score 7 101 Is the species highly domesticated? y=-3, n=0 n 102 Has the species become naturalized where grown? y=1, n=-1 103 Does the species have weedy races? y=1, n=-1 201 Species suited to tropical or subtropical climate(s) - If island is primarily wet habitat, then (0-low; 1-intermediate; 2- High substitute "wet tropical" for "tropical or subtropical" high) (See Appendix 2) 202 Quality of climate match data (0-low; 1-intermediate; 2- High high) (See Appendix 2) 203 Broad climate suitability (environmental versatility) y=1, n=0 n 204 Native or naturalized in regions with tropical or subtropical climates y=1, n=0 y 205 Does the species have a history of repeated introductions outside its natural range? y=-2, ?=-1, n=0 y 301 Naturalized beyond native range y = 1*multiplier (see y Appendix 2), n= question 205 302 Garden/amenity/disturbance weed n=0, y = 1*multiplier (see y Appendix 2) 303 Agricultural/forestry/horticultural weed n=0, y = 2*multiplier (see n Appendix 2) 304 Environmental weed n=0, y = 2*multiplier (see n Appendix 2) 305 Congeneric weed n=0, y = 1*multiplier (see y Appendix 2) 401 Produces spines, thorns or burrs y=1, n=0 y 402 Allelopathic y=1, n=0 n 403 Parasitic y=1, n=0 n 404 Unpalatable to grazing animals y=1, n=-1 405 Toxic to animals y=1, -

The Alien Vascular Flora of Tuscany (Italy)
Quad. Mus. St. Nat. Livorno, 26: 43-78 (2015-2016) 43 The alien vascular fora of Tuscany (Italy): update and analysis VaLerio LaZZeri1 SUMMARY. Here it is provided the updated checklist of the alien vascular fora of Tuscany. Together with those taxa that are considered alien to the Tuscan vascular fora amounting to 510 units, also locally alien taxa and doubtfully aliens are reported in three additional checklists. The analysis of invasiveness shows that 241 taxa are casual, 219 naturalized and 50 invasive. Moreover, 13 taxa are new for the vascular fora of Tuscany, of which one is also new for the Euromediterranean area and two are new for the Mediterranean basin. Keywords: Vascular plants, Xenophytes, New records, Invasive species, Mediterranean. RIASSUNTO. Si fornisce la checklist aggiornata della fora vascolare aliena della regione Toscana. Insieme alla lista dei taxa che si considerano alieni per la Toscana che ammontano a 510 unità, si segnalano in tre ulteriori liste anche i taxa che si ritengono essere presenti nell’area di studio anche con popolazioni non autoctone o per i quali sussistono dubbi sull’effettiva autoctonicità. L’analisi dello status di invasività mostra che 241 taxa sono casuali, 219 naturalizzati e 50 invasivi. Inoltre, 13 taxa rappresentano una novità per la fora vascolare di Toscana, dei quali uno è nuovo anche per l’area Euromediterranea e altri due sono nuovi per il bacino del Mediterraneo. Parole chiave: Piante vascolari, Xenofte, Nuovi ritrovamenti, Specie invasive, Mediterraneo. Introduction establishment of long-lasting economic exchan- ges between close or distant countries. As a result The Mediterranean basin is considered as one of this context, non-native plant species have of the world most biodiverse areas, especially become an important component of the various as far as its vascular fora is concerned. -

Italian Botanist 10 Supplementary Data to Notulae to the Italian Alien Vascular Flora: 10 Edited by G
Italian Botanist 10 Supplementary data to Notulae to the Italian alien vascular flora: 10 Edited by G. Galasso, F. Bartolucci Categories concerning the occurrence status of taxa follow Galasso et al. (2018). 1. Nomenclatural updates Family Nomenclature according to Revised nomenclature References/Note Galasso et al. (2018) Fabaceae Acacia dealbata Link subsp. Acacia dealbata Link Hirsch et al. (2017, 2018, 2020) dealbata Pinaceae Abies nordmanniana (Steven) Abies nordmanniana (Steven) Another subspecies exists Spach Spach subsp. nordmanniana Asteraceae Centaurea iberica Spreng. subsp. Centaurea iberica Trevir. ex iberica Spreng. subsp. iberica Poaceae Digitaria ischaemum (Schreb. ex Digitaria ischaemum (Schreb.) Synonym of Digitaria violascens Schweigg.) Muhlenb. var. Muhl. var. violascens (Link) Link violascens (Link) Radford Radford Poaceae Gigachilon polonicum Seidl ex Gigachilon polonicum (L.) Seidl Synonym of Triticum turgidum Á.Löve subsp. dicoccon ex Á.Löve subsp. dicoccon L. subsp. dicoccon (Schrank ex (Schrank) Á.Löve (Schrank) Á.Löve, comb. inval. Schübl.) Thell. Poaceae Gigachilon polonicum Seidl ex Gigachilon polonicum (L.) Seidl Synonym of Triticum turgidum Á.Löve subsp. durum (Desf.) ex Á.Löve subsp. durum (Desf.) L. subsp. durum (Desf.) Husn. Á.Löve Á.Löve Poaceae Gigachilon polonicum Seidl ex Gigachilon polonicum (L.) Seidl Synonym of Triticum turgidum Á.Löve subsp. turanicum ex Á.Löve subsp. turanicum L. subsp. turanicum (Jakubz.) (Jakubz.) Á.Löve (Jakubz.) Á.Löve Á.Löve & D.Löve Poaceae Gigachilon polonicum Seidl ex Gigachilon polonicum (L.) Seidl Synonym of Triticum turgidum Á.Löve subsp. turgidum (L.) ex Á.Löve subsp. turgidum (L.) L. subsp. turgidum Á.Löve Á.Löve Balsaminaceae Impatiens cristata auct., non Impatiens tricornis Lindl. Akiyama and Ohba (2016); it is Wall. -

Invasive Plants in Southern Forests
Invasive Plants in Southern Forests United States Department of Agriculture A Field Guide for the Identification of Invasive PlantsSLIGHTLY inREVISED NOVEMBERSouthern 2015 Forests United States Forest Service Department Southern Research Station James H. Miller, Erwin B. Chambliss, and Nancy J. Loewenstein of Agriculture General Technical Report SRS–119 Authors: James H. Miller, Emeritus Research Ecologist, and Erwin B. Chambliss, Research Technician, Forest Available without charge from the Service, U.S. Department of Agriculture, Southern Research Station, Auburn University, AL 36849; and Southern Research Station Nancy J. Loewenstein, Research Fellow and Alabama Cooperative Extension System Specialist for Also available online at Forest Invasive Plants, School of Forestry and Wildlife Sciences, Auburn University, AL 36849. www.srs.fs.usda.gov/pubs/35292 and invasive.org, or as a free download for iPhones and iPads at the AppStore Front Cover Upper left—Chinese lespedeza (Lespedeza cuneata) infestation that developed from dormant seed in the soil seed bank after a forest thinning operation. Upper right—Kudzu (Pueraria montana) infestation within the urban-wildland interface. Lower left—Chinese privet (Ligustrum sinense) and dormant kudzu invading and replacing a pine- hardwood stand. Lower right—Cogongrass (Imperata cylindrica) infestation under mature slash pine (Pinus elliottii). Funding support for all printings provided by the Southern Research Station, Insect, Disease, and Invasive Plants Research Work Unit, and Forest Health Protection, Southern Region, Asheville, NC. First Printed April 2010 Slightly Revised February 2012 Revised August 2013 Reprinted January 2015 Slightly Revised November 2015 Southern Research Station 200 W.T. Weaver Blvd. Asheville, NC 28804 www.srs.fs.usda.gov i A Field Guide for the Identification of Invasive Plants in Southern Forests James H. -

Biology of Invasive Plants 1. Pyracantha Angustifolia (Franch.) C.K. Schneid
Invasive Plant Science and Biology of Invasive Plants 1. Pyracantha Management angustifolia (Franch.) C.K. Schneid www.cambridge.org/inp Lenin Dzibakwe Chari1,* , Grant Douglas Martin2,* , Sandy-Lynn Steenhuisen3 , Lehlohonolo Donald Adams4 andVincentRalphClark5 Biology of Invasive Plants 1Postdoctoral Researcher, Centre for Biological Control, Department of Zoology and Entomology, Rhodes University, Makhanda, South Africa; 2Deputy Director, Centre for Biological Control, Department of Zoology and Cite this article: Chari LD, Martin GD, Entomology, Rhodes University, Makhanda, South Africa; 3Senior Lecturer, Department of Plant Sciences, and Steenhuisen S-L, Adams LD, and Clark VR (2020) Afromontane Research Unit, University of the Free State, Qwaqwa Campus, Phuthaditjhaba, South Africa; 4PhD Biology of Invasive Plants 1. Pyracantha Candidate, Department of Plant Sciences, and Afromontane Research Unit, University of the Free State, angustifolia (Franch.) C.K. Schneid. Invasive Qwaqwa Campus, Phuthaditjhaba, South Africa and 5Director, Afromontane Research Unit, and Department of Plant Sci. Manag 13: 120–142. doi: 10.1017/ Geography, University of the Free State, Qwaqwa Campus, Phuthaditjhaba, South Africa inp.2020.24 Received: 2 September 2020 Accepted: 4 September 2020 Scientific Classification *Co-lead authors. Domain: Eukaryota Kingdom: Plantae Series Editors: Phylum: Spermatophyta Darren J. Kriticos, CSIRO Ecosystem Sciences & David R. Clements, Trinity Western University Subphylum: Angiospermae Class: Dicotyledonae Key words: Order: Rosales Bird dispersed, firethorn, introduced species, Family: Rosaceae management, potential distribution, seed load. Genus: Pyracantha Author for correspondence: Grant Douglas Species: angustifolia (Franch.) C.K. Schneid Martin, Centre for Biological Control, Synonym: Cotoneaster angustifolius Franch. Department of Zoology and Entomology, EPPO code: PYEAN Rhodes University, P.O. Box 94, Makhanda, 6140 South Africa. -

Second Contribution to the Vascular Flora of the Sevastopol Area
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Wulfenia Jahr/Year: 2015 Band/Volume: 22 Autor(en)/Author(s): Seregin Alexey P., Yevseyenkow Pavel E., Svirin Sergey A., Fateryga Alexander Artikel/Article: Second contribution to the vascular flora of the Sevastopol area (the Crimea) 33-82 © Landesmuseum für Kärnten; download www.landesmuseum.ktn.gv.at/wulfenia; www.zobodat.at Wulfenia 22 (2015): 33 – 82 Mitteilungen des Kärntner Botanikzentrums Klagenfurt Second contribution to the vascular flora of the Sevastopol area (the Crimea) Alexey P. Seregin, Pavel E. Yevseyenkov, Sergey A. Svirin & Alexander V. Fateryga Summary: We report 323 new vascular plant species for the Sevastopol area, an administrative unit in the south-western Crimea. Records of 204 species are confirmed by herbarium specimens, 60 species have been reported recently in literature and 59 species have been either photographed or recorded in field in 2008 –2014. Seventeen species and nothospecies are new records for the Crimea: Bupleurum veronense, Lemna turionifera, Typha austro-orientalis, Tyrimnus leucographus, × Agrotrigia hajastanica, Arctium × ambiguum, A. × mixtum, Potamogeton × angustifolius, P. × salicifolius (natives and archaeophytes); Bupleurum baldense, Campsis radicans, Clematis orientalis, Corispermum hyssopifolium, Halimodendron halodendron, Sagina apetala, Solidago gigantea, Ulmus pumila (aliens). Recently discovered Calystegia soldanella which was considered to be extinct in the Crimea is the most important confirmation of historical records. The Sevastopol area is one of the most floristically diverse areas of Eastern Europe with 1859 currently known species. Keywords: Crimea, checklist, local flora, taxonomy, new records A checklist of vascular plants recorded in the Sevastopol area was published seven years ago (Seregin 2008). -

Abies Concolor (White Fir)
Compiled here is distribution, characteristics and other information on host species featured as ‘Host of the Month’ in past issues of the COMTF Monthly Report. Abies concolor (white fir) This is an evergreen tree native to the mountains of southern Oregon, California, the southern Rocky Mountains, and Baja California. Large and symmetrical, white fir grows 80 – 120ft tall and 15 – 20ft wide in its native range and in the Pacific Northwest. White fir is one of the top timber species found in the Sierra Nevada Mountains of CA and is a popular Christmas tree, as well as one of the most commonly grown native firs in Western gardens. Young trees are conical in shape, but develop a dome-like crown with age. The flattened needles of white fir are silvery blue-green, blunt at the tip , and grow 2 – 3in long. Often curving upwards, the needles extend at right angles from the twig, and twigs produce a citrus smell when needles are broken. White fir is monoecious, producing yellow- to red-toned, catkin-like male flowers and inconspicuous yellow-brown female flowers. The oblong cones grow 3 – 5 in upright, are yellow-green to purple in color, and are deciduous at maturity, dispersing seed in the fall. New twigs are dark- orange, but become gray-green, then gray with maturity. The bark of saplings is thin, smooth, and gray, turning thick, ash-gray with age, and developing deep irregular furrows. P. ramorum- infected Abies concolor (white fir) was first reported in the October 2005 COMTF newsletter as having been found at a Christmas tree farm in the quarantined county of Santa Clara. -

RHS the Garden Magazine Index 2017
GardenThe INDEX 2017 Volume 142, Parts 1–12 Index 2017 1 January 2017 2 February 2017 3 March 2017 4 April 2017 5 May 2017 6 June 2017 Coloured numbers in Acer: Alchemilla mollis 6: 47, Governor’ 3: 24 in art exhibition, RHS Petheram 4: 31 bold before the page campestre ‘William 48, 49, 51 fanninii 1: 17 Lindley Library 9: 89 Aralia elata ‘Variegata’ 5: number(s) denote the Caldwell’ 8: 41 Alder, Fern, on: Gibbon’s ‘Mistral Tigre’ 10: 7 Newton’s apple tree 2: 31, 31 part number (month). reader’s response Rent alleyway, nemorosa ‘Flore Pleno’ 11 Arbutus unedo 11: 49 Each part is paginated 11: 90 Bermondsey, London 4: 54, 54 ‘Bardsey’ 8: 30 Archer, William separately. cappadocicum 10: 52–55 pavonina 3: 64 ‘Beauty of Bath’ 8: 30 (naturalist) 1: 43 ‘Aureum’ 8: 41 Allium: Angelica sylvestris ‘Braeburn’ 10: 49 arches, plants for 9: Numbers in italics x conspicuum photogram 11: 90 ‘Vicar’s Mead’ 12: 39 ‘Charles Ross’ 8: 30 22–23 denote an image. ‘Phoenix’ 12: 15 atropurpureum 6: 28– Annual General Meeting ‘Devonshire architectural plants 4: 42 davidii ‘Cascade’ 11: 23 29, 29 2017, RHS 1: 67; 7: 93; 9: Quarrenden’ 10: 91 Ardle, Jon, on: Where a plant has a griseum 12: 15, 15, 56, 56 sativum (see garlic) 91 ‘Discovery’ 8: 30, 30 La Seigneurie, Sark 1: Trade Designation micranthum 10: 97, 97 sphaerocephalon 6: 47, Anthriscus sylvestris ‘Gala’ 10: 49 52–56 (also known as a selling palmatum: 50 ‘Ravenswing’ 4: 50, 55 ‘James Grieve’ 8: 30, 30 winter gardening name) it is typeset in ‘Beni-kawa’ 12: 15 triquetrum 8: 15, 15 ants: ‘Katja’ 8: 30 tasks 11: 54–55 a different font to ‘Cascade Gold’ 3: 12, tuberosum flowers as a common black (Lasius ‘Laxton’s Fortune’ 8: Armillaria (see honey distinguish it from the 12 garnish 5: 98, 99, 99 niger) 6: 41 30, 30 fungus, under fungus) cultivar name (shown ‘Sango-kaku’ 12: 15 allotments: on peaches 10: 92 ‘Limelight’ 8: 30 Armitage, James, et al, in ‘Single Quotes’). -
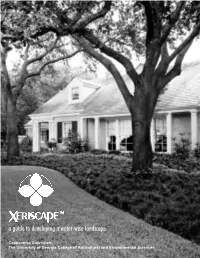
Xeriscape: a Guide to Developing a Water-Wise Landscape
a guide to developing a water-wise landscape Cooperative Extension The University of Georgia College of Agricultural and Environmental Sciences TABLE OF CONTENTS Introduction........................................................................................................................................1 Step 1: Planning and Design ...........................................................................................................2 Begin With a Base Map .........................................................................................................2 Catalog Site Characteristics...................................................................................................2 Incorporate Shade Into the Design ........................................................................................3 Plan for Different Use Areas ..................................................................................................3 Establish Water-use Zones ....................................................................................................4 Develop a Master Plan...........................................................................................................5 Fit Plants to the Design..........................................................................................................6 Renovation of an Existing Landscape for Improved Water Conservation .............................6 Step 2: Soil Analysis.........................................................................................................................8 -
Review of Recent Plant Naturalisations in South Australia and Initial Screening for Weed Risk
Review of recent plant naturalisations in South Australia and initial screening for weed risk Technical Report 2012/02 www.environment.sa.gov.auwww.environment.sa.gov.au Review of recent plant naturalisations in South Australia and initial screening for weed risk Chris Brodie, State Herbarium of SA, Science Resource Centre, Department for Environment and Natural Resources and Tim Reynolds, NRM Biosecurity Unit, Biosecurity SA June 2012 DENR Technical Report 2012/02 This publication may be cited as: Brodie, C.J. & Reynolds, T.M. (2012), Review of recent plant naturalisations in South Australia and initial screening for weed risk, DENR Technical Report 2012/02, South Australian Department of Environment and Natural Resources, Adelaide For further information please contact: Department of Environment and Natural Resources GPO Box 1047 Adelaide SA 5001 http://www.environment.sa.gov.au © State of South Australia through the Department of Environment and Natural Resources. Apart from fair dealings and other uses permitted by the Copyright Act 1968 (Cth), no part of this publication may be reproduced, published, communicated, transmitted, modified or commercialised without the prior written permission of the Department of Environment and Natural Resources. Disclaimer While reasonable efforts have been made to ensure the contents of this publication are factually correct, the Department of Environment and Natural Resources makes no representations and accepts no responsibility for the accuracy, completeness or fitness for any particular purpose of the contents, and shall not be liable for any loss or damage that may be occasioned directly or indirectly through the use of or reliance on the contents of this publication. -

The College Gardens the Dates Following Entries Are Those of Previous Catalogues in Which the Plant Has Appeared
The College Gardens The dates following entries are those of previous catalogues in which the plant has appeared. This catalogue of the trees and shurbs is both incomplete and out of date, but what is included is substantially correct. The last catalogue was prepared by Dr John Prest in 1980. Current text entries and images have been taken from many sources on the internet. Staircase 1 Staircase 2 Staircase 3-4 Staircase 5-6 Library wall Old Common Room Chapel wall Large library quad walls by college office Master's lodgings Staircase 10-11 Staircase 12-13 Staircase 13-14 Beds outside staircase 14-15 Staircase 14-15 Staircase 16-17 Staircase 17-18 Staircase 19-20 In grid in back gate quad Back gate quad by kitchen entrance Left of hall steps Right of hall steps Buttery and SCR Trinity wall and buildings Master's garden, north side Master's garden, east side Master's garden, south side Master's garden, in lawn Fellows' garden Fellows' garden, gate Fellows' garden, gate Fellows' garden, in lawn Outside Fellows' garden, in lawn Fellows garden, outside wall Fellows' garden, gate Trees in main lawn Trees in croquet lawn Trees in bulb lawn Trees in triangular lawn Staircase 1 Pyracantha Coccinea Evergreen to semi-evergreen shrub, 6-18 ft (1.8-5.5 m), many cultivars, variable habit. Leaves alternate, simple, narrow-elliptic or lanceolate, 2.5-6.5 cm long, crenulate-serrulate, apex acute or rarely obtuse (often a sturdy point), lustrous dark green above. Flowers perfect, white, 8 mm across, in 5-7.5 cm long clusters (corymbs) in spring or early summer. -

RECOMMENDED NATIVE PLANTS for LANDSCAPING in the TEXAS HILL COUNTRY Prepared by the Kerrville Chapter of the Native Plant Society of Texas
Native Plant Society of Texas RECOMMENDED Evergreen Yaupon* Ilex vomitoria A 501(c)(3) non-profit organization that promotes NATIVE PLANTS research, conservation and Prairie Verbena* utilization of native plants Verbena bipinnatifida and plant habitats of Texas FOR LANDSCAPING through education, out- reach and example. IN THE TEXAS HILL COUNTRY Prepared by Kerrville Chapter of the Native Plant Society of Texas Bald Cypress ** Taxodium distichum http://www.npsot.org/Kerrville/ Texas Madrone * Arbutus xalapensis Bur Oak ** Honey Locust ** Quercus macrocarpa Gleditsia triacanthos Buttonbush *** Cephalanthus occidentalis Evergreen Sumac * Rhus Virens * Sketches by Margaret Campbell. Courtesy of the University of Texas Libraries, The University of Texas at Austin. For more information, please visit our website: ** Sketches by Britton, N.L., and A. Brown. 1913. http://www.npsot.org/Kerrville/ Courtesy of Kentucky Native Plant Society. Rev. March 2011 *** Courtesy of the USDA Natural Resources Conservation Service. RECOMMENDED NATIVE PLANTS FOR LANDSCAPING IN THE TEXAS HILL COUNTRY Prepared by the Kerrville Chapter of the Native Plant Society of Texas This descriptive list of native plants was developed for The Kerrville Chapter the use of NPSOT Chapter members and new arrivals to of the Native Plant Society of Texas our community interested in our native flora. Our primary is dedicated to the understanding, criteria were that the plants listed should be: Table of Contents preservation and enjoyment of the native flora ● Suitable for landscaping in the Texas Hill Country of the Texas Hill Country. Information/References ............. Page 2 ● Available through commercial resources as Our chapter meets the container-grown plants or seeds Trees and Shrubs ......................