“Éperonner Le Monde”
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
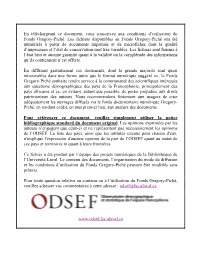
C-Doc 023 Odsef.Pdf
En téléchargeant ce document, vous souscrivez aux conditions d’utilisation du Fonds Gregory-Piché. Les fichiers disponibles au Fonds Gregory-Piché ont été numérisés à partir de documents imprimés et de microfiches dont la qualité d’impression et l’état de conservation sont très variables. Les fichiers sont fournis à l’état brut et aucune garantie quant à la validité ou la complétude des informations qu’ils contiennent n’est offerte. En diffusant gratuitement ces documents, dont la grande majorité sont quasi introuvables dans une forme autre que le format numérique suggéré ici, le Fonds Gregory-Piché souhaite rendre service à la communauté des scientifiques intéressés aux questions démographiques des pays de la Francophonie, principalement des pays africains et ce, en évitant, autant que possible, de porter préjudice aux droits patrimoniaux des auteurs. Nous recommandons fortement aux usagers de citer adéquatement les ouvrages diffusés via le fonds documentaire numérique Gregory- Piché, en rendant crédit, en tout premier lieu, aux auteurs des documents. Pour référencer ce document, veuillez simplement utiliser la notice bibliographique standard du document original. Les opinions exprimées par les auteurs n’engagent que ceux-ci et ne représentent pas nécessairement les opinions de l’ODSEF. La liste des pays, ainsi que les intitulés retenus pour chacun d'eux, n'implique l'expression d'aucune opinion de la part de l’ODSEF quant au statut de ces pays et territoires ni quant à leurs frontières. Ce fichier a été produit par l’équipe des projets numériques de la Bibliothèque de l’Université Laval. Le contenu des documents, l’organisation du mode de diffusion et les conditions d’utilisation du Fonds Gregory-Piché peuvent être modifiés sans préavis. -

Les Cahiers D'outre-Mer, 226-227
Les Cahiers d’Outre-Mer Revue de géographie de Bordeaux 226-227 | Avril-Septembre 2004 Afriques Le négoce caravanier au Sahara central : histoire, évolution des pratiques et enjeux chez les Touaregs Kel Aïr (Niger) Julien Brachet Édition électronique URL : http://journals.openedition.org/com/512 DOI : 10.4000/com.512 ISSN : 1961-8603 Éditeur Presses universitaires de Bordeaux Édition imprimée Date de publication : 1 avril 2004 Pagination : 117-136 ISSN : 0373-5834 Référence électronique Julien Brachet, « Le négoce caravanier au Sahara central : histoire, évolution des pratiques et enjeux chez les Touaregs Kel Aïr (Niger) », Les Cahiers d’Outre-Mer [En ligne], 226-227 | Avril-Septembre 2004, mis en ligne le 13 février 2008, consulté le 19 avril 2019. URL : http://journals.openedition.org/ com/512 ; DOI : 10.4000/com.512 Ce document a été généré automatiquement le 19 avril 2019. © Tous droits réservés Le négoce caravanier au Sahara central : histoire, évolution des pratiques et... 1 Le négoce caravanier au Sahara central : histoire, évolution des pratiques et enjeux chez les Touaregs Kel Aïr (Niger) Julien Brachet 1 Le massif de l’Aïr constitue une vaste zone montagneuse située au nord-ouest du Niger en bordure saharo-sahélienne. Ses nombreux points d’eau et pâturages en ont fait un lieu privilégié de passage des caravanes sahariennes et transsahariennes depuis l’Antiquité. 2 Les Touaregs 1 Kel 2 Aïr, arrivés de façon échelonnée dans ce massif entre les XIe et XVe siècles, trouvèrent dans leur implication à ce commerce, par sa domination (pillages, taxations) ou sa pratique, d’une part une importante source de revenu, d’autre part un moyen de s’établir territorialement de façon importante dans la zone, en dominant de vastes espaces. -

Julien Brachet Dtraversent Le Sahara Central Focalisent L’Attention Des Médias Et Des Pouvoirs Publics, Tant En Afrique Qu’En Europe
epuis le début des années 2000, les flux migratoires qui Julien Julien Brachet Dtraversent le Sahara central focalisent l’attention des médias et des pouvoirs publics, tant en Afrique qu’en Europe. En dépit Brachet des obstacles qui entravent la circulation dans cette région, reflets des dysfonctionnements de l’État nigérien et du durcissement des politiques migratoires des États maghrébins, des migrants origi- naires de toute une partie du continent se rendent via le Niger € en Afrique du Nord, d’où la plupart reviennent après quelques migrations 22 mois ou quelques années. Ces migrations entre les deux rives du Sahara constituent le principal facteur de dynamisme et de transformation de la région d’Agadez, dans le nord du Niger, et tendent plus largement à redéfinir une nouvelle géographie saha- 9832046 transsahariennes rienne en mettant en contact des lieux et des acteurs de façon inédite. En analysant ces mouvements migratoires tant du point de vue de leur organisation propre, des logiques et des structures qui les sous-tendent, que de leurs incidences sur les sociétés et Vers un désert cosmopolite les espaces traversés, le présent ouvrage déconstruit nombre des discours médiatiques et politiques qui entretiennent la peur d’un et morcelé (niger) péril migratoire illusoire, en montrant que la grande majorité des migrants qui traversent aujourd’hui le Sahara ne sont pas des indi- vidus fuyants des situations de misère extrême ou de conflit, et n’ont pas pour objectif de se rendre en Europe. Dans un contexte global de crispation identitaire et de durcissement des politiques migratoires, l’analyse des effets et des enjeux du contrôle crois- sant de ces circulations dans les espaces de transit soulève en défi- nitive la question du droit à la mobilité, tant au niveau local qu’à l’échelle internationale. -

Situations Pastorales Et Agf Dans Le Sahel Nigef
SITUATIONS PASTORALES ET AGF DANS LE SAHEL NIGEF SIITUATIONS PASTORALES ET AGROPASTORALES DANS LE SAHEL NIGERIEN La zone sahélienne, au sens large, s'étend de l'isohyète 100 mm au nord, à l'isohyète 500 mm au sud ; elle concerne 50 % de la superficie du Niger et couvre environ 640 000 km 2 ; le reste du pays est occupé au nord par le désert (44 %) et au sud par une étroite frange soudanienne (6 %). C'est le plus sahélien des États francophones puisque le Mali (40 %), la Mauritanie (39 %), le Tchad (32 %), le Sénégal (27 %) et le Burkina Faso (7 %) possèdent un domaine sahélien moins étendu (cf. Boudet, 1974). Le cadre socio-historique Il est difficile au Niger de séparer populations sahéliennes et non sahéliennes tant elles sont intime ment mêlées. Depuis des siècles, éleveurs et paysans ont pratiqué une cohabitation souvent faite de luttes armées, de coups de mains, mais aussi d'échanges et de services rendus réciproques entre sociétés économiquement complémentaires. Il faut rappeler brièvement que le Niger a connu l'influence de nombreux empires et États sur la plus grande partie de son territoire au cours de périodes successives. Dès le VIle siècle, le Songhay, le long du Niger, le Kanem, sur les bords du lac Tchad, constituent aux deux extrémités Ouest et Est des empires qui, au cours des siècles, étendent leL.;r influence vers le nord, jusqu'à l'Aïr pour le pre mier, vers les oasis du Kawar pour le second. Le Kanem est supplanté par l'empire du Bornou sur ses marges occidentales au xve siècle, alors que le Songhay atteint son apogée et succède à l'em pire du Mali déclinant au Soudan central. -

Un Désert Cosmopolite. Migrations De Transit Dans La Région D'agadez
Un désert cosmopolite. Migrations de transit dans la région d’Agadez (Sahara nigérien) Julien Brachet To cite this version: Julien Brachet. Un désert cosmopolite. Migrations de transit dans la région d’Agadez (Sahara nigérien). Sciences de l’Homme et Société. Université Panthéon-Sorbonne - Paris I, 2007. Français. tel-00339059v1 HAL Id: tel-00339059 https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00339059v1 Submitted on 15 Nov 2008 (v1), last revised 23 Nov 2009 (v2) HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. UNIVERSITÉ PARIS 1 PANTHÉON -SORBONNE École doctorale de géographie de Paris U.F.R. de Géographie 2007 UN DÉSERT COSMOPOLITE . MIGRATIONS DE TRANSIT DANS LA RÉGION D ’A GADEZ (S AHARA NIGÉRIEN ) Thèse pour l’obtention du doctorat en géographie Présentée et soutenue publiquement le 19 décembre 2007 Julien BRACHET Sous la direction de Emmanuel GRÉGOIRE Membres du jury : - Jean-Louis CHALÉARD , Professeur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (président). - Brigitte BERTONCELLO , Professeur à l’Université de Provence - Aix-Marseille I (rapporteuse). - André BOURGEOT , Anthropologue, Directeur de recherche émérite au CNRS (rapporteur). - Jérôme LOMBARD , Chargé de recherche à l’IRD (examinateur) . - Olivier PLIEZ , Chargé de recherche au CNRS (examinateur) . -

Nobles Et Religieux Chez Les Touaregs Kel Denneg
I EDMONDBERNUS Histoires parallèles et croisées Nobles et religieux chez les Touaregs Kel Denneg Edmond BERNUS,Histoires parallèles et croisies. Nobles et religieux chez les Touaregs Kel Denneg. - Au sein ( une confédération touarègue, cadre politique d’une communauté culturelle vivante, nobles et religieux donnent deux versions contradictoires et complémentaires de leur histoire commune. Cet exemple fait apparaître la volonté de chaque partenaire de se construire un rôle positif correspondant à l’image qu’il se donne de lui-même et qu’il veut laisser a la postérité. Chez les Touaregs religieux cela peut poser le problème de la conscience d’une identité débordant parfois du cadre de l’ethnie. Dans une région du Niger oh cohabitent depuis deux siècles Hausa et Toua- regs Kel Gres’, paysans et anciens pasteurs nomades, deux ethnologues, Pierre Bonte et Nicole Échard, ont tenté naguère de confronter les traditions de ces communautés qu’ils avaient étudiées chacun de leur côté : Dans la société hausa, la référence au religieux - qui justifie et maintient les relations entre les ,a groupes sociaux constituant les communautés villageoises - donne une colora- tion dominante et spécifique au contenu de ce savoir historique ; dans la société Kel Gress, ce rôle est le fait du politique qui constitue l’armature des rapports de classe )) (Bonte & Échard 1976 : 290). Cette approche comparative a stimulé une réflexion commune aboutissant 8 la rédaction d’un article au titre évocateur : (( Histoire et histoires n. Si on a pu ainsi confronter avec bonheur -

Eperonner Le Monde. Nomadisme, Cosmos Et Politique Chez Les Touaregs Hélène Claudot-Hawad
Eperonner le monde. Nomadisme, cosmos et politique chez les Touaregs Hélène Claudot-Hawad To cite this version: Hélène Claudot-Hawad. Eperonner le monde. Nomadisme, cosmos et politique chez les Touaregs. Edisud, 199 p., 2001. halshs-00474014 HAL Id: halshs-00474014 https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00474014 Submitted on 18 Apr 2010 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Couv Eperonn2 4/07/07 14:29 Page 1 ÉSORDRE NOMADE ou ordre différent ? Les idées, les valeurs, les Ddécisions et les actions qui ont façonné l’histoire touarègue ont souvent été décryptées par les regards extérieurs comme les débordements chaotiques d’un monde sans foi ni loi. Croisant les sources externes et internes, ces textes explorent au contraire la question désertée et cependant centrale du “politique” dans cette société nomade. Ils s’attachent à dégager les modèles originaux mis en œuvre et les principes structurants de l’ordre social, qui font écho à la vision touarègue de l’ordre cosmique. Ils analysent leurs interactions, leurs transformations et leurs recompositions en cette période troublée qui s’étend de la fin du XIXe siècle jusqu’à l’orée du XXIe siècle. -

Ways of Manifesting Collectivism: an Analysis of Iranian and African Cultures
Technical Details Ways of Manifesting Collectivism: An Analysis of Iranian and African Cultures Nina G. Hamedani, MS,* Tristan M. Purvis, PhD,* Sharon Glazer, PhD, & Joseph Dien, PhD March 2012 1 CONTENTS Chapter 1: Introduction .......................................................................................................................... 3 Culture ............................................................................................................................................... 3 Relational models theory: a Recap .................................................................................................... 4 Chapter 2: Iranian Culture ...................................................................................................................... 7 Strategic Significance of Iran ............................................................................................................. 7 Religion, Tradition, and Change ........................................................................................................ 8 “Persian” or “Iranian” ......................................................................................................................... 9 Identity and Nationalism .................................................................................................................. 10 Historical Perspective ............................................................................................................... 11 Iranian Collectivism ........................................................................................................................ -

Fonds Suzanne & Edmond BERNUS 224 APOM/1-160
RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ Fonds Suzanne & Edmond BERNUS 224 APOM 1-160 (1947-2003) IRD - Service Archives Fabien BORDELÈS Avec la participation de Sarah LÉPAULARD Marseille 2015 En couverture : « Don Quichotte et Sancho Panza du Niger » par Suzanne Bernus - 224 APOM 102. « Chercheur modèle, infatigable et organisatrice irremplaçable, Suzanne Bernus, tout en se dévouant avec une ferveur exemplaire à des travaux collectifs, continue à mener avec pertinence ses recherches personnelles.» Jean ROUCH (Rapport d’évaluation 1979, source CNRS cote 910025 DPAA, sous dérogation) « (…) J’ai eu grand plaisir à participer à la soutenance de l’excellent Bernus, dont la solidité, la simplicité et l’honnêteté sont exemplaires : en un temps où l’enflure du vocabulaire tend trop souvent à masquer la pauvreté des connaissances, cela fait vraiment plaisir (…). » Théodore MONOD (Lettre du 10 octobre 1978, source Muséum national d’histoire naturelle de Paris, cote : MsMD) Répertoire numérique détaillé – Fonds Suzanne et Edmond BERNUS 224 APOM 2 Avant propos Suzanne et Edmond Bernus ont constitué, utilisé et conservé les sources (cahiers de terrain, fichiers index, dossiers thématiques, presse, cartes, revues, tirés à part reçus) et les outils (herbier, documents sonores) de leurs recherches, ainsi que leurs résultats (phographies, films documentaires, articles…). Cette ethnologue et ce géographe, qui furent également tous les deux historiens, archéologues, cinéastes, photographes… ont vécu leur sujet d’étude et l’ont traité dans toutes ses dimensions, pour le rendre dans une langue simple et claire. Ce fonds offre une remarquable synthèse de la connaissance sur les Touaregs. Le service archives de l’Institut de recherche pour le développement (IRD) et les Archives nationales d’Outre-mer (ANOM) tiennent à remercier Caroline Bernus, Jacques Bernus et Cécile Guy Bernus pour le don des archives de leurs parents et leurs concours dans le traitement et la valorisation de ce fonds. -

Honneur Et Politique. Les Choix Stratégiques Des Touaregs Pendant La Colonisation Française Hélène Claudot-Hawad
Honneur et politique. Les choix stratégiques des Touaregs pendant la colonisation française Hélène Claudot-Hawad To cite this version: Hélène Claudot-Hawad. Honneur et politique. Les choix stratégiques des Touaregs pendant la coloni- sation française. Revue des Mondes Musulmans et de la Méditerranée, Université de Provence, 1990, pp.11-49. halshs-00648591 HAL Id: halshs-00648591 https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00648591 Submitted on 6 Dec 2011 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. 1 onneur et politique Les choix stratégiques des Touaregs pendant h la colonisation française* La perception du monde touareg comme un agrégat de tribus querelleuses, en dissensions internes constantes, domine les écrits de la période coloniale et prévaut également dans la plupart des études historiques ou ethnologiques récentes. Ainsi, A. Salifou (1973 : 24) estime qu’au XIXe siècle, quand les convoi- tises européennes commencent à se manifester, « l’unité politique de l’Aïr reste encore à faire. Les tribus les plus puissantes du pays s’y sont taillées chacune son domaine propre ». À propos des Ajjer, M. Gast (1986 : 393) considère que « les différents opposants à la domination française n’ont pas de pensée politique cohérente et coordonnée ». -

The Uranium Curse - the Northen Niger's Su Ering from Its Wealth
news file The uranium curse - The Northen Niger's suering from its wealth “ Our society has it got a right to ignore the destruction of a whole people the original crime of which would be to live in a once waste but turned immensely rich Sahara ? “ Arlit AGADEZ NIAMEY Tchinaghen Association- Peace and solidarity with the Northern Niger www.tchinaghen.org News file The uranium curse - The Northern Niger’s suffering from its wealth “Our society has it got a right to ignore the destruction of a whole people the original crime of which would be to live in a once waste but turned immensely rich Sahara?” Issouf ag Maha Thanks to Annie and Luisa for their translation of the original french document : “La malédiction de l’uranium, le Nord-Niger victime de ses richesses” To get in touch : Tchinaghen Association Peace and solidarity with the Northern Niger [email protected] - 33(0)6.28.05.76.57 Web site : www.tchinaghen.org 1 SUMMARY I. In Niger : The Tuareg people are threatened p.3 ▷ In Niger, autochthonous communities are in danger p.3 ▷ The factors of destabilization and marginalization p.4 ▷ 139 research licences allowed p.6 II. Maps p.7 ▷ The Tuareg way of life: a precious balance p.7 ▷ The Tuareg people are threatened by uranium mining work p.8 ▷ Nuclear colonization and plundering of the Tuareg pasture-lands by foreign companies p.9 III. Report on a predicted desert : Irhazer plain near Agadez, Niger p.10 ▷ Compulsions by the surroundings p.10 ▷ More and more wasting p.10 ▷ A surprising management p.11 ▷ Which future ? p.12 IV. -

La Malédiction De L'uranium - Le Nord-Niger Victime De Ses Richesses
d'informationdossier La malédiction de l'uranium - Le Nord-Niger victime de ses richesses "Notre monde a-t-il le droit de laisser passer sous silence la destruction de tout un peuple dont le crime originel serait d’habiter un Sahara jadis inculte mais devenu immensément riche ?" Arlit AGADEZ NIAMEY Collectif Tchinaghen - Paix et Solidarité au Nord-Niger www.tchinaghen.org Dossier d'information La malédiction de l'uranium - Le Nord-Niger victime de ses richesses "Notre monde a-t-il le droit de laisser passer sous silence la destruction de tout un peuple dont le crime originel serait d’habiter un Sahara jadis inculte mais devenu immensément riche ?" Issouf ag Maha Paix et Solidarité au Nord-Niger Boîte n°26 - 3 passage Rauch, 75011 Paris [email protected] - www.tchinaghen.org n°siret : 505 038 364 00012 Mise à jour : Août 2008 Photographies et textes : Collectif Tchinaghen Imprimé par nos soins copyleft SOMMAIRE ● L’espace des grands nomades agonise 4 ▷ Au Niger les communautés autochtones sont menacées 4 ▷ Les facteurs de déstabilisation et de marginalisation 5 ▷ 139 permis de recherche d’uranium octroyés 7 ● Cartes 8 ▷ Le mode de vie touareg : un équilibre précieux 8 ▷ Le peuple touareg menacé par l'exploitation de l'uranium 9 ▷ Colonialisme nucléaire et spoliation des terres agro-pastorales touarègues 10 ● Chronique d’un désert annoncé : la plaine de l’Irhazer à Agadez 11 ▷ Les contraintes du milieu 11 ▷ La surenchère du pillage 12 ▷ Une gestion surprenante 12 ▷ Quel avenir ? 13 ● AREVA à Arlit et Akokan depuis 40 ans 14 ▷ AREVA exploite