Les Maires De Thumeries
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Forum Soda S Club.Pdf
Tu as entre 14 et 17 ans, ? Viens profiter de nombreuses activités et mettre en place des projets culturels, sportifs... Des animateurs t’accueilleront, tout au long de l’année, hors vacances scolaires : • Viens participer à des activités variées et originales (roller-hockey, futsal, musique,...), • Viens créer ton prochain mini-séjour, • Organise des événements sur le territoire (concert, tournoi sportif, ...), • Deviens l’ambassadeur des ados en Pévèle Carembault avec le Conseil communautaire des jeunes. Contact Service Animation Jeunesse Pévèle Carembault 85, Rue de Roubaix - 59242 Templeuve-en-Pévèle Tél. : 03 28 76 99 76 [email protected] www.pevelecarembault.fr Du lundi au vendredi 8h30-12h et 13h30-17h30 FORUM ÉTÉ ADOS 2ème édition Contact Service Animation Jeunesse SAMEDI de 10h à 16h Pévèle Carembault à Genech 85, Rue de Roubaix - 59242 Templeuve-en-Pévèle 5 MAI Institut de Genech Tél. : 03 28 76 99 76 2018 rue de la Libération [email protected] www.pevelecarembault.fr Du lundi au vendredi 8h30-12h et 13h30-17h30 Pour les ados de 12 à 16 ans • Inscription à la semaine complète, • Tous les jours : accueil échelonné de 7h30 à 10h et de 17h à 18h30, • Restauration possible le midi, • Paiement des semaines d’activités après chaque vacances. Pour découvrir les activités de cet été Le 5 mai de 10h à 16h, venez rencontrer les équipes de direction de chaque Soda’s Club du territoire et découvrez ce qu’elles proposent aux ados : • Des mini-camps, • Des stages, • Des sorties, • Des animations, Venez • … nombreux ! Un t-shirt -

Territoire Du Scot De Lille Métropole (Sources : ORB Npdc 2014, D’Après ARCH 2009)
En savoir plus Territoire du SCoT de Lille Métropole MÉTROPOLE LILLE SCoT de Malgré la forte artificialisation* de son territoire et la faible proportion laissée aux espaces naturels et semi-naturels, le territoire du SCoT abrite un nombre important des espèces régionales : six espèces de plantes régionales sur dix, les deux tiers des Oiseaux, un peu moins de la moitié des espèces de Mammifères. De plus, près de 9,5 % du territoire sont occupés par des habitats à enjeux écologiques majeurs ou forts. Le Schéma de cohérence territoriale (SCoT)* de Lille Néanmoins, cette diversité est menacée, entre autres, parce que les Métropole est en cours de cœurs de biodiversité* (ZNIEFF de type 1) sont peu protégés (5,5 % des révision, comme suite à ZNIEFF de type 1 sont sous protection réglementaire forte ou en Natura l’actualisation en 2008 du Schéma directeur* de 2002, 2000) et donc subissent des destructions, de lafragmentation* , etc. Il en qui couvrait le périmètre résulte une banalisation des habitats naturels, de la faune et de la flore. de l’Arrondissement de Lille (88 000 hectares). Son Les espaces naturels remarquables du territoire du SCoT de Lille (sources : ORB NPdC 2014, d'après DREAL 2013, CEN NPdC 2001, ARCH 2009, BD Forêt® v2 2009 et AEAP 2009). périmètre est néanmoins N.B. : Les " Espaces naturels remarquables " sont issus des périmètres de ZNIEFF type 1 modifiés. amené à évoluer, par suite de la constitution d’une nouvelle intercommunalité, la CC de Pévèle-Carembault, actuellement sur deux territoires de SCoT (Lille Métropole et Douaisis). C’est le territoire le plus peuplé du Nord - Pas-de-Calais et l’un des plus urbanisés. -

LISTE-DES-ELECTEURS.Pdf
CIVILITE NOM PRENOM ADRESSE CP VILLE N° Ordinal MADAME ABBAR AMAL 830 A RUE JEAN JAURES 59156 LOURCHES 62678 MADAME ABDELMOUMEN INES 257 RUE PIERRE LEGRAND 59000 LILLE 106378 MADAME ABDELMOUMENE LOUISA 144 RUE D'ARRAS 59000 LILLE 110898 MONSIEUR ABU IBIEH LUTFI 11 RUE DES INGERS 07500 TOURNAI 119015 MONSIEUR ADAMIAK LUDOVIC 117 AVENUE DE DUNKERQUE 59000 LILLE 80384 MONSIEUR ADENIS NICOLAS 42 RUE DU BUISSON 59000 LILLE 101388 MONSIEUR ADIASSE RENE 3 RUE DE WALINCOURT 59830 WANNEHAIN 76027 MONSIEUR ADIGARD LUCAS 53 RUE DE LA STATION 59650 VILLENEUVE D ASCQ 116892 MONSIEUR ADONEL GREGORY 84 AVENUE DE LA LIBERATION 59300 AULNOY LEZ VALENCIENNES 12934 CRF L'ESPOIR DE LILLE HELLEMMES 25 BOULEVARD PAVE DU MONSIEUR ADURRIAGA XIMUN 59260 LILLE 119230 MOULIN BP 1 MADAME AELVOET LAURENCE CLINIQUE DU CROISE LAROCHE 199 RUE DE LA RIANDERIE 59700 MARCQ EN BAROEUL 43822 MONSIEUR AFCHAIN JEAN-MARIE 43 RUE ALBERT SAMAIN 59650 VILLENEUVE D ASCQ 35417 MADAME AFCHAIN JACQUELINE 267 ALLEE CHARDIN 59650 VILLENEUVE D ASCQ 35416 MADAME AGAG ELODIE 137 RUE PASTEUR 59700 MARCQ EN BAROEUL 71682 MADAME AGIL CELINE 39 RUE DU PREAVIN LA MOTTE AU BOIS 59190 MORBECQUE 89403 MADAME AGNELLO SYLVIE 77 RUE DU PEUPLE BELGE 07340 colfontaine 55083 MONSIEUR AGNELLO CATALDO Centre L'ADAPT 121 ROUTE DE SOLESMES BP 401 59407 CAMBRAI CEDEX 55082 MONSIEUR AGOSTINELLI TONI 63 RUE DE LA CHAUSSEE BRUNEHAUT 59750 FEIGNIES 115348 MONSIEUR AGUILAR BARTHELEMY 9 RUE LAMARTINE 59280 ARMENTIERES 111851 MONSIEUR AHODEGNON DODEME 2 RUELLE DEDALE 1348 LOUVAIN LA NEUVE - Belgique121345 MONSIEUR -

Marque-Deûle
Sommaire Unité de présentation Lys- Marque-Deûle ...........................................................................3 Principaux évènements marquants d'inondation..............................................................5 Inondations de la Lys et de ses affluents du 13 au 30 novembre 1974.................................... 6 Inondations de décembre 1993 et janvier 1994........................................................................ 6 Inondations de la Lys et de ses affluents en décembre 1999................................................... 8 Ruissellements et coulées de boue sur le bassin versant de la Marque le 29 juillet 2000 ....... 9 Inondations et ruissellements de fin octobre à début décembre 2000.................................... 10 Impacts potentiels des inondations futures ....................................................................12 Inondations par débordement de cours d’eau, ruissellement, torrents de montagne et ruptures de digues de protection............................................................................................. 12 Inondations par remontée de nappes ..................................................................................... 31 Inondations par rupture d’ouvrage de retenue........................................................................ 31 Annexes.............................................................................................................................33 Références.....................................................................................................................35 -

Recueil Des Actes Administratifs N°R32-2020-250 Publié Le 17 Juillet
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS N°R32-2020-250 PREFET DE LA RÉGION PUBLIÉ LE 17 JUILLET 2020 HAUTS-DE-FRANCE 1 Sommaire Agence régionale de santé Hauts-de-France R32-2020-07-15-002 - Arrêté DOS-SDES-GRHH-2020-60 modifiant la composition nominative du conseil d'administration du centre de lutte contre le cancer "Oscar Lambret" à LILLE (3 pages) Page 4 R32-2020-07-15-001 - DECISION N° DPPS – ETP – 2020 / 064 PORTANT MODIFICATION D’AUTORISATION DU CH Fourmies A DISPENSER LE PROGRAMME D’EDUCATION THERAPEUTIQUE DU PATIENT « Programme d'éducation thérapeutique pour le diabète gestationnel » (3 pages) Page 8 R32-2020-06-30-520 - Décision tarifaire portant fixation de ladotation globale de financement pourl'année 2020 du SSIAD PA à RONCHIN (5 pages) Page 12 R32-2020-06-30-509 - Décision tarifaire portant fixation de ladotation globale de financement pourl'année 2020 du SSIAD PA PHà LA MADELEINE (5 pages) Page 18 R32-2020-06-30-511 - Décision tarifaire portant fixation de ladotation globale de financement pourl'année 2020 du SSIAD PA PH CH à LE QUESNOY - BAVAY (5 pages) Page 24 R32-2020-06-30-510 - Décision tarifaire portant fixation de ladotation globale de financement pourl'année 2020 du SSIAD PA PH à LANDRECIES (5 pages) Page 30 R32-2020-06-30-512 - Décision tarifaire portant fixation de ladotation globale de financement pourl'année 2020 du SSIAD PA PH à LEWARDE (5 pages) Page 36 R32-2020-06-30-514 - Décision tarifaire portant fixation de ladotation globale de financement pourl'année 2020 du SSIAD PA PH à MAUBEUGE (5 pages) Page 42 R32-2020-06-30-515 -

Liste Des Inscrits GP Thumeries 2021 Au 10052021
LISTE DES INSCRITS DU GRAND PRIX DE THUMERIES 2021 DAMES Rang Nom et prénom Club Catégorie WAGR L.Or Mérite Idx 1 PAROLA Lucile LYS CHANTILLY ADULTE F 120 -2.0 2 NOE Kitrie BORDEAUX LAC CADET 2 / GIRL 138 2.4 3 CUNAUD Charlotte BRIGODE ADULTE F 208 0.2 4 BENOIT Constance BONDUES MID AMATEUR F 226 1.9 5 RONCORONI Anouk AMIENS MINIME 1 / GIRL 235 4.9 6 NIZET Bérénice PRIEURE MINIME 2 / GIRL 243 4.8 7 MASUREL Clemence BRIGODE ADULTE F 262 5.2 8 LAURENCE Sylvia COUDRAY MONTCEAUX SENIOR F 265 4.2 9 DAVAINE Marion LE TOUQUET MID AMATEUR F 2.4 10 HIOT Romane AMIENS CADET 2 / GIRL 2.6 11 LENTREBECQ Constance SART BENJAMIN 2 4.1 12 GORCZYCA Chloé BRIGODE ADULTE F 4.6 13 MATLEGA Ambre ST GERMAIN BENJAMIN 2 7.7 14 DELANNE Capucine BRIGODE MINIME 2 / GIRL 7.8 15 BOUQUET Charlotte BONDUES BENJAMIN 1 8.7 16 NGUYEN Agnes COUDRAY MONTCEAUX SENIOR F 9.0 17 RATAJ Samantha MERIGNIES CADET 1 / GIRL 10.4 18 DARLOY Céleste MERIGNIES POUSSIN 2 10.8 19 LAFON Catherine BONDUES SENIOR F 12.4 20 MACHET - LAFON Zoe BONDUES BENJAMIN 1 16.4 Wild Card Ligue MESSIEURS Rang Nom et prénom Club Catégorie WAGR L.Or Mérite Idx 1 FAUCQUEZ Maxence SART MINIME 1 / BOY oui -2.3 2 DELAVAL Gabriel SART MINIME 1 / BOY oui 1.2 3 MIJIC Arthur BONDUES CADET 2 / BOY 115 0.8 4 LAM Maxime PARIS COUNTRY MINIME 2 / BOY 222 0.8 5 ABRAHAM Patrick AMIENS SENIOR M 227 0.3 6 HOUDAYER Thomas VAUDREUIL CADET 2 / BOY 228 0.8 7 GUERN Emile ROUEN MINIME 2 / BOY 230 1.7 8 GEORGES Yvan DUNKERQUE SENIOR M 237 3.2 9 RODRIGUEZ Maxime BRIGODE ADULTE M 241 -2.7 10 SINGER Nicolas BONDUES MID AMATEUR M 251 -

Agence Responsable Tél Resp. Port Resp. Tél. Agence Adresse CP Ouverture Agence
Agence Responsable Tél Resp. Port Resp. Tél. Agence Adresse CP Ouverture Agence LILLE CENTRE FENNELL Vincent 03 20 78 54 18 06 22 47 48 57 LILLE Rihour Adj. : MALLET Julie 03 20 78 54 07 06 03 74 47 93 03 20 78 54 54 28 Place Rihour 59000 L au S Adj. : GUFFROY Matthieu 03 20 78 54 12 07 71 32 48 14 LILLE Royale PARISON BENJAMIN 03 20 12 10 31 06 29 21 52 67 03 20 12 10 30 42 Rue Royale (RDC) 59000 M au S HUYGHE Jeremy 03 20 21 91 64 06 03 74 64 49 LILLE Gambetta 03 20 21 91 40 323 Rue L. Gambetta 59000 M au S Adj. : BEUSCART Nicolas 03 20 21 91 45 06 14 73 41 59 LILLE Cormontaigne GONCALVES Bérengère 03 20 22 75 51 06 12 08 60 84 03 20 22 75 50 3 Bld Montebello 59000 M au S LILLE Victor Hugo FERRANT Fanny 03 20 29 85 30 06 12 08 60 98 03 20 29 85 55 2/2 Bis Bld Victor Hugo 59000 M au S LILLE Flandres FENNELL Vincent 03 20 78 54 18 06 22 47 48 57 03 20 78 54 05 28 Place Rihour (3ème étage) 59000 L au V LILLE Nationale REVIDI Benjamin 03 20 78 54 39 07 71 32 48 20 03 20 78 54 34 31 Rue Nationale 59800 M au S LA MADELEINE PERENCHIES BAELDE Alexia 03 20 00 19 81 06 14 07 33 07 03 20 00 19 80 16 Rue de la Prevote 59840 M au S STIEVENART Sandrine 03 20 81 83 10 07 77 25 82 01 CROIX République 03 20 81 83 33 2 Place de la République 59170 L au S Adj. -
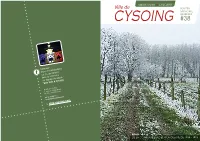
Ville-Cysoing.Com > Ville-Cysoing.Com
BULLETIN MUNICIPAL JANVIER 2018 #38 MIEUX VIVRE À CYSOING Retrouvez toutes les informations sur les animations dans la commune sur la page Facebook “Bien Vivre à Cysoing“ MAIRIE DE CYSOING 2, place de la République BP 67 - 59830 Cysoing 03 20 79 44 70 [email protected] > ville-cysoing.com DOSSIER DE LA CONQUÊTE DU CIEL À LA GUERRE DE 1914 - 1918 Édito Très chers Cysoniennes et Cysoniens, Sommaire BULLETIN MUNICIPAL La fin d’année mouvementée appelle à dresser un bilan de l’action S’agissant de notre Pyramide, le début des travaux a permis de JANVIER 2018 menée en 2017 et tracer quelques perspectives pour 2018. mettre en évidence l’urgence d’une intervention sur cette vieille dame de 267 ans. N’hésitez pas à participer au projet de restauration via Qu’il me soit permis de ne pas revenir sur le «grand la Fondation du Patrimoine, elle a besoin de votre soutien. chambardement politique» au niveau national. Les urnes ont parlé, Sur le plan des travaux, pour votre sécurité des aménagements #38 je tiens simplement à souhaiter la réussite, pour notre pays et nos ont été réalisés sur les rues Ladreyt, Jeanne d’Arc et au chemin concitoyens. Vous le savez, la politique ne se mesure pas aux des Caches Vaches. Les deux premiers passages piétons 3 D paroles, mais aux actes et ce qui est vrai au niveau national, de France ont également été testés autour de l’école maternelle l’est aussi au niveau local, c’est en tous cas tout le sens de notre Saint Exupéry. -

Mémoire : Développement Du Tourisme Durable À Thumeries
Typhaine DEMARCK Gwendoline GAC Mathilde REYNIER Hortense SADONES Mémoire : Développement du Tourisme Durable à Thumeries Université Catholique de Lille Année universitaire 2010/2011 1 1 2 Typhaine DEMARCK Gwendoline GAC Mathilde REYNIER Hortense SADONES Mémoire : Développement du Tourisme Durable à Thumeries Université Catholique de Lille Année universitaire 2010/2011 2 3 Remerciements Nous tenons à remercier tout particulièrement M. Jean-Louis CARLIER pour son accueil, sa disponibilité et pour nous avoir accompagnées tout au long de notre mémoire. Nous adressons aussi nos remerciements à M. CHERIF, propriétaire de la nouvelle salle de séminaires de Thumeries, M. BESSANT, de l’association « Les attelages du grand courant», et M. LEMAIRE, directeur du cyclo club de Phalempin, pour leur temps consacré à notre projet, Enfin, nous remercions M. CHEROUTRE, pour nous avoir suivies au cours de ce projet. 4 Table des matières INTRODUCTION 7 I. LE CONTEXTE 8 1. LA PRESENTATION DE LA VILLE DE THUMERIES 8 A. La situation géographique 8 B. L’importance historique des entreprises Beghin 9 C. La population de Thumeries 10 D. La vie associative 11 a. Qu’est-ce qu’une vie associative ? 11 b. Quelles sont les différentes associations à Thumeries ? 11 c. Les rencontres lors de la vie associative 11 d. L’activité des associations 11 e. La vie associative autour de la vie communale 11 f. Lien avec le développement durable 12 E. Le développement économique 13 2. LE DEVELOPPEMENT DURABLE 14 A. Au niveau mondial 14 B. En France 14 C. A Thumeries 15 3. LE TOURISME DURABLE 16 A. Définition 16 B. -

Pévèle, Tourmignies, Attiches, Thumeries
CAHIER D’ACTEURS 5 Un contexte particulier • Construire une deuxième ligne à côté. “Une nouvelle ligne destinée à renforcer Cette solution est trop compliquée à le transit et à favoriser les échanges avec mettre en place du fait des densités les pays européens” de population importantes existantes, Pour des raisons de sécurité d’approvisionne- dans un territoire très utilisé par l’acti- ment le réseau électrique français est depuis vité agricole, le développement écono- longtemps interconnecté avec les autres mique, l’habitat... pays européens. Cette interconnexion nous • Construire une ligne souterraine en lieu permet de nous approvisionner en électri- et place de l’existant. Si techniquement cité dans les pays européens les plus compé- c’est aujourd’hui possible, les difficul- titifs et d’exporter notre surplus d’énergie tés restent grandes et le coût est prohi- produite. bitif (460 millions d’euros) RTE (Réseau de transport d’électricité) • Construire une nouvelle ligne double - responsable du transport du flux du réseau qui transportera deux lignes (circuits) Communes de la Pévèle électrique a pour rôle d’assurer la rencontre électriques en haut des mêmes pylônes entre l’offre et la demande afin de garantir – afin de tripler la puissance par rapport Moncheaux, Mons-en- l’alimentation en électricité au meilleur prix à la ligne actuelle. Pévèle, Tourmignies, aux utilisateurs. C’est ainsi que le territoire C’est sur cette dernière voie que s’engage national est maillé de lignes à forte puis- RTE. Cette solution permettrait d’augmen- Attiches, Thumeries sance, appelées “autoroutes” et de lignes de ter la puissance et d’atteindre le niveau de plus faible capacité. -

Liste Enseignants Referents Du Nord 2019-2020
LISTE ENSEIGNANTS REFERENTS DU NORD 2019-2020 1 ANDRE Guy Cité Scolaire Camille Claudel - Rue Paul FOURMIES 59613 06 34 44 07 65 [email protected] Avesnes Lafargue Valenciennes 2 BELLET Pauline Collège du Septentrion rue du Collège BRAY DUNES 59123 06 34 44 15 51 [email protected] Dunkerque Lille 2 3 DECROIX Rémi* Collège Victor Hugo - rue de Luchon SOMAIN 59490 06 46 04 93 29 ens.ref.somain@ac-lille,fr Douai Cambrai 4 BENCTEUX Catherine Collège Mendès France 19, rue de Soissons TOURCOING 59200 06 46 04 93 15 [email protected] Roubaix Tourcoing 5 BLONDEAU Lilia Collège Arthur Rimbaud 1 rue du Chemin VILLENEUVE D'ASCQ 03.20.84.14.91 [email protected] Lille 1 Lille 3 Vert B.P. 30 235 59654 cedex 6 BOUEZ Françoise Collège Saint Exupéry 23 rue du Progrès LILLE HELLEMMES 06 34 44 22 82 [email protected] Lille 1 Lille 3 59260 7 BRICCHI Lydia Collège Descartes rue Lavoisier MONS EN BAROEUL 06 46 04 93 32 [email protected] Lille 1 Lille 3 59370 8 BRICOUT Christelle Collège Félix Del Marle - 62 Rue Henri AULNOY AYMERIES 06 35 22 94 44 [email protected] Avesnes Barbusse 59620 Valenciennes 9 BRIQUET Christine Collège J.Moulin 6 rue Roland Garros WATTIGNIES 59139 06 34 44 36 49 [email protected] Lille 1 Lille 3 10 BROUTIN Véronique* Lycée Fondation Depoorter 7-9 rue HAZEBROUCK 59190 06 09 12 01 02 [email protected] Dunkerque Lille 2 Depoorter 11 CACHERA Karine Collège Demailly rue du collège Demailly BP SECLIN 59113 -

MONS En NOUVELLES ÉTÉ 2016 Distribution : Conseil Municipal
MONS 34 ÉTÉ en NOUVELLES 2016 > LE JOURNAL COMMUNAL DE MONS-EN-PÉVÈLE DOSSIER Rucher communautaire : P12 LES ABEILLES FONT LE BUZZZZ ! >13 A découvrir dans ce numéro : ©Photo : Didier DUBAELE PROJET THT CYCLISME FÊTE MÉDIÉVALE P 16 P 18 P 21 > Mobilisation massive des Pévèlois ! > Le Paris-Roubaix 2016 > Une journée au Moyen Âge Toutes les informations et événements sur : www.mairie-monsenpevele.fr EDITO A vos AGENDAS ! Samedi 1er octobre Concours de tarot organisé par le club de tarot > Salle des fêtes Dimanche 28 août En vous mobilisant massivement lors Pique-nique organisé de l’enquête publique sur le projet de par la Municipalité reconstruction de la ligne THT (pages 16 et > Stade 17), vous avez démontré votre volonté de Jeudi 1er septembre Dimanche 2 octobre préserver notre environnement. Je vous en Rentrée des classes Fête de la Saint Hubert remercie. Notre paysage pittoresque rend organisée par le Syndicat d’Initiative notre village attractif et nous devons le Samedi 10 > Cense abbatiale protéger ! et dimanche 11 septembre ème 6 Mountain bike Pévèl’tour Samedi 8 octobre Assemblée générale de la FNACA Cavaliers, cyclistes, randonneurs viennent organisé par le Team VTT > Espace gare > Salle des fêtes se ressourcer à Mons-en-Pévèle. Sur nos chemins, ils croiseront bientôt les écoliers Vendredi 16 septembre Vendredi 21 et samedi 22 octobre qui profitent de vacances bien méritées (page Apéritif de rentrée Représentations théâtrales 20). Les membres des associations locales, et assemblée générale organisées par le Théâtre du Pévèle après une année active (pages 21 à 25), de l’Association de Parents d’Elèves > Salle des fêtes méritent, eux aussi, un peu de repos.