De M.FELLAG Soutenu Le
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
Magic Mike August 2012
MAGA MAGIC MIKE AUGUST 2012... ““UnnhheessiiittaattiiinngglllyyThheeReexxiiisstthheebbeessttcciiinneemaaIIIhhaavveeeevveerrkknnoownn…”” ((SSuunnddaayyTiiimeess2012)) ““ppoossssiiibblllyyBrriiittaaiiinn’’’ssmoossttbbeeaauuttiiiffuulllcciiinneemaa.........””((BBC)) AUGUST 2012 Issue 89 www.therexberkhamsted.com 01442 877759 Mon-Sat 10.30-6pm Sun 4.30-5.30pm To advertise email [email protected] INTRODUCTION Gallery 4-5 BEST IN AUGUST August Evenings 11 Coming Soon 26 August Films at a glance 26 August Matinees 27 Rants and Pants 42-43 SEAT PRICES (+ REX DONATION £1.00) Circle £8.00+1 Concessions £6.50+1 At Table £10.00+1 Concessions £8.50+1 Royal Box (seats 6) £12.00+1 From infidelity in Caramel, Nadine takes her or for the Box £66.00+1 All matinees £5, £6.50, £10 (box) +1 women to war. Where Do We Go Now BOX OFFICE : 01442 877759 Mon to Sat 10.30 – 6.00 Mon 6 7.30. Egypt/France/Italy/Lebanon 2012 Sun 4.30 – 6.30 FILMS OF THE MONTH Disabled and flat access: through the gate on High Street (right of apartments) Some of the girls and boys you see at the Box Office and Bar: Dayna Archer Liam Parker Julia Childs Amberly Rose Ally Clifton Georgia Rose Nicola Darvell Sid Sagar Romy Davis Liam Stephenson Karina Gale Tina Thorpe Ollie Gower Beth Wallman Elizabeth Hannaway Jack Whiting Billie Hendry-Hughes Olivia Wilson Thanks to McConaughey's oily power, it's not Abigail Kellett Roz Wilson Amelia Kellett Keymea Yazdanian all sex, violence & chicken legs. Lydia Kellett Yalda Yazdanian Killer Joe Fri 3 7.30/Sat 4 7.00 USA 2012 Ushers: Amy, Amy P, Annabel, Ella, Ellie, Ellen W, Hannah, India, James, Kitty, Luke, Meg, Tyree Sally Rowbotham In charge Alun Rees Chief projectionist (Original) Jon Waugh 1st assistant projectionist Martin Coffill Part-time assistant projectionist Anna Shepherd Part-time assistant projectionist Jacquie Rose Chief Admin Oliver Hicks Best Boy Simon Messenger Writer Jack Whiting Writer "Like a whole series of The Wire in a single Jane Clucas & Lynn Hendry PR/Sales/FoH film..."?? Luckily it's French. -

The Fifth Republic at Fifty
Franco-Maghrebi Crossings International Conference November 3-5, 2011 Winthrop-King Institute for Contemporary French and Francophone Studies Florida State University, Tallahassee Conference Director: Alec G. Hargreaves Administrative Coordinator: Racha Sattati Program All sessions take place in the Diffenbaugh Building on the FSU campus. Details are subject to change. THURSDAY, NOVEMBER 3 11:45AM, 12:30PM, 1:15PM – Complimentary Bus from Hotel Duval (pick-up at North Monroe entrance) to FSU Campus 12:00 noon-6:00 pm – Registration, 4th floor, Diffenbaugh 1:30 pm-3:00 pm – Panels 1A, 1B, 1C Panel 1A, Diffenbaugh 009 From Colonial Conquest to Decolonization Chair: Lindsey Scott (FSU) Alisha Valani (University of Toronto) - Entre brassage et homogénéité : colonisation, exil et folie au Maghreb Jennifer Fredette (SUNY Albany) and Richard Fogarty (SUNY Albany) - Forever apart: Enduring themes of “otherness” in French discourse on North African Muslims and Islam, 1914-1918 and 1989-2011 Doris Gray ( Florida State University) - Tunisia after the revolution: the end of post- colonialism? Panel 1B, Diffenbaugh 129 Memory I Chair: Robyn Cope (FSU) Janice Gross (Grinnell College) - Slimane Benaïssa: Performing the Tightrope of Franco-Algerian Memory Eveline Caduc (Université de Nice-Sophia Antipolis) - « Un futur pour héritages déterritorialisés » Patricia Reynaud (School of Foreign Service-Qatar Georgetown University) - Fractures et cicatrices dans Bent Keltoum Panel 1C, Diffenbaugh 005 Women Writers Chair: Virginia Osborn (FSU) Oana Panaite -

2 Days in NEW York PRESENTED by ENTERTAINMENT WEEKLY
The Premieres program showcases some of the most highly anticipated dramatic films of the coming year. Catch world premieres and the latest work from established directors at the Sundance Film Festival before they create a splash at local theatres. 2 DAYS IN New York DIRECTOR: Julie Delpy France, 2011, 91 min., color English and French with English subtitles Marion and Mingus live cozily—perhaps too cozily—with their cat and two young children from previous relationships. However, when Marion’s jolly father (played by director Delpy’s real-life dad), her oversexed sister, and her sister’s outrageous boyfriend unceremoniously descend upon them for a visit, it initiates two unforgettable days that will test Marion and Mingus’s relationship. With their unwitting racism and sexual frankness, the French triumvirate hilariously has no boundaries or filters . and no person is left unscathed in its wake. Directed and cowritten by Julie Delpy, 2 Days in New York is a deliciously PRESENTED by Entertainment Weekly witty romp. One of the pleasures of this follow-up film to 2 Days in Paris is the addition of Chris Rock, who—amid the Gallic mayhem—convincingly plays the straight man as Marion’s hipster American boyfriend. With great skill and energy, Delpy heightens cultural differences to comedic extremes but also manages to show that sometimes change is the best solution to a relationship that’s been pushed to its limit.—K.Y. Pr: Christophe Mazodier Ci: Lubomir Bakchev Ed: Isabelle Devinck PrD: Judy Rhee Wr: Julie Delpy, Alexia Landeau Principal Cast: Julie Delpy, Chris Rock, Albert Delpy, Alexia Landeau, Alex Nahon Monday, January 23, 6:30 p.m. -

Date Title Director Cast the Devil Inside William Brent Bell Fernanda
2012 (Film release dates are for Toronto, Ontario, Canada.) See IMDB.com for full list of Cast & Crew, Poster art, story synopsis, and viewer’s comments on any of the movie titles. Date Title Director Cast Jan. 6, 2012: The Devil Inside William Brent Bell Fernanda Andrade Jan. 13, 2012: Beauty and the Beast 3D (Animation) Gary Trousdale, Kirk Wise Paige O’Hara Contraband Baltasar Kormákur Mark Wahlberg A Dangerous Method (UK/Germany/Cdn) David Cronenberg Keira Knightley The Iron Lady (UK/France) Phyllida Lloyd Meryl Streep Joyful Noise Todd Graff Queen Latifah Pariah Dee Rees Adepero Oduye Red Light Revolution (China) Sam Voutas Zhao Jun Spellbound (Chilling Romance) (South Korea) In-Ho Hwang Ye-jin Son The Swell Season (Documentary) Nick August-Perna Glen Hansard Jan. 20, 2012: Coriolanus (UK) Ralph Fiennes Ralph Fiennes The Divide (Germany/US/Cdn) Xavier Gens Lauren German The Front Line (South Korea) Hun Jang Shin Ha-kyun Haywire Steven Soderbergh Gina Carano In the Land of Blood and Honey Angelina Jolie Zana Marjanovic Not Since You Jeff Stephenson Desmond Harrington Red Tails Anthony Hemingway Cuba Gooding Jr. A Separation (Iran) Asghar Farhadi Leila Hatami Underworld: Awakening Mans Marlind, Björn Stein Kate Beckinsale The Viral Factor (Hong Kong) Dante Lam Jay Chou Jan. 27, 2012: The Grey Joe Carnahan Liam Neeson Man on a Ledge Asger Leth Sam Worthington Monsieur Lazhar (FrCdn) Philippe Falardeau Mohamed Fellag One for the Money Julie Anne Rbinson Katherine Heigl Tyrannosaur (UK) Paddy Considine Peter Mullan Feb. 3, 2012: Albert Nobbs (UK/Ireland) Rodrigo García Glenn Close Big Miracle Ken Kwapis Drew Barrymore Chronicle (UK/US) Josh Trank Dane DeHaan The Innkeepers Ti West Sara Paxton Inside Lara Roxx (Documentary) Mia Donovan Lara Roxx Miss Bala (Mexico) Gerardo Naranjo Stephanie Sigman Moon Point (Cdn) Sean Cisterna Nick McKinlay Pink Ribbons, Inc. -

Tu Dors Nicole
and present TU DORS NICOLE a Stéphane Lafleur film with Julianne Côté Catherine St-Laurent Francis La Haye Simon Larouche Godefroy Reding and Marc-André Grondin Length: 93 min Original language: French Format: 35 mm, black & white CANADIAN DISTRIBUTION PUBLICITY Sébastien Létourneau Judith Dubeau Les Films Christal IXION Communications Tel : +1 514 336 9696 Tel : +1 514 495 8176 Fax : +1 514 336 0607 Cell : +1 514 983 6286 [email protected] [email protected] TU DORS NICOLE synopsis Making the most of the family home while her parents are away, Nicole (22) is enjoying a peaceful summer with her best friend Véronique. When Nicole’s older brother shows up with his band to record an album, the girls’ friendship is put to the test. Their vacation takes an unexpected turn, punctuated by a heatwave, Nicole’s growing insomnia and the persistent courtship of a 10-year-old boy. Tu dors Nicole takes a humorous look at the beginning of adulthood and all its possibilities. 1 TU DORS NICOLE | PRESS KIT (AUGUST 2014) TU DORS NICOLE cast Nicole Julianne CÔTÉ Véronique Catherine ST-LAURENT Rémi Marc-André GRONDIN JF Francis LA HAYE Pat Simon LAROUCHE Martin Godefroy REDING Martin’s voice Alexis LEFEBVRE crew Writer and Director Stéphane LAFLEUR Producers Luc DÉRY, Kim McCRAW Line producer Claude PAIEMENT Story consultant Valérie BEAUGRAND-CHAMPAGNE Casting director Lucie ROBITAILLE Director of photography Sara MISHARA Production designer André-Line BEAUPARLANT Costume designer Sophie LEFEBVRE First assistant director Danielle LAPOINTE Editor Sophie LEBLOND Sound Pierre BERTRAND, Sylvain BELLEMARE, Bernard GARIÉPY STROBL Original music Rémy NADEAU-AUBIN, ORGAN MOOD Postproduction supervisor Erik DANIEL Production micro_scope Distribution in Canada Les Films Christal International sales Séville International 2 TU DORS NICOLE | PRESS KIT (AUGUST 2014) TU DORS NICOLE director’s biography Stéphane Lafleur is a filmmaker, musician and film editor. -

Le Temps De L'euro
LeMonde Job: WMR0199--0001-0 WAS TMR0199-1 Op.: XX Rev.: 01-01-99 T.: 17:52 S.: 75,06-Cmp.:02,08, Base : LMQPAG 18Fap:100 No:0963 Lcp: 700 CMYK ENQUETE Le temps de l’euro 0123 Il arrive, il est arrivé... Depuis une semaine, c’est la mobilisation générale dans les télévisions et les radios pour accompagner l’entrée dans l’ère SIPA de la monnaie unique. Pages 2-3 MULTIMEDIA Internet en prison Aux Etats-Unis, en Autriche et en Allemagne, certains pénitenciers autorisent l’évasion virtuelle. Mais elle est sévèrement contrôlée. Pages 32-33 TELEVISION L’« affaire Ochoa » Retour sur l’épisode le plus obscur de la révolution castriste : l’exécution ARTE d’officiers supérieurs accusés Chandler, Rachel, Phoebe, Ross, Monica et Joey de trafic de drogue, en juillet 1989. CANAL JIMMY Une première. Page 5 (David Schwimmer-Jennifer Aniston) ? Voilà où tout réside. Dans le quiproquo permanent qui Le secret les oppose et les rapproche sans cesse, dans les actes manqués qui font que lorsque Ross est CINEMA prêt à passer le pas, c’est Rachel qui n’ose pas, de « Friends » et quand Rachel est prête, Ross s’est déjà jeté avec l’audace des timides dans les bras d’une Science-fiction Canal Jimmy, autre. « Fahrenheit 451 », de François Cette impossibilité authentiquement tragique dimanche 10 janvier, 20 h 55 à trouver le bonheur est le ressort caché et prin- Truffaut, d’après Ray Bradbury. cipal de « Friends ». C’est elle qui, sans en avoir La mort programmée du livre, l’air, donne son épaisseur à la comédie, bâtit sa ES scénarios comme celui-là, la télé différence. -

University of Florida Thesis Or Dissertation Formatting
ALGERIANS REMEMBER: AN ORAL HISTORY OF FRENCH COLONIAL ENCOUNTER By KHADIDJA ARFI A DISSERTATION PRESENTED TO THE GRADUATE SCHOOL OF THE UNIVERSITY OF FLORIDA IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY UNIVERSITY OF FLORIDA 2014 1 © 2014 Khadidja Arfi 2 To the Algerian people and those whose testimories have been neglected in writing their histories around the world and at all times 3 ACKNOWLEDGMENTS I thank my professors for their support throughout my studies at the University of Florida and many other institutions. I express my deepest thanks and gratitude to Dr. Peter Schmidt for his continuous mentoring, support, and advice. I express my gratitude to my committee members Dr. Faye Harrison, Dr. Abdoulaye Kane, Dr. Maria Stoilkova, and Dr. Paul Ortiz for their encouragement and very constructive critiques throughout this project. I am grateful to Algerians in the town and villages of Dellys, Algeria. They were most welcoming, loving, generous, and supportive in making this project a successful one. I especially remember in my prayers those among them who passed away and left this world before I was able to publish and transmit their testimonies. I thank many Dellysians who were so helpful in facilitating my stay and aiding me to access many places and institutions. I mostly present my great gratitude to my host family for their compassion and support and for providing me with delicious food and comfortable stay throughout my fieldwork. I am grateful to my parents, Mohamed Kheder and Souag Fatma, who never stopped showing their love and compassion until they passed away. -
Reminder List for Distinguished Achievements During 2012 Reminder List of Productions Eligible for Awards
REMINDER LIST FOR DISTINGUISHED ACHIEVEMENTS DURING 2012 REMINDER LIST OF PRODUCTIONS ELIGIBLE FOR AWARDS All films that have qualified for consideration for 2012 Academy Awards in the non-specialized categories are listed alphabetically by title. Voters making selections in their own branch categories list only film titles on their ballots, not the individuals responsible for the various achievements. For that reason, as well as for reasons of printing time and convenience of using this pamphlet, full credit rosters are not provided for the listed films. An exception to the above exists in the four Acting categories, where simply listing titles would not provide enough voting information. Actors Branch members filling out their Nominations ballots must indicate both titles and the particular performers they are voting for. For that reason, the Reminder List provides a listing of up to fifty cast members for each film. Pictures eligible in the Animated Feature Film, Documentary Feature and Foreign Language Film categories are also eligible in the Best Picture category, provided they meet the qualifications for the category. Foreign Language films are eligible for awards in other categories provided they meet the requirements of Awards Rules Two and Three. The reminder list is also available online at www.oscars.org/awards/academyawards/rules/reminderlist.html A Notes ABRAHAM LINCOLN: VAMPIRE HUNTER Benjamin Walker. Dominic Cooper. Anthony Mackie. Mary Elizabeth Winstead. Rufus Sewell. Marton Csokas. Jimmi Simpson. Joseph Mawle. Robin McLeavy. Erin Wasson. John Rothman. Cameron M. Brown. Frank Brennan. Lux Haney-Jardine. Curtis Harris. Bill Martin Williams. Alex Lombard. Raevin Stinson. Jaqueline Fleming. John Neisler. -
150 Canadian Films
150 CANADIAN FILMS MESSAGE FROM THE PRIME MINISTER OF CANADA Dear Friends: I am delighted to extend my warmest greetings to Canadians on National Canadian Film Day, a Canada 150 Signature Project, presented by REEL CANADA. This one-day event connects Canadians from sea to sea to celebrate the achievements of Canadian filmmakers. The film festival is one of many cultural projects during the Sesquicentennial year that will help build a sense of pride in and attachment to everything our remarkable country represents. National Canadian Film Day focuses on discovery, with opportunities to view culturally diverse Canadian films on television, online and in theatres large and small across the country. I would like to commend REEL CANADA for coordinating this exciting celebration of homegrown film excellence and I encourage everyone to get involved. With so many works to choose from, and an audience eager to explore the best of Canada’s rich film history, National Canadian Film Day is sure to be a resounding success. On behalf of the Government of Canada, I offer my best wishes for an enjoyable and memorable experience. Justin P.J. Trudeau Prime Minister of Canada The Rt. Hon. Justin P.J. Trudeau, P.C., M.P. Prime Minister of Canada MESSAGE FROM THE MINISTER OF CANADIAN HERITAGE As we kick off the 150th anniversary of Confederation, we want to support projects that inspire national pride and strengthen the bonds between citizens from coast to coast to coast. This is why we are pleased to support REEL CANADA and its National Canadian Film Day 150. -

About the Transmission of Maghrebi Arabic En France
Dominique CAUBET, Professeur des Universités Arabe maghrébin – INALCO, [email protected] Directrice du CRÉAM (Centre de Recherches et d’études sur l’arabe maghrébin) http://www.univ-tours.fr/rfs/cream.htm ABOUT THE TRANSMISSION OF MAGHREBI ARABIC IN FRANCE 1. NORTH-AFRICAN/MAGHREBI ARABIC: A DEFINITION What I am referring to are the languages spoken in the North of Africa, next to Berber, as a mother-tongue or a second language (for berberophones). Among the Arabic ‘cluster’ (David Cohen calls it ‘l’élément arabe’), it is not neutral to decide what is a language and what is a dialect; it shows indeed, a political and ideological position. Linguists will say that Classical Arabic, Moroccan Arabic and Algerian Arabic form separate linguistic entities/systems that function differently, especially on the level of syntax or such categories as aspect or nominal determination, as well as that of lexicon. Since the independences, a national koine is in the making (especially for Morocco or Tunisia), which leaves space to dialectal variation inside the country. These languages are learnt naturally inside the family or with friends, whereas Classical Arabic, or its modernised version, Modern Standard Arabic (MSA) can only be aquired at school or in the mosks. There is no inter-comprehension between Algerian Arabic and MSA or Yemeni Arabic and Moroccan Arabic. As far as France is concerned, Maghrebi Arabic (MA) refers to the languages spoken in France by people whose family originates in the Maghreb. One may also wonder whether a new variety of Arabic is not in the making with this new situation of linguistic contacts between people coming from different countries or regions of the Maghreb. -

Contemporary Algerian Filmmaking: from "Cinã©Ma National" to "Cinã
Florida State University Libraries Electronic Theses, Treatises and Dissertations The Graduate School 2007 Contemporary Algerian Filmmaking: from "Cinéma National" to "Cinéma De L'Urgence" (Mohamed Chouikh, Merzak Allouache, Yamina Bachir-Chouikh, Nadir Moknèche) Cheira Belguellaoui Follow this and additional works at the FSU Digital Library. For more information, please contact [email protected] THE FLORIDA STATE UNIVERSITY COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES CONTEMPORARY ALGERIAN FILMMAKING: FROM “CINÉMA NATIONAL” TO “CINÉMA DE L’URGENCE” (MOHAMED CHOUIKH, MERZAK ALLOUACHE, YAMINA BACHIR-CHOUIKH, NADIR MOKNÈCHE) By CHEIRA BELGUELLAOUI A Dissertation submitted to the Department of Modern Languages and Linguistics in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Degree Awarded: Fall semester, 2007 Copyright © 2007 Cheira Belguellaoui All Rights Reserved The members of the Committee approve the Dissertation of Cheira Belguellaoui defended on July 27, 2007. Alec G. Hargreaves Professor Directing Dissertation Mark G. Cooper Outside Committee Member William J. Cloonan Committee Member Reinier Leushuis Committee Member The Office of Graduate Studies has verified and approved the above named committee members. ii To the memory of my grandmother. iii ACKNOWLEDGEMENTS I would like to thank Dr. Alec G. Hargreaves for his ongoing support, limitless patience, valuable feedback and meticulous insights. I am likewise grateful to Dr. William J. Cloonan whose friendship and mentoring enabled me to push and look forward, and Dr. Mark Cooper whose invaluable expertise has made this research particularly rich. Finally, Dr. Reinier Leushuis whose motivation, practical advice and availability never failed. Most importantly, I am indebted to the Winthrop-King Institute whose scholarships and travel grants made the pursuit of this study possible. -
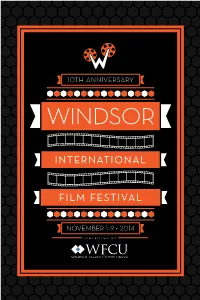
WIFF-2014-Program.Pdf
The Windsor International Film Festival (WIFF) is a cultural, not-for-profit organization whose mission is to recognize and celebrate the art of cinema by showcasing Canadian and international films and filmmakers. Through its exhibition, education, and community development programs, WIFF builds audiences for Canadian content and talent, provides training opportunities for emerging filmmakers, and promotes the creative economy of Windsor and Southwestern Ontario. WINDSOR INTERNATIONAL FILM FESTIVAL Denise Deziel | Debra Henderson (Vice Chair) | Mori McIntosh (Secretary) | Kim Nelson | Pat Papadeas | Sung Min Bae | Lynne Watts (Chair) | Martha Winterbottom (Treasurer) Honorary Members: Mark Boscariol, Peter Coady, Michael Reboulis, Lou Tortola WINDSOR INTERNATIONAL FILM FESTIVAL Executive Director: Vincent Georgie Managing Director: Nick Cacciato Technical Director: Sung Min Bae Administrative Manager: Michael Ruffolo Box Office Coordinators: Jen Holson and Rowena Cacciato Volunteer Coordinator: Rowena Cacciato Program Manager, 48-Hour FlickFest and 100 Mile Shorts: Svjetlana Oppen Print Traffic Coordinator: Alan Bull Graphic Design & Layout: Dave Houle WINDSOR INTERNATIONAL FILM FESTIVAL P.O. Box 591 | Station A | Windsor, ON | N9A 6M6 windsorfilmfestival.com Photo: Nick Brancaccio/Windsor Star Brancaccio/Windsor Nick Photo: Happy Birthday WIFF! 10 Years Already From humble beginnings in the fall of 2005 to what is now an established cultural force on the Canadian film scene, WIFF has a lot to celebrate in its 10th Anniversary. Every November, our passionate, loyal and enthusiastic audience turns to us to show them the very best that the world film landscape has to offer them. WIFF is a time to take risks, to explore new genres, to find out what both the world’s most established and up-and-coming filmmakers have on their minds.