Debordements 1.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Delegates Guide
Delegates Guide 9–14 March, 2018 Cultural Partners Supported by Friends of Qumra Media Partner QUMRA DELEGATES GUIDE Qumra Programming Team 5 Qumra Masters 7 Master Class Moderators 14 Qumra Project Delegates 17 Industry Delegates 57 QUMRA PROGRAMMING TEAM Fatma Al Remaihi CEO, Doha Film Institute Director, Qumra Jaser Alagha Aya Al-Blouchi Quay Chu Anthea Devotta Qumra Industry Qumra Master Classes Development Qumra Industry Senior Coordinator Senior Coordinator Executive Coordinator Youth Programmes Senior Film Workshops & Labs Coordinator Senior Coordinator Elia Suleiman Artistic Advisor, Doha Film Institute Mayar Hamdan Yassmine Hammoudi Karem Kamel Maryam Essa Al Khulaifi Qumra Shorts Coordinator Qumra Production Qumra Talks Senior Qumra Pass Senior Development Assistant Coordinator Coordinator Coordinator Film Programming Senior QFF Programme Manager Hanaa Issa Coordinator Animation Producer Director of Strategy and Development Deputy Director, Qumra Meriem Mesraoua Vanessa Paradis Nina Rodriguez Alanoud Al Saiari Grants Senior Coordinator Grants Coordinator Qumra Industry Senior Qumra Pass Coordinator Coordinator Film Workshops & Labs Coordinator Wesam Said Eliza Subotowicz Rawda Al-Thani Jana Wehbe Grants Assistant Grants Senior Coordinator Film Programming Qumra Industry Senior Assistant Coordinator Khalil Benkirane Ali Khechen Jovan Marjanović Chadi Zeneddine Head of Grants Qumra Industry Industry Advisor Film Programmer Ania Wojtowicz Manager Qumra Shorts Coordinator Film Training Senior Film Workshops & Labs Senior Coordinator -
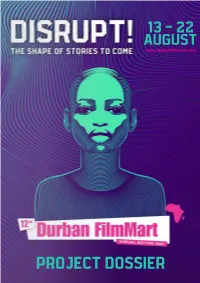
View the 2021 Project Dossier
www.durbanfilmmart.com Project Dossier Contents Message from the Chair 3 Combat de Nègre et de Chiens (Black Battle with Dogs) 50 introduction and Come Sunrise, We Shall Rule 52 welcome 4 Conversations with my Mother 54 Drummies 56 Partners and Sponsors 6 Forget Me Not 58 MENTORS 8 Frontier Mistress 60 Hamlet from the Slums 62 DFM Mentors 8 Professional Mourners 64 Talents Durban Mentors 10 Requiem of Ravel’s Boléro 66 Jumpstart Mentors 13 Sakan Lelmoghtrebat (A House For Expats) 68 OFFICAL DFM PROJECTS The Day and Night of Brahma 70 Documentaries 14 The Killing of A Beast 72 Defying Ashes 15 The Mailman, The Mantis, and The Moon 74 Doxandem, les chasseurs de rêves Pretty Hustle 76 (Dream Chasers) 17 Dusty & Stones 19 DFM Access 78 Eat Bitter 21 DFM Access Mentors 79 Ethel 23 PARTNER PROJECTS IN My Plastic Hair 25 FINANCE FORUM 80 Nzonzing 27 Hot Docs-Blue Ice Docs Part of the Pack 29 Fund Fellows 81 The Possessed Painter: In the Footsteps The Mother of All Lies 82 of Abbès Saladi 31 The Wall of Death 84 The Woman Who Poked The Leopard 33 What’s Eating My Mind 86 Time of Pandemics 35 Unfinished Journey 37 Talents Durban 88 Untitled: Miss Africa South 39 Feature Fiction: Bosryer (Bushrider) 89 Wataalat Loughatou él Kalami (Such a Silent Cry) 41 Rosa Baila! (Dance Rosa) 90 Windward 43 Kinafo 91 L’Aurore Boréale (The Northern Lights) 92 Fiction 45 The Path of Ruganzu Part 2 93 2065 46 Yvette 94 Akashinga 48 DURBAN FILMMART 1 PROJECT DOSSIER 2021 CONTENTS Short Fiction: Bedrock 129 Crisis 95 God’s Work 131 Mob Passion 96 Soweto on Fire 133 -

Index to Volume 26 January to December 2016 Compiled by Patricia Coward
THE INTERNATIONAL FILM MAGAZINE Index to Volume 26 January to December 2016 Compiled by Patricia Coward How to use this Index The first number after a title refers to the issue month, and the second and subsequent numbers are the page references. Eg: 8:9, 32 (August, page 9 and page 32). THIS IS A SUPPLEMENT TO SIGHT & SOUND Index 2016_4.indd 1 14/12/2016 17:41 SUBJECT INDEX SUBJECT INDEX After the Storm (2016) 7:25 (magazine) 9:102 7:43; 10:47; 11:41 Orlando 6:112 effect on technological Film review titles are also Agace, Mel 1:15 American Film Institute (AFI) 3:53 Apologies 2:54 Ran 4:7; 6:94-5; 9:111 changes 8:38-43 included and are indicated by age and cinema American Friend, The 8:12 Appropriate Behaviour 1:55 Jacques Rivette 3:38, 39; 4:5, failure to cater for and represent (r) after the reference; growth in older viewers and American Gangster 11:31, 32 Aquarius (2016) 6:7; 7:18, Céline and Julie Go Boating diversity of in 2015 1:55 (b) after reference indicates their preferences 1:16 American Gigolo 4:104 20, 23; 10:13 1:103; 4:8, 56, 57; 5:52, missing older viewers, growth of and A a book review Agostini, Philippe 11:49 American Graffiti 7:53; 11:39 Arabian Nights triptych (2015) films of 1970s 3:94-5, Paris their preferences 1:16 Aguilar, Claire 2:16; 7:7 American Honey 6:7; 7:5, 18; 1:46, 49, 53, 54, 57; 3:5: nous appartient 4:56-7 viewing films in isolation, A Aguirre, Wrath of God 3:9 10:13, 23; 11:66(r) 5:70(r), 71(r); 6:58(r) Eric Rohmer 3:38, 39, 40, pleasure of 4:12; 6:111 Aaaaaaaah! 1:49, 53, 111 Agutter, Jenny 3:7 background -

CHIFFRES ET NOMBRES GDES PTES LGS 11 Réalisateurs
CHIFFRES ET NOMBRES GDES PTES LGS 11 réalisateurs September 11 u 2 3 ABADI Sou Cherchez la femme 2 2 ABBASS Hiam Héritage (Inheritance) 2 3 ABEL Dominique Rumba 2 ABEL Dominique Fée (La) 1 ABOUET Marguerite Aya de Yopougon 1 2 ABRAHAMSON Lenny Garage 1 ABRAHAMSON Lenny Room 3 3 ABRAMS Jeffrey-Jacob Star Trek: into darkness 3D 3 2 ABRAMS Jeffrey-Jacob Super 8 3 ABU-ASSAD Hany Montagne entre nous (La) (The 3 Mountain Between Us) A DONNER ABU-ASSAD Hany Omar 2 2 ABU-ASSAD Hany Paradise now 2 2 ACEVEDO César Terre et l'ombre (La) (La Tierra y la 2 Sombra) ACHACHE Mona Hérisson (Le) 3 1 ACKERMAN Chantal Nuit et jour 3 2 ADABACHYAN Aleksandr Mado, poste restante 1 3 ADE Maren Toni Erdmann 3 2 ADLON Percy Zuckerbaby 1 3 AFFLECK Ben Argo 2 3 AFFLECK Ben Town (The) 3 3 AGHION Gabriel Absolument fabuleux 2 moy AGHION Gabriel Pédale dure 1 2 AGOU Christophe Sans adieu 1 1 AGOU Christophe Sans adieu 1 1 AGÜERO Pablo Eva ne dort pas (Eva no duerme) 2 AIELLO Shu Paese de Calabria (Un) 2 AJA Alexandre Mirrors 2 AJA Alexandre Piranha – 3D 3 3 AKERMAN Chantal Captive 3 3 AKERMAN Chantal Divan à New York (Un) 2 2 AKHAVAN Desiree Come as you are (The Miseducation of 2 2 Cameron Post) AKIN Fatih In the fade 2 1 AKIN Fatih Soul kitchen (Soul kitchen) 1 AKIN Fatih Cut (The) (La Blessure) 2 AKIN Fatih New York, I love you 2 2 AKIN Fatih Polluting paradise 1 3 AKOLKAR Dheeraj Liv et Ingmar (Liv & Ingmar) 2 2 ALBERDI Maite Ecole de la vie (L') (The Grown-Ups) 1 ALBERTINI Dario Figlio Manuel (Il) 1 1 ALCALA José Coup d'éclat 2 1 ALDRICH Robert En quatrième vitesse -

Reparto Extraordinario Salas De Cine 2012-2018
1 de 209 Listado de obras audiovisuales Reparto Extraordinario Com. Púb. Salas de Cine 2012 - 2018 Dossier informativo Departamento de Reparto El listado incluye las obras y prestaciones cuyos titulares no hayan sido identificados o localizados al efectuar el reparto, por lo que AISGE recomienda su consulta para proceder a la identificación de tales titulares. 2 de 209 Tipo Código Titulo Tipo Año Protegida Lengua Obra Obra Obra Producción Producción Globalmente Explotación Actoral 725826 ¡¡¡CAVERRRRNÍCOLA!!! Cine 2004 Castellano Actoral 1051717 ¡A GANAR! Cine 2018 Castellano Actoral 3609 ¡ATAME! Cine 1989 Castellano Actoral 991437 ¡AVE, CESAR! Cine 2016 Castellano Actoral 19738 ¡AY, CARMELA! Cine 1989 Castellano Actoral 6133 ¡FELIZ NAVIDAD, MISTER LAWRENCE! Cine 1982 Castellano Actoral 964045 ¡QUE EXTRAÑO LLAMARSE FEDERICO! Cine 2013 Castellano Actoral 1051718 ¡QUÉ GUAPA SOY! Cine 2018 Castellano Actoral 883562 ¿PARA QUE SIRVE UN OSO? Cine 2011 Castellano Actoral 945650 ¿QUE HACEMOS CON MAISIE? Cine 2012 Castellano Actoral 175 ¿QUE HE HECHO YO PARA MERECER ESTO? Cine 1984 Castellano Actoral 954473 ¿QUE NOS QUEDA? Cine 2012 Castellano Actoral 12681 ¿QUE OCURRIO ENTRE MI PADRE Y TU MADRE? Cine 1972 Castellano Actoral 1051727 ¿QUIÉN ESTÁ MATANDO A LOS MOÑECOS? Cine 2018 Castellano Actoral 925329 ¿QUIEN MATO A bAMbI? Cine 2013 Castellano Actoral 801520 ¿QUIEN QUIERE SER MILLONARIO? Cine 2008 Castellano Actoral 12772 ¿QUIEN TEME A VIRGINIA WOOLF? Cine 1966 Castellano Actoral 1020330 ¿TENIA QUE SER EL? Cine 2017 Castellano Actoral 884410 ¿Y -

CHIFFRES ET NOMBRES GDES PTES LGS 01:45 1 ENGLAND Yan
CHIFFRES ET NOMBRES GDES PTES LGS 01:45 1 ENGLAND Yan 10.000 3 3 EMMERICH Roland 100% cachemire 3 3 LEMERCIER Valérie 101 nuits 1 2 VARDA Agnès 10 canoës, 150 lances et 3 épouses 2 DE-HEER Rolf 10 Cloverfield lane 2 1 TRACHTENBERG Dan 10e chambre - Instants d'audiences 1 DEPARDON Raymond 11.6 (The French Job) 2 GODEAU Philippe 11 commandements (Les) 2 DE-MADRID Les-Reals 12 ans d'âge 2 2 PROUST Frédéric 12 jours 3 2 DEPARDON Raymond 12 years a slave (homme) 3 McQUEEN(II) Steve 12 years a slave (paysage) 2 2 McQUEEN(II) Steve 13 hours 1 2 BAY Michael 15 ans et demi 2 2 DESAGNAT François 15H17 pour Paris 1 1 EASTWOOD Clint 15 minutes 3 HERZFELD John 16 ans ou presque 1 2 SÉGUÉLA Tristan 17, rue bleue 3 2 CHENOUGA Chad 17 fois Cécile Cassard 3 2 HONORÉ Christophe 18 ans après 3 SERREAU Coline 19 (Nineteen) 1 WATANABE Kazushi 2046 1 WONG Kar-Wai 20 ans d'écart 1 MOREAU David 21 grammes (21 Grams) 1 IÑÁRRITU Alejandro- Gonzales 21 Nuits avec Pattie 2 3 LARRIEU Frères 22 janvier tout doit disparaître (Le) 2 MUYL Philippe 24 city (Er shi si cheng ji) 1 2 JIA Zhang-Ke 24 hour party people 2 WINTERBOTTOM Michael 24 mesures 2 1 LESPERT Jalil 27 robes (27 Dresses) 1 FLETCHER Anne 28 semaines plus tard (28 Weeks Later) 1 1 FRESNADILLO Juan-Carlos 2 automnes 3 hivers 2 2 BETBEDER Sébastien 2 days in New York 2 3 DELPY Julie 2 days in Paris 1 DELPY Julie 2e sous-sol 3 4 KHALFOUN Franck 2 filles d'aujourd'hui (Career Girls) 3 1moy LEIGH Mike 3, chronique d'une famille singulière 1 2 STOLL-WARD Pablo 300 : La naissance d'un empire (300: 3 1 MURRO Noam -

Apichatpong Weerasethakul Bankonk, Thailand, 1970 Lives and Works in Chai Mai, Thailand
kurimanzutto apichatpong weerasethakul Bankonk, Thailand, 1970 lives and works in Chai Mai, Thailand education & residencies 2016 Member of the Academy of Motion Picture Arts and Sciences, United States. Jury member for the Sundance Film Festival, United States. 2001 Artist Residency at Sapporo Artist In Residence Program (S-AIR), Japan. 1997 MFA in Film-making at The School of the Art Institute of Chicago. 1994 BA in Architecture at Khon Kaen University, Thailand. grants & awards 2018 International Federation of Film Archives (FIAF) Award, Thailand. 2017 Commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres awarded by the Minister of Culture, France. 2016 The Prince Claus Awards awarded by The Prince Claus Fund, The Netherlands. Grand Prize awarded by the Bildrausch Film Festival, Basel, Switzerland. (Cemetery of Splendour) Asia Pacific Screen Award awarded by Brisbane City Council, Australia. (Cemetery of Splendour) 2015 Gijon Film Festival Award awarded by City Council of Gijón, Spain. 2014 The Yanghyun Art Prize. Korea. 2013 Fukuoka Prize (Art and Culture) awarded by The Fukuoka City International Foundation, Japan. The Sharjah Biennial Prize awarded by the 11th Sharjah Biennial, United Arab Emirates. The Silver Mirror Honorary Award awarded by the Films From the South kurimanzutto Festival, Norway. 2011 Commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres awarded by the Minister of Culture, France. 2010 Palme d’Or awarded by the Cannes Film Festival, France. (Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives) Asia Art Award Forum awarded by the Asia Art Award Forum Committee, CJ Culture Foundation, Alternative Space LOOP, Korea Sports Promotion Foundation, Korea. Hugo Boss Award Nominee awarded by the Solomon R. -

Obras Reparto Extraordinario Salas De Cine 2008-2017
Página 1 de 263 Listado de obras audiovisuales Reparto Extraordinario Salas de Cine 2008 -2017 Dossier informativo Departamento de Reparto El listado incluye las obras y prestaciones cuyos titulares no hayan sido identificados o localizados al efectuar el reparto, por lo que AISGE recomienda su consulta para proceder a la identificación de tales titulares. Página 2 de 263 Tipo Código Titulo Tipo Año Protegida Lengua Obra Obra Obra Producción Producción Globalmente Explotación Actoral 991437 ¡AVE, CESAR! Cine 2016 Castellano Actoral 19738 ¡AY, CARMELA! Cine 1989 Castellano Actoral 6133 ¡FELIZ NAVIDAD, MISTER LAWRENCE! Cine 1982 Castellano Actoral 964045 ¡QUE EXTRAÑO LLAMARSE FEDERICO! Cine 2013 Castellano Actoral 847625 ¿ESTAS AHI? Cine 2010 Castellano Actoral 726410 ¿INFIDELIDAD? Cine 2007 Castellano Actoral 885904 ¿NO QUERIAIS SABER POR QUE LAS MATAN? POR NADA Cine 2009 Castellano Actoral 883562 ¿PARA QUE SIRVE UN OSO? Cine 2011 Castellano Actoral 725425 ¿POR QUE SE FROTAN LAS PATITAS? Cine 2006 Castellano Actoral 945650 ¿QUE HACEMOS CON MAISIE? Cine 2012 Castellano Actoral 175 ¿QUE HE HECHO YO PARA MERECER ESTO? Cine 1984 Castellano Actoral 954473 ¿QUE NOS QUEDA? Cine 2012 Castellano Actoral 12681 ¿QUE OCURRIO ENTRE MI PADRE Y TU MADRE? Cine 1972 Castellano Actoral 726688 ¿QUIEN DICE QUE ES FACIL? Cine 2007 Castellano Actoral 925329 ¿QUIEN MATO A BAMBI? Cine 2013 Castellano Actoral 752562 ¿QUIEN MATO A LA LLAMITA BLANCA? Cine 2007 Castellano Actoral 801520 ¿QUIEN QUIERE SER MILLONARIO? Cine 2008 Castellano Actoral 12772 ¿QUIEN TEME -

How to Cite Complete Issue More Information About This Article
Antipoda. Revista de Antropología y Arqueología ISSN: 1900-5407 Departamento de Antropología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de los Andes Marrero-Guillamón, Isaac The Politics and Aesthetics of Non-Representation: Re- Imagining Ethnographic Cinema with Apichatpong Weerasethakul Antipoda. Revista de Antropología y Arqueología, no. 33, 2018, October-December, pp. 13-32 Departamento de Antropología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de los Andes DOI: https://doi.org/10.7440/antipoda33.2018.02 Available in: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81457433002 How to cite Complete issue Scientific Information System Redalyc More information about this article Network of Scientific Journals from Latin America and the Caribbean, Spain and Journal's webpage in redalyc.org Portugal Project academic non-profit, developed under the open access initiative The Politics and Aesthetics of Non-Representation: Re-Imagining Ethnographic Cinema with Apichatpong Weerasethakul Isaac Marrero-Guillamón* Goldsmiths, University of London, Reino Unido https://doi.org/10.7440/antipoda33.2018.02 How to cite this article: Marrero-Guillamón, Isaac. 2018. “The Politics and Aesthetics of Non-Rep- resentation: Re-Imagining Ethnographic Cinema with Apichatpong Weerasethakul”. Antípoda. Revista de Antropología y Arqueología 33: 13-32. https://doi.org/10.7440/antipoda33.2018.02 Reception date: November 14, 2017; Acceptance date: July 30, 2018; Modification date: August 23, 2018. Abstract: This article argues that the work of Thai filmmaker Apichatpong Weerasethakul offers conceptual and methodological tools that may contribute to the re-imagination of ethnographic cinema beyond represen- 13 tation. Weerasethakul’s films emerge out of a para-ethnographic engagement with people and places, rely on participatory methods and operate as hosting devices for a multiplicity of subaltern beings and stories. -

Four Asian Filmmakers Visualize the Transnational Imaginary Stephen Edward Spence University of New Mexico
University of New Mexico UNM Digital Repository American Studies ETDs Electronic Theses and Dissertations Spring 4-17-2017 "Revealing Reality": Four Asian Filmmakers Visualize the Transnational Imaginary Stephen Edward Spence University of New Mexico Follow this and additional works at: https://digitalrepository.unm.edu/amst_etds Part of the American Studies Commons, Film and Media Studies Commons, Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Studies Commons, and the Race, Ethnicity and Post-Colonial Studies Commons Recommended Citation Spence, Stephen Edward. ""Revealing Reality": Four Asian Filmmakers Visualize the Transnational Imaginary." (2017). https://digitalrepository.unm.edu/amst_etds/54 This Dissertation is brought to you for free and open access by the Electronic Theses and Dissertations at UNM Digital Repository. It has been accepted for inclusion in American Studies ETDs by an authorized administrator of UNM Digital Repository. For more information, please contact [email protected]. i Stephen Edward Spence Candidate American Studies Department This dissertation is approved, and it is acceptable in quality and form for publication: Approved by the Dissertation Committee: Rebecca Schreiber, Chairperson Alyosha Goldstein Susan Dever Luisela Alvaray ii "REVEALING REALITY": FOUR ASIAN FILMMAKERS VISUALIZE THE TRANSNATIONAL IMAGINARY by STEPHEN EDWARD SPENCE B.A., English, University of New Mexico, 1995 M.A., Comparative Literature & Cultural Studies, University of New Mexico, 2002 DISSERTATION Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy American Studies The University of New Mexico Albuquerque, New Mexico May, 2017 iii ACKNOWLEDGEMENTS This project has been long in the making, and therefore requires substantial acknowledgments of gratitude and recognition. First, I would like to thank my fellow students in the American Studies Graduate cohort of 2003 (and several years following) who always offered support and friendship in the earliest years of this project. -

Sight & Sound Annual Index 2017
THE INTERNATIONAL FILM MAGAZINE Index to Volume 27 January to December 2017 Compiled by Patricia Coward How to use this Index The first number after a title refers to the issue month, and the second and subsequent numbers are the page references. Eg: 8:9, 32 (August, page 9 and page 32). THIS IS A SUPPLEMENT TO SIGHT & SOUND SUBJECT INDEX SUBJECT INDEX After the Storm (2016) 6:52(r) Amour (2012) 5:17; 6:17 Armano Iannucci Shows, The 11:42 Ask the Dust 2:5 Bakewell, Sarah 9:32 Film review titles are also interview with Koreeda Amours de minuit, Les 9:14 Armisen, Fred 8:38 Asmara, Abigail 11:22 Balaban, Bob 5:54 included and are indicated by Hirokazu 7:8-9 Ampolsk, Alan G. 6:40 Armstrong, Jesse 11:41 Asquith, Anthony 2:9; 5:41, Balasz, Béla 8:40 (r) after the reference; age and cinema Amy 11:38 Army 2:24 46; 10:10, 18, 44 Balch, Antony 2:10 (b) after reference indicates Hotel Salvation 9:8-9, 66(r) An Seohyun 7:32 Army of Shadows, The Assange, Julian Balcon, Michael 2:10; 5:42 a book review Age of Innocence, The (1993) 2:18 Anchors Aweigh 1:25 key sequence showing Risk 8:50-1, 56(r) Balfour, Betty use of abstraction 2:34 Anderson, Adisa 6:42 Melville’s iconicism 9:32, 38 Assassin, The (1961) 3:58 survey of her career A Age of Shadows, The 4:72(r) Anderson, Gillian 3:15 Arnold, Andrea 1:42; 6:8; Assassin, The (2015) 1:44 and films 11:21 Abacus Small Enough to Jail 8:60(r) Agony of Love (1966) 11:19 Anderson, Joseph 11:46 7:51; 9:9; 11:11 Assassination (1964) 2:18 Balin, Mireille 4:52 Abandon Normal Devices Agosto (2014) 5:59 Anderson, Judith 3:35 Arnold, David 1:8 Assassination of the Duke Ball, Wes 3:19 Festival 2017, Castleton 9:7 Ahlberg, Marc 11:19 Anderson, Paul Thomas Aronofsky, Darren 4:57 of Guise, The 7:95 Ballad of Narayama, The Abdi, Barkhad 12:24 Ahmed, Riz 1:53 1:11; 2:30; 4:15 mother! 11:5, 14, 76(r) Assassination of Trotsky, The 1:39 (1958) 11:47 Abel, Tom 12:9 Ahwesh, Peggy 12:19 Anderson, Paul W.S. -

Éclats Et Absences. Fictions Ethnographiques
THÈSE DE DOCTORAT de l’Université de recherche Paris Sciences et Lettres PSL Research University Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris Ecole Normale Supérieure rue d’Ulm . Ecole doctorale n°540 Ecole doctorale transdisciplinaire Lettres/Sciences Spécialité Programme SACRe COMPOSITION DU JURY : M. WAT Pierre Paris 1, Président du jury Soutenue par Laura HUERTAS M. AUMONT Jacques MILLAN Paris 3, Rapporteur le 27/04/2017 M. BONFAND Alain ENSBA, Membre du jury Dirigée par Alain BONFAND M. RENE MARTIN François-René ENSBA, Membre du jury M. BURKI Marie-José ENSBA, Membre du jury M. BETTINELLI Philippe CNAP, Membre du jury Logo établissement ! Éclat et absences Fictions ethnographiques Projet de recherche artistique de : Laura Huertas Millán Sous la direction de : Alain Bonfand François-René Martin Marie-José Burki Programme de recherche ARP / SACRe Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris Ecole Normale Supérieure rue d’Ulm Université Paris Sciences et Lettres Octobre 2016 1 2 Nous vivons sur cette terre, à nous prêtée En ces lieux, nous les hommes… Mais là-bas, où-sont-les-Décharnés, Là-bas, dans leur demeure, Qui pour toujours est séparée d’ici… ? Nezahualcoyotl, XVe siècle. 3 4 Au début des années 1990, le maire de Bogota décida de mettre en place une politique de rationnement de l’électricité. El Niño asséchait nos sources d’eau et les barrages baissaient de niveau. Le rationnement fut progressif, d’abord un jour sur deux, bientôt au quotidien, de 18h à 21h. Pas de saisons sur notre ligne équatoriale, le soleil disparaissait implacablement à l’heure même de l’extinction des feux.