Mises En Scènes Francophones Du Sida
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Thèse Finale TIENDREBEOGO P. Issiaka
UNIVERSITE OUAGA I Pr JOSEPH KI-ZERBO UNIVERSITESORBONNE NOUVELLE PARIS 3 ECOLE DOCTORALE LETTRES, ECOLE DOCTORALE ARTS ET MEDIAS SCIENCES HUMAINES ET COMMUNICATIONS INSTITUT DE RECHERCHE EN ETUDES THEATRALES CENTRE DE RECHERCHES ET D’ETUDES EN LANGUES LABORATOIRE SCENES FRANCOPHONES ET ECRITURES LITTERATURES ET ARTS DU SAHEL (CRELLAS)DE L’ALTERITE (SEFEA) LABORATOIRE LITTERATURES, ESPACES ET SOCIETES (LLES) THESE DE DOCTORAT UNIQUE EN COTUTELLE L’IMPACT DU THEATRE D’INTERVENTION SOCIALE SUR LE DEVELOPPEMENT DU BURKINA FASO Spécialité : Etudes Théâtrales Présentée et soutenue publiquement par Pingdewindé Issiaka TIENDREBEOGO Le 18 janvier 2018 à l’Université Ouaga I Pr Joseph Ki-Zerbo Directrice de thèse : Sylvie CHALAYE Co-directeur de thèse : Issou GO Jury : M. Amos FERGOMBE, Président, Professeur des Universités, Université Artois, Lille Mme Sylvie CHALAYE, Professeur des Universités, Université Sorbonne Nouvelle, Paris 3 M. Issou GO, Professeur Titulaire, Université Ouaga I Pr Joseph Ki-Zerbo M. Sié Alain KAM, Professeur Titulaire, Université Ouaga I Pr Joseph Ki-Zerbo M.Dominique TRAORE, Maître de Conférences, Université Félix Houphouët-Boigny DEDICACE A mes très chers parents qui déjà, dorment ! A ma chère épouse ! A mes chers enfants : Touwindsida Teddy Elvis Delwendé Myriam Grâce Wendbenedo Nobel Chris i REMERCIEMENTS Je tiens à exprimer toute ma reconnaissance à mes deux directeurs de thèse : au Professeur GO Issou, avec qui nous cheminons depuis un bon moment. Sa patience, son sens élevé de l’écoute, sa rigueur ont permis à ce travail de voir le jour. Je remercie le Professeur CHALAYE Sylvie d’avoir accepté de me diriger. Son professionnalisme, sa disponibilité et sa compétence ont permis au travail de prospérer. -

Jean-Charles Book4cd.Pdf (7.203Mb)
TRANSOCEANIC STUDIES Ileana Rodríguez, Series Editor For my poto mitan— my maternal grandmother Ursula Hérard Scharoun, my mother Denise Acacia Jean-Charles and in loving memory of my paternal grandmother Anna Joseph Jean- Charles (1918–2007) Conflict Bodies The Politics of Rape Representation in the Francophone Imaginary RÉGINE MICHELLE JEAN-CHARLES THE OHIO STATE UNIVERSITY PRESS COLUMBUS Copyright © 2014 by The Ohio State University. All rights reserved. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Jean-Charles, Régine Michelle. Conflict bodies : the politics of rape representation in the francophone imaginary / Régine Michelle Jean-Charles. p. cm. — (Transoceanic studies) Includes bibliographical references and index. ISBN 978-0-8142-1246-2 (cloth : alk. paper) — ISBN 0-8142-1246-8 (cloth : alk. paper) — ISBN 978-0-8142-9349-2 (cd-rom) — ISBN 0-8142-9349-2 (cd-rom) 1. French literature—Foreign countries—History and criticism. 2. Rape in literature. 3. Vio- lence in literature. 4. Politics and literature. 5. Haitian literature—History and criticism. 6. Guadeloupe literature (French)—History and criticism. 7. Rwandan literature (French)— History and criticism. 8. Congolese (Democratic Republic) literature (French)—History and criticism. I. Title. II. Series: Transoceanic studies. PQ3809.J43 2014 843'.9099729—dc23 2013025855 Cover design by Janna Thompson-Chordas Type set in Adobe Palatino Printed by Thomson-Shore, Inc. The paper used in this publication meets the minimum requirements of the American National Standard for Information -

Update for Oxford Website Project Page Echoes October2009
Research Project: Ending Mass Atrocities: Echoes in Southern Cultures Summary and Update November 2009 Contributing Authors By September 2009, all contributing authors to the project and final publication were identified and commissioned to write their chapters. This followed an intensive period of research, communication with scholars around the world, and interdisciplinary consultations in the four case study countries, to identify suitable authors from all parts of the world with the necessary qualifications and motivation. A major aim of this project is to draw upon the wisdom and knowledge of southern scholars whose work is often highly respected and well known within their home countries or regions but is often not known or ignored in the literature in international relations and politics, and in policy circles around the United Nations. All the commissioned authors originate from countries that experienced violent conflict or mass atrocities, and have first hand experience in living through and addressing these issues. Almost all of them have chosen to work in their countries of origin. The authors represent a wide geographic spread and a mix of Anglophone, Francophone, Hispanophone and Arabophone, and they draw on a broad range of literary and scholarly traditions. As with the editors, a solid gender balance also exists. The final list of contributing authors is as follows: Ending Mass Atrocities: Echoes in the South Chapter Authors Affiliation Country of Origin/Work PART ONE: THEMES 1.Religion and Prof Mutombo Professor of World Religion; State Democratic Spiritual Nkulu- N’sengha Univ of California, Northridge Republic of Traditions Congo/USA 2. Philosophy Prof Yolanda Angulo Professor of Philosophy, UNAM, Mexico and Ethics Parra and Director-General , Centro de Estudios Genealógicos para la investigación de la cultura en México y América Latina, 3. -

Literature, Genocide, and the Commodification of Trauma in Post-Conflict Rwanda
SOMEONE TO TELL THE STORY: LITERATURE, GENOCIDE, AND THE COMMODIFICATION OF TRAUMA IN POST-CONFLICT RWANDA By Kathryn Mara A THESIS Submitted to Michigan State University in partial fulfillment of the requirements for the degree of African American and African Studies- Master of Arts 2015 ABSTRACT SOMEONE TO TELL THE STORY: LITERATURE, GENOCIDE, AND THE COMMODIFICATION OF TRAUMA IN POST-CONFLICT RWANDA By Kathryn Mara The purpose of this research is to identity the significance of authorship in the literature of the Rwandan Genocide. It will examine the arguably un-interrogated condition in which literature(s) are assigned value, dependent on such qualities as the author’s proximity to the events described, the authenticity of the narrative, and its aesthetic value. This trajectory goes far beyond who is best equipped to represent the trauma of genocide, or who “owns” its memory; instead, it hopes to determine the manner in which genocide is experienced without the author necessarily experiencing The Genocide. Most of all, it wishes to interrogate the ethics of representing an experience that may not be one’s “own.” will be accomplished, using a content analysis of Rwandan survivor testimony, the African Writers’ Project, “Écrire par devoir de mémoire,” and Western literature about the Genocide. An examination of these groups of literature will reveal that proximity to the events is valuable, but an outside voice is also useful, in representation of the Rwandan Genocide. TABLE OF CONTENTS I. Introduction 1 II. Authoring the Trauma of Genocide 5 III. The Story/ies of the Rwandan Genocide 11 IV. Survivor Testimony: Possession is to Positionality 21 V. -
Theatre and the Rwandan Genocide
University of Nebraska - Lincoln DigitalCommons@University of Nebraska - Lincoln Modern Languages and Literatures, Department French Language and Literature Papers of October 2006 Theatre and the Rwandan Genocide Marie-Chantal Kalisa University of Nebraska - Lincoln, [email protected] Follow this and additional works at: https://digitalcommons.unl.edu/modlangfrench Part of the Modern Languages Commons Kalisa, Marie-Chantal, "Theatre and the Rwandan Genocide" (2006). French Language and Literature Papers. 31. https://digitalcommons.unl.edu/modlangfrench/31 This Article is brought to you for free and open access by the Modern Languages and Literatures, Department of at DigitalCommons@University of Nebraska - Lincoln. It has been accepted for inclusion in French Language and Literature Papers by an authorized administrator of DigitalCommons@University of Nebraska - Lincoln. Published in Peace Review: A Journal of Social Justice 18:4 (October 2006), pp. 515–521. Copyright © 2006 Taylor & Francis Group, LLC. Used by permission. http://www.usfca.edu/peacereview/PRHome.html DOI: 10.1080/10402650601030476 Theatre and the Rwandan Genocide Chantal Kalisa In 1994, Rwanda was the scene of genocide, or more precisely in French, “le théâtre du génocide” (theatre of genocide). Perpetrators and victims played their role while the rest of the world watched the “spectacle” live on televi- sion. Perhaps because of its spectacular aspect, the Rwandan genocide has in- spired a number of artistic materials. In the last decade, we have indeed wit- nessed the growth of literary and artistic expression in relation to the Rwan- dan genocide. Survivors and witnesses have told their stories in books and songs. Journalists, as well as other travelers “to the end of Rwanda,” to use Véronique Tadjo’s words, have borne witness to the genocide. -

Nouvelles Dramaturgies Africaines Francophones Du Chaos
NOUVELLES DRAMATURGIES AFRICAINES FRANCOPHONES DU CHAOS A Dissertation SUBMITTED TO THE FACULTY OF UNIVERSITY OF MINNESOTA and UNIVERSITY SORBONNE NOUVELLE PARIS 3 BY SYLVIE NDOME NGILLA IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY Co-Advisers: Mária Brewer and Sylvie Chalaye December 2014 © Sylvie Ndome Ngilla, 2014 Remerciements Je tiens à exprimer vivement toute ma gratitude à mes deux co-directrices de thèse, Sylvie Chalaye et Mária Minich Brewer, qui avec une infinie patience ont favorisé l’aboutissement de ce projet de recherche. La rigueur de leur analyse et la richesse de nos échanges m’ont constamment poussée à aller plus loin et affiner les directions de mon travail. Leurs précieux conseils tout au long de ces années continuent de m’accompagner. Je remercie également tous les autres membres de mon comité en France et aux Etats- Unis pour leur enthousiasme et leurs remarques avisées. J’adresse aussi mes remerciements à tous les dramaturges africains. Continuez à nous faire rêver ! Enfin, un grand merci du cœur à toute ma famille et surtout à ma mère qui sait toujours trouver les mots pour me remettre sur pied. i Dédicace À ma mère, ii Abstract A new type of African Francophone theater has emerged since the 1990s, which announced a breaking point within the African literary landscape. This generation of contemporary writers from the African diaspora engages with notions of fragmentation, displacement, and instability that suggest a reconfiguration of chaos in Francophone African literary production since the Independences. The history of African literatures since 1960, when a large majority of former African colonies became independent, is marked by the theme of chaos with significant differences. -

Theater and the Rwandan Genocide
University of Nebraska - Lincoln DigitalCommons@University of Nebraska - Lincoln Modern Languages and Literatures, Department French Language and Literature Papers of 2019 Theater and the Rwandan Genocide Chantal Kalisa Follow this and additional works at: https://digitalcommons.unl.edu/modlangfrench Part of the Africana Studies Commons, Political Science Commons, and the Theatre and Performance Studies Commons This Article is brought to you for free and open access by the Modern Languages and Literatures, Department of at DigitalCommons@University of Nebraska - Lincoln. It has been accepted for inclusion in French Language and Literature Papers by an authorized administrator of DigitalCommons@University of Nebraska - Lincoln. Published in Art from Trauma: Genocide and Healing Beyond Rwanda, ed. Rangira Béa Gallimore & Gerise Herndon. University of Nebraska Press, Lincoln, 2019. Copyright © 2019 Board of Regents of the University of Nebraska. The late Marie-Chantal Kalisa was Associate Professor of Modern Languages at the University of Nebraska-Lincoln. SIX Theater and the Rwandan Genocide CHANTAL KALISA In 1994 Rwanda was the scene of genocide, or, more precisely in French, it was Ie theatre dugenocide (theater of genocide). Perpe trators and victims played their role while the rest of the world watched the "spectacle" live on television. Perhaps because of its spectacular aspect, the Rwandan genocide has inspired a num ber of artistic materials. In the last decade we have indeed wit nessed the growth of literary and artistic expression in relation to the Rwandan genocide. Survivors and witnesses have told their stories in books and songs. Journalists, as well as other travel ers "to the end of Rwanda," to use Veronique Tadjo's words, have borne witness to the genocide. -

Regarding Westernization in Central Africa: Hybridity in the Works Of
Louisiana State University LSU Digital Commons LSU Doctoral Dissertations Graduate School 2011 Regarding Westernization in Central Africa: Hybridity in the Works of Three Chadian Playwrights Enoch Reounodji Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College, [email protected] Follow this and additional works at: https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_dissertations Part of the Theatre and Performance Studies Commons Recommended Citation Reounodji, Enoch, "Regarding Westernization in Central Africa: Hybridity in the Works of Three Chadian Playwrights" (2011). LSU Doctoral Dissertations. 2893. https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_dissertations/2893 This Dissertation is brought to you for free and open access by the Graduate School at LSU Digital Commons. It has been accepted for inclusion in LSU Doctoral Dissertations by an authorized graduate school editor of LSU Digital Commons. For more information, please [email protected]. REGARDING WESTERNIZATION IN CENTRAL AFRICA: HYBRIDITY IN THE WORKS OF THREE CHADIAN PLAYWRIGHTS A Dissertation Submitted to the Graduate Faculty of the Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy In The Department of Theatre By Enoch Reounodji B.A., University of Chad (Chad), 1991 M.A., University of Maiduguri (Nigeria), 1999 August 2011 Dedication For Trophine, Gracie, and Gloria: my warmth, my world, my life. In loving memory of my mother and father: “the dead are not dead.” ii Acknowledgments This dissertation represents a long journey marked by setbacks and successes. It has been a collaborative endeavor. Many people have contributed toward the completion of this work, which is a huge accomplishment for my academic life, my family, and my entire community. -
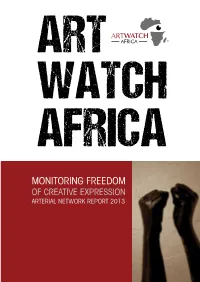
Monitoring Freedom of Creative Expression
ART WATCH AFRICA MONITORING FREEDOM OF CREATIVE EXPRESSION ARTERIAL NETWORK REPORT 2013 ART WATCH AFRICA MONITORING FREEDOM OF CREATIVE EXPRESSION ARTERIAL NETWORK REPORT 2013 RESEARCH CONDUCTED BY ARTERIAL NETWORK Compiled by Nadia Nkwaya Research Supervisor: Carole Karemera Research coordinators: Dounia Benslimane, Telesphore Mba Bizo, Joshua Nyampimbi Project Manager: Espera Donouvossi Country Researchers: Houda Hamdi (Algeria) - Gandonou Medard (Benin)- Bicaba Paul Ismael (Burkina Faso) -Buyehere Parfait, Teddy Mazina, Christian Mbanza (Burundi)- Ngwana Christian Fozo (Cameroon) -Mabiala Pierre Claver (Congo)- Abdramane Kamate (Cote d’Ivoire)- Theodore Nganzi (DRC)- Amira Samy (Egypt, Libya, Eritrea)- Andnet Dagnew Bezie (Ethiopia)- John Owo(Ghana) -Maggie Ottieno, Nancy Onyango (Kenya) -Clifton Kawanga (Malawi)- Mamadou Sangare (Mali)-Tghana Cheikh Saad Bouh (Mauritania)-Nirveda Alleck (Mauritius)-Moulay Abdelaziz Errachidi (Morocco)-Jacob Sakaria (Namibia)-Maki Garba (Niger)-Ropo Ewenla (Nigeria)-Antoine De Padoue Sisibo (Rwanda)-Jacqueline Ndiaye (Senegal)-Martin Kennedy (Seychelles)-Mervet Helal (Somalia)-Valmont Layne (South Africa)- Maswati Dludlu (Swaziland)-Komla Konou (Togo)-Ouafa Belgacem (Tunisia)-Ellady Muyambi (Uganda)- Kenneth Chulu (Zambia)- Eric Mazango (Zimbabwe) Proofreading: Rebecca Dickerson, Marius Drissen Design: Christopher Abrahams Photo credit: Christian Mbanza & Nelson Niyakire This research was made possible through the generous support of Mimeta ISBN 978-0-9869900-7-6 ARTWATCH AFRICA REPORT 2013 TABLE OF -

What 'I' Cannot Say: Testifying of Trauma Through
“What ‘I’ Cannot Say: Testifying of Trauma through Translation” Dissertation Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy in the Graduate School of The Ohio State University By Heidi Brown, M.A. Graduate Program in French and Italian The Ohio State University 2014 Dissertation Committee: Jennifer Willging, Advisor Danielle Marx-Scouras Maurice Stevens Cheikh Thiam Copyright by Heidi Brown 2014 Abstract This dissertation proposes a new theory of translation to explain how trauma testimony is performed by survivors who have experienced a death of their selves. It shows that certain 20th century French and Francophone authors translate their voices across languages, literary genres, and bodies (both human and animal) in order to testify of trauma when they are no longer able to bear witness in the first-person. The two French works studied—Journal (2008) by Hélène Berr and La Douleur [The War] (1985) by Marguerite Duras—exhibit translations by the authors to different subject- positions within themselves. Berr translates across languages to negotiate between different socio-linguistically constructed identities and cites English literature to speak in her stead when she is no longer able to voice her experiences. On the other hand, Duras translates across different literary genres (autobiography, auto-fiction, and fiction) in order to recreate a sense of self and increase her capacity for emotional expression. The two Francophone works studied—Djamila Boupacha (1962) by Simone de Beauvoir and Gisèle Halimi and Le passé devant soi [The Past Ahead] (2008) by Gilbert Gatore—exhibit translation movements across bodies. Djamila Boupacha translates her voice to Gisèle Halimi, her Tunisian-French lawyer, and to Simone de Beauvoir, a French feminist author, in order to testify of the torture she endured during the Algerian War. -

Les Caractéristiques Et L'évolution Du Théâtre Pour Le Développement En Afrique Noire Francophone: Le Cas Du Burkina Faso
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL LES CARACTÉRISTIQUES ET L'ÉVOLUTION DU THÉÂTRE POUR LE DÉVELOPPEMENT EN AFRIQUE NOIRE FRANCOPHONE: LE CAS DU BURKINA FASO MÉMOIRE PRÉSENTÉ COMME EXIGENCE PARTIELLE DE LA MAÎTRISE EN THÉÂTRE PAR FABIENNE ROY MAI 2009 UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL Service des bibliothèques Avertissement La diffusion de ce mémoire se fait dans le respect des droits de son auteur, qui a signé le formulaire Autorisation de reproduire et de diffuser un travail de recherche de cycles supérieurs (SDU-522 - Rév.01-2üü6). Cette autorisation stipule que «conformément à l'article 11 du Règlement no 8 des études de cycles supérieurs, [l'auteur] concède à l'Université du Québec à Montréal une licence non exclusive d'utilisation et de publication de la totalité ou d'une partie importante de [son] travail de recherche pour des fins pédagogiques et non commerciales. Plus précisément, [l'auteur] autorise l'Université du Québec à Montréal à reproduire, diffuser, prêter, distribuer ou vendre des copies de (son] travail de recherche à des fins non commerciales sur quelque support que ce soit, y compris l'Internet. Cette licence et cette autorisation n'entraînent pas une renonciation de [la] part [de l'auteur] à [ses] droits moraux ni à [ses] droits de propriété intellectuelle. Sauf entente contraire, [l'auteur] conserve la liberté de diffuser et de commercialiser ou non ce travail dont [il] possède un exemplaire.» REMERCIEMENTS Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont soutenue dans ce long cheminement d'écriture. Un remerciement particulier à Mme Martine Beaulne, directrice de ce mémoire, qui a accepté de me soutenir dans ma rédaction. -

Writing Trauma and Affective Unsettlement in Post-Genocide Rwanda Fiction
University of New Mexico UNM Digital Repository Foreign Languages & Literatures ETDs Electronic Theses and Dissertations Summer 7-13-2020 Bodies in Shame: Writing Trauma and Affective Unsettlement in Post-Genocide Rwanda Fiction Cole A. Carvour University of New Mexico - Main Campus Follow this and additional works at: https://digitalrepository.unm.edu/fll_etds Part of the Comparative Literature Commons, and the French and Francophone Language and Literature Commons Recommended Citation Carvour, Cole A.. "Bodies in Shame: Writing Trauma and Affective Unsettlement in Post-Genocide Rwanda Fiction." (2020). https://digitalrepository.unm.edu/fll_etds/137 This Thesis is brought to you for free and open access by the Electronic Theses and Dissertations at UNM Digital Repository. It has been accepted for inclusion in Foreign Languages & Literatures ETDs by an authorized administrator of UNM Digital Repository. For more information, please contact [email protected], [email protected], [email protected]. i Cole Carvour Candidate Foreign Languages and Literatures Department This thesis is approved, and it is acceptable in quality and form for publication: Approved by the Thesis Committee: Dr. Pamela Cheek, Co-chairperson Dr. Stephen Bishop, Co-chairperson Dr. Pim Higginson Dr. Kimberly Gauderman ii BODIES IN SHAME: WRITING TRAUMA AND AFFECTIVE UNSETTLEMENT IN POST-GEONCIDE RWANDA FICTION by COLE CARVOUR B.A., COMPARATIVE LANGUAGES AND LINGUSITICS, EARLHAM COLLEGE, 2014 THESIS Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Arts Comparative Literatures and Cultural Studies The University of New Mexico Albuquerque, New Mexico July 2020 iii DEDICATIONS This thesis is dedicated to the victims and survivors of violence, both fictional and real, who have entrusted me with their stories, taught me to listen, and greatly transformed and enriched my life.