Jean-Loup Samaan*
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The United States and Russian Governments Involvement in the Syrian Crisis and the United Nations’ Kofi Annan Peace Process
ISSN 2039-2117 (online) Mediterranean Journal of Social Sciences Vol 5 No 27 ISSN 2039-9340 (print) MCSER Publishing, Rome-Italy December 2014 The United States and Russian Governments Involvement in the Syrian Crisis and the United Nations’ Kofi Annan Peace Process Ken Ifesinachi Ph.D Professor of Political Science, University of Nigeria [email protected] Raymond Adibe Department of Political Science, University of Nigeria [email protected] Doi:10.5901/mjss.2014.v5n27p1154 Abstract The inability of the Syrian government to internally manage the popular uprising in the country have increased international pressure on Syria as well as deepen international efforts to resolve the crisis that has developed into a full scale civil war. It was the need to end the violent conflict in Syria that informed the appointment of Kofi Annan as the U.N-Arab League Special Envoy to Syria on February 23, 2012. This study investigates the U.S and Russian governments’ involvement in the Syrian crisis and the UN Kofi Annan peace process. The two persons’ Zero-sum model of the game theory is used as our framework of analysis. Our findings showed that the divergence on financial and military support by the U.S and Russian governments to the rival parties in the Syrian conflict contradicted the mandate of the U.N Security Council that sanctioned the Annan plan and compromised the ceasefire agreement contained in the plan which resulted in the escalation of violent conflict in Syria during the period the peace deal was supposed to be in effect. The implication of the study is that the success of any U.N brokered peace deal is highly dependent on the ability of its key members to have a consensus, hence, there is need to galvanize a comprehensive international consensus on how to tackle the Syrian crisis that would accommodate all crucial international actors. -

1 TRIAL of ANWAR RASLAN And
INTERNATIONAL RESEARCH AND DOCUMENTATION CENTRE FOR WAR CRIMES TRIALS TRIAL OF ANWAR RASLAN and EYAD AL GHARIB Higher Regional Court – Koblenz, Germany Trial Monitoring Report 1 Hearing dates of April 23, 24, 27, 28 & 29, 2020 Highlights Trial Day 1 • Anwar Raslan and Eyad Al-Gharib appeared in court for the first time. The charges of the indictment were read out in court, including charges of torturing 4,000 persons at Al- Khatib (Branch 251), which led to 58 deaths • The proceedings were adjourned early because Anwar Raslan did not have sufficient time to consult with his attorney Trial Day 2 • A Police Inspector testified as to the main components of his investigation of the Accused • Several witnesses had named Anwar Raslan in asylum proceedings, alerting the authorities to the importance of investigating him • Other evidence obtained in the investigation included the Caesar photos, 3 documents signed by Anwar Raslan as head of Branch 251, and media files/texts obtained from Raslan Trial Day 3 • An expert in conflict research testified about Syrian history, religious makeup and structures of the intelligence agencies and branches • The expert spoke about a history of torture and mistreatment under Hafez Al-Assad and Bashar Al-Assad • Many attorneys questioned the expertise of the witness and challenged her on certain facts Trial Day 4 • Three witnesses from the German government testified as to Anwar Raslan’s transit to Germany and his application for asylum • Proceedings were adjourned until May 18, 2020 1 INTERNATIONAL RESEARCH AND DOCUMENTATION CENTRE FOR WAR CRIMES TRIALS Trial Day 1 – April 23, 2020 There was considerable public interest in the first day of the trial with around 50 people waiting outside to enter the courtroom. -

Why States Rebel Understanding State Sponsorship of Terrorism
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Fakultät für Wirtschafts-und Sozialwissenschaften Institut für Politische Wissenschaft Why States Rebel Understanding State Sponsorship of Terrorism Magdalena Kirchner Betreuer: Prof. Dr. Sebastian Harnisch Dissertation zur Erlangung des Grades eines Dr. rer. pol. eingereicht an der Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften der Ruprecht-Karls- Universität Heidelberg Heidelberg, im Februar 2014 ! Table of Content Tables _________________________________________________________________________ V Figures ________________________________________________________________________ VI Abbreviations __________________________________________________________________ VII 1 Introduction: Internationalizing intrastate conflict ................................................ 1 1.1 Why states interfere – an empirical puzzle __________________________________________ 1 1.2 State of research _____________________________________________________________ 3 1.3 Theoretical overview __________________________________________________________ 7 1.4 State sponsorship of terrorism ___________________________________________________ 9 1.4.1 Definitions ............................................................................................................ 9 1.4.2 Pyramid or rag rug? Patterns of sponsorship revisited ............................................ 12 1.5 Research questions __________________________________________________________ 17 1.6 Research design _____________________________________________________________ -

Reshuffling the Cards? (Ii): Syria's New Hand
RESHUFFLING THE CARDS? (II): SYRIA’S NEW HAND Middle East Report N°93 – 16 December 2009 TABLE OF CONTENTS EXECUTIVE SUMMARY AND RECOMMENDATIONS................................................. i I. INTRODUCTION ............................................................................................................. 1 II. LESSONS FROM 2008..................................................................................................... 2 A. FROM RADICALISM TO PRAGMATISM...........................................................................................2 B. THE ECONOMIC GAMBIT..............................................................................................................7 C. TURKISH-MEDIATED TALKS ........................................................................................................8 D. THE LEBANESE CRISIS ...............................................................................................................11 E. IMPROVING RELATIONS WITH IRAQ............................................................................................15 III. PRESIDENT ASSAD’S TRANSITION ........................................................................ 18 IV. SYRIA AND THE OBAMA ADMINISTRATION...................................................... 20 A. WHO GOES FIRST?.....................................................................................................................21 B. WHAT DOES THE U.S. WANT?...................................................................................................22 -

Syrien – Zwischen Beständigkeit Und Wandel
Schriftenreihe der Landesverteidigungsakademie Nadja Thoma Syrien – zwischen Beständigkeit und Wandel Gesellschaftliche Strukturen und politisches System . 6/2008 Wien, Juni 2008 Impressum: Schriftenreihe der Landesverteidigungsakademie Herausgeber: © BMLV / LVAk Für die Herausgabe verantwortlich: Bgdr Dr. Walter Feichtinger Layout und Grafik: Medienstelle Landesverteidigungsakademie Druck und Endfertigung: ReproZ Wien/Akademiedruckerei LVAk 1070 Wien, Stiftgasse 2a Erscheinungsjahr: 2008 ISBN 3-902456-97-3 ReproZ Wien Inhaltsverzeichnis Vorwort 5 Dank 7 1. Einleitung 9 2. Grundlagen 11 2.1. Wichtige Daten zu Syrien 11 2.2. Historischer Abriss (20. Jahrhundert bis heute) 12 2.3. Bevölkerung 14 2.3.1. Die kurdische Minderheit 16 2.3.2. Die palästinensische Minderheit 21 2.3.3. Christliche Gruppen 22 2.3.4. Die drusische Minderheit 24 2.3.5. Die alawitische/nusairische Minderheit 26 2.4. Die Bedeutung neopatrimonialer Strukturen für Gesellschaft und Politik 28 3. Innenpolitische Entwicklungen 31 3.1. Von Hafez zu Bashshar al-Asad 32 3.2. Der Damaszener Frühling und die syrische Zivilgesellschaft 34 3.3. Die Oppositionsparteien 38 3.3.1. Die Muslimbrüder 38 3.3.2. Die Nationaldemokratische Sammlung 42 3.3.3. Die Partei der Kommunistischen Aktion 43 3.3.4. Die Sozialistische arabische Bacth-Partei 43 3.3.5. Die kurdischen Parteien 43 3.4. Das Regime und der Islam 44 3.5. Das Militär 49 3.6. Die Frage der Liberalisierung 51 4. Außenpolitische Entwicklungen 55 4.1. Syrisch-libanesische Beziehungen 56 4.1.1. Historischer Überblick 56 4.1.2. Der Fall Hariri 60 3 4.1.3. Der Libanon nach dem syrischen Abzug 63 4.1.4. -

Reshuffling the Cards? (Ii): Syria’S New Hand
RESHUFFLING THE CARDS? (II): SYRIA’S NEW HAND Middle East Report N°93 – 16 December 2009 TABLE OF CONTENTS EXECUTIVE SUMMARY AND RECOMMENDATIONS................................................. i I. INTRODUCTION ............................................................................................................. 1 II. LESSONS FROM 2008..................................................................................................... 2 A. FROM RADICALISM TO PRAGMATISM...........................................................................................2 B. THE ECONOMIC GAMBIT..............................................................................................................7 C. TURKISH-MEDIATED TALKS ........................................................................................................8 D. THE LEBANESE CRISIS ...............................................................................................................11 E. IMPROVING RELATIONS WITH IRAQ............................................................................................15 III. PRESIDENT ASSAD’S TRANSITION ........................................................................ 18 IV. SYRIA AND THE OBAMA ADMINISTRATION...................................................... 20 A. WHO GOES FIRST?.....................................................................................................................21 B. WHAT DOES THE U.S. WANT?...................................................................................................22 -

The New Logic of the Syrian Conflict and Its Meaning for NATO by Jean-Loup Samaan1
Research Paper Research Division - NATO Defense College, Rome - No. 86 – December 2012 The New Logic of the Syrian Conflict And its Meaning for NATO by Jean-Loup Samaan1 As the Syrian crisis persists despite the prevailing conviction in Contents the Western media that Bashar Al Assad’s regime is doomed, its escalation to the whole of the Middle East is an increasing- ly distinct prospect. Turkey’s recent call for the deployment of 1. The dual escalation logic of NATO Patriot missiles to protect its borders highlights that the the Syrian conflict 2 Alliance is now forced to discuss the issue internally as well as 2. Consequences for the Atlantic Alliance 6 with its partners in the region. From the outset, a variety of dip- 3. A NATO policy to counter lomatic and military considerations have meant that it is not fea- Assad’s spillover strategy 7 sible to envisage a NATO intervention in Syria along the lines of Operation Unified Protector in Libya. Because the UN Security Council is unlikely to reach consensus on the matter, launching a NATO-led operation would only worsen the existing tensions with Russia and China. In addition, the Syrian regime’s military capabilities, particularly in terms of air defence, are a significant deterrent against military engagement like Libya. Research Paper ISSN 2076 - 0949 (Res. Div. NATO Def. Coll., Print) Despite genuine hesitation about intervening in Syria, concern ISSN 2076 - 0957 about preserving security in the direct vicinity of the country is (Res. Div. NATO Def. Coll., Online) growing in earnest. -
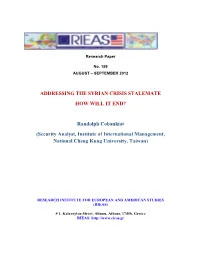
Addressing the Syrian Crisis Stalemate How Will It End?
Research Paper No. 159 AUGUST – SEPTEMBER 2012 ADDRESSING THE SYRIAN CRISIS STALEMATE HOW WILL IT END? Randolph Cobankiat (Security Analyst, Institute of International Management, National Cheng Kung University, Taiwan) RESEARCH INSTITUTE FOR EUROPEAN AND AMERICAN STUDIES (RIEAS) # 1, Kalavryton Street, Alimos, Athens, 17456, Greece RIEAS: http://www.rieas.gr RIEAS MISSION STATEMENT Objective The objective of the Research Institute for European and American Studies (RIEAS) is to promote the understanding of international affairs. Special attention is devoted to transatlantic relations, intelligence studies and terrorism, European integration, international security, Balkan and Mediterranean studies, Russian foreign policy as well as policy making on national and international markets. Activities The Research Institute for European and American Studies seeks to achieve this objective through research, by publishing its research papers on international politics and intelligence studies, organizing seminars, as well as providing analyses via its web site. The Institute maintains a library and documentation center. RIEAS is an institute with an international focus. Young analysts, journalists, military personnel as well as academicians are frequently invited to give lectures and to take part in seminars. RIEAS maintains regular contact with other major research institutes throughout Europe and the United States and, together with similar institutes in Western Europe, Middle East, Russia and Southeast Asia. Status The Research Institute for European and American Studies is a non-profit research institute established under Greek law. RIEAS’s budget is generated by membership subscriptions, donations from individuals and foundations, as well as from various research projects. The Institute is autonomous organization. Its activities and views are independent of any public or private bodies, and the Institute is not allied to any political party, denominational group or ideological movement. -

Syrisk Militärtjänst
TEMARAPPORT maj 2017, version 3.0 Reguljär och irreguljär syrisk militärtjänst Lifos Temarapport: Reguljär och irreguljär syrisk militärtjänst 3.0 Om rapporten Denna rapport följer EU:s allmänna riktlinjer för framtagande av landinformation (2008) avsedd för handläggning av migrationsärenden. Den bör inte användas som exklusivt underlag i samband med avgörandet av ett enskilt ärende utan vägas mot annan relevant rapportering och bevisning. Informationen i rapporten återspeglar inte nödvändigtvis Migrationsverkets officiella inställning i alla delar. Lifos har ingen avsikt att genom rapporten göra politiska eller rättsliga ställningstaganden. Temarapport: Reguljär och irreguljär syrisk militärtjänst maj 2017, version 3.0 Lifos – Center för landinformation och -analys inom migrationsområdet © Migrationsverket (Swedish Migration Agency), 2016 Omslagsbild: Syrian Arab Army (YouTube, 2012-10-15) Publikationen kan laddas ner från http://lifos.migrationsverket.se maj 2017 2 (75) Innehåll Brief summary ................................................................................................ 4 1. Introduktion ............................................................................................ 5 1.1. Mer om rapporten; avgränsningar ................................................... 5 1.2. Övergripande lägesbild .................................................................... 5 2. Försvarsmakten - militära strukturer ...................................................... 8 2.1. Armén (SAA), elitförband och ”hybrider” ................................... -

Les Relations De La Turquie Avec La Syrie
Les relations de la Turquie avec la Syrie Uğur Kaya et Dilek Yankaya DOI : 10.4000/books.ifeagd.277 Éditeur : Institut français d’études anatoliennes Lieu d'édition : Istanbul Année d'édition : 2013 Date de mise en ligne : 4 novembre 2014 Collection : La Turquie aujourd’hui ISBN électronique : 9782362450341 http://books.openedition.org Édition imprimée ISBN : 9782362450112 Nombre de pages : 76 Référence électronique KAYA, Uğur ; YANKAYA, Dilek. Les relations de la Turquie avec la Syrie. Nouvelle édition [en ligne]. Istanbul : Institut français d’études anatoliennes, 2013 (généré le 12 janvier 2021). Disponible sur Internet : <http://books.openedition.org/ifeagd/277>. ISBN : 9782362450341. DOI : https://doi.org/ 10.4000/books.ifeagd.277. Ce document a été généré automatiquement le 12 janvier 2021. © Institut français d’études anatoliennes, 2013 Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540 1 La République arabe syrienne et la République de Turquie partagent une frontière de 911 km, la plus longue pour chacun des deux pays. Cette frontière qui relie et que franchissent des rivières communes les a aussi longtemps séparées : depuis les années 1950 s’y étendaient des champs de mines. Cette frontière a vu passer des peuples, parfois des milices, beaucoup de commerçants entre 2000 et 2011 et enfin, massivement, des réfugiés depuis 2011. Divers sens lui ont été attribués - source de litige dans le cas du sandjak d’Alexandrette et des fleuves Tigre et Euphrate jusqu’en 2004, puis voie de commerce depuis 2000 -, en fonction de la perception réciproque des dirigeants des deux États et de leurs opinions publiques. Cette étude reprend l’évolution tourmentée des relations entre la Turquie et la Syrie depuis les années 1950 jusqu’à la crise syrienne actuelle. -
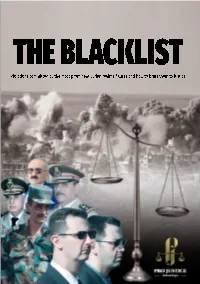
The Blacklist
THE BLACKLIST Violations committed by the most prominent Syrian regime figures and how to bring them to justice The Blacklist violations committed by the most prominent Syrian Regime figures and how to bring them to justice The Blacklist, violations committed by the most prominent Syrian Re- gime figures and how to bring them to justice First published in the US 2019 by Pro-Justice 8725 Ginger Snap Lane, San Diego, CA 92129 Email. [email protected] Tel. +18588886410 ISBN: 978-605-7896-11-7 Copyright © Pro-justice All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in any retrieval system or transmitted in any form or by any means without prior permission in writing of Pro-justice Pro-justice is a non-profit that seeks to maintain the principle of accountabil- ity and preclude impunity for major war criminal and human rights violators in societies that suffer from or have just exited civil wars and natural disasters, with special focus on the Middles East and Syria. Visit www.pro-justice.org to read more about pro-justice activities and pub- lications The Blacklist violations committed by the most prominent Syrian Regime figures and how to bring them to justice Foreword More than eight years have passed since Syrians took to the streets as part of a peaceful movement demanding freedom and human dignity. Since then, the Syrian government has continued to resist the laws of inevitable transformation, trying in vain to stop the process of political development and reform through its levers of killing and repression. -
Chronology of Major Conflicts and Political Events
Chronologies Appendices Chronology of Major Conflicts and Political Events Chronologies January 2012 cludes the structural deficit of 0% for such as transport, energy and trade, and autonomous communities from 2020. cuts in the privileges of certain profes- In Spain, the government submits a sional sectors. budgetary stability bill. France announc- France es aid to halt rising unemployment. In Malta Italy, the Council of Ministers approves • On 10 January the Minister of Fi- a reform plan to relaunch the economy. nance François Baroin announces that • On 26 January, thanks to the casting Greece continues negotiating a reform France will be the first country to apply vote of the President of the Parliament, plan with the EU and the IMF in ex- the Tobin Tax on financial transactions the government defeats a vote of no change for more aid, which is widely as an anti-crisis measure. confidence moved by the leader of the rejected by its citizens. In Malta, the gov- • On 18 January Nicolas Sarkozy an- Labour Party Joseph Muscat given the ernment defeats a vote of no confidence. nounces aid of 1 billion euros to fight internal divisions in the government. In Slovenia, Janez Jansa is appointed unemployment, branded as “insufficient” Prime Minister. Croatia approves EU ac- by unions, which also oppose the rise Slovenia cession in a referendum. In Cyprus, two in VAT announced by the government. 316 former ministers are prosecuted for their • On 24 January the Senate passes • On 17 January Slovenia and Croatia responsibility in the explosion of an ar- the bill that outlaws denial of the “Arme- agree the composition of the arbitration senal in 2011.