Mohotani : Une Ile Protegee Aux Marquises Par Ni
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
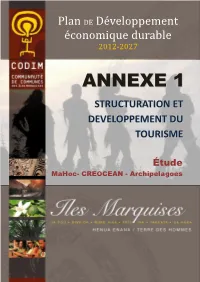
Annexe 1 2 SOMMAIRE
Plan DE Développement économique durable 2012-2027 AANNNNEEXXEE 11 SSTTRRUUCCTTUURRAATTIIOONN EETT DDEEVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT DDUU TTOOUURRIISSMMEE Étude MaHoc- CREOCEAN - Archipelagoes PDEM 2013 – Annexe 1 2 SOMMAIRE Pages Rapport phase 1 : Diagnostic 5 Introduction 8 Les données de cadrage 13 L'offre touristique actuelle et les projets 25 Le diagnostic de la demande 57 L'organisation touristique et les outils marketing 75 Benchmarking de produits et de destinations 89 Conclusions du diagnostic 93 Annexes 95 Rapport phase 2 : Définition du positionnement de la destination et du produit 179 "Tourisme aux Marquises" Introduction 181 Rappel méthodologique 182 Rappel sur le potentiel de développement touristique des îles Marquises 185 Stratégie marketing du tourisme aux Marquises 188 Axes stratégiques du développement touristique 205 Rapport phase 3 : Plan d’actions opérationnel pour le développement 209 du tourisme aux Marquises Rappel méthodologique 212 Le plan d'actions opérationnel 213 ANNEXES 261 Complément au rapport phase 3 : réponses aux notes du Conseil Communautaire 262 des 31 août et 1er septembre 2012 Calendrier de mise en œuvre 266 Proposition de charte graphique identité Tourisme aux Marquises 268 Exemple de cahier des charges pour l’implantation d’une aire technique pour la 278 plaisance PDEM 2013 – Annexe 1 3 PDEM 2013 – Annexe 1 4 COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES ÎLES MARQUISES Structuration et développement du tourisme aux Marquises Rapport de phase 1 Diagnostic Mars 2012 PDEM 2013 – Annexe 1 5 SOMMAIRE Introduction .......................................................................................................................................... -

The Marquesas
© Lonely Planet Publications 199 The Marquesas Grand, brooding, powerful and charismatic. That pretty much sums up the Marquesas. Here, nature’s fingers have dug deep grooves and fluted sharp edges, sculpting intricate jewels that jut up dramatically from the cobalt blue ocean. Waterfalls taller than skyscrapers trickle down vertical canyons; the ocean thrashes towering sea cliffs; sharp basalt pinnacles project from emerald forests; amphitheatre-like valleys cloaked in greenery are reminiscent of the Raiders of the Lost Ark; and scalloped bays are blanketed with desert arcs of white or black sand. This art gallery is all outdoors. Some of the most inspirational hikes and rides in French Polynesia are found here, allowing walkers and horseback riders the opportunity to explore Nuku Hiva’s convoluted hinterland. Those who want to get wet can snorkel with melon- headed whales or dive along the craggy shores of Hiva Oa and Tahuata. Bird-watchers can be kept occupied for days, too. Don’t expect sweeping bone-white beaches, tranquil turquoise lagoons, swanky resorts and THE MARQUESAS Cancun-style nightlife – the Marquesas are not a beach holiday destination. With only a smat- tering of pensions (guesthouses) and just two hotels, they’re rather an ecotourism dream. In everything from cuisine and dances to language and crafts, the Marquesas do feel different from the rest of French Polynesia, and that’s part of their appeal. Despite the trap- pings of Western influence (read: mobile phones), their cultural uniqueness is overwhelming. They also make for a mind-boggling open-air museum, with plenty of sites dating from pre-European times, all shrouded with a palpable historical aura. -

Traditional Marquesan Agriculture and Subsistence: the Historical Evidence
Rapa Nui Journal: Journal of the Easter Island Foundation Volume 20 | Issue 2 Article 5 2006 Traditional Marquesan Agriculture and Subsistence: The iH storical Evidence David J. Addison ASPA Archaeological Specialists Department Supervisor Follow this and additional works at: https://kahualike.manoa.hawaii.edu/rnj Part of the History of the Pacific slI ands Commons, and the Pacific slI ands Languages and Societies Commons Recommended Citation Addison, David J. (2006) "Traditional Marquesan Agriculture and Subsistence: The iH storical Evidence," Rapa Nui Journal: Journal of the Easter Island Foundation: Vol. 20 : Iss. 2 , Article 5. Available at: https://kahualike.manoa.hawaii.edu/rnj/vol20/iss2/5 This Research Paper is brought to you for free and open access by the University of Hawai`i Press at Kahualike. It has been accepted for inclusion in Rapa Nui Journal: Journal of the Easter Island Foundation by an authorized editor of Kahualike. For more information, please contact [email protected]. Addison: Traditional Marquesan Agriculture and Subsistence Traditional Marquesan Agriculture and Subsistence: The Historical Evidence Part I of IV - General Descriptions, Garden Locations, the Agricultural Calendar, Hydrology and Soils, Cultigens, and Agricultural Techniques David1. Addison* HE MARQUESAS ISLANDS (Figure 1) have long captivated nario for the prehistoric involution of Marquesan power T the attention of social scientists. Members of the Bishop structures. Museum's Bayard-Dominick Expedition did the first fonnal While social and political structures and relationships anthropological and archaeological research in the archipel have been dominant research topics, little attention has been ago (Figure 2) in the early 20'h century (e.g. -

Marquesas Islands)
Motu Iti (Marquesas Islands) The uninhabited island located 42 kilometers northwest of Nuku Hiva, the largest island in the Marquesas. In fact, there Motu Iti of several tiny islets, all rise from the same basaltic base. In the east, the 0.2 -acre main island still a 300 x 80 m measuring, upstream 76 m from the sea projecting rock humps and two smallest rocky reefs. The main island is 670 m long, 565 m wide and reaches a height of 220 meters, it is a geologically very young volcanic island, which consists mainly of basalt rocks. Because of the low geological age Motu Iti is not surrounded by a sea on the outstanding coral Motu Iti (sometimes also called Hatu Iti) is one of the northern Marquesas Islands in French Polynesia. Located west-northwest from Nuku Hiva, Motu Iti is the site of extensive seabird rookeries. Motu Iti is administratively part of the commune (municipality) of Nuku-Hiva, itself in the administrative subdivision of the Marquesas Islands. Marquesas Islands of French Polynesia. Northern Marquesas: Eiao ⢠Hatutu ⢠Motu Iti ⢠Motu One ⢠Nuku Hiva ⢠Ua Huka ⢠Ua Pu. Southern Marquesas: Fatu Hiva ⢠Fatu Huku ⢠Hiva Oa ⢠Moho Tani ⢠Motu Nao ⢠Tahuata ⢠Terihi. Archipelagos of French Polynesia: Aust Motu Iti (Marquesas Islands). From Wikipedia, the free encyclopedia. This article is about the island in French Polonesia. For the islet off of Easter Island, see Motu Iti (Rapa Nui). Motu Iti. Motu Iti (sometimes also called Hatu Iti) is one of the northern Marquesas Islands in French Polynesia. -

Guide Floristique Eiao, Hatutaa, Mohotani
Direction Del'environnement DIREN g u i de f l o r i s t i q u e - E i a o , H a t u t a a , M o h o t a n i Eiao, Hatutaa, Mohotani Hatutaa, Eiao, Direction Del'environnement Guide floristique Guide Jean-François Butaud & Frédéric Jacq Frédéric & Butaud Jean-François Origine du guide Ce petit guide floristique porte sur trois îles inhabi- tées de l’archipel des Marquises ayant été classées comme réserves naturelles dès 1971. Les informations présentées proviennent à la fois de l’analyse de la bibliographie botanique existante mais également de prospections de terrain initiées par la Direction de l’Environnement en 2007 et 2008. L’atoll de Motu One, situé à l’Est de Hatutaa et éga- lement classé réserve naturelle, ne comprend, quant à lui, plus aucune végétation. Présentation des fiches Ce petit guide présente un peu plus d’une centaine d’espèces se développant sur les îles de Eiao, Hatutaa et Mohotani. Il s’agit de la totalité des plantes indigènes connues à ce jour sur ces îles ainsi que les autres plantes locales considérées comme ayant été introduites lors des migrations polyné- siennes. Par ailleurs, quelques introductions plus récentes particulièrement répandues y ont été jointes. Les espèces, ou plutôt taxons, sont présentés par ordre alphabétique de leurs noms scientifiques au sein de cinq groupes constitués par les types biolo- giques : arbres, arbustes et arbrisseaux, fougères, herbacées, lianes. Pour chaque taxon, outre son nom scientifique accepté, est indiqué sa famille botanique d’appar- tenance. Eiao, Hatutaa, Mohotani - Guide floristique 1 Le statut biogéographique est également précisé : espèces indigènes non introduites par l’homme, introductions polynésiennes implan- tées lors des migrations polynésiennes près d’un millier d’années auparavant et introductions modernes importées depuis la redécou- verte européenne, essentiellement depuis la fin du xviiie siècle. -

Origin of Basalts from the Marquesas Archipelago (South Central Pacific Ocean) : Isotope and Trace Element Constraints
Earth atid Planetary Science Letters, 82 (1987) 145-152 145 Elsevier Science Publishers B.V., Amsterdam - Printed in The Netherlands Origin of basalts from the Marquesas Archipelago (south central Pacific Ocean) : isotope and trace element constraints C. Dupuy ', P. Vidal 2, H.G. Barsczus 193 and C. Chauve1 I Centre GPologique et Géophysique, CNRS et Université des Sciences et Techniques du h,nguedoc, pl. Eugène Bataillon, 34060 Montpellier Cedex (France) Origine, Evolution et Dynamique des Magmas (UA IO), CNRS et Université de Clermont-Ferrand I< 5, rue Kessler, 63038 Clertnont-Ferrand Cedex (France) Centre ORSTOM, B.P. 529, Papeete, Tahiti (Fretich Polynesia) Max-Planck-Institutfùr Chemie, Postfach 3060, 0-6500 Maim (ER.G.) Received April 9,1986; revised version accepted November 26,1986 Basalts from the Marquesas Archipelago display significant variations according to magmatic type in 143Nd/144Nd (0.512710-0.512925) and a7Sr/86Sr (0.70288-0.70561) suggesting heterogeneities at various scales in the mantle source, with respectively the highest and lowest values in tholeiites compared to alkali basalts. This relationship is the reverse from that observed in the Hawaiian islands. Systematic indications of magma mixing are recognized from the relationships between trace element and isotopic ratios. Tholeiites from Ua Pou Island which have unradiogenic Sr (about 0.7028) plot close to basalts from Tubuai and St. Helena, i.e. distinctly below the main mantle trend in the Nd vs. Sr isotopic diagram. It is suggested that the source of these tholeiites is ancient subducted lithosphere which has suffered previous extraction of liquid with island arc tholeiite composition. -

Law of Thesea
Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea Office of Legal Affairs Law of the Sea Bulletin No. 82 asdf United Nations New York, 2014 NOTE The designations employed and the presentation of the material in this publication do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the Secretariat of the United Nations concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. Furthermore, publication in the Bulletin of information concerning developments relating to the law of the sea emanating from actions and decisions taken by States does not imply recognition by the United Nations of the validity of the actions and decisions in question. IF ANY MATERIAL CONTAINED IN THE BULLETIN IS REPRODUCED IN PART OR IN WHOLE, DUE ACKNOWLEDGEMENT SHOULD BE GIVEN. Copyright © United Nations, 2013 Page I. UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA ......................................................... 1 Status of the United Nations Convention on the Law of the Sea, of the Agreement relating to the Implementation of Part XI of the Convention and of the Agreement for the Implementation of the Provisions of the Convention relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks ................................................................................................................ 1 1. Table recapitulating the status of the Convention and of the related Agreements, as at 31 July 2013 ........................................................................................................................... 1 2. Chronological lists of ratifications of, accessions and successions to the Convention and the related Agreements, as at 31 July 2013 .......................................................................................... 9 a. The Convention ....................................................................................................................... 9 b. -

Photo-Identification of Melon-Headed Whales (Peponocephala Electra) in the Marquesas Islands: Creation of the First Photo-Identification Catalog and Estimation of Group Size and Minimum
AN ABSTRACT OF THE THESIS OF John Ralph McClung II for the degree of Master of Science in Wildlife Science presented on March 9, 2017. Title: Photo-identification of Melon-headed Whales (Peponocephala electra) in the Marquesas Islands: Creation of the First Photo-identification Catalog and Estimation of Group Size and Minimum Abundance in a Remote Archipelago Abstract approved: ________________________________________________________ C. Scott Baker For many species of oceanic dolphins, photo-identification and genetic data indicate that these island-associated populations are demographically isolated from pelagic populations and that island-associated populations exhibit very different patterns of movement and habitat use. Melon-headed whales (Peponocephala electra) are generally considered a pelagic dolphin, but have been documented around oceanic islands where deep water occurs close to shore. In the main Hawaiian Islands, for example, analysis of ten years of photo-identification data shows that melon-headed whales form a relatively small and apparently isolated population. Melon-headed whales have also been documented around several islands in the Marquesas archipelago of French Polynesia, but no information on their population structure in the islands exists. To better understand this population of melon-headed whale, I analyzed over 6,000 photographs collected during Expedition Marquesas, a series of small-boat sampling surveys conducted around six islands – Hiva Oa, Tahuata, Mohotani, Ua Huka, Ua Pou and Nuku Hiva – in March and April of 2012. Photographs and biopsy samples were collected during 14 encounters with melon-headed whales at four of the islands; Mohotani, Ua Huka, Ua Pou, and Nuku Hiva. In this thesis, I compiled the first photo-identification catalog for melon-headed whales in the islands by analyzing photographs to identify individual dolphins based on distinctive markings to their dorsal fins (referred to as distinctively marked individuals or DMIs). -

ROV) in the Marquesas Islands, French Polynesia (Crustacea: Decapoda
Zootaxa 3550: 43–60 (2012) ISSN 1175-5326 (print edition) www.mapress.com/zootaxa/ ZOOTAXA Copyright © 2012 · Magnolia Press Article ISSN 1175-5334 (online edition) urn:lsid:zoobank.org:pub:214A5D4F-E406-4670-BBB6-2EA5931713E9 Deep-water decapod crustaceans studied with a remotely operated vehicle (ROV) in the Marquesas Islands, French Polynesia (Crustacea: Decapoda) JOSEPH POUPIN1, 4, LAURE CORBARI2, THIERRY PÉREZ3 & PIERRE CHEVALDONNÉ3 1Institut de Recherche de l’École Navale, IRENav, groupe des écoles du Poulmic, CC 600, Lanvéoc, F-29240 BREST Cedex 9, France. E-mail: [email protected] 2UMR7138 Systématique, Adaptation, Évolution, Muséum national d’Histoire naturelle, 43 rue Cuvier, 75005 Paris, France. E-mail: [email protected] 3UMR CNRS 7263 IMBE, Institut Méditerranéen de la Biodiversité et d'Écologie marine et continentale, Aix-Marseille Université, Station Marine d'Endoume, Rue de la Batterie des Lions, 13007 Marseille, France. E-mail: [email protected], [email protected] 4Corresponding author Abstract Decapod crustaceans were studied in the Marquesas Islands, French Polynesia, between 50–550 m by using a remotely operated vehicle (ROV) equipped with high resolution cameras and an articulated arm. Careful examination of videos and photographs combined with previous inventories made in the area with conventional gears allowed the identification of 30 species, including 20 species-level determinations. Species identified belong to shrimps (Penaeoidea, Stenopodidea, and Caridea), lobsters (Astacidea and Achelata), anomurans (Galatheoidea and Paguroidea), and brachyuran crabs (Dromioidea, Homolodromioidea, Raninoidea, Leucosioidea, Majoidea, Parthenopoidea, Portunoidea, and Trapezioidea). Most of these species were observed and photographed in situ for the first time. A discussion is given on the geographic distribution, density, ecology, and behavior. -

A DNA Barcode Reference Library of the French Polynesian Shore Fishes 4 5 Erwan Delrieu-Trottin1,2,3,4, Jeffrey T
bioRxiv preprint doi: https://doi.org/10.1101/595793; this version posted June 7, 2019. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license. 1 Data Descriptor 2 3 A DNA barcode reference library of the French Polynesian shore fishes 4 5 Erwan Delrieu-Trottin1,2,3,4, Jeffrey T. Williams5, Diane Pitassy5, Amy Driskell6, Nicolas Hubert1, Jérémie 6 Viviani3,7,8, Thomas H. Cribb9 , Benoit Espiau3,4, René Galzin3,4, Michel Kulbicki10, Thierry Lison de Loma3,4, 7 Christopher Meyer11, Johann Mourier3,4,12, Gérard Mou-Tham10, Valeriano Parravicini3,4, Patrick 8 Plantard3,4, Pierre Sasal3,4, Gilles Siu3,4, Nathalie Tolou3,4, Michel Veuille4,13, Lee Weigt6 & Serge Planes3,4 9 10 1. Institut de Recherche pour le Développement, UMR 226 ISEM (UM2-CNRS-IRD-EPHE), Université de 11 Montpellier, Place Eugène Bataillon, CC 065, F-34095 Montpellier cedex 05, France 12 2. Museum für Naturkunde, Leibniz-Institut für Evolutions-und Biodiversitätsforschung an der Humboldt- 13 Universität zu Berlin, Invalidenstrasse 43, Berlin 10115, Germany 14 3. PSL Research University, EPHE-UPVD-CNRS, USR 3278 CRIOBE, Université de Perpignan, 58 Avenue 15 Paul Alduy, 66860, Perpignan, France. 16 4. Laboratoire d’Excellence «CORAIL», Papetoai, Moorea, French Polynesia , France. 17 5. Division of Fishes, Department of Vertebrate Zoology, National Museum of Natural History, 18 Smithsonian Institution, 4210 Silver Hill Road, Suitland, MD 20746, USA 19 6. Laboratories of Analytical Biology, National Museum of Natural History, Smithsonian Institution, 20 Washington, D.C., 20013, United States of America 21 7. -

French Polynesia): Distribution and Relative Abundance As Obtained from a Small Boat Dedicated Survey
Aquatic Mammals 2002, 28.2, 198–210 Cetaceans of the Marquesas Islands (French Polynesia): distribution and relative abundance as obtained from a small boat dedicated survey Alexandre Gannier Equipe Terre-Océan, U.P.F., BP6570 Faaa Aéroport, Tahiti, French Polynesia and Centre de Recherche sur les Cétacés, 306 avenue Mozart, 06600 Antibes, France Abstract Introduction A dedicated survey of the cetacean population of The Marquesas Archipelago lies in the middle of the Marquesas Islands in French Polynesia, located the tropical Pacific at a latitude of 9)S and a at about 9)S and 140)W, took place from a 15-m longitude of 140)W, between the Eastern Tropical ketch between 29 November 1998 and 27 January Pacific (ETP) and the Society Islands (Fig. 1a). It 1999 and included visual searching (with three includes ten elevated islands, extending over an area observers on duty) and acoustic sampling with a of 91,750 km2 (Fig. 1b). The archipelago is located towed hydrophone. A total effective effort of close to the mesotrophic equatorial band, in con- 2255 km was logged in the study area (63 250 km2), trast to oligotrophic waters found further south around all islands, as well as in the open sea (Longhurst & Pauly, 1987; Longhurst, 1999). More between the islands. The boat moved on zig-zag than 20 species of cetaceans frequent the waters of tracks dictated by sea and wind conditions, cruising French Polynesia, at least seasonally (Reeves et al., on engine most of the time, at a mean speed of 1999). Sightings in the Society Archipelago, about 9 km/h. -

Regional Ecosystems Survey of the South Pacific Area
-1 AVRIt 1981 Technical Paper No. 179 INTERNATIONAL UNION SOUTH PACIFIC COMMISSION FOR CONSERVATION OF NATURE AND NATURAL RESOURCES REGIONAL ECOSYSTEMS SURVEY OF THE SOUTH PACIFIC AREA by Arthur L. Dahl Regional Ecological Adviser South Pacific Commission South Pacific Commission , Noumea, New Caledonia 55/81 June 1980 UIRART \m TABLE OF CONTENTS Page A. Introduction 1 B. Qassification and Characterisation of Ecosystems 5 C. Regional Ecosystems Survey 11 I. New Guinea 24 II. Bismarck Archipelago 31 III. Solomon Islands 33 IV. New Caledonia - Loyalty Islands 36 V. New Hebrides - Santa Cruz Islands 41 VI. Norfolk - Lord Howe - Kermadec 44 VII. Fiji 46 VIII. Tonga - Niue 52 IX. Samoa - Wallis and Futuna 56 X. Tuvalu - Tokelau 61 XI. Kiribati - Nauru 62 XII. Mariana Islands 64 XIII. Caroline Islands 71 XIV. Marshall Islands 76 XV. Phoenix - Line - Northern Cook Islands 78 XVI. Cook - Austral Islands 81 XVII. Society Islands 83 XVIII. Tuamotu Archipelago 86 XIX. Marquesas Islands 88 XX Pitcairn - Gambier Islands - Rapa 91 D. Regional Reserve Network 93 E. Types of Conservation Approaches 94 F. National Conservation Plans 95 G. Acknowledgements 96 Literature Cited 97 (i) 1 A. INTRODUCTION This survey of the ecosystems of the Pacific Islands included within the area of the South Pacific Commission (Fig. 1) has been undertaken to summarise the available informa tion on the need for and present progress towards the conservation of nature in the region and to provide an indication of the environmental framework within which sound develop ment must take place. The study was recommended by the South Pacific Conference on National Parks and Reserves (Wellington, New Zealand, February 1975) which called for a survey of existing and potential protected areas in the South Pacific.