Revue Mycologique
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Strážovské Vrchy Mts., Resort Podskalie; See P. 12)
a journal on biodiversity, taxonomy and conservation of fungi No. 7 March 2006 Tricholoma dulciolens (Strážovské vrchy Mts., resort Podskalie; see p. 12) ISSN 1335-7670 Catathelasma 7: 1-36 (2006) Lycoperdon rimulatum (Záhorská nížina Lowland, Mikulášov; see p. 5) Cotylidia pannosa (Javorníky Mts., Dolná Mariková – Kátlina; see p. 22) March 2006 Catathelasma 7 3 TABLE OF CONTENTS BIODIVERSITY OF FUNGI Lycoperdon rimulatum, a new Slovak gasteromycete Mikael Jeppson 5 Three rare tricholomoid agarics Vladimír Antonín and Jan Holec 11 Macrofungi collected during the 9th Mycological Foray in Slovakia Pavel Lizoň 17 Note on Tricholoma dulciolens Anton Hauskknecht 34 Instructions to authors 4 Editor's acknowledgements 4 Book notices Pavel Lizoň 10, 34 PHOTOGRAPHS Tricholoma dulciolens Vladimír Antonín [1] Lycoperdon rimulatum Mikael Jeppson [2] Cotylidia pannosa Ladislav Hagara [2] Microglossum viride Pavel Lizoň [35] Mycena diosma Vladimír Antonín [35] Boletopsis grisea Petr Vampola [36] Albatrellus subrubescens Petr Vampola [36] visit our web site at fungi.sav.sk Catathelasma is published annually/biannually by the Slovak Mycological Society with the financial support of the Slovak Academy of Sciences. Permit of the Ministry of Culture of the Slovak rep. no. 2470/2001, ISSN 1335-7670. 4 Catathelasma 7 March 2006 Instructions to Authors Catathelasma is a peer-reviewed journal devoted to the biodiversity, taxonomy and conservation of fungi. Papers are in English with Slovak/Czech summaries. Elements of an Article Submitted to Catathelasma: • title: informative and concise • author(s) name(s): full first and last name (addresses as footnote) • key words: max. 5 words, not repeating words in the title • main text: brief introduction, methods (if needed), presented data • illustrations: line drawings and color photographs • list of references • abstract in Slovak or Czech: max. -

Phylum Order Number of Species Number of Orders Family Genus Species Japanese Name Properties Phytopathogenicity Date Pref
Phylum Order Number of species Number of orders family genus species Japanese name properties phytopathogenicity date Pref. points R inhibition H inhibition R SD H SD Basidiomycota Polyporales 98 12 Meruliaceae Abortiporus Abortiporus biennis ニクウチワタケ saprobic "+" 2004-07-18 Kumamoto Haru, Kikuchi 40.4 -1.6 7.6 3.2 Basidiomycota Agaricales 171 1 Meruliaceae Abortiporus Abortiporus biennis ニクウチワタケ saprobic "+" 2004-07-16 Hokkaido Shari, Shari 74 39.3 2.8 4.3 Basidiomycota Agaricales 269 1 Agaricaceae Agaricus Agaricus arvensis シロオオハラタケ saprobic "-" 2000-09-25 Gunma Kawaba, Tone 87 49.1 2.4 2.3 Basidiomycota Polyporales 181 12 Agaricaceae Agaricus Agaricus bisporus ツクリタケ saprobic "-" 2004-04-16 Gunma Horosawa, Kiryu 36.2 -23 3.6 1.4 Basidiomycota Hymenochaetales 129 8 Agaricaceae Agaricus Agaricus moelleri ナカグロモリノカサ saprobic "-" 2003-07-15 Gunma Hirai, Kiryu 64.4 44.4 9.6 4.4 Basidiomycota Polyporales 105 12 Agaricaceae Agaricus Agaricus moelleri ナカグロモリノカサ saprobic "-" 2003-06-26 Nagano Minamiminowa, Kamiina 70.1 3.7 2.5 5.3 Basidiomycota Auriculariales 37 2 Agaricaceae Agaricus Agaricus subrutilescens ザラエノハラタケ saprobic "-" 2001-08-20 Fukushima Showa 67.9 37.8 0.6 0.6 Basidiomycota Boletales 251 3 Agaricaceae Agaricus Agaricus subrutilescens ザラエノハラタケ saprobic "-" 2000-09-25 Yamanashi Hakusyu, Hokuto 80.7 48.3 3.7 7.4 Basidiomycota Agaricales 9 1 Agaricaceae Agaricus Agaricus subrutilescens ザラエノハラタケ saprobic "-" 85.9 68.1 1.9 3.1 Basidiomycota Hymenochaetales 129 8 Strophariaceae Agrocybe Agrocybe cylindracea ヤナギマツタケ saprobic "-" 2003-08-23 -

Fritschiana 42 0009.Pdf
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Fritschiana Jahr/Year: 2003 Band/Volume: 42 Autor(en)/Author(s): Buzina Walter, Braun H., Freudenschuß K., Lackner A., Stammberger H. Artikel/Article: Basidiomyceten in den Atemwegen: Saprophyten oder Pathogene? 9 © Institut für Pflanzenwissenschaften der Karl-Franzens-Universität Graz, Austria, download unter www.biologiezentrum.at - I - - II - FRITSCHIANA 29. Mykologische Dreiländertagung Veröffentlichungen 9. - 14. September 2002 aus dem Institut für Botanik Institut für Botanik, Karl-Franzens-Universität Graz der Karl-Franzens-Universität Graz [http://www-ang.kfunigraz.ac.at/~scheuer/Dreilaendertagung-2002.htm] 42 Veranstalter Institut für Botanik (Karl-Franzens-Universität Graz) Arbeitskreis Heimische Pilze (Naturwissenschaftlicher Verein für Steiermark und Steiermärkisches Landesmuseum Joanneum - Referat Botanik) Österreichische Mykologische Gesellschaft (Institut für Botanik, Universität Wien) Organisationskomitee Dr. Christian Scheuer, Prof. Dr. Paul Blanz (Institut für Botanik) Dir. Harald Kahr, Dr. Alfred Aron, Helmut Pidlich-Aigner (Arbeitskreis Heimische Pilze) 29. Mykologische Dreiländertagung Dkfm. Anton Hausknecht, Wolfgang Klofac (Österreichische Mykologische Gesellschaft) 9. - 14. September 2002 Institut für Botanik Karl-Franzens-Universität Graz Redaktion für die Tagungsbeiträge Dr. Christian Scheuer (Institut für Botanik) Tagungsbeiträge Seite 1–82 (Inhaltsverzeichnis auf -
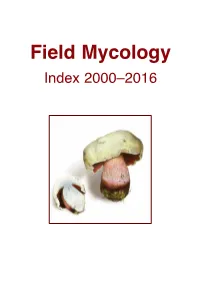
Field Mycology Index 2000 –2016 SPECIES INDEX 1
Field Mycology Index 2000 –2016 SPECIES INDEX 1 KEYS TO GENERA etc 12 AUTHOR INDEX 13 BOOK REVIEWS & CDs 15 GENERAL SUBJECT INDEX 17 Illustrations are all listed, but only a minority of Amanita pantherina 8(2):70 text references. Keys to genera are listed again, Amanita phalloides 1(2):B, 13(2):56 page 12. Amanita pini 11(1):33 Amanita rubescens (poroid) 6(4):138 Name, volume (part): page (F = Front cover, B = Amanita rubescens forma alba 12(1):11–12 Back cover) Amanita separata 4(4):134 Amanita simulans 10(1):19 SPECIES INDEX Amanita sp. 8(4):B A Amanita spadicea 4(4):135 Aegerita spp. 5(1):29 Amanita stenospora 4(4):131 Abortiporus biennis 16(4):138 Amanita strobiliformis 7(1):10 Agaricus arvensis 3(2):46 Amanita submembranacea 4(4):135 Agaricus bisporus 5(4):140 Amanita subnudipes 15(1):22 Agaricus bohusii 8(1):3, 12(1):29 Amanita virosa 14(4):135, 15(3):100, 17(4):F Agaricus bresadolanus 15(4):113 Annulohypoxylon cohaerens 9(3):101 Agaricus depauperatus 5(4):115 Annulohypoxylon minutellum 9(3):101 Agaricus endoxanthus 13(2):38 Annulohypoxylon multiforme 9(1):5, 9(3):102 Agaricus langei 5(4):115 Anthracoidea scirpi 11(3):105–107 Agaricus moelleri 4(3):102, 103, 9(1):27 Anthurus – see Clathrus Agaricus phaeolepidotus 5(4):114, 9(1):26 Antrodia carbonica 14(3):77–79 Agaricus pseudovillaticus 8(1):4 Antrodia pseudosinuosa 1(2):55 Agaricus rufotegulis 4(4):111. Antrodia ramentacea 2(2):46, 47, 7(3):88 Agaricus subrufescens 7(2):67 Antrodiella serpula 11(1):11 Agaricus xanthodermus 1(3):82, 14(3):75–76 Arcyria denudata 10(3):82 Agaricus xanthodermus var. -

Doctoraatsthesis Kris De Gussem
UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT WETENSCHAPPEN Vakgroep Analytische Scheikunde Optimisation of Raman spectroscopy for the analysis of Basidiomycota: spores, latex and mycelium Optimalisatie van Ramanspectroscopie voor de analyse van Basidiomycota: sporen, latex en mycelium Kris De Gussem Academiejaar 2006 - 2007 Proefschrift neergelegd tot het verkrijgen van de graad van Doctor in de Wetenschappen, Scheikunde Promotor: Prof. Dr. Luc Moens Co-promotor: Prof. Dr. Annemieke Verbeken Co-promotor: Dr. Peter Vandenabeele The front page shows a picture of a specimen of Lepista nuda . It was photographed by Martine Decoussemaeker in De Panne (Westhoekreservaat). Lactarius deterrimus (Picture by Ruben Walleyn) Lactarius deterrimus as observed by a mycologist, microscopic view of a lamella (in 10% KOH) (Picture by Jorinde Nuytinck) Intensity (Arbitrary units) 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 Raman shift (cm -1) Lactarius deterrimus as observed by a Raman spectroscopist, Raman spectrum of a single spore 1 cttggtcatt tagaggaagt aaaagtcgta acaaggtttc cgtaggtgaa cctgcggaag 61 gatcattatc gtacaaacat gtgnntgagn ngcgtgcgag ggctgtcgct gactttttga 121 ngacacaaaa gtcgtgcacg ccggagtgcg tcctctnnnn cacantaaaa ntccatctca 181 cccttttgtg caccaccgcg tgggtgccct tcngggatcg aatcgatcca ggagggggnc 241 ttgcgttttc acacaaaccc cttttaaaaa ngtgtagaat gaccccactt tgcgatnnna 301 cgcaatcaat acaactttca acaacggatc tcttggctct cgcatcgatg aagaacgcag 361 cgaaatgcga tacgtaatgt gaattgcaga attcagtgaa tcatcgaatc tttgaacgca 421 ccttgcgccc cttggtattc cgaggggcac acccgtttga gtgtcgtgaa aatctcaacc -

Lactarius Porninsis Rolland, Bull
© Miguel Ángel Ribes Ripoll [email protected] Condiciones de uso Lactarius porninsis Rolland, Bull. Soc. mycol. Fr. 5: 168 (1889) = Lactarius aurantiacus Fr. ss. Quél., Bres. Russulaceae, Russulales, Incertae sedis, Agaricomycetes, Basidiomycota, Fungi = Lactarius tithymalinus ss. Quél. Material estudiado Eslovenia, Sleme Vrsic Pass, 33T VM033438, 1807 m, en bosque mixto de alerce (Larix decidua) y abeto rojo (Picea abies), 11-IX-2007, leg. Miguel Á. Ribes, MAR110907-83; Italia, Dolomitas, Grosté-Refugio de Tuckett, 32T PS443176, 1936 m, en bosque de alerce (Larix decidua), 13-IX-2006, leg. Miguel Á. Ribes, MAR130906-57; Italia, Valle de Ayas, Lac Bleu, 32T MR021818, 1612 m, en pradera con alerce (Larix decidua), 18-IX-2009, leg. Miguel Á. Ribes, MAR180909-02; Suiza, Pontresina, 32T NS681491, 1800 m., en bosque mixto de alerce (Larix decidua) y pino cembro (Pinus cembra), 25-IX-2010, leg. Miguel Á. Ribes, MAR250910 461. Descripción macroscópica Basidiomas con píleos hasta de 10 cm de diámetro, plano-convexo, luego plano y finalmente ligeramente deprimido a infundibuliforme, bastante carnoso, margen ligeramente involuto de joven, con la cutícula sutil, elástica, separable, viscosa en tiempo húmedo, de color anaranjado, naranja-ocre a naranja-rosado, más oscura en el centro, más o menos zonada y con el margen más claro. Láminas densas, subdecurrentes y bifurcadas cerca del estípite, de color ligeramente más claro que la cutícula. Estípite subcilíndrico, ligeramente atenuado en el ápice, pruinoso, lleno en ejemplares jóvenes pero pronto completamente hueco, de color crema-naranja, concolor a las láminas. Olor característico a mandarina o flor de naranjo, sabor no muy agradable y algo amargo. -

Hypogeous Gasteroid Lactarius Sulphosmus Sp. Nov. and Agaricoid Russula Vinosobrunneola Sp
Mycosphere 9(4): 838–858 (2018) www.mycosphere.org ISSN 2077 7019 Article Doi 10.5943/mycosphere/9/4/9 Copyright © Guizhou Academy of Agricultural Sciences Hypogeous gasteroid Lactarius sulphosmus sp. nov. and agaricoid Russula vinosobrunneola sp. nov. (Russulaceae) from China Li GJ1,2, Zhang CL1, Lin FC1*and Zhao RL1,3* 1 State Key Laboratory for Rice Biology, Institute of Biotechnology, Zhejiang University, Hangzhou 310058, China 2 State Key Laboratory of Mycology, Institute of Microbiology, Chinese Academy of Sciences, No. 1 West Beichen Rd, Chaoyang District, Beijing 100101, China 3 College of Life Sciences, University of Chinese Academy of Sciences, Huairou District, Beijing 100408, China Li GJ, Zhang CL, Lin FC, Zhao RL 2018 – Hypogeous gasteroid Lactarius sulphosmus sp. nov. and agaricoid Russula vinosobrunneola sp. nov. (Russulaceae) from China. Mycosphere 9(4), 838– 858, Doi 10.5943/mycosphere/9/4/9 Abstract Two new species of Russulaceae from China are herein described and illustrated based on their morphologies and phylogenies. A hypogeous gasteroid species, Lactarius sulphosmus sp. nov. and an agaricoid species, Russula vinosobrunneola sp. nov. are introduced. The latter is morphologically distinguished from R. sichuanensis, although the ITS-based phylogeny was unable to distinguish them. Therefore, a multi-gene phylogenetic analysis of the nLSU, ITS, mtSSU, and tef-1α gene sequences of Russula subsection Laricinae was carried out, which supports the assertion that they are different species. Key words – Basidiomycota – phylogeny – Agaricomycetes – Russulales – taxonomy Introduction Sequestrate and angiocarpic basidiomata have frequently been observed in many groups of Agaricomycetes (Calonge & Martín 2000, Watling & Martín 2003, Danks et al. 2010, Henkel et al. -

Praktická Mykológia (Možnosti Pestovania a Využívania Húb) Autori
Táto publikácie je financovaná z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre roz- voj vidieka, projekt: Nové možnosti využívania húb človekom v pôdohospodárstve (011BB280003) Martin Pavlík, Marcel Golian, Anna Pavlíková, Pavol Hlaváč Praktická mykológia (Možnosti pestovania a využívania húb) Autori: © Ing. Martin Pavlík, PhD., Ing. Marcel Golian, PhD., PaedDr. Anna Pavlíková, PhD., Ing. Pavol Hlaváč, PhD. OBSAH OBSAH PESTOVANIE HÚB Úvod (Martin Pavlík)....................................................................................................... 7 1 Úvod do mykológie (Martin Pavlík) ........................................................................ 9 1.1 Existencia a rozširovanie húb............................................................................ 9 1.2 Huby v ich prirodzenom prostredí .................................................................. 10 1.2.1 Saprofytické huby................................................................................. 10 1.2.2 Parazitické huby ................................................................................... 10 1.2.3 Symbiotické huby ................................................................................. 11 1.3. Rozdelenie húb ................................................................................................ 12 1.3.1 Oddelenie MYXOMYCOTA – slizovky .............................................. 13 1.3.2 Oddelenie EUMYCOTA – pravé huby ................................................ 14 1.3.2.1 Trieda PHYCOMYCETES – plesne ...................................... -

Detecting the Variability of Hydnum Ovoideisporum (Agaricomycetes, Cantharellales) on the Basis of Italian Collections, and H
Mycosphere Doi 10.5943/mycosphere/4/1/2 Detecting the variability of Hydnum ovoideisporum (Agaricomycetes, Cantharellales) on the basis of Italian collections, and H. magnorufescens sp. nov. Vizzini A1*, Picillo B2, Ercole E1 , Voyron S1 and Contu M3 1Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi, Università degli Studi di Torino, Viale P.A. Mattioli 25, 10125 Torino, Italy 2Via Roma 139, 81017 S. Angelo d’Alife (CE), Italy 3Via Marmilla 12, 07026 Olbia, Italy Vizzini A, Picillo B, Ercole E, Voyron S, Contu M 2013 – Detecting the variability of Hydnum ovoideisporum (Agaricomycetes, Cantharellales) on the basis of Italian collections, and H. magnorufescens sp. nov. Mycosphere 4(1), 32–44, Doi 10.5943 /mycosphere/4/1/2 Hydnum ovoideisporum is a species of the Hydnum rufescens complex recently described from Spain, and characterized by having a pileus with deep orange tones, ovoid to broadly ellipsoid basidiospores, and growing in Mediterranean areas on calcareous soil. In this paper, four South Italian collections found under Quercus and traditionally determined as H. rufescens, were analyzed on the basis of morphological and molecular (ITS) data; three of them were proven to be conspecific with H. ovoideisporum even though they differ from the type by globose to subglobose spores, and one has a smooth hymenophore. H. ovoideisporum f. depauperatum f. nov. is established for accommodating specimens with a smooth hymenophoral surface. Finally, H. magnorufescens sp. nov. is established for a collection with large basidiomes without strong orange-reddish tinges, and with globose to subglobose spores. Key words – Biodiversity – cantharelloid clade – Hydnaceae – ITS nrDNA phylogeny – taxonomy Article Information Received 11 December 2012 Accepted 2 January 2013 Published online 28 January 2013 *Corresponding author: Alfredo Vizzini – e-mail – [email protected] Introduction smooth, colourless, and cystidia usually absent The genus Hydnum L., typified by H. -
Diversity of Mycoflora in Conifer Forests of Munsiary and Its Adjoining Areas of Uttarakhand, India
Received: 14th June-2014 Revised: 30th July-2014 Accepted: 3rd Aug-2014 Research article DIVERSITY OF MYCOFLORA IN CONIFER FORESTS OF MUNSIARY AND ITS ADJOINING AREAS OF UTTARAKHAND, INDIA A.K Das1 and N. Das2* 1P.G. Dept. of Botany, Bethune College, Kolkata 700006, India [email protected] 2P.G. Dept. of Botany, Barasat Govt. College, Barasat, Kolkata 700124, W.B., India Corresponding author: [email protected] ABSTRACT: The present study was carried out in different forest areas of Uttarakhand especially at Munsiary and its adjoining areas between the period of September-October, 2012. Field trips were undertaken at various altitudes ranges from 1500 to 2500 meter. The specimens, especially fruiting bodies of macrofungi were collected and examined in the laboratory. Forty five specimens were identified and all of them were belonged to the subdivision Basidiomycotina. A good number of specimens were found to be associated with forest trees especially with the members of pinaceae for their mycorrhizal association. Key Words: Basidiomycotina, Macrofungal diversity, Mycorrhizal association, Munsiary, Uttarakhand INTRODUCTION Munsiary is a hill resort situated in Pithoragarh district of Uttarakhand of North India. The average temperature during September and October ranges between 14 ⁰C-18 ⁰C. It lies at the base of the great Himalayan mountain range, at an elevation of about 2200m (7200ft.). The forest areas of Munsiary are ideal and represents the most fascinating and characteristic vegetation of Indian subcontinent. Earlier workers have done their research work on the diversity of mushrooms in many areas of Uttarakhand and North western Himalayas [1-6]. But the present workers paid their attention on the study of macrofungal diversity in different forest areas of Munsiary and the adjoining areas of Uttarakhand and provide important information on diversity of macrofungi of mycorrhizal association. -

C=IE, St=Warszawa, O=Ditorpolish Bot, Ou=St
Color profile: Disabled Composite 150 lpi at 45 degrees C:\3stylers\Botanika 2007\Okladka_97.cdr 7 stycznia 2008 17:41:17 Color profile: Disabled Composite 150 lpi at 45 degrees C:\3stylers\Botanika 2007\Okladka_97.cdr 7 stycznia 2008 17:41:17 Botanika 2007.indb 1 2008-01-07 16:40:16 Botanika 2007.indb 2 2008-01-07 16:43:01 CONTENTS 1. Introduction .......................................................................................................................................... 5 2. Study area ............................................................................................................................................. 6 3. History of mycological research in the Góry Świętokrzyskie Mts. ................................................ 15 4. Material and methods ........................................................................................................................ 16 5. Basidiomycetes and plant communities ............................................................................................ 18 5. 1. Syntaxonomic classifi cation of the examined plant communities .......................................... 18 5. 2. Non-forest communities ............................................................................................................ 19 5. 3. Forest communities .................................................................................................................... 38 5. 4. Relationships between plants and Basidiomycetes ............................................................... -

BEDO-Mushroom.Pdf
บัญชีรายการทรัพย์สินชีวภาพ เห็ด บัญชีรายการทรัพย์สินชีวภาพ เห็ด เลขมาตรฐานหนังสือ : ISBN 978-616-91741-0-3 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 พิมพ์ครั้งที่ 1 : มิถุนายน 2556 จัดพิมพ์โดย : ส�านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ที่ปรึกษา : 1. นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ประธานกรรมการบริหารส�านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 2. นางสุชาดา ชยัมภร รองผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ รักษาการแทนผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 3. นายเสมอ ลิ้มชูวงศ์ รองผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ คณะทา� งาน : 1. นายเชลง รอบคอบ นิติกร 2. นางสาวปทิตตา แกล้วกล้า เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ 3. นางสาวศศิรดา ประกอบกุล เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ 4. นายกฤชณรัตน สิริธนาโชติ เจ้าหน้าที่จัดการองค์ความรู้ 5. นายรัตเขตร์ เชยกลิ่น เจ้าหน้าที่จัดการองค์ความรู้ คณะด�าเนินงาน : 1. นางสาวอนงค์ จันทร์ศรีกุล ที่ปรึกษาโครงการฯ ข้าราชการบ�านาญ กรมวิชาการเกษตร 2. ผศ. ดร. อุทัยวรรณ แสงวณิช หัวหน้าโครงการฯ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3. รศ. พูนพิไล สุวรรณฤทธิ์ รองหัวหน้าโครงการฯ ข้าราชการบ�านาญ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4. นางอัจฉรา พยัพพานนท์ ผู้ร่วมโครงการฯ ข้าราชการบ�านาญ กรมวิชาการเกษตร 5. ดร. เจนนิเฟอร์ เหลืองสอาด ผู้ร่วมโครงการฯ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 6. นายบารมี สกลรักษ์ ผู้ร่วมโครงการฯ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ลิขสิทธ์ิโดย : ส�านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 0 2141 7800 โทรสาร 0 2143 9202 www.bedo.or.th