Université D'ottawa University of Ottawa
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

FIERSFIERS !! Des Tonnes D'idées D'activités Pour Célébrer Notre Fierté Pendant Toute L'année…
FIERSFIERS !! Des tonnes d'idées d'activités pour célébrer notre fierté pendant toute l'année… ! La rentrée (septembre) 2 ! La Fête du drapeau franco-ontarien (25 septembre) 4 ! La musique, nos artistes et la Nuit sur l'étang (octobre) 12 ! La Journée des enseignantes et enseignants (octobre) 21 ! La Journée des enfants (novembre) 24 ! La création de la FESFO et « l'Organizzaction! » (novembre) 25 ! Le Jour du souvenir (11 novembre) 29 ! La Fête de la Sainte-Catherine (25 novembre) 30 ! La Journée contre la violence faite aux femmes (6 décembre) 33 ! Le Temps des Fêtes (décembre) 38 ! Une « Bonne année » remplie de fierté! (janvier) 41 ! La Journée anti-toxicomanie (janvier) 46 ! La Victoire sur le règlement 17 (février) 47 ! Le Mois de l'Histoire des Noirs (février) 50 ! La Saint-Valentin (14 février) 52 ! Le Carnaval (février) 53 ! La Semaine de la francophonie (mi-mars) 57 ! La Chaîne humaine SOS Montfort (20 au 22 mars) 63 ! La Journée « Mettons fin au racisme! » (21 mars) 64 ! Le Théâtre et la scène franco-ontarienne (avril) 66 ! La Journée de l'environnement (avril) 68 ! La Semaine du bénévolat (avril) 69 ! La Semaine de l'Éducation (début mai) 70 ! La Semaine des Jeux franco-ontariens (mi-mai) 72 ! La Fête de Dollard (jour de congé férié en mai) 75 ! L'aventure touristique en Ontario français (juin) 77 ! L'arrivée de l'été! (21 juin) 80 ! La Fête de la Saint-Jean Baptiste (24 juin) 81 ! Les « Au revoir »… (fin juin) 82 ! Remerciements 84 AUTRES INFORMATIONS À DÉCOUVRIR ! ! Explications historiques des fêtes du calendrier : Rubrique -

Le Passage Du Canada Français À La Francophonie Mondiale : Mutations Nationales, Démocratisation Et Altruisme Au Mouvement Richelieu, 1944 – 1995
Le passage du Canada français à la Francophonie mondiale : mutations nationales, démocratisation et altruisme au mouvement Richelieu, 1944 – 1995 par Serge Dupuis A thesis presented to the University of Waterloo in fulfilment of the thesis requirement for the degree of Doctor of Philosophy in History Waterloo, Ontario, Canada, 2013 © Serge Dupuis 2013 I hereby declare that I am the sole author of this thesis. This is a true copy of the thesis, including any required final revisions, as accepted by my examiners. I understand that my thesis may be made electronically available to the public. Je déclare par la présente que je suis le seul auteur de cette thèse. Il s’agit d’une copie réelle de la thèse, y compris toute révision finale requise, telle qu’acceptée par les examinateurs. Je comprends que ma thèse pourrait être rendue disponible électroniquement au public. Serge Dupuis 30 August 2013 ii Abstract / Résumé This thesis argues that French Canada did not simply fragment into regional and provincial identities during the 1960s and 1970s, but was also kept afloat by the simultaneous emergence of a francophone supranational reference. In order to demonstrate this argument, I have studied the archives of the Richelieu movement, a French Canadian society founded in 1944 in Ottawa, which was internationalized in the hopes of developing relationships amongst the francophone elite around the world. This thesis also considers the process of democratization and the evolution of conceptions of altruism within the movement, signalling again the degree to which the global project of the Francophonie captivated the spirits of Francophones in North America, but also in Europe, the Caribbean and Africa. -

The FCHS NEWSLETTER President A
The FCHS NEWSLETTER www.frenchcolonial.org President A. J. B. (John) Johnston April 2002 Newsletter Parks Canada, Atlantic Service Center 1869 Upper Water St. 2nd Floor, Pontac House Halifax, Nova Scotia B3J 1S9 Tel. 902-426-9805 Fax. 902-426-7012 e-mail: [email protected] This issue of the Newsletter is packed with useful information, including the preliminary Past President Dale Miquelon program for the upcoming New Haven meeting. History Department Please send in your registration forms as soon as University of Saskatchewan Saskatoon, Sask. S7N 0W0 possible so that the conference organizers can plan Tel. 306-242-1745 accordingly for the Mystic Seaport trip and the Fax 306-966-5852 Saturday banquet. Also included in this issue are e-mail: [email protected] the minutes from our last meeting in Detroit, Vice President notices, a message from the President, a final update Robert S. DuPlessis Department of History on the transition from the Proceedings to a journal Swarthmore College format, and a call for papers for the 2003 meeting to 500 College Ave be held in Toulouse, France. Swarthmore, PA 19081-1397 Tel. 610-328-8131 Also enclosed with this edition of the Fax 610-328-8171 Newsletter is an advertisement insert for two e-mail [email protected] volumes of potential interest published by the Secretary-Treasurer University of Rochester Press. William Newbigging Finally, the webpage continues to attract Department of History Algoma University College interest from potential new members and contains a 1520 Queen Street East useful list of links. As usual, information for Sault Ste. -

White Paper on Francophone Arts and Culture in Ontario Arts and Culture
FRANCOPHONE ARTS AND CULTURE IN ONTARIO White Paper JUNE 2017 TABLE OF CONTENTS SUMMARY 05 BACKGROUND 06 STATE OF THE FIELD 09 STRATEGIC ISSUES AND PRIORITY 16 RECOMMANDATIONS CONCLUSION 35 ANNEXE 1: RECOMMANDATIONS 36 AND COURSES OF ACTION ARTS AND CULTURE SUMMARY Ontario’s Francophone arts and culture sector includes a significant number of artists and arts and culture organizations, working throughout the province. These stakeholders are active in a wide range of artistic disciplines, directly contribute to the province’s cultural development, allow Ontarians to take part in fulfilling artistic and cultural experiences, and work on the frontlines to ensure the vitality of Ontario’s Francophone communities. This network has considerably diversified and specialized itself over the years, so much so that it now makes up one of the most elaborate cultural ecosystems in all of French Canada. However, public funding supporting this sector has been stagnant for years, and the province’s cultural strategy barely takes Francophones into account. While certain artists and arts organizations have become ambassadors for Ontario throughout the country and the world, many others continue to work in the shadows under appalling conditions. Cultural development, especially, is currently the responsibility of no specific department or agency of the provincial government. This means that organizations and actors that increase the quality of life and contribute directly to the local economy have difficulty securing recognition or significant support from the province. This White Paper, drawn from ten regional consultations held throughout the province in the fall of 2016, examines the current state of Francophone arts and culture in Ontario, and identifies five key issues. -

Preventing the Burden of Occupational Cancer in Canada
Preventing the Burden of Occupational Cancer in Canada STAKEHOLDER SYMPOSIUM REPORT Vancouver, BC March 31st, 2016 ©CAREX Canada Burden of Occupational Cancer – Symposium Report Table of Contents Introduction _________________________________________________________________ 2 The Burden of Occupational Cancer Study _________________________________________ 3 Human Burden ____________________________________________________________________ 3 Economic Burden __________________________________________________________________ 3 Crystalline Silica ______________________________________________________________ 4 Panel Q&A Themes_________________________________________________________________ 6 Diesel Engine Exhaust _________________________________________________________ 7 Panel Q&A Themes_________________________________________________________________ 9 Asbestos ___________________________________________________________________ 10 Panel Q&A Themes________________________________________________________________ 13 Solar Radiation ______________________________________________________________ 14 Panel Q&A Themes________________________________________________________________ 16 Priorities for Prevention_______________________________________________________ 17 Crystalline Silica __________________________________________________________________ 17 Diesel Engine Exhaust _____________________________________________________________ 18 Asbestos ________________________________________________________________________ 19 Solar Radiation ___________________________________________________________________ -

Qui-Suis-Je Réponses Et Démarche
1. Vous pouvez créer votre propre banque de référents culturels selon votre région 2. Imprimez les photos 3. Coller une image derrière le dos de chacun des participants 4. Les participants doivent se promener et essayer de deviner qui est dans leur dos en posant des questions aux autres participants 5. Lorsque la personne a deviné son référent culturel, elle doit le prendre et le coller sur le mur 6. Faire un retour en présentant les différents référents culturels dévoilés Image Nom/organisme ou autre Description 1 Ronald Caza Avocat qui a défendu la cause Montfort et plusieurs autres causes francophones 2 Le pape François Notre pape 3 Improtéine Groupe d’improvisation francophone très populaire en Ontario 4 Bernard-Grandmaître Ancien politicien. Une école élémentaire porte son nom 5 Damien Robitaille Artiste francophone originaire de Lafontaine en Ontario 6 Le Paysagiste Artiste franco-ontarien originaire de Sudbury. Son vrai nom: Dayv Poulin 7 Justin Trudeau Premier ministre du Canada 8 Stef Paquette Artiste franco-ontarien originaire de Hammer en Ontario. Improvisateur, comédien, chanteur 9 Jeanne-Lajoie Originaire de Lefaivre en Ontario, ancienne enseignante qui a défendu le droit à l’éducation en français. Une école porte maintenant son nom 10 Samuel-Genest Personnage important dans la création de nos propres conseils scolaires francophones. Une école secondaire porte son nom 11 Paul Demers Artiste franco-ontarien, auteur de la célèbre chanson Notre-Place. Ancien animateur culturel au Collège catholique Samuel-Genest 12 Lise Paiement Ancienne enseignante qui a eu beaucoup d’impact sur la francophonie en Ontario. Responsable de la mise en oeuvre de la pédagogie culturelle. -

AUTHOR Guindon, Rene; Poulin, Pierre Francophones in Canada: A
DOCUMENT RESUME ED 429 441 FL 025 787 AUTHOR Guindon, Rene; Poulin, Pierre TITLE Francophones in Canada: A Community of Interests. New Canadian Perspectives . Les liens dans la francophonie canadienne. Nouvelles Perspectives Canadiennes. INSTITUTION Canadian Heritage, Ottawa (Ontario). ISBN ISBN-0-662-62279-0 ISSN ISSN-1203-8903 PUB DATE 1996-00-00 NOTE 112p. AVAILABLE FROM Official Languages Support Programs, Department of Canadian Heritage, 15 Eddy, Ottawa, Ontario, Canada K1A-0M5 (Cat. no. CH-2/1-1996); Tel: 819-994-2224; Web site: http://www.pch.gc.ca/offlangoff/perspectives/index.htm (free). PUB TYPE Books (010)-- Reports Descriptive (141)-- Multilingual/Bilingual Materials (171) LANGUAGE English, French EDRS PRICE MF01/PC05 Plus Postage. DESCRIPTORS Cultural Exchange; Demography; Economic Factors; Educational Mobility; Educational Policy; Faculty Mobility; Foreign Countries; *French; *French Canadians; Information Dissemination; *Intergroup Relations; Kinship; *Land Settlement; *Language Minorities; *Language Role; Mass Media; Migration Patterns; Shared Resources and Services; Social Networks; Social Support Groups; Tourism IDENTIFIERS *Canada; Francophone Education (Canada); Francophonie ABSTRACT This text examines the ties that bind Francophones across Canada to illustrate the diversity and depth of the Canadian Francophone community. Observations are organized into seven chapters. The first looks at the kinship ties of Canadian Francophones, including common ancestral origins, settlement of the Francophone regions, and existence of two particularly large French Canadian families, one in Acadia and one in Quebec. The second chapter outlines patterns of mobility in migration, tourism, and educational exchange. Chapter three looks at the circulation of information within and among Francophone communities through the mass media, both print and telecommunications. The status of cultural exchange (literary, musical, and theatrical) is considered next. -

Solutions for Workplace Change: Funded Projects, 1999-2011
Solutions for Workplace Change: Funded Projects, 1999-2011 Prepared by the WSIB Research Secretariat Updated May 1, 2012 Funded Projects, 1999-2011 Page 3 Introduction The Solutions for Workplace Change competitive research grants program reflects the ongoing commitment of Ontario‘s Workplace Safety & Insurance Board (WSIB) to high quality occupational health and safety and workers‘ compensation research. The program‘s purpose is to fund rigorous scientific research aimed at preventing occupational injury and disease; improving diagnosis, treatment, rehabilitation, and return to work of injured workers; studying knowledge transfer and exchange; and ensuring the early and safe return to work and fair compensation of injured workers and the appropriate assessment of employers. The objectives of the research grants program are to support research directions that reflect the needs of Ontario workplaces, to develop a research program that meets international stan- dards of excellence, to expand Ontario‘s research capacity in occupational health and safety and workers‘ compensation, and to coordinate WSIB-supported research in Ontario. Solutions for Workplace Change is overseen by a multi-stakeholder Research Advisory Council (RAC), composed of representatives of researchers, workers, employers, health and safety associations, the Ministry of Labour, the Institute for Work & Health, and the WSIB. The RAC reviews all grant applications through a peer-review process, and makes funding recommen- dations to the WSIB Board of Directors. The program also funds two Centres of Research Expertise: the Centre of Research Expertise on the Prevention of Musculoskeletal Disorders (CRE-MSD), administered through the University of Waterloo and directed by Dr Richard P. Wells, and the Centre of Research Expertise in Occupational Disease (CREOD), administered through the University of Toronto and St. -
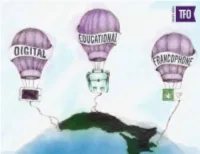
2016-2017, Groupe Média TFO Continued Its Digital Transformation
Groupe Média TFO is a premium destination for audiences seeking innovative educational and cultural content in French, always at the forefront of digital learning. TFO is at the service of 2 million students and 30 000 teachers throughout Ontario and Canada, and has the number-one educational YouTube in French channel in Canada. We have received awards and accolades from Austin to Amsterdam (Kidscreen Awards, Gémeaux, Caissies, IBC Awards, SXSW Film Design Awards and more). 5 TABLE OF CONTENTSTABLE OF 08 MESSAGE FROM THE CHAIR OF INNOVATION AND CREATIVITY 50 INNOVATIVE INITIATIVES THE BOARD OF DIRECTORS 25 LABORATOIRE D’UNIVERS MaXi 09 MESSAGE FROM THE PRESIDENT IDÉLLO’s transformed classroom VIRTUELS FSL students are all ears on IDÉLLO’s À L’ÉCOUTE AND CEO 36 MINIVERSE: A TINY SHOW THAT SAW BIG New ways to learn with IDÉLLO 38 MINI TFO: THE FORERUNNER TO MINIVERSE Vubble WHO ARE WE? Les Tablettistes 40 ORIGINAL EDUCATIONAL CONTENT IN FRENCH 13 OUR MANDATE FLIPTUBEUR 48 PROGRAMMING IN TUNE WITH OUR VALUES FLIP TFO 14 MISSION, VISION, VALUES Planète BRBR 15 OUR STRATEGIC GOALS BRBR 16 STRATEGIC POSITIONING 66 DIGITAL PROPERTIES STATEMENT Immersive, fun, educational applications 17 STRATEGIC PLANNING Something for everyone on TFO.ORG ONproduit.ca 18 THE BOARD OF DIRECTORS 19 MANAGEMENT TEAM 6 THE FRANCO-ONTARIAN OUR DRIVING FORCES RESULTS COMMUNITY: THE HEARTBEAT OF 89 A STRONG, AMBITIOUS EMPLOYER BRAND 107 OUR ACCOMPLISHMENTS TFO 90 OUR CREATIVE TALENT 112 PRIZES AND AWARDS 73 TFO GOES ON THE ROAD TO MEET WITH THE 93 T.A.C.O. 115 OUR MILESTONES COMMUNITY 95 AGREEMENTS AND PARTNERSHIPS: A 76 TFO PRODUCTIONS: PUTTING ONTARIO SPRINGBOARD FOR LA FRANCOPHONIE FRANCOPHONES CENTRE STAGE FINANCIAL STATEMENTS #ONfr TFO 24.7, The New Francophone Perspective TOWARD.. -

Édition De Septembre 2017
UNE RENTRÉE EN VERT ET BLANC! IDELLO SE FAIT REMARQUER À NICE CET ÉTÉ! En septembre, l’Ontario français est 03 COUP DE CŒUR à l’honneur sur IDÉLLO! Doublement cette Idello se fait remarquer à Nice cet été! année, car TFO fête ses 30 ans en 2017! Trente années pendant lesquelles 04 UNE RENTRÉE EN VERT ET BLANC! l’organisation qui s’appelait La Chaîne Découvrez les ressources d'IDÉLLO pour à ses débuts, a accompagné et participé célébrer le Jour des Franco-Ontariens, activement à dynamiser et enrichir la le 25 septembre culture franco-ontarienne. La collaboration également prend une large place dans cette édition. Une compétence Ça n’est pas pour faire des jaloux, mais il a fait bon vivre et FLIPTUBEURS 2.0 07 clé qu’IDÉLLO vous aide à développer apprendre en cet été de 2017 sur la Côte d’Azur, en France. chaque jour avec vos élèves et vos enfants. Comme chaque année, les Universités du Monde qui se 08 FAÇONNER LES 150 ANNÉES Bon retour en salle de classe et très bonne tiennent au Lycée du Parc Impérial de la ville de Nice, furent AU CANADA année scolaire 2017-2018 à toutes et tous! l’occasion pour une rencontre de professeurs de français WorldVuze et IDÉLLO aident les jeunes de tout langue seconde (FLS) ou de français langue étrangère (FLE) le pays à y contribuer Hélène Chalant qui viennent se ressourcer et apprendre de façon harmonieuse Apprentissage numérique et amicale. Les Canadiens membres de l’ACPI contribuent Groupe Média TFO 10 COMPÉTENCES DU 21E SIÈCLE à cette belle aventure depuis quelques années déjà. -
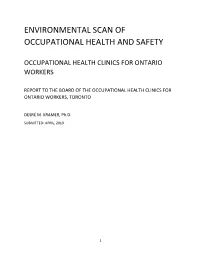
Environmental Scan of Occupational Health and Safety
ENVIRONMENTAL SCAN OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY OCCUPATIONAL HEALTH CLINICS FOR ONTARIO WORKERS REPORT TO THE BOARD OF THE OCCUPATIONAL HEALTH CLINICS FOR ONTARIO WORKERS, TORONTO DESRÉ M. KRAMER, Ph.D. SUBMITTED: APRIL, 2019 1 Contents Executive Summary ....................................................................................................................................... 4 Scope of the Environmental Scan on Work and Health ................................................................................ 5 Key Informant Interviews.......................................................................................................................... 6 Document review ...................................................................................................................................... 7 1. The Economic Environment ...................................................................................................................... 9 1.1. Changes in the Global Market............................................................................................................ 9 1.2. Income Inequity/Disparity ............................................................................................................... 10 1.3. State of the Canadian/Ontario Labour Market ................................................................................ 12 1.4 Union Membership in Canada .......................................................................................................... 12 1.5. Unemployment -

Info Liaison
Document generated on 10/01/2021 4:15 p.m. Liaison Info Liaison Number 93, September 1997 URI: https://id.erudit.org/iderudit/41932ac See table of contents Publisher(s) Les Éditions l'Interligne ISSN 0227-227X (print) 1923-2381 (digital) Explore this journal Cite this document (1997). Info Liaison. Liaison, (93), 40–42. Tous droits réservés © Les Éditions l'Interligne, 1997 This document is protected by copyright law. Use of the services of Érudit (including reproduction) is subject to its terms and conditions, which can be viewed online. https://apropos.erudit.org/en/users/policy-on-use/ This article is disseminated and preserved by Érudit. Érudit is a non-profit inter-university consortium of the Université de Montréal, Université Laval, and the Université du Québec à Montréal. Its mission is to promote and disseminate research. https://www.erudit.org/en/ Nouvelle série Prix littéraire PIERRE PELLETIER président de la FCCF culturelle à TfO Jacques-Poirier 1998 Les Productions Médiatique, Artiste-écrivain bien connu Connections productions et Les écrivains ont jusqu'au 3 pour son leadership dans le TfO mettent en ondes la octobre 1997 pour faire par milieu culturel ontarien, Pierre nouvelle émission Boîte à venir leurs manuscrits au Raphaël Pelletier a été élu à chansons d'aujourd'hui, cet jury du Prix littéraire Jacques- la présidence de la Fédération automne, qui présentera des Poirier-Outaouais 1998. Ce culturelle canadienne-française artistes de l'Acadie et d'ici : prix comporte une bourse de (FCCF). « C'est par le biais Aymar, Paquette, Poliquin, 2 500 $, la publication de de projets forts et d'activités Brasse Camarade, Breen Le l'ouvrage chez VLB éditeur bien précises sur le terrain, bœuf, Josée Gauvreau, Éric et une invitation au Salon par une diffusion accrue des Dubeau Joëlle Roy, Deux du livre de l'Outaouais.