SERVIR Commeire
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

03148-0389 ©2014 by REVELL Gmbh
® Sd.Kfz. 164 „Nashorn“ 03148-0389 ©2014 BY REVELL GmbH. A subsidiary of Hobbico, Inc. PRINTED IN GERMANY Sd.Kfz. 164 „Nashorn“ Sd.Kfz. 164 „Nashorn“ Insgesamt wurden zwischen 1942-1944 ca. 500 Fahrzeuge Between 1942 and 1944 the total number built of this self- dieses Panzerjägers auf Selbstfahrlafette (Basis Panzer III/IV) propelled anti-tank gun based on the chassis of the Panzer III/IV gebaut. Die starke 8,8 cm Pak konnte jeden Feindpanzer bereits tank, was approx. 500. The powerful 8.8 cm Pak could destroy auf große Entfernungen zerstören. Die Panzerung konnte any enemy tank from great distances. The armour however, wegen des Gewichtslimits von 24 Tonnen jedoch nicht mit der due to its weight limit of 24 tonnes, could not compete with eines Kampfpanzers mithalten. In vorbereiteten Stellungen und that of a battle tank. In prepared and defensive positions the in der Defensive bewährte sich das Nashorn auch gegen große Nashorn (Rhinoceros) also proved itself against large tank units Panzerrudel und war bis zur Einführung der Jagdpanzer IV und and remained the most effective German tank destroyer until Jagdpanther der effektivste deutsche Panzerjäger. the introduction of the Jagdpanzer IV and Jagdpanther. 03148 PAGE 2 03148 Verwendete Symbole / Used Symbols Bitte beachten Sie folgende Symbole, die in den nachfolgenden Baustufen verwendet werden. Please note the following symbols, which are used in the following construction stages. Veuillez noter les symboles indiqués ci-dessous, qui sont utilisés dans les étapes suivantes du montage. Neem a.u.b. de volgende symbolen in acht, die in de onderstaande bouwfasen worden gebruikt. -
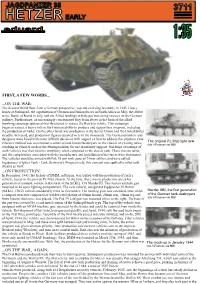
Jagdpanzer 38 Hetzer Early
JAGDPANZER38 3711 HETZER EARLY eduard 1:35 FIRST, A FEW WORDS... ...ON THE WAR: The Second World War, from a German perspective, was not evolving favorably in 1943. Heavy losses at Stalingrad, the capitulation of German and Italian forces in North Africa in May, the defeat at the Battle of Kursk in July, and the Allied landings in Italy put increasing stresses on the German military. Furthermore, an increasingly concentrated fury from above in the form of the allied bombing campaign appeared that threatened to reduce the Reich to rubble. This campaign began to extract a heavy toll on the German ability to produce and support her weapons, including the production of tanks. On the other hand, war production in the Soviet Union and the United States steadily increased, and production figures attained were in the thousands. The German planners and designers were faced with some difficult decisions with respect on how to address the situation. One The original Pz.38(t) light tank effective method was to construct a series of tank hunter/destroyers on the chassis of existing tanks, foto V.Francev via MBI resulting in vehicles such as the Sturmgeschütz, for use in infantry support. One huge advantage of such vehicles was their relative simplicity when compared to the classic tank. There was no turret, and the complexities associated with the manufacture and installation of the turret were eliminated. The vehicles would be armed with Pak 39 anti tank guns of 75mm caliber, and were called Jagdpanzer (Fighter Tank - Tank Destroyer). Progressively, this concept was applied to other tank chassis as well. -

1 Title Fonts
TITLE FONTS “Quotes Quotes Quotes Quotes Quotes Quotes Quotes Quotes Quotes Quotes Quotes Quotes Quotes Quotes Quotes Quotes Quotes Quotes Quotes Quotes Quotes Quotes.” - Quoted Person Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla sollicitudin mi sed pulvinar ornare. Aliquam mollis enim eu fermentum consequat. Quisque metus augue, tristique sit amet tortor eget, accumsan placerat orci. Donec non fringilla turpis, nec congue enim. # Result # Result # Result 11 31 51 12 32 52 13 33 53 14 34 54 15 35 55 16 36 56 21 41 61 22 42 62 23 43 63 24 44 64 25 45 65 26 46 66 1 Matt Russell (order #9597485) Not One Step Back Comrades Matt Russell (order #9597485) The Directorate of the Armoured Forces of the Red Army HELL ON TREADS T34 Tank SERVICE MANUAL and D66 Tables Moscow 1942 Peoples Technical Writer DEREK CHAPPELL EDITing Commisar JOE MCNEIL Matt Russell (order #9597485) Table of Contents Allied Tanks 4-5 Axis Tanks 6-7 Crew Generator 8 Crew Twist Generator 9 Standard Feature Generator 10 Strange Feature Generator 11 Mission Generator 12-13 Obstacle Generator 14 Complication Generator 15 2 Matt Russell (order #9597485) Introduction The d66 Table is a random generation table, crewed by two brave six- sided die and ready to serve the Motherland! Using these tables, much stress can be avoided by tank crews, as these clever systems, designed by top Soviet Roleplaying Engineers beyond the Ural Mountains, allow the automation of previously difficult choices which could paralyze a man with indecision! The Operation of the d66 Table is simple, and will pose no great challenge to the clever Soviet crewman. -

GURPS WWII Classic
World War II raged from the deserts of North Africa to the jungles of the South Pacific, from the mountaintops of the Alps to the beaches of Normandy, across (and under) the high seas, and through the skies above it all. Soldiers in all of these places relied upon the machines of war: bombers, fighters, tanks, jeeps, ships, submarines, landing craft, and much more. GURPS WWII: Motor Pool has a huge variety of historically accurate vehicles from mankind’s greatest conflict. Many of the vehicles were common; others were rare or even unique. From the stodgy General Lee tank to the earliest helicopters and the wildly impractical Maus, Motor Pool has tons of new gear for every GURPS WWII player. Motor Pool also gathers in one place all the refinements to the vehicle design system that have evolved since the original corebook came out, as well as a new system to describe any WWII-era conveyance in a few simple steps. These additions include scores of new weapons to be fitted on your war machines – some historical and some products of the imagination. On top of all that, Motor Pool has advice on S how to integrate vehicles into a roleplaying T E campaign, with details on how vehicle crews V really lived and fought, from the difficulties of E supply to getting their machine moving at all. J A Whether you’re campaigning by land, by sea, or C by air, Motor Pool dramatically expands your K options! S O N . AGAINST HEAVY METAL! FIRST EDITION,FIRST PRINTING G A PUBLISHED APRIL 2004 M ISBN 1-55634-642-5 E 9!BMF@JA:RSUSQQoYjZ]ZiZdZ` S 8 0 1 Printed in 1 SJG02495 8011 the USA World War II raged from the deserts of North Africa to the jungles of the South Pacific, from the mountaintops of the Alps to the beaches of Normandy, across (and under) the high seas, and through the skies above it all. -

Zoznam Prihlásených Modelov
súťažné autor model kategória mierka číslo 1. Peter Kuba Messerschmitt Bf 109 E3 LVS1 1/72 Messerchmitt Bf 110 C -6, 2. Peter Kuba DS 1/72 Kettenkrad, personál 3. Peter Kuba Messerschmitt Bf 109 G6/AS LVS1 1/72 4. Peter Kuba P 51D Mustang LVS1 1/72 5. Marek Hrin Avro Lancaster Mk III Dambuster LVS1 1/72 6. Lukáš Harant CAS K27 Tatra 815 PT - 7. Lukáš Harant AV14 Tatra 815 PT - 8. Lukáš Harant Tatra 815 200N51 PT - 9. Lukáš Harant OT -64 PT - 10. Lukáš Harant Maměnka z Pu steven PS - 11. Lukáš Harant 422.025 Arcivévoda Karel PO - 12. Marián Bartúnek Sd.Kfz 7/2 BTRP2 1/35 13. Marián Bartúnek Sturmtiger BTRP2 1/35 14. Marián Bartúnek Tiger I BTRP2 1/35 15. Marián Bartúnek Sd.Kfz. 223 BTRK2 1/35 16. Ivan Stančík F-15 E LPS2 1/48 17. Ivan Stančík MiG -21 F LPS2 1/48 18. Ivan Stančík Jak 3 LVS2 1/48 19. Ivan Stančík Spitfire Mk VIII LVS2 1/48 20. Andrej Balog VW Golf GTI CDR 1/24 Ing. Anton - Lištová kosačka Agrosam - 1/8 Baumann 21. Lukáš Hulvák Peugeot 20 7 S2000: Solberg - Patterson CDR 1/24 22. Peter Pilát BMW r75 DS 1/35 23. Peter Pilát Zundap 750 DS 1/35 24. Petr Chalupa Bell 47h 13 MASH LPS1 1/72 25. Petr Chalupa VT -34 ČSLA BTRP2 1/35 26. Petr Chalupa IDF -M113 Fitter BTRP2 1/35 - Petr Chalu pa M10, Normandy, 1944 BTRP2 1/35 - Petr Chalupa M36 Jackson BTRP2 1/35 - Petr Chalupa M32 ARV BTRP2 1/35 - Petr Chalupa M3A1 Scout Car DS 1/35 27. -

Catalogos Modelismo Enero 2021.Xlsx
AEROBONUS 350001 1/35 WWII German Submarine Kriegsmarine Sailor #1 (Standing, Arms Bent) Bs150 AEROBONUS 350002 1/35 WWII German Submarine Kriegsmarine Crew #1 (Sitting, Arms Up) Bs150 AEROBONUS 350003 1/35 WWII German Submarine Kriegsmarine Crew #2 (Sitting, Arms Bent) Bs150 AEROBONUS 350004 1/35 WWII German Submarine Kriegsmarine Sailor #2 (Bending) Bs150 AEROBONUS 350005 1/35 WWII German Submarine Kriegsmarine Sailor w/Rope Bs150 AEROBONUS 350006 1/35 WWII German Submarine Kriegsmarine Sailor #3 (Posed as Climbing Ladder) Bs150 AEROBONUS 350007 1/35 WWII German Submarine Kriegsmarine Sailor #4 (Sitting, Arms Down) Bs150 AEROBONUS 350008 1/35 WWII German Submarine Kriegsmarine Sailor #5 (One Knee Bent) Bs150 AEROBONUS 350009 1/35 WWII German Submarine Kriegsmarine Sailor #6 (Standing, Arms at Side) Bs150 AEROBONUS 350010 1/35 WWII German Submarine Kriegsmarine Officer w/Binoculars Bs150 AEROBONUS 350011 1/35 WWII German Submarine Kriegsmarine Ceremony Officer #1 Bs150 AEROBONUS 350012 1/35 WWII German Submarine Kriegsmarine Ceremony Officer #2 (Saluting) Bs150 AEROBONUS 350013 1/35 WWII German Schnellboat Kriegsmarine Ceremony Sailor #1 Bs150 AEROBONUS 350014 1/35 WWII German Schnellboat Kriegsmarine Ceremony Sailor #2 Bs150 AEROBONUS 350015 1/35 WWII Geramn Schnellboat Kriegsmarine Ceremony Sailor #3 Bs150 AEROBONUS 350016 1/35 WWII German Schnellboat Kriegsmarine Ceremony Sailor #4 Bs150 AEROBONUS 350017 1/35 WWII Geramn Schnellboat Kriegsmarine Ceremony Sailor #4 Bs150 ACADEMY 12115 1/35 AH60L DAP Black Hawk Helicopter Bs865 ACADEMY -

Sd. Kfz. 164 Nashorn Sd
Sd. Kfz.164 Nashorn 03148-0389 2005 BY REVELL GmbH & CO. KG PRINTED IN GERMANY Sd. Kfz. 164 Nashorn Sd. Kfz. 164 Nashorn Insgesamt wurden zwischen 1942-44 ca. 500 Fahrzeuge dieses Between 1942 and 44 the total number built of this self-pro- Panzerjägers auf Selbstfahrlafette (Basis Panzer III/IV) gebaut. pelled anti-tank gun based on the chassis of the Panzer III/IV Die starke 8,8cm Pak konnte jeden Feindpanzer bereits auf tank, was approx. 500. The powerful 8.8 cm Pak could destroy große Entfernungen zerstören. Die Panzerung konnte wegen any enemy tank from great distances. The armour however, des Gewichtslimits von 24t jedoch nicht mit der eines due to its weight limit of 24 tonnes, could not compete with Kampfpanzers mithalten. In vorbereiteten Stellungen und in that of a battle tank. In prepared and defensive positions the der Defensive bewährte sich das Nashorn auch gegen große Nashorn (Rhinoceros) also proved itself against large tank units Panzerrudel und war bis zur Einführung der Jagdpanzer IV und and remained the most effective German tank destroyer until Jagdpanther der effektivste deutsche Panzerjäger. the introduction of the Jagdpanzer IV and Jagdpanther. 03148 Vor dem Zusammensetzen gut durchlesen! Read before you start! D: Achtung: Jedes Teil ist numeriert (1). Reihenfolge der Montageschritte beachten. Benötigte Werkzeuge: Messer und Feile N: OBS! Les nøye igjennom monteringsanvisningen før sammenbyggingen. Hver del er nummerert (1). Følg rekkefølgen på monter- zum Entfernen und Entgraten der Teile (2) Gummiband, Klebeband und Wäscheklammern zum Zusammenhalten der geklebten ingstrinnene. N ødvendig verktøy: Kniv og fil for fjerning av grader på delene (2), gummibånd, tape og klesklyper for å holde sam- Einzelteile (3). -

Diplomová Práce Finální Verze Pro
Západo česká univerzita v Plzni Fakulta filozofická Diplomová práce Srovnání tankových vojsk SSSR a nacistického N ěmecka v období 2. sv ětové války Ladislav Sluka Plze ň 2019 Západo česká univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra historických v ěd Studijní program Historické v ědy Studijní obor Moderní d ějiny Diplomová práce SROVNÁNÍ TANKOVÝCH VOJSK SSSR A NACISTICKÉHO N ĚMECKA V OBDOBÍ 2. SV ĚTOVÉ VÁLKY Ladislav Sluka Vedoucí práce: PhDr. Roman Kodet Ph.D. Katedra historických v ěd Fakulta filozofická Západo české univerzity v Plzni Plze ň, 2019 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalá řskou/diplomovou práci na téma "Srovnání tankových vojsk SSSR a Nacistického N ěmecka v období 2. sv ětové války" vypracoval samostatn ě pod odborným dohledem vedoucího diplomové práce za použití pramen ů uvedených v p řiložené bibliografii. Plze ň, dne 29.4.2019 …………………………… podpis autora 1 Úvod.............................................................................................................................1 2 SSSR a N ěmecko v období mezi válkami....................................................................4 2.1 Státní politika, ekonomika a pr ůmysl...................................................................4 2.2 Armáda..................................................................................................................9 2.3 Tankové síly........................................................................................................11 2.4 Sov ětsko-n ěmecká spolupráce............................................................................16 -

Jagdpanzer 38 Hetzer (Sd.Kfz.138/2), Se Od Starého Typu the First Prototype at April 1St, 1944 Antitank Gun Mounted in an Open Fighting Compartment
JAGDPANZER38 3713 HETZER MID production eduard 1:35 FIRST, A FEW WORDS... NEJPRVE NÌKOLIK SLOV... ...ON THE WAR: ...O VÁLCE The Second World War, from a German perspective, was not V roce 1943 se válka z pohledu Nìmecka nevyvíjela dobøe. evolving favorably in 1943. Heavy losses at Stalingrad, Po tìžž kých porá kách u Stalingradu v únoru, po kapitulaci the capitulation of German and Italian forces in North Africa nìmeckých a italských vojsk v Severní Africe v kvìtnu, in May, the defeat at the Battle of Kursk in July, and the Allied po prohrané bitvì u Kurska vè ervenci a vylodìní spojencù landings in Italy put increasing stresses on the German v Itálii se nìmecké ozbrojené síly dostávaly pod stále sílící military. Furthermore, an increasingly concentrated fury from tlak spojeneckých armád. A co více, pomalu, ale jistì, se above in the form of the allied bombing campaign appeared rozbíhala spojenecká bombardovací ofenzíva, která již brzy The original Pz.38(t) light tank that threatened to reduce the Reich to rubble. This campaign mìla zmìnit Nìmecko v hromadu trosek. Tato bombardovací foto V.Francev via MBI began to extract a heavy toll on the German ability to produce ofenzíva významnì rozvracela nìmecké výrobní kapacity and support her weapons, including the production of tanks. a naruš ovala i výrobu tankù. Na druhé stranì, výrobní linky On the other hand, war production in the Soviet Union and the v Rusku i v Americe bìž ely na plné obrátky a chrlily tisíce United States steadily increased, and production figures tankù. V této situaci stáli Nìmci pøed otázkou, jak se s tímto attained were in the thousands. -

Soviet Tank Development During the Second World War Jeremy Paugh Concordia University - Portland, [email protected]
Concordia University - Portland CU Commons Undergraduate Theses Spring 2019 Steel Monsters: Soviet Tank Development during the Second World War Jeremy Paugh Concordia University - Portland, [email protected] Follow this and additional works at: https://commons.cu-portland.edu/theses Part of the History Commons CU Commons Citation Paugh, Jeremy, "Steel Monsters: Soviet Tank Development during the Second World War" (2019). Undergraduate Theses. 185. https://commons.cu-portland.edu/theses/185 This Open Access Thesis is brought to you for free and open access by CU Commons. It has been accepted for inclusion in Undergraduate Theses by an authorized administrator of CU Commons. For more information, please contact [email protected]. HST 493- Steel Monsters: Soviet Armor Development During World War 2 A senior thesis submitted to The Department of History College of Arts & Sciences In partial fulfillment of the requirements for a Bachelor of Arts degree in History By: Jeremy Paugh Faculty Supervisor ______________________________________________ _____________ Dr. Joel Davis Date Department Chair _______________________________________________ _____________ Kimberly Knutsen Date Dean, College of Arts & Sciences ________________________________________________ _____________ Dr. Michael Thomas Date Provost _______________________________________________________ _____________ Michelle Cowing Date Concordia University Portland, Oregon May, 2018 1 Abstract: This thesis aims to explore the far-reaching effects of armored warfare and tank -

A Német Pz. IV-Es Jagdpanzer Vadászpáncélosok
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Repository of the Academy's Library 1. ábra. A német Pz IV-es Jagdpanzer vadászpáncélos egy kiállításon Schmidt László A német Pz. IV-es Jagdpanzer vadászpáncélosok zok az eredmények, amelyeket a rohamlövegekkel harckocsik okoztak, de az ellenállás addig még nem ismert felszerelt német alakulatok az 1939-41-ig terjedő szívóssága is. Aidőszakban az ellenséges páncélosokkal vívott har- Itt már számított, hogy mennyi idő alatt tehető tűzkésszé cokban elértek, valamint a német ipar törekvése arra, hogy egy löveg, vagy, hogy egy tüzelőállás változtatást milyen lehetőség szerint csak egyfajta páncélteknőt kelljen gyárta- gyorsan képes végrehajtani a kezelőszemélyzet. ni, együttesen vezetett ahhoz, hogy a Heereswaffenamt A német eszközök tekintetében a nehéz helyzeten javíta- (Hadsereg Fegyverzetügyi Hivatala) megbízást adjon a ni akaró, páncélvadásznak nevezett, de valójában csak Jagdpanzer IV-es páncélos kifejlesztésére. önjáróvá tett lövegek, a Pz.Jg.I., a Marder II., a Marder III. A háborús események 1939-től történő megindulásával – különösen a két utóbbi 75 mm-es lövegeikkel – már alkal- Európa lengyel, nyugat- és dél-európai hadszínterein a masak lettek volna a feladat ellátására, azonban felépítmé- német harckocsik tűzereje tökéletesen elegendőnek bizo- nyeik gyenge páncélzata a személyzet számára csak kézi- nyult. Az ellenséges páncélosok elleni harcban alkalmazott fegyverek és kisebb repeszek ellen nyújtott valamennyi vontatott, vagy járművekre szerelt lövegek is megfeleltek védelmet. az elvárásoknak. Ezeken a harctereken nem jelentett elvi- A harcot ezért inkább lesből, vagy mozgékonyságukat selhetetlen hátrányt, hogy a vontatott lövegek le- és felcsa- kihasználva kezdtek. Az ezekkel a lövegekkel felszerelt tolása idő- és munkaigényes volt. -

Mestrado Em Ciências Militares, Na Especialidade De Artilharia
ACADEMIA MILITAR DIRECÇÃO DE ENSINO Curso de Artilharia Mestrado em Ciências Militares, na Especialidade de Artilharia A Artilharia de Campanha na "BlitzKrieg". A organização e os meios de Artilharia de Campanha na "Guerra Relâmpago" na 2ª Guerra Mundial Autor: Asp. Al. Art. Helder Manuel G. S. Santiago Orientador: TCor. Art. Pedro Marquês de Sousa Lisboa, 29 de Julho de 2011 ACADEMIA MILITAR DIRECÇÃO DE ENSINO Curso de Artilharia Mestrado em Ciências Militares, na Especialidade de Artilharia A Artilharia de Campanha na "BlitzKrieg". A organização e os meios de Artilharia de Campanha na "Guerra Relâmpago" na 2ª Guerra Mundial Autor: Asp. Al. Art. Helder Manuel G. S. Santiago Orientador: TCor. Art. Pedro Marquês de Sousa Lisboa, 29 de Julho de 2011 “A Artilharia de Campanha na "BlitzKrieg". A organização e os meios de Artilharia de Campanha na "Guerra Relâmpago" na 2ª Guerra Mundial” Dedicatória Dedico este trabalho, impreterivelmente a todos os que com enorme paciência me encaminharam e me aconselharam na sua realização. Ao Tenente-Coronel Marquês de Sousa, para mim um fiel exemplo de Oficial a seguir, dedico este trabalho exaustivo. Dedico igualmente à Tatiana Fonseca por todo o apoio prestado, amor e carinho, ao meu pai e à minha mãe por todo o incentivo durante a realização e elaboração do trabalho. Asp Al Art Helder Silveira Santiago i “A Artilharia de Campanha na "BlitzKrieg". A organização e os meios de Artilharia de Campanha na "Guerra Relâmpago" na 2ª Guerra Mundial” Agradecimentos Agradeço a Deus tudo o que tenho hoje. Sei que é graças a Ele, que o meu caminho escuro e sombrio, se foi tornando mais claro, luminoso e menos sinuoso.