Télécharger L'article Complet Au Format
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Shell Repair in Anticalyptraea (Tentaculita) in the Late Silurian (Pridoli) of Baltica
Carnets de Géologie [Notebooks on Geology] - Letter 2012/01 (CG2012_L01) Shell repair in Anticalyptraea (Tentaculita) in the late Silurian (Pridoli) of Baltica 1 Olev VINN Abstract: Shell repair is common in the late Silurian (Pridoli) encrusting tentaculitoid tubeworm Anti- calyptraea calyptrata from Saaremaa, Estonia (Baltica), and is interpreted here as a result of failed predation. A. calyptrata has a shell repair frequency of 29 % (individuals with scars) with 17 speci- mens. There is probably an antipredatory adaptation, i.e. extremely thick vesicular walls, in the mor- phology of Silurian Anticalyptraea. The morphological and ecological evolution of Anticalyptraea could thus have been partially driven by predation. Key Words: Predation; shell repair; Tentaculita; Anticalyptraea; Pridoli; Silurian; Estonia. Citation: VINN O. (2012).- Shell repair in Anticalyptraea (Tentaculita) in the late Silurian (Pridoli) of Baltica.- Carnets de Géologie [Notebooks on Geology], Brest, Letter 2012/01 (CG2012_L01), p. 31- 37. Résumé : Réparation de la coquille chez Anticalyptraea (Tentaculita) dans le Silurien supé- rieur (Pridoli) du bouclier balte (Baltica).- La réparation de coquilles est habituelle chez Anticalyp- traea calyptrata, un vers tentaculitoïde encroûtant du Silurien supérieur (Pridoli) à Saaremaa, Estonie (bouclier balte), et est interprétée ici comme la conséquence d'une prédation qui aurait échoué. A. calyptrata a une fréquence de réparation de la coquille de 29% (individus présentant des cicatrices) pour 17 spécimens. Ceci est probablement une adaptation contre la prédation, c'est-à-dire la présence de parois vésiculaires et très épaisses, présentes dans la morphologie de l'Anticalyptraea du Silurien. L'évolution morphologique et écologique d'Anticalyptraea pourrait donc pour partie avoir été provoquée par la prédation. -
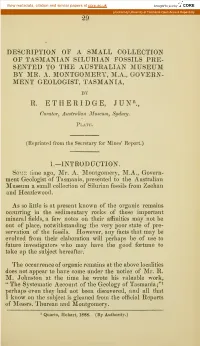
Papers and Proceedings of the Royal Society of Tasmania
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by University of Tasmania Open Access Repository •29 DESCRIPTION OF A SMALL COLLECTION OF TASMANIAN SILURIAN FOSSILS PRE- SENTED TO THE AUSTRALIAN MUSEUM BY MR. A. MONTGOMERY, M.A., GOVERN- MENT GEOLOGIST, TASMANIA, BY R. ETHERIDGE, JUN«, Curator^ Australian Museum^ Sydney. Plate. (Reprinted from the Secretary for Mines' Report.) 1.—INTRODUCTION. 80:*.:^ time ago, Mr. A. Montgomery, M.A., Govern- ment Geologist of Tasmania, presented to the Australian Museum a small collection of Silurian fossils from Zeehan and Heazlewood. As so little is at present known of the organic remains occurring in the sedimentary rocks of these important mineral fields, a few notes on their affinities may not be out of place, notwithstanding the very poor state of pre- servation of the fossils. However, any facts that may be evolved from their elaboration will perhaps be of use to future investigators who may have the good fortune to take up the subject hereafter. '^Fhe occurrence of organic remains at the above localities does not appear to have come under the notice of Mr. R. M. Johnston at the time he wrote his valuable work, " The Systematic Account of the Geology of Tasmania;"^ perhaps even they had not been discovered, and all that I know on the subject is gleaned from the official Reports of Messrs. Thureau and Montgomery. • Quarto, Hobart, 1888, (By Authority.) 30 2.—GEOLOGY. Mr. G. Thurean informs us^ tliat tlie rocks eontaininj^ the silver-lead ores at Zeehan belong to the Sikiriaii series, and consist of very murli contorted dark blue shales and grey sandstones. -

A New Species of Conchicolites (Cornulitida, Tentaculita) from the Wenlock of Gotland, Sweden
Estonian Journal of Earth Sciences, 2014, 63, 3, 181–185 doi: 10.3176/earth.2014.16 SHORT COMMUNICATION A new species of Conchicolites (Cornulitida, Tentaculita) from the Wenlock of Gotland, Sweden Olev Vinna, Emilia Jarochowskab and Axel Munneckeb a Department of Geology, University of Tartu, Ravila 14A, 50411 Tartu, Estonia; [email protected] b GeoZentrum Nordbayern, Fachgruppe Paläoumwelt, Universität Erlangen-Nürnberg, Loewenichstr. 28, 91054 Erlangen, Germany Received 2 June 2014, accepted 4 August 2014 Abstract. A new cornulitid species, Conchicolites crispisulcans sp. nov., is described from the Wenlock of Gotland, Sweden. The undulating edge of C. crispisulcans sp. nov. peristomes is unique among the species of Conchicolites. This undulating peristome edge may reflect the position of setae at the tube aperture. The presence of the undulating peristome edge supports the hypothesis that cornulitids had setae and were probably related to brachiopods. Key words: tubeworms, tentaculitoids, cornulitids, Silurian, Baltica. INTRODUCTION Four genera of cornulitids have been assigned to Cornulitidae: Cornulites Schlotheim, 1820, Conchicolites Cornulitids belong to encrusting tentaculitoid tubeworms Nicholson, 1872a, Cornulitella (Nicholson 1872b) and and are presumably ancestors of free-living tentaculitids Kolihaia Prantl, 1944 (Fisher 1962). The taxonomy (Vinn & Mutvei 2009). They have a stratigraphic range of Wenlock cornulitids of Gotland (Sweden) is poorly from the Middle Ordovician to the Late Carboniferous studied, mostly due to their minor stratigraphical (Vinn 2010). Cornulitid tubeworms are found only in importance. normal marine sediments (Vinn 2010), and in this respect The aim of the paper is to: (1) systematically they differ from their descendants, microconchids, which describe a new species of cornulitids from the Wenlock lived in waters of various salinities (e.g., Zatoń et al. -

A Middle Devonian Radiolarian Fauna from the Chotec Limestone (Eifelian) of the Prague Basin (Barrandian, Czech Republic)
A Middle Devonian radiolarian fauna from the Chotec Limestone (Eifelian) of the Prague Basin (Barrandian, Czech Republic) Andreas BRAUN Institute of Paleontology, University of Bonn, Nussallee 8, 53115 Bonn (Germany) [email protected] Petr BUDIL Cesky geologicky ustav, Klarov 3, 118 21 Praha 1 (Czech Republic) [email protected] Braun A. & Budil P. 1999. — A Middle Devonian radiolarian fauna from the Chotec Limestone (Eifelian) of the Prague Basin (Barrandian, Czech Republic), in De Wever P. & Caulet J.-P. (eds), InterRad VIII, Parls/Biervllle 8-13 septembre 1997, Geodiversitas 21 (4): 581-592. ABSTRACT The occurrence of radiolarian faunas in the upper part of the Chotec Limestone is discussed in terms of faunal composirion, systematics and geo logical implications. The most common entactinid species are rreated syste matically. The occurrence of radiolarians in large numbers in the rock KEYWORDS succession began approximately 2 meters below rhe onset of the black shale Radiolarians, Middle Devonian, sedimentation (Kacak Member). The abrupt sedimentological change, com upper Eifelian, monly viewed as an event therefore does not coincide with the faunal turno Barrandian, ver, leading to a radiolarian dominance well before the onset of black shale Chotec Limestone, Kacak event. deposition. RÉSUMÉ Une faune de radiolaires du Calcaire De Chotec (Devonien moyen, Eifelien supérieur) du bassin de Prague (Barrandien, République tchèque). La présence de faunes de radiolaires dans la partie supérieure du Calcaire de Chotec esr discutée en tenant compte de la composition faunique, de la sys tématique et des implications géologiques. Les espèces d'entactinés les plus communes sont traitées systématiquement. Les radiolaires sont présenrs en MOTS CLES grand nombre dans la succession sédimentaire environ 2 mètres au-dessous Radiolaires, Dévonien moyen, des premiers schisres noirs (Kacak Formation). -
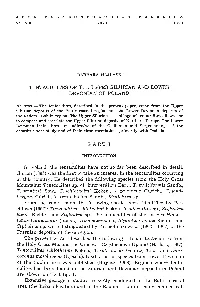
Tentaculites of the Upper Silurian and Lower Devonian of Poland
ACT A PAL A EON T 0 LOG ICA POLONICA Vol. XIX 1974 No. 4 BARBARA HAJI..ASZ TENTACULITES OF THE UPPER SILURIAN AND LOWER DEVONIAN OF POLAND Abstract. - The tentaculites, described in the present paper, come from the Upper Silurian deposits of the Baltic coastal region and the Lower Devonian deposits of the Radom-Lublin region. The Upper Silurian assemblage of tentaculites allows one to compare and correlate the Upper Silurian deposits of Northern Europe. The Lower Devonian tentaculites are' indicative of the Gedinnian and Siegenian age of the deposits under study and of their close correlations primarily with Podolia. PART I INTRODUCTION In Poland, the tentaculites have not so far been described in detail. Giirich (1895) was the first to take an interest in the tentaculites occurring in this country. He described the following species from the Holy Cross Mountains: Tentaculites sp. d. intermedium Barr., T. multiformis Sandb., T.ornatus? Sow., T. schlotheimi Koken., T. polonicus Gurich., T. sand bergeri Gurich, T. tenuicinctus Sandb., Styliolites sp. From the same region, the following species were identified by Paj chlowa (1957): Tentaculites schlotheimi Koken., Tentaculites sp., Styliolina laevis Richter and Styliolina sp. The tentaculites of the species Homoc tenus tenuicinctus (Roem.), Homoctenus sp., Styliolina laevis Richter and Styliolina sp. were distinguished by Koscielniakowska (1962-1967) in the Frasnian deposits of these region. The present writer described the following Eifelian tentaculites from the Holy Cross Mts and the Cracow-Cz~stochowaUpland (Hajlasz, 1967): Tentaculites schlotheimi Koken., T. subconicus Geinitz, T.sp., and Dicri coconus mosolovicus (Ljasch.). Next, a list of species from Lower Devonian of the Lublin area was published (Hajlasz, 1968). -

The Classic Upper Ordovician Stratigraphy and Paleontology of the Eastern Cincinnati Arch
International Geoscience Programme Project 653 Third Annual Meeting - Athens, Ohio, USA Field Trip Guidebook THE CLASSIC UPPER ORDOVICIAN STRATIGRAPHY AND PALEONTOLOGY OF THE EASTERN CINCINNATI ARCH Carlton E. Brett – Kyle R. Hartshorn – Allison L. Young – Cameron E. Schwalbach – Alycia L. Stigall International Geoscience Programme (IGCP) Project 653 Third Annual Meeting - 2018 - Athens, Ohio, USA Field Trip Guidebook THE CLASSIC UPPER ORDOVICIAN STRATIGRAPHY AND PALEONTOLOGY OF THE EASTERN CINCINNATI ARCH Carlton E. Brett Department of Geology, University of Cincinnati, 2624 Clifton Avenue, Cincinnati, Ohio 45221, USA ([email protected]) Kyle R. Hartshorn Dry Dredgers, 6473 Jayfield Drive, Hamilton, Ohio 45011, USA ([email protected]) Allison L. Young Department of Geology, University of Cincinnati, 2624 Clifton Avenue, Cincinnati, Ohio 45221, USA ([email protected]) Cameron E. Schwalbach 1099 Clough Pike, Batavia, OH 45103, USA ([email protected]) Alycia L. Stigall Department of Geological Sciences and OHIO Center for Ecology and Evolutionary Studies, Ohio University, 316 Clippinger Lab, Athens, Ohio 45701, USA ([email protected]) ACKNOWLEDGMENTS We extend our thanks to the many colleagues and students who have aided us in our field work, discussions, and publications, including Chris Aucoin, Ben Dattilo, Brad Deline, Rebecca Freeman, Steve Holland, T.J. Malgieri, Pat McLaughlin, Charles Mitchell, Tim Paton, Alex Ries, Tom Schramm, and James Thomka. No less gratitude goes to the many local collectors, amateurs in name only: Jack Kallmeyer, Tom Bantel, Don Bissett, Dan Cooper, Stephen Felton, Ron Fine, Rich Fuchs, Bill Heimbrock, Jerry Rush, and dozens of other Dry Dredgers. We are also grateful to David Meyer and Arnie Miller for insightful discussions of the Cincinnatian, and to Richard A. -

Marissa Pitter, “Unearthing the Unknown: the Fossils of The
1 Unearthing the Unknown: The Fossils of the Budden Collection Marissa Pitter Fig. 1. South Gallery Room. Hinckley, Maine: L.C. Bates Museum. Photo: John Meader Photography, ©2020. In the South Gallery Room of the L.C. Bates Museum sit eight fossil display cases. In the cramped sixth case rests a significant fossil, the Pertica quadrifaria—Maine’s state fossil which comes from the rocks of the world-renowned Trout Valley Formation. Alongside the rare fossilized remains of Pertica lies “The Budden Collection,” a group of seven fossils found in northern Maine and donated to the museum in 2013. A label sits below each fossil identifying the name of the specimen (and at times, its genus and species), the geologic period and 2 formation, and the location where the fossil was found. The exact descriptions that the L.C. Bates Museum provides on the labels is given in Table 1. Table 1. The Budden Collection Fossils Fossil Geologic Period Geologic Formation Location Favositid Coral (1) Silurian Hardwood Mountain Hobbstown Township, Maine Favositid Coral (2) Silurian Hardwood Mountain Hobbstown Township, Maine Horn coral with trace Devonian Seboomook Tomhegan Township, fossils Maine Rugose Coral Ordovician/Silurian Formation Unknown Shin Pond, Maine Brachiopod Devonian Seboomook Tomhegan Township, Mucrospirifer? Maine Brachiopods likely Devonian Formation Unknown Big Moose Township, steinkerns (fossilized Maine outlines) Leptostrophia and Devonian likely Seboomook Big Moose Township, Tentaculites Maine The question mark following “Mucrospirifer,” the unknown geologic formations, and the impreciseness of the geologic age of the rugose coral indicate there are some uncertainties among the museum’s identifications. The table also points to some commonalities among the fossil collection. -

Devonian Tentaculitoidea of the Malvinokaffric Realm of Brazil, Paraná Basin
Palaeontologia Electronica palaeo-electronica.org Devonian Tentaculitoidea of the Malvinokaffric Realm of Brazil, Paraná Basin Jeanninny Carla Comniskey and Renato Pirani Ghilardi ABSTRACT The Tentaculitoidea is represented by extinct invertebrates characterized by small, conic, carbonate shells of animals that inhabiting exclusively marine environ- ments. The tentaculitoids occur from the Ordovician to Devonian, with diversity peak- ing in the Middle Devonian. The Tentaculitoidea has three orders: Tentaculitida (benthic habit), Homoctenida, and Dacryoconarida (planktonic habit). In Brazil, the old- est tentaculitoids occur in strata of the early Silurian, with the genus Tentaculites. Spec- imens of the Dacryoconarida and Homoctenida orders were only found in the Lower Devonian strata. In this study, we conducted taxonomic analyses of specimens in col- lections from various research institutions, including samples used in the last system- atic study with this group, in mid-1991. The present study aims to review the systematic aspects of the tentaculitoids of the Devonian strata, Paraná basin, Brazil. Seven species of tentaculitoids were identified: two species previously described, Ten- taculites jaculus and Tentaculites crotalinus and five news species: Tentaculites kozlo- wskii, Tentaculites paranaensis, Uniconus ciguelii, Homoctenus katzerii, and Styliolina langenii. This is the first known occurrence of the genus Uniconus in Devonian strata from Brazil. The analyzed species of homoctenids and dacryoconarids are larger than those previously described in the specialized literature. This study demonstrated that the tentaculitoids of the Paraná Basin have a stratigraphic distribution from the end of the Pragian to the early Givetian. Jeanninny Carla Comniskey. Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Pós-Graduação em Biologia Comparada, Universidade de São Paulo-USP. -

The Paleoecology of Tentaculitids from the Silurian Arisaig Group, Nova Scotia, Canada
Wittmer, J. 2007. 20th Annual Keck Symposium; http://keck.wooster.edu/publications THE PALEOECOLOGY OF TENTACULITIDS FROM THE SILURIAN ARISAIG GROUP, NOVA SCOTIA, CANADA JACALYN WITTMER Beloit College Research Advisors: Hilary Lackey and Carl Mendelson INTRODUCTION Ten fossiliferous beds from the Arisaig Group (see Lackey et al., Table 1, this volume) contain The Silurian rocks of Nova Scotia record a abundant tentaculitids lying parallel to bedding diverse sedimentologic and paleontologic planes; vertically oriented shells occur rarely. history. The aim of this research is to These beds are composed predominantly of understand the paleoecology of portions shales and siltstones, and contain fossiliferous of the Arisaig Group by studying certain grainstone lenses that are interpreted to be paleoecological indicators associated with tempestites (Boucot et al., 1974). tentaculitids. Tentaculitid orientation can yield clues about the local depositional METHODS environment. This information may be augmented by taxonomic and petrographic Fieldwork was done in Arisaig, Nova Scotia, studies of tentaculitid-bearing beds, allowing between July 16 and August 8, 2006. Ten beds a better understanding of the Silurian marine that contained abundant tentaculitids (>15) and environment. were exposed along the shoreline were selected for detailed study from the following formations Tentaculitids are annulated, conical, shelled in the Silurian section at Arisaig: Ross Brook organisms of uncertain biologic affinities that Formation (4), Doctors Brook Formation (3), range from the Ordovician to the end of the Moydart Formation (3) (Fig. 1). Each bed was Devonian (Cornell et al., 2003). The bilateral measured and described using a Jacobs staff shells are typically compartmentalized by (outfitted with a protractor to account for dip), a transverse septa with conical embryonic meter stick, and a Brunton compass. -

Ascocerid Cephalopods from the Hirnantian?–Llandovery Stages of the Southern Paraná Basin (Paraguay, South America): first Record from High Paleolatitudes
Journal of Paleontology, page 1 of 11 Copyright © 2018, The Paleontological Society 0022-3360/18/0088-0906 doi: 10.1017/jpa.2018.59 Ascocerid cephalopods from the Hirnantian?–Llandovery stages of the southern Paraná Basin (Paraguay, South America): first record from high paleolatitudes M. Cichowolski,1,2 N.J. Uriz,3 M.B. Alfaro,3 and J.C. Galeano Inchausti4 1Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Departamento de Ciencias Geológicas, Área de Paleontología, Ciudad Universitaria, Pab. 2, C1428EGA, Buenos Aires, Argentina 〈[email protected]〉 2CONICET-Universidad de Buenos Aires, Instituto de Estudios Andinos “Don Pablo Groeber” (IDEAN), Buenos Aires, Argentina 3División Geología del Museo de La Plata, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Argentina. 〈[email protected]〉, 〈[email protected]〉 4Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones de Paraguay, Asunción, Paraguay 〈[email protected]〉 Abstract.—Ascocerid cephalopods are described for the first time from high paleolatitudes of Gondwana. Studied material was collected from the Hirnantian?–Llandovery strata of the Eusebio Ayala and Vargas Peña formations, Paraná Basin, southeastern Paraguay. The specimens are poorly preserved and were questionably assigned to the sub- family Probillingsitinae Flower, 1941, being undetermined at genus and species rank because diagnostic characters are not visible. A particular feature seen in our material is the presence of both parts of the ascocerid conch (the juve- nile or cyrtocone and the mature or brevicone) joined together, which is a very rare condition in the known paleonto- logical record. The specimens are interpreted as at a subadult stage of development because fully grown ascocerids would have lost the juvenile shell. -

Explanatory Notes for the Time–Space Diagram and Stratotectonic Elements Map of Tasmania
Tasmanian Geological Survey TASMANIA DEVELOPMENT Record 1995/01 AND RESOURCES Tasgo NGMA Project Sub-Project 1: Geological Synthesis Explanatory notes for the Time–Space Diagram and Stratotectonic Elements Map of Tasmania by D. B. Seymour and C. R. Calver Tasmanian Geological Survey Record 1995/01 1 CONTENTS INTRODUCTION ..................................................................................................................... 4 KING ISLAND.......................................................................................................................... 5 ?Mesoproterozoic ............................................................................................................... 5 Neoproterozoic orogenesis and granitoid intrusive rocks ................................................ 5 ?Neoproterozoic sequences ................................................................................................ 5 Early Carboniferous granitoid intrusive rocks ................................................................ 6 ROCKY CAPE ELEMENT....................................................................................................... 7 ?Mesoproterozoic: Rocky Cape Group ............................................................................... 7 Burnie and Oonah Formations ........................................................................................ 7 Smithton Synclinorium .................................................................................................... 7 Ahrberg Group ................................................................................................................. -

Taxonomic Revision and Paleoecology of Middle Devonian (Eifelian) Fishes of the Onondaga, Columbus and Delaware Limestones of the Eastern United States
Graduate Theses, Dissertations, and Problem Reports 2002 Taxonomic revision and paleoecology of Middle Devonian (Eifelian) fishes of the Onondaga, Columbus and Delaware limestones of the eastern United States Robert Lewis Martin West Virginia University Follow this and additional works at: https://researchrepository.wvu.edu/etd Recommended Citation Martin, Robert Lewis, "Taxonomic revision and paleoecology of Middle Devonian (Eifelian) fishes of the Onondaga, Columbus and Delaware limestones of the eastern United States" (2002). Graduate Theses, Dissertations, and Problem Reports. 1678. https://researchrepository.wvu.edu/etd/1678 This Dissertation is protected by copyright and/or related rights. It has been brought to you by the The Research Repository @ WVU with permission from the rights-holder(s). You are free to use this Dissertation in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you must obtain permission from the rights-holder(s) directly, unless additional rights are indicated by a Creative Commons license in the record and/ or on the work itself. This Dissertation has been accepted for inclusion in WVU Graduate Theses, Dissertations, and Problem Reports collection by an authorized administrator of The Research Repository @ WVU. For more information, please contact [email protected]. Taxonomic Revision and Paleoecology of Middle Devonian (Eifelian) Fishes of the Onondaga, Columbus and Delaware Limestones of the eastern United States. Robert L. Martin Dissertation submitted to the College of Arts and Sciences at West Virginia University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Geology Thomas Kammer, Ph.D.