Document D'objectifs
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Vos Élus De Provence-Alpes Agglomération
VOS ÉLUS DE PROVENCE-ALPES AGGLOMÉRATION Le bureau de Provence-Alpes agglomération Les autres élus par commune Archail Auzet Barles Barras Digne-les-Bains Patricia GRANET-BRUNELLO Présidente de Provence-Alpes Agglomération Delphine ISOARDI Christian ISOARD Marc JOUVES Rémy GRAVIÈRE Céline OGGÉRO-BAKRI Michel BLANC Mireille ISNARD Laurence ISNARD-AUBERT n Carole TOUSSAINT René VILLARD Conseillère communautaire Conseiller communautaire Conseiller communautaire Conseiller communautaire Conseillère communautaire Conseiller communautaire Conseillère communautaire Conseillère communautaire Maire de Digne-les-Bains er 1 vice-présidente déléguée aux Vice-président délégué Conseillère municipale Maire Conseiller municipal Maire Adjointe au maire Adjoint au maire Conseillére municipale Adjointe au maire relations avec les communes aux déchets à Archail à Barles Maire d’Estoublon Maire de Château-Arnoux-Saint-Auban Château-Arnoux-Saint-Auban Beaujeu Damien MOULARD Mireille PARIS Bernard PIERI Pierre SANCHEZ Conseiller communautaire Conseillère communautaire Conseiller communautaire Conseiller communautaire Adjoint au maire Conseillère municipale Adjoint au maire Adjoint au maire Gérard PAUL Sandrine COSSERAT Gilbert REINAUDO Marc BONDIL Gérard BENOÎT Philippe BERTRAND Laura LAQUET Florent CROZALS Vice-président délégué Vice-présidente déléguée à la Vice-président délégué Vice-président délégué aux Conseiller communautaire Conseiller communautaire Conseillère communautaire Conseiller communautaire à l’habitat et à l’urbanisme transition écologique -

3B2 to Ps Tmp 1..96
1975L0271 — EN — 14.04.1998 — 014.001 — 1 This document is meant purely as a documentation tool and the institutions do not assume any liability for its contents ►B COUNCIL DIRECTIVE of 28 April 1975 concerning the Community list of less-favoured farming areas within the meaning of Directive No 75/268/EEC (France) (75/271/EEC) (OJ L 128, 19.5.1975, p. 33) Amended by: Official Journal No page date ►M1 Council Directive 76/401/EEC of 6 April 1976 L 108 22 26.4.1976 ►M2 Council Directive 77/178/EEC of 14 February 1977 L 58 22 3.3.1977 ►M3 Commission Decision 77/3/EEC of 13 December 1976 L 3 12 5.1.1977 ►M4 Commission Decision 78/863/EEC of 9 October 1978 L 297 19 24.10.1978 ►M5 Commission Decision 81/408/EEC of 22 April 1981 L 156 56 15.6.1981 ►M6 Commission Decision 83/121/EEC of 16 March 1983 L 79 42 25.3.1983 ►M7 Commission Decision 84/266/EEC of 8 May 1984 L 131 46 17.5.1984 ►M8 Commission Decision 85/138/EEC of 29 January 1985 L 51 43 21.2.1985 ►M9 Commission Decision 85/599/EEC of 12 December 1985 L 373 46 31.12.1985 ►M10 Commission Decision 86/129/EEC of 11 March 1986 L 101 32 17.4.1986 ►M11 Commission Decision 87/348/EEC of 11 June 1987 L 189 35 9.7.1987 ►M12 Commission Decision 89/565/EEC of 16 October 1989 L 308 17 25.10.1989 ►M13 Commission Decision 93/238/EEC of 7 April 1993 L 108 134 1.5.1993 ►M14 Commission Decision 97/158/EC of 13 February 1997 L 60 64 1.3.1997 ►M15 Commission Decision 98/280/EC of 8 April 1998 L 127 29 29.4.1998 Corrected by: ►C1 Corrigendum, OJ L 288, 20.10.1976, p. -

Prefecture Des Alpes De Haute-Provence
Digne-les-Bains, le 8 mars 2017 Liste des personnes habilitées à établir des procurations de vote dans le département des Alpes-de-Haute-Provence Le vote par procuration permet à un électeur qui ne pourra pas voter personnellement le jour de l’élection de confier son vote à un électeur de son choix inscrit dans la même commune qui votera à sa place. Dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, les procurations peuvent être établies par : les Vices-présidentes du Tribunal d’Instance de Digne-les-Bains ; le directeur des services de greffe judiciaire de ce tribunal ; pour les communes de Colmars-les-Alpes, Allos, Beauvezer, Thorame- Basse, Thorame-Haute, Villars-Colmars, Saint-André-les-Alpes, Allons, Angles, Moriez, La-Mure-sur-Argens, Lambruisse : les officiers et agents de police judiciaire de la communauté de brigades de Colmars-les-Alpes ; pour les communes d’Annot, Braux, Le Fugeret, Méailles, Saint- Benoît, Ubraye, Vergons, d’Entrevaux, Castellet-les-Sausses, La Rochette, Saint-Pierre, Sausses, Val-de-Chalvagne : les officiers et agents de police judiciaire de la communauté de brigades d'Annot ; pour les communes de Barcelonnette, Condamine, Enchastrayes, Faucon de-Barcelonnette, Jausiers, Val d’Oronaye, Saint-Paul-sur- Ubaye, Saint-Pons, Les Thuiles, Uvernet-Fours : les officiers et agents de police judiciaire de la communauté de brigades de Barcelonnette ; pour les communes de Barrême, Blieux, Chaudon-Norante, Senez, Clumanc, Saint-Jacques, Saint-Lions, Tartonne, Beynes, Bras-d’Asse, Chateauredon, Mézel, Estoublon, Saint-Jeannet, -

Annex II. Summary Information 7. Other Products
Ref. Ares(2013)3642812 - 05/12/2013 Annex II. Summary information 7. Other products Country of origin Product Geographical indication proposed for protection Italy Sauces Aceto Balsamico di Modena Italy Sauces Aceto balsamico tradizionale di Modena Spain Saffron Azafrán de la Mancha France Essential oil Huile essentielle de lavande de Haute-Provence Spam Confectionary Jijona Greece Other products Κρόκος Κοζάνης / Krokos Kozanis (spices etc.) Cyprus Baker's wares Λουκούμι Γεροσκήπου / Loukoumi Geroskipou Greece Natural gums and Μαστίχα Χίου / Masticha Chiou resins Spain Baker's wares Turrón de Alicante 8 C 152/18 Į EN Į Official Journal of the European Union 6.7.2007 OTHER ACTS COMMISSION Publication of an application pursuant to Article 6(2) of Council Regulation (EC) No 510/2006 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs (2007¡C 152/08) This publication confers the right to object to the application pursuant to Article 7 of Council Regulation (EC) No 510/2006 ('). Statements of objection must reach the Commission within six months from the date of this publication. SUMMARY COUNCIL REGULATION (EC) No 510/2006 'ACETO BALSAMICO DI MODENA' EC No: rr/PGI/005/0430/18.11.2004 PDO ( ) PGI ( X ) This summary sets out the main elements of the product specification for information purposes. 1. Responsible department in the Member State: Name: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Address: Via XX Settembre, 20 1-00187 Roma Tel.: (39) 06 481 99 68 Fax: (39) 06 42 01 31 26 e-mail: [email protected] 2. Applicant group: Name: Consorzio Aceto Balsamico di Modena Soc. -

Provence Alpes Sommaire
Communauté d’agglomération PROVENCE ALPES SOMMAIRE Entrepreneuriat et potentiel 7 ÉCONOMIQUE Édito 3 LE TOURISME, 10 un acteur clé l’économie locale PROVENCE ALPES 4 AGGLOMÉRATION ATOUTS ET SPÉCIFICITÉS 12 du territoire Une population Un territoire 5 QUI SE STABILISE 14 NUMÉRIQUE Contact Agence Les projets de Développement UN SECTEUR TERTIAIRE ÉCONOMIQUES ET TOURISTIQUES des Alpes non marchand prépondérant 6 15 DU TERRITOIRE de Haute-Provence [email protected] +33 (0)4 92 31 57 29 Ressources documentaires Population : Insee, Recensement de la population 2017 Offre touristique : AD04, APIDAE, OTSI, Atout France, Plate- Données thermalisme : Établissement thermal de Digne-les-Bains Emploi : CCI04, Insee, CLAP 2017 forme Class, 2018 Données remontées mécaniques : DSF, 2017 Transmission d’entreprise : Enquête auprès des entreprises du Fréquentation touristique : AD04, FVT Orange, 2017 Accès internet et couverture réseau mobile 3G : France Très territoire réalisée en septembre 2017, CCI04 Emploi touristique : CRT PACA - JLJECO - base COMETE, 2015 Haut Débit, 2018 / ARCEP, 2018 Agriculture : Agreste, recensements agricoles 2010 Consommation touristique : AD04, CRT PACA, Enquête régionale Les entreprises et le numérique : Enquête au 1er trimestre 2017 Ressources forestières : Observatoire régional de la forêt méditerranéenne auprès des clientèles touristiques 2010/2011/ AD04, FVT, 2017 auprès de entreprises implantées dans une commune de PAA, CCI04 Ce document a été réalisé avec le concours financier de l’Etat, la Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur. -
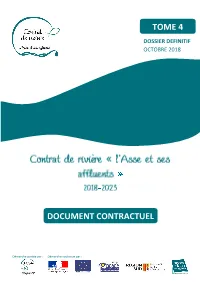
Tome 4 Document Contractuel
TOME 4 DOSSIER DEFINITIF OCTOBRE 2018 DOCUMENT CONTRACTUEL Démarche portée par : Démarche soutenue par : Composition du Dossier Le présent projet de Contrat de Rivière « l’Asse et ses affluents » est présenté par le Syndicat Mixte De Défense de Berges de l’Asse (SMDBA), structure animatrice de la démarche. Il est composé de 4 tomes : Tome 1 : Document technique Contexte et motivation de la démarche Etat des lieux du bassin versant Objectifs à atteindre et problématiques à résoudre sur le bassin Stratégie du Contrat (objectifs et contenu) Contribution du Contrat aux SDAGEs Mise en œuvre, animation et suivi du Contrat Tome 2 : Cahier des fiches actions Récapitulatif des actions par volet Fiches actions par volet Tome 3 : Document de synthèse Etapes de la construction Acteurs impliqués Diagnostic du territoire, enjeux et objectifs Synthèse du programme d’actions Tome 4 : Document contractuel Contenu du Contrat Engagements des partenaires Contrôle, révision et résiliation Signatures des maîtres d’ouvrage et des financeurs Rédaction : L’équipe technique du Syndicat Mixte de Défense des Berges de l’Asse (SMDBA) : Amandine ALONZO (chargée de missions rivière) Crédits photo : Amandine Alonzo Contrat de Rivière « l’Asse et ses affluents » 2018-2023 – Tome 4 – Document contractuel I SOMMAIRE TITRE 1 – CONTENU DU CONTRAT DE RIVIERE .......................................................... 1 Article 1 - Périmètre du Contrat de Rivière ................................................................................ 1 Article 2 - Durée -

Hameau Du Poil Senez
rando-alpes-haute-provence.fr Propulsé par geotrek.fr Hameau du Poil Senez LE POIL (RM CD04) Cette jolie randonnée permet de Informations pratiques découvrir, au coeur d'un environnement Pratique : Randonnée pédestre préservé, les chemins qui reliaient entre eux les dizaines de villages et de Durée : 3 h 30 hameaux encore habités il y a moins Longueur : 11.6 km d'un siècle. Aujourd'hui désertés, ils ne sont plus troublés que par le son clair Dénivelé positif : 542 m de l'eau des fontaines qui apporte un Difculté : Facile appréciable réconfort aux promeneurs. Depuis le départ, l'itinéraire rejoint l'ancienne Type : Boucle route d'accès au village du Poil en passant par le gîte du Saule Mort, puis contourne le rocher du Thèmes : Balade en famille, Histoire et patrimoine, Hors des Chastelar contre lequel le hameau est bâti. Il sentiers battus croise au niveau du gué les anciens sentiers muletiers qui menaient vers les villages de Majastres et de Blieux. 1/6 26 sep. 2021 • Hameau du Poil Itinéraire Départ : Parking de Chabrejas, route de Majastres Arrivée : Parking de Chabrejas, route de Majastres Balisage : PR P - Parking de Chabrejas (1 017 m) - Depuis le parking prendre la route à droite sur environ 1 km ( ). 1 - - Quitter la route départementale et prendre à gauche la piste menant vers le gîte. Le dépasser puis continuer à monter jusqu'à un petit col. Redescendre à travers une forêt de hêtres, franchir un petit pont qui enjambe "Le Clovion" et faire encore 150 m. 2- Le Gué (1 031 m) - Prendre à gauche le chemin conduisant au village. -

Glider Accidents 1999 -2001
LA SECURITE DE L'AVIATION CIVILE LA SECURITE DE L'AVIATION Glider Accidents - BUREAU D'ENQUETES ET D'ANALYSES POUR D'ENQUETES ET D'ANALYSES - BUREAU 1999 - 2001 DU LOGEMENT, TOURISME ET DE LA MER STUDY MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, Table of Contents GLOSSARY______________________________________________________ 4 CONTEXT _______________________________________________________ 5 1 - PRESENTATION OF ACCIDENTS _________________________________ 6 1.1 Statistics___________________________________________________________ 6 1.2 Events Studied______________________________________________________ 7 1.2.1 In-flight loss of control ________________________________________ 8 1.2.2 Collision with obstacle/terrain __________________________________ 8 1.2.3 Missed landing / takeoff ______________________________________ 9 1.2.4 Mid-air collisions ____________________________________________ 9 1.3 Additional Information _______________________________________________ 9 1.3.1 Information on pilots ________________________________________ 10 1.3.2 Distribution of accidents _____________________________________ 12 2 - ANALYSIS AND CAUSAL FACTORS _____________________________ 16 2.1 Failings Occurring during Flight Preparation ____________________________ 16 2.2 Decision Making ___________________________________________________ 16 2.3 Representation of the Situation, Evaluation of Meteorological Conditions____ 17 2.4 Lack of Vigilance ___________________________________________________ 18 2.5 Fatigue ___________________________________________________________ -

Recueil Des Actes Administratifs
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 1ère quinzaine de décembre 2018 2018-114 Parution le lundi 17 décembre 2018 PRÉFECTURE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 2018-114 1ère quinzaine de décembre 2018 SOMMAIRE La version intégrale de ce recueil des actes administratifs est en ligne sur le site Internet de la Préfecture : www alpes-de-haute-provence gouv fr, rubrique « Nos Publications » PREFECTURE Direction des services du cabinet Arrêté préfectoral n02018-344-007 du 10 décembre 2018 portant approbation du plan départemental de prévention et de gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid Pg 1 Arrêté préfectoral n02018-348-004 du 14 décembre 2018 accordant la médaille d'honneur agricole à l'occasion de la promotion du 1er janvier 2019 Pg 3 Arrêté préfectoral n02018-348-005 du 14 décembre 2018 accordant la médaille d'honneur régionale, départementale et communale à l'occasion de la promotion du 1er janvier 2019Pg 7 Direction de la Citoyenneté et de la légalité Bureau des Affaires Juridiques et du droit de l'Environnement Arrêté préfectoral n02018-320-004 du 16 novembre 2018 portant modification de la Commission de Suivi de Site (CSS) dans le cadre du fonctionnement des établissements Géosel-Géométhane situés à Manosque Pg 15 Bureau des Collectivités Territoriales et des Elections Arrêté préfectoral n02018-341-001 du 7 décembre 2018 portant habilitations à la publication des annonces judiciaires et légales pour l'année 2019 Pg 22 Arrêté préfectoral n02018-341-002 du 7 décembre 2018 portant modification -

Trois Asses Alpes-De-Haute-Provence 14
Barrême, Beynes, Blieux, Chaudon-Norante, Clumanc, Estoublon, Majastres, Moriez, Saint-Jacques, Saint-Jurs, FICHE Saint-Lions, Senez, Tartonne Trois Asses Alpes-de-Haute-Provence 14 Forêt domaniale des trois Asses Caractéristiques Occupation du sol Forêts <1% <1% Duyes-Bléone Milieux à végétation arbustive et/ou herbacée Haut Verdon Espaces ouverts, Photographie : L. Micas, ONF 5% sans ou avec peu de végétation 14% Barrême Territoires Valensole agricoles 22% Moyen Verdon Territoires artificialisés Haut Esteron 59% Surfaces en eaux > Surface boisée de production : 20 310 ha. > Surface totale : 49 690 ha. > Taux de boisement : 41 %. > Taux de boisement régional : 35 %. (> Source 1) (> Source 2) (> Source 3) L'espace forestier à dires d'acteurs > Rôle de production faible pouvant être légèrement accru pour le bois d'industrie et de chauffage. > Accessibilité et conditions d'exploitation relativement bonnes en forêt publique, difficiles en forêt privée. > Forte activité sylvopastorale. > Rôle social et environnemental existant mais pas dominant. > Très faible risque d'incendie, toutefois des besoins en équipements supplémentaires existent et surtout des besoins d'entretien du dispositif actuel. > Stabilisation de la déprise agricole. (> Sources 2 et 17) Occupation du sol et espaces boisés Types d'espaces > Espaces boisés > Autres espaces Forêts de conifères Territoires artificialisés Limites communales Territoires agricoles Forêts de feuillus Limites des espaces forestiers Milieux semi-naturels Forêts mélangées Maquis/Garrigues Communes principales -

Atlas Des Hébergements Touristiques
Atlas des hébergements touristiques 2015 Forcalquier - Campagne St St Lazare Campagne La La 1 www.alpes-haute-provence.com Sommaire 1. Les hébergements touristiques dans les Alpes de Haute-Provence 1.1. Taux de fonction touristique par commune ........................................................................................................................................................ page 4 1.2. Répartition de la capacité d’accueil des Alpes de Haute-Provence (hébergement marchand et résidences secondaires) .......................... page 5 2. Les hébergements marchands dans les Alpes de Haute-Provence 2.1. L’hôtellerie ............................................................................................................................................................................................................. page 7 2.2.L’hôtellerie de plein air ....................................................................................................................................................................................... page 14 2.3.Les résidences de tourisme et résidences hôtelières ......................................................................................................................................... page 23 2.4.Les hébergements collectifs ................................................................................................................................................................................ page 24 2.5.Les meublés labellisés ........................................................................................................................................................................................ -

DISCOVERY BOOKLET VERDON NATURAL REGIONAL PARK BOOKLET DISCOVERY BOOKLET DISCOVERY 30 50 40 34 25 48 45 49 10 47 13 16 21 12 14 6 8 4 Carbon Footprint
VERDON NATURAL REGIONAL PARK DISCOVERY BOOKLET DISCOVERY BOOKLET DISCOVERY Welcome to the Verdon Natural Regional Park The story of the Verdon starts with a river which rises in the southern Alps at an altitude of around 3,000 m to where it meets the Durance, covering SOMMAIRE the 165 km which will take it from being an Alpine torrent to a powerful river. Half-way along its course, as it goes through the Gorges, the Verdon carves its way through its meanders, using 4 Life-sized nature the slightest faults of the Pre-Alpine limestone mountains. Major development projects have 6 The Verdon's precious water used the river's energy to regulate its flow by building dams. Water then becomes precious as 8 Meeting the Verdon and living there it is a source of energy and a reservoir of drinking 10 On the Verdon's trails water for the whole region. It is also the basis of leisure and relaxation activities. The alternating 12 The Verdon for all white waters, big lakes and Gorges are perfect for a number of different sports. 13 The Valeurs Parc brand Since 1997, the Verdon Natural Regional Park 14 Coming to the Verdon and getting around has joined up with the river's fate by uniting 46 municipalities of its catchment area and the Alpes- 16 THE VALENSOLE PLATEAU de-Haute-Provence and Var departments. The Park is first and foremost founded on a territorial 21 THE HILLS OF THE HAUT VAR project which has made it possible to enhance the exceptional character of its landscapes and offer its 25 THE BASSES GORGES inhabitants opportunities for a good life.