Annales Historiques De La Révolution Française
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
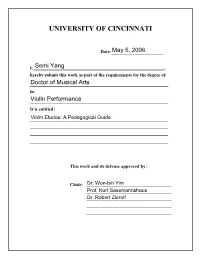
University of Cincinnati
UNIVERSITY OF CINCINNATI Date:___________________ I, _________________________________________________________, hereby submit this work as part of the requirements for the degree of: in: It is entitled: This work and its defense approved by: Chair: _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ VIOLIN ETUDES: A PEDAGOGICAL GUIDE A document submitted to the Division of Research and Advanced Studies of the University of Cincinnati in partial fulfillment of the requirements for the degree of DOCTOR OF MUSICAL ARTS in the Performance Studies Division of the College-Conservatory of Music 2006 by Semi Yang [email protected] B.M., Queensland Conservatorium of Music, Griffith University, Australia, 1995 M.M., Queensland Conservatorium of Music, Griffith University, Australia, 1999 Advisor: Dr. Won-bin Yim Reader: Prof. Kurt Sassmannshaus Reader: Dr. Robert Zierolf ABSTRACT Studying etudes is one of the most essential parts of learning a specific instrument. A violinist without a strong technical background meets many obstacles performing standard violin literature. This document provides detailed guidelines on how to practice selected etudes effectively from a pedagogical perspective, rather than a historical or analytical view. The criteria for selecting the individual etudes are for the goal of accomplishing certain technical aspects and how widely they are used in teaching; this is based partly on my experience and background. The body of the document is in three parts. The first consists of definitions, historical background, and introduces different of kinds of etudes. The second part describes etudes for strengthening technical aspects of violin playing with etudes by Rodolphe Kreutzer, Pierre Rode, and Jakob Dont. The third part explores concert etudes by Wieniawski and Paganini. -

A Bassoon in Stockholm ... R
A BassoonR in Stockholm ... FRANZ BERWALD septet & quartet ÉDOUARD DU PUY quintet BIS-2141 BIS-2141_f-b.indd 1 2015-09-11 13:03 BERWALD, Franz (1796–1868) Septet in B flat major (1817/28) 23'15 for clarinet, horn, bassoon, violin, viola, cello and double bass 1 I. Introduzione. Adagio – Allegro molto 8'12 2 II. Poco adagio – Prestissimo – Adagio 8'38 3 III. Finale. Allegro con spirito 6'20 Du PUY, Édouard (?1770–1822) Quintet in A minor for bassoon and strings 21'01 4 I. Allegro moderato 7'45 5 II. Andante sostenuto 5'08 6 III. Rondo. Allegro [composed by Carl Braun (1788–1835)] 8'06 BERWALD, Franz Quartet in E flat major (1819) 23'43 for piano, clarinet, horn and bassoon 7 I. Introduzione. Adagio – Allegro ma non troppo 11'17 8 II. Adagio 3'13 9 III. Finale. Allegro 9'10 TT: 68'53 2 Donna Agrell bassoon Lorenzo Coppola clarinet · Teunis van der Zwart horn Marc Destrubé & Franc Polman violins Yoshiko Morita viola · Albert Brüggen cello Robert Franenberg double bass Ronald Brautigam fortepiano Instrumentarium Bassoon: Grenser & Wiesner, Dresden, c. 1820 Clarinet: Agnès Guéroult, Paris 2000, after Heinrich Grenser (c.1800) Horn: ‘Cor Solo’, Couesnon, Paris, 1900 Violins: Anonymous Brescian violin, school of Rogieri, c.1685 (Marc Destrubé) Tilman Muthesius, Potsdam, 2012, after Matteo Goffriller (1725) (Franc Polman) Viola: Edward Panphilon, England 1669 Cello: Dan Sun, Beijing 2012. Double Bass: Vincenzo Panormo, London 1804 Piano: Lagrassa, Viennese school, c.1815 (courtesy of Edwin Beunk) 3 Frans Preumayr, a German Bassoon Virtuoso in Sweden Our recording contains chamber music composed in the early nineteenth century in Stockholm and performed by the well-known bassoon virtuoso, Frans Preumayr (1782–1853), who moved to Sweden from Germany at the beginning of the 1800s with his two brothers, also musicians. -

Nobel Week Stockholm 2018 – Detailed Information for the Media
Nobel Week Stockholm • 2018 Detailed information for the media December 5, 2018 Content The 2018 Nobel Laureates 3 The 2018 Nobel Week 6 Press Conferences 6 Nobel Lectures 8 Nobel Prize Concert 9 Nobel Day at the Nobel Museum 9 Nobel Week Dialogue – Water Matters 10 The Nobel Prize Award Ceremony in Stockholm 12 Presentation Speeches 12 Musical Interludes 13 This Year’s Floral Decorations, Concert Hall 13 The Nobel Banquet in Stockholm 14 Divertissement 16 This Year’s Floral Decorations, City Hall 20 Speeches of Thanks 20 End of the Evening 20 Nobel Diplomas and Medals 21 Previous Nobel Laureates 21 The Nobel Week Concludes 22 Follow the Nobel Prize 24 The Nobel Prize Digital Channels 24 Nobelprize org 24 Broadcasts on SVT 25 International Distribution of the Programmes 25 The Nobel Museum and the Nobel Center 25 Historical Background 27 Preliminary Timetable for the 2018 Nobel Prize Award Ceremony 30 Seating Plan on the Stage, 2018 Nobel Prize Award Ceremony 32 Preliminary Time Schedule for the 2018 Nobel Banquet 34 Seating Plan for the 2018 Nobel Banquet, City Hall 35 Contact Details 36 the nobel prize 2 press MeMo 2018 The 2018 Nobel Laureates The 2018 Laureates are 12 in number, including Denis Mukwege and Nadia Murad, who have been awarded the Nobel Peace Prize Since 1901, the Nobel Prize has been awarded 590 times to 935 Laureates Because some have been awarded the prize twice, a total of 904 individuals and 24 organisations have received a Nobel Prize or the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel -
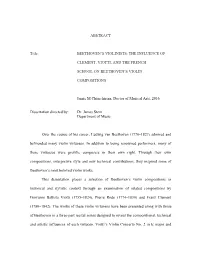
Dissertation FINAL 5 22
ABSTRACT Title: BEETHOVEN’S VIOLINISTS: THE INFLUENCE OF CLEMENT, VIOTTI, AND THE FRENCH SCHOOL ON BEETHOVEN’S VIOLIN COMPOSITIONS Jamie M Chimchirian, Doctor of Musical Arts, 2016 Dissertation directed by: Dr. James Stern Department of Music Over the course of his career, Ludwig van Beethoven (1770–1827) admired and befriended many violin virtuosos. In addition to being renowned performers, many of these virtuosos were prolific composers in their own right. Through their own compositions, interpretive style and new technical contributions, they inspired some of Beethoven’s most beloved violin works. This dissertation places a selection of Beethoven’s violin compositions in historical and stylistic context through an examination of related compositions by Giovanni Battista Viotti (1755–1824), Pierre Rode (1774–1830) and Franz Clement (1780–1842). The works of these violin virtuosos have been presented along with those of Beethoven in a three-part recital series designed to reveal the compositional, technical and artistic influences of each virtuoso. Viotti’s Violin Concerto No. 2 in E major and Rode’s Violin Concerto No. 10 in B minor serve as examples from the French violin concerto genre, and demonstrate compositional and stylistic idioms that affected Beethoven’s own compositions. Through their official dedications, Beethoven’s last two violin sonatas, the Op. 47, or Kreutzer, in A major, dedicated to Rodolphe Kreutzer, and Op. 96 in G major, dedicated to Pierre Rode, show the composer’s reverence for these great artistic personalities. Beethoven originally dedicated his Violin Concerto in D major, Op. 61, to Franz Clement. This work displays striking similarities to Clement’s own Violin Concerto in D major, which suggests that the two men had a close working relationship and great respect for one another. -

New 6-Page Template a 27/4/16 9:32 PM Page 1
573000bk Kummer:New 6-page template A 27/4/16 9:32 PM Page 1 Frédéric Kummer (1797–1879) und François Schubert (1808–1878) zu den bekanntesten Bühnenwerken des Opern- und führt im pianissimo wieder nach G-dur und zum Dreivier- Duos Concertants pour Violon et Violoncelle Ballettkomponisten Louis Joseph Ferdinand Hérold teltakt zurück – zunächst als ruhiges Moderato molto mit (1791–1833) und zu den beliebtesten Singspielen des 19. der Melodie im Violoncello, dann als abschließendes Friedrich August (alias Frédéric) Kummer wurde am 5. Unterricht bei seinem Vater und bei Antonio Rolla (1798- Jahrhunderts gehörte. Das Duo in der Tonart D-dur beginnt Allegro molto. August 1797 in Meiningen geboren. Sein Vater Friedrich 1837) wurde er in Paris von Charles Philippe Lafont (1781- mit einem Allegro, das neben einigen lieblichen Momenten Die Deux Duos de Concert pour Violon et Violoncelle August sen. (1770-1849) war zunächst Oboist in der 1839) ausgebildet, der seinerseits bei Rodolphe Kreutzer viel virtuoses Passagenwerk enthält. Von hier aus führt der op. 52 schließlich beginnen mit einem Souvenir de Fra Hofkapelle des Herzogs von Sachsen-Meiningen, und Pierre Rode studiert hatte. Da man ihn bisweilen mit Weg zu einem Andantino mit zwei Variationen, denen sich Diavolo, der wohl besten opéra-comique des Autorenteams übersiedelte aber mit seiner Familie bald nach der Geburt dem weitaus berühmteren Franz Schubert aus Wien ein Melancolico in Moll und im Dreivierteltakt anschließt. Daniel-François-Esprit Auber (1782–1871) und Eugène seines Sohnes nach Dresden und gab seinem Sprössling verwechselte, nahm er in Paris, wo er unter anderem mit Danach werden die ursprüngliche Tonart und der Scribe (1791–1861), dessen Namen wir üblicherweise im Frédéric den ersten Musikunterricht, bevor dieser von Justus Chopin Freundschaft schloss, den Namen »François« an. -

Henry Thoreau, from Which He Would Obtain Plutarch Materials Plus Quotes from Crates of Thebes and Simonides’S “Epigram on Anacreon” That He Would Recycle in a WEEK.)
HDT WHAT? INDEX 1814 1814 EVENTS OF 1813 General Events of 1814 SPRING JANUARY FEBRUARY MARCH SUMMER APRIL MAY JUNE FALL JULY AUGUST SEPTEMBER WINTER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER Following the death of Jesus Christ there was a period of readjustment that lasted for approximately one million years. –Kurt Vonnegut, THE SIRENS OF TITAN THE NEW-ENGLAND ALMANACK FOR 1814. By Isaac Bickerstaff. Providence, Rhode Island: John Carter. THE NEW-ENGLAND ALMANACK FOR 1814. By Isaac Bickerstaff. Providence: John Carter. Sold also by George Wanton, Newport. 21-year-old Edward Hitchcock calculated and published a COUNTRY ALMANAC (recalculated and reissued each year to 1818). John Farmer’s “A Sketch of Amherst, New Hampshire” (2 COLL. MASS. HIST. SOC. II. BOSTON). Noah Webster, Esq. became a member of the Massachusetts General Court (he would serve also in 1815 and 1817). Carl Phillip Gottfried von Clausewitz was reinstated in the Prussian army. EVENTS OF 1815 HDT WHAT? INDEX 1814 1814 The 2d of 3 volumes of a revised critical edition of an old warhorse, ANTHOLOGIA GRAECA AD FIDEM CODICIS OLIM PALATINI NUNC PARISINI EX APOGRAPHO GOTHANO EDITA ..., prepared by Christian Friedrich Wilhelm Jacobs, appeared in Leipzig (the initial volume had appeared in 1813 and the final volume would appear in 1817). ANTHOLOGIA GRAECA (My working assumption, for which I have no evidence, is that this is likely to have been the unknown edition consulted by Henry Thoreau, from which he would obtain Plutarch materials plus quotes from Crates of Thebes and Simonides’s “Epigram -

Svenskt Musikhistoriskt Arkiv Bulletin 29
ISSN 0586-0709 SVENSKT MUSIKHISTORISKT ARKIV BULLETIN 29 Silhuetter ur det gustavianska musiklivet STOCKHOLM 1995 – 1 – INNEHÅLL: Silhuetter ur det gustavianska musiklivet Av Leif Jonsson SVENSKT MUSIKHISTORISKT ARKIV (SMA) Postadress: Box 16326 103 26 STOCKHOLM Besöksadress: Nybrokajen 13, Stockholm Expeditionstid: Vardagar 9-12, 13-15 Telefoner: Expedition 666 45 60 Arkivchef 666 45 62 Arkivavdelning 666 45 67 Bibliografiskt avdelning 666 45 63 Bildavdelning 666 45 66 Telefax: 666 45 65 SMA Bulletin nr 29, Juni 1995. Red. Peter Söderbäck – 2 – Silhuetter ur det gustavianska musiklivet en preliminär inventering av Leif Jonsson Ett antal silhuetter av sångare, musiker och dansare i 1780-talets Stockholm påträffades vid SMA:s inventering av Stockholms stadsarkiv i J. H. A. Flodmarks okatalogiserade arkiv (se SMA:s Bulletin 28). Dessa påminner om andra silhuetter från samma tidsperiod och musikmiljö som finns återgivna i ett par klassiska handböcker om den gustavianska epoken: Flodmark, Stenborgska skådebanorna (1893) och Personne, Svenska teatern (1– 2, 1913–14). Detta väckte min nyfikenhet och ledde till en inventering av andra silhuett- bestånd. Huvudparten av de silhuetter som jag därvid fann i olika bibliotek och arkiv tycktes vara tillkomna inom en relativt kort tidsrymd – främst 1780-talet.1 En ansenlig del av dessa visade sig också återge sångare, musiker och dansare knutna till Kungl. teatern och Stenborgs teater. Ett typiskt drag i sammanhanget är att kopior av en och samma silhuett ofta förekommer i skilda samlingar. Dessa är aldrig helt identiska men man kan ändå sluta sig till att de – i olika led – är kopierade från en enda ursprunglig silhuett. Flest bevarade sådana finns det enligt mina noteringar så långt av en speciell Bellmansilhuett (sju stycken) och en efter dansösen Giovanna Bassi (sex stycken). -

Bram Van Sambeek Swedish Chamber Orchestra Alexei Ogrintchouk
MOZART · DU PUY · WEBER MOZART • DU PUY BASSOON CONCERTOS WEBER Bram van Sambeek Swedish Chamber Orchestra Alexei Ogrintchouk BIS-2467 MOZART, Wolfgang Amadeus (1756—91) Bassoon Concerto in B flat major, K 191 (1774) (Bärenreiter) 17'30 1 I. Allegro 7'11 2 II. Andante ma Adagio 6'16 3 III. Rondo. Tempo di Menuetto 3'52 von WEBER, Carl Maria (1786—1826) Bassoon Concerto in F major, Op. 75 (1811/1822) (Vita Musica) 17'08 4 I. Allegro ma non troppo 8'04 5 II. Adagio 4'29 6 III. Rondo. Allegro 4'23 Du PUY, Édouard (c. 1770—1822) Bassoon Concerto in C minor (1812) World Première Recording 30'30 Autograph manuscript (‘Concerto pour le Basson’) at the National Library of Sweden Realisation, editing, score and parts: Marijn van Prooijen and Bram van Sambeek 7 I. Adagio non troppo — Allegro moderato 13'00 8 II. Adagio 6'58 9 III. Rondo. Allegretto 10'19 TT: 66'15 Bram van Sambeek bassoon Swedish Chamber Orchestra Alexei Ogrintchouk conductor 3 Mozart: Bassoon Concerto in B flat major We bassoonists consider Mozart’s bassoon concerto the absolute pinnacle of our repertoire. That is because Mozart is so famous and brilliant but also because his beautiful concerto features at almost any occasion in one’s career, whether it is an audition for an orchestral position or a final round for a competition. The com- position is very well-balanced, in accordance with the style of the period, but even so the first and third movements are extremely playful, with idiomatic jumps and staccato passages in the solo part and cheeky exchanges between the orchestra and the bassoon. -

Musikkultur Och Musiksmak I 1700-Talets Sverige Ett Bidrag Till Lyssnandets Historia
420 CHARLOTTA WOLFF Musikkultur och musiksmak i 1700-talets Sverige Ett bidrag till lyssnandets historia de tidigmoderna samhällena, där en stor del av befolkningen inte var läs- och skrivkunnig, spelade musik och sång en betydande roll i traderingen av kollektiva föreställningar, identiteter och begrepp. IUr ett kulturhistoriskt perspektiv kan ljuden och musiken betraktas som en del av de sociala praktiker och föreställningar som strukturerar vardagen. Hur vi upplever ljud och musik är inte heller någon historisk konstant, utan påverkas av det omgivande ljudlandskapet och samtida uppfattningar om hur oljud och välljud påverkar människan. Det är dock först under de senaste årtiondena som den sonora världen blivit föremål för mer systematisk kulturhistorisk forskning.1 1. Artikeln är producerad som en del av författarens arbete som forskare vid Finlands Akademi, som fnansierat projektet Comic Opera and Society in France and Northern Europe, ca. 1760–1790 (Helsingfors universitet 2013–2018, nr 273395). 1. Den kulturhistoriska forskningen om 1700-talets ljudlandskap lyfer bl.a. fram ljud och buller i en vardaglig, ofa urban kontext. Denna typ av ljudens kulturhistoria är besläktad med lukternas och andra störande sinnesintrycks historia. Exempelvis Emily Cockayne beskriver allehanda förargelser, stök och urbant tumult i 1700-talets Lon- don såsom skrikande försäljare och medelmåttiga gatumusikanter, skällande hundar, tjutande och bökande grisar, smuts, ojämna gator, trafkbuller, oljud från hantver- karbodar, tiggare, larmande nattsvirare och högljudda grannar. Det tidigmoderna ljudlandskapet har också analyserats i en senannalistisk studie av Jean-Pierre Gutton, som påpekat sambandet mellan en stark muntlig kultur och hörselsinnets och de ljudliga, icke-visuella signalernas betydelse. Utöver arbetets och stadens buller lyfer Gutton fram det kontrollerade och samhällsstrukturerande ljudet från kyrkklockor och religiös sång. -

Dokumenterat – Bulletin Från Musik- Och Teaterbiblioteket Nr 45/2013
DOKUMENTERAT 45 1 DOKUMENTERAT BULLETIN FRÅN MUSIK- OCH TEATERBIBLIOTEKET DOKUMENTERAT 45 2 Dokumenterat 45/2013 Utges av Musik- och teaterbiblioteket vid Statens musikverk Postadress: Box 16326, 103 26 Stockholm Besöksadress, låneexpedition: Torsgatan 19, Stockholm Telefon: Överbibliotekarie/arkivchef: 08-519 554 04 arkiv: 08-519 554 17 rariteter: 08-519 554 15 teater: 08-519 554 47 iSSn 1404-9899 Redaktörer: Inger Enquist ([email protected]) och Rikard Larsson ([email protected]) Omslagfoto: Lars-Gunnar Bodin Grafisk form: Jonas André http://statensmusikverk.se/musikochteaterbiblioteket/ DOKUMENTERAT 45 3 Innehåll Elektronmusikarkiv i Statens musikverks samlingar 4 Pär Johansson Marys koffert 17 Magnus Blomkvist Moderna Dansteaterns arkiv 25 Onna Heinonen Grétry and the Gustavian musical theatre 29 Alan Swanson Man tager vad man haver 50 – historien om 1600-talets teatrar i Sverige Virve Polsa Nyförvärv 2011-2012 64 – bestånd i arkiv, bibliotek och museer Inger Enquist DOKUMENTERAT 45 4 Elektronmusikarkiv i Statens musikverks samlingar Pär Johansson¹ i StatenS muSikverkS Samlingar finns arkiv av stort intresse för den som vill forska om Sveriges nutida konstmusik, och särskilt den elektro- akustiska musiken (EAM).2 Här ska jag behandla några av dessa arkiv, med tonvikt på Fylkingens och Elektronmusikstudion emS, vilkas betydelse för svensk elektronmusik knappast kan överskattas. Fylkingen är Sveriges viktigaste scen för både inhemsk och utländsk EAM, och bedriver en betydande skivutgivning. EMS har länge varit fristående från statliga radiostationer, musikhögskolor och universitet, vilket gör den unik ur ett internationellt perspektiv. Studion driver en internationell gästtonsättarverksamhet samt en populär kursverksamhet som erbjuder en alternativ väg in i musiklivet. Inte så få komponister har, precis som denna artikels författare, gått emS utbildningar och varit aktiva i Fylkingen för att senare bli invalda i Föreningen svenska tonsättare (fSt). -

Of the Royal Family Resided Mainly on the First Floor
4 of Kings •srmatio on Berna and evolu MIKAEL ALM & BRITT-INGER JOHANSSON (EDS.) Opuscula Historica Upsaliensia utges av Historiska institutionen vid Uppsala universitet och syftar till att sprida information om den forskning som bedrivs vid och i anslutning till institutionen. Huvudredaktör: Mikael Alm Redaktion: Josefin Englund, Jonas Lindström, Cristina Prytz och Patrik Winton. Löpande prenumeration tecknas genom skriftlig anmälan till Opuscula, Historiska institutionen, Box 628, 751 26 Uppsala, [email protected], http://www.hist.uu.se/opuscula/ Enstaka nummer kan beställas från Swedish Science Press, Box 118, 751 04 Uppsala, www.ssp.nu, [email protected], telefon 018/36 55 66, telefax 018/36 52 77 Scripts of Kingship Essays on Bernadotte and Dynastic Formation in an Age of Revolution MIKAEL ALM & BRITT-INGER JOHANSSON (EDS.) Distribution Swedish Science Press, Box 118, 751 04 Uppsala [email protected], www.ssp.nu Cover illustration: Pehr Krafft (the Younger), The Coronation of Charles XIVJohn in Stockholm 1818 (detail). Nationalmuseum. Photo: Nationalmuseum, Stockholm. © The authors Graphic design: Elina Antell Print: Reklam & katalogtryck AB, Uppsala 2008 ISSN 0284-8783 ISBN 978-91-977312-2-5 Editors' Preface The following nine essays emanate from the interdisciplinary project The Making of a Dynasty (Sw: En dynasti blir till. Medier, myter och makt kring Karl XIV Johan), financed by The Bank of Sweden Tercentenary Foundation and directed by Nils Ekedahl. The introduction by Solfrid Söderlind is written specifically for this book, and Torkel Janssons contribution is an elaborated version of a previously published artide. The remaining seven essays were all presented as conference papers at the European Social Science and History Conference (ESSHC) in Amsterdam in March 2006. -

The Fifteenth-Anniversary Season: the Glorious Violin July 14–August 5, 2017 David Finckel and Wu Han, Artistic Directors Experience the Soothing Melody STAY with US
The Fifteenth-Anniversary Season: The Glorious Violin July 14–August 5, 2017 David Finckel and Wu Han, Artistic Directors Experience the soothing melody STAY WITH US Spacious modern comfortable rooms, complimentary Wi-Fi, 24-hour room service, itness room and a large pool. Just two miles from Stanford. BOOK EVENT MEETING SPACE FOR 10 TO 700 GUESTS. CALL TO BOOK YOUR STAY TODAY: 650-857-0787 CABANAPALOALTO.COM DINE IN STYLE 4290 Bistro features creative dishes from our Executive Chef and Culinary Team. Our food is a fusion of Asian Flavors using French techniques while sourcing local ingredients. TRY OUR CHAMPAGNE SUNDAY BRUNCH RESERVATIONS: 650-628-0145 4290 EL CAMINO REAL PALO ALTO CALIFORNIA 94306 Music@Menlo The Glorious Violin the fifteenth-anniversary season July 14–August 5, 2017 DAVID FINCKEL AND WU HAN, ARTISTIC DIRECTORS Contents 2 Season Dedication 3 A Message from the Artistic Directors 4 Welcome from the Executive Director 4 Board, Administration, and Mission Statement 5 The Glorious Violin Program Overview 6 Essay: “Violinists: Old Time vs. Modern” by Henry Roth 10 Encounters I–V 13 Concert Programs I–VII Léon-Ernest Drivier (1878–1951). La joie de vivre, 1937. Trocadero, Paris, France. Photo credit: Archive 41 Carte Blanche Concerts I–V Timothy McCarthy/Art Resource, NY 60 Chamber Music Institute 62 Prelude Performances 69 Koret Young Performers Concerts 72 Master Classes 73 Café Conversations 74 The Visual Arts at Music@Menlo 75 Music@Menlo LIVE 76 2017–2018 Winter Series 78 Artist and Faculty Biographies 90 Internship Program 92 Glossary 96 Join Music@Menlo 98 Acknowledgments 103 Ticket and Performance Information 105 Map and Directions 106 Calendar www.musicatmenlo.org 1 2017 Season Dedication Music@Menlo’s ifteenth season is dedicated to the following individuals and organizations that share the festival’s vision and whose tremendous support continues to make the realization of Music@Menlo’s mission possible.