Chronique D'histoire Maritime
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Book Reviews
Book Reviews Tim Barrett. The Navy and the Na- background as it developed from the tion. Australia’s Maritime Power in British Royal Navy (RN). There are the 21st Century. Melbourne, AU: brief accounts of twentieth-century Melbourne University Press, naval conflicts —Jutland, the Battle www.mun.com.au, 2017. 89 pp., of the Atlantic, and the Coral Sea— notes index. AU $19.99, paper; ISBN and convincingly relates their impor- 978-0-522-87158-6. (E-book avail- tance to Australian naval power. The able) lessons he draws from these battles and other issues are that the RAN Vice-Admiral Tim Barrett, Chief of must focus on protecting Australia the Royal Australian Navy (RAN) through application of military force since 2014, has written a short (77 at the enemy. This encompasses five pages of text) book in which he posi- major points: projecting force at a tions the RAN within its historical distance (the Coral Sea battle); im- context, its work with other navies, posing great and unacceptable costs how the RAN fits in with Australia as on the adversary (Jutland); targeted a whole, and what the future holds. and decisive lethal force (the RN in Barrett states his basic thesis in the 1982 Falklands War and the US the very first paragraph: the RAN is a Navy [USN] in the first Persian Gulf national enterprise, part and parcel of war); agility through quick decision- Australian society, which supports, making (the Battle of Leyte Gulf in and must be supported by, the nation 1944); and the use of sea control (the as a whole. -

'The Admiralty War Staff and Its Influence on the Conduct of The
‘The Admiralty War Staff and its influence on the conduct of the naval between 1914 and 1918.’ Nicholas Duncan Black University College University of London. Ph.D. Thesis. 2005. UMI Number: U592637 All rights reserved INFORMATION TO ALL USERS The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. In the unlikely event that the author did not send a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if material had to be removed, a note will indicate the deletion. Dissertation Publishing UMI U592637 Published by ProQuest LLC 2013. Copyright in the Dissertation held by the Author. Microform Edition © ProQuest LLC. All rights reserved. This work is protected against unauthorized copying under Title 17, United States Code. ProQuest LLC 789 East Eisenhower Parkway P.O. Box 1346 Ann Arbor, Ml 48106-1346 CONTENTS Page Abstract 4 Acknowledgements 5 Abbreviations 6 Introduction 9 Chapter 1. 23 The Admiralty War Staff, 1912-1918. An analysis of the personnel. Chapter 2. 55 The establishment of the War Staff, and its work before the outbreak of war in August 1914. Chapter 3. 78 The Churchill-Battenberg Regime, August-October 1914. Chapter 4. 103 The Churchill-Fisher Regime, October 1914 - May 1915. Chapter 5. 130 The Balfour-Jackson Regime, May 1915 - November 1916. Figure 5.1: Range of battle outcomes based on differing uses of the 5BS and 3BCS 156 Chapter 6: 167 The Jellicoe Era, November 1916 - December 1917. Chapter 7. 206 The Geddes-Wemyss Regime, December 1917 - November 1918 Conclusion 226 Appendices 236 Appendix A. -

Jefferson Stereoptics & SADDY STEREOVIEW CONSIGNMENT AUCTIONS ($5.00)
Jefferson Stereoptics & SADDY STEREOVIEW CONSIGNMENT AUCTIONS ($5.00) John Saddy 787 Barclay Road London Ontario N6K 3H5 CANADA Tel: (519) 641-4431 Fax: (519) 641-0695 Website: https://www.saddyauctions.com E-mail: [email protected] AUCTION #16-2 Phone, mail, fax, and on-line auction with scanned images. CLOSING DATES: 9:00 p.m. Eastern Thursday, December 15, 2016 Lots 1 to 527 (Part 1) & Friday, December 16, 2016 Lots 528 to 1061 (Part 2) In the event of a computer crash or other calamity, this auction will close one week later. “BUYER’S PREMIUM CHARGES INCREASE TO 9%” TO ALL OUR STEREOVIEW BIDDERS: PLEASE NOTE THAT THERE’S AN INCREASE IN OUR “BUYER’S PREMIUM CHARGES; IT IS NOW 9%. (We will absorb Paypal charges.) The amount will be automatically added to the invoice. We thank you in advance for your understanding. Your business is very much appreciated. BIDDING RULES AND TERMS OF SALE TABLE OF CONTENTS 1. All lots sold to the highest bidder. This auction contains some lots which are less older formats such as View- 2. Minimum increments: Up to $100, $3., $101 or higher, $10. (Bids only Master, Tru-Vue and others. These lots are prefixed with “(VM)” so if they even dollars, no change.) come up in a list from the Search Engine, you’ll know by the prefix that they 3. Maximum Bids accepted, winning bidder pays no more than one are Not stereoview cards. There is a separate Table of Contents for them increment above 2nd highest bid. Ties go to earliest bidder. -

Friends of the Royal Naval Museum
friends of the Royal Naval Museum and HMS Victory Scuttlebutt The magazine of the National Museum of the Royal Navy (Portsmouth) and the Friends ISSUE 44 SPRING 2012 By subscription or £2 Scuttlebutt The magazine of the National Museum of the Royal Navy (Portsmouth) and the Friends CONTENTS Council of the Friends 4 Chairman’s Report (Peter Wykeham-Martin) 5 New Vice Chairman (John Scivier) 6 Treasurers Report (Roger Trise) 6 Prestigious BAFM Award for ‘Scuttlebutt’ (Roger Trise) 7 News from the National Museum of the Royal Navy (Graham Dobbin) 8 HMS Victory Change of Command (Rod Strathern) 9 Steam Pinnace 199 & London Boat Show (Martin Marks) 10 Lottery Bid Success 13 Alfred John West Cinematographer 15 Peter Hollins MBE, President 199 Group (Martin Marks) 17 Skills for the Future Project (Kiri Anderson) 18 New Museum Model Series – Part 1: HMS Vanguard (Mark Brady) 20 The National Museum of the Royal Navy: 100 Years of Naval Heritage 23 at Portsmouth Historic Dockyard (Campbell McMurray) The Royal Navy and Libya (Naval Staff) 28 The Navy Campaign – “We need a Navy” (Bethany Torvell) 31 The Story of Tactical Nuclear Weapons in the Royal Navy (John Coker) 32 The Falklands War Conference at the RNM – 19 May 2012 35 Thirtieth Anniversary of the Falklands Conflict (Ken Napier) 36 HMS Queen Elizabeth - Update on Progress (BAE Systems) 38 Lost CS Forester Manuscript Found (New CS Forester book) (John Roberts) 39 Museum Wreath Workshop 39 Geoff Hunt – Leading Marine Artist (Julian Thomas) 40 Book Reviews 40 AGM – 3 May 2012 (Executive Secretary) -

From the Early Settlements to Reconstruction
The Laird Rams: Warships in Transition 1862-1885 Submitted by Andrew Ramsey English, to the University of Exeter as a thesis for the degree of Doctor of Philosophy in Maritime History, April 2016. This thesis is available for Library use on the understanding that it is copyright material and that no quotation from the thesis may be published without proper acknowledgement. I certify that all material in this thesis which is not my own work has been identified and that no material has previously been submitted and approved for the award of a degree by this or any other University. (Signature) Andrew Ramsey English (signed electronically) 1 ABSTRACT The Laird rams, built from 1862-1865, reflected concepts of naval power in transition from the broadside of multiple guns, to the rotating turret with only a few very heavy pieces of ordnance. These two ironclads were experiments built around the two new offensive concepts for armoured warships at that time: the ram and the turret. These sister armourclads were a collection of innovative designs and compromises packed into smaller spaces. A result of the design leap forward was they suffered from too much, too soon, in too limited a hull area. The turret ships were designed and built rapidly for a Confederate Navy desperate for effective warships. As a result of this urgency, the pair of twin turreted armoured rams began as experimental warships and continued in that mode for the next thirty five years. They were armoured ships built in secrecy, then floated on the Mersey under the gaze of international scrutiny and suddenly purchased by Britain to avoid a war with the United States. -

In Peril on the Sea – Episode Eleven Chapter 3
In Peril on the Sea – Episode Eleven Chapter 3 CHRONICLE OF THE ROYAL CANADIAN NAVY 3 THE FIRST MONTHS OF WAR, 1939-1940 “Top hats being trampled:” The Volunteer Reserve mobilizes, 1939 The RCNVR mobilized well before Canada declared war on 10 September 1939 and most trained personnel were immediately sent to Halifax or Esquimalt. As recruiting began for wartime service, there were shortages of everything except men. Sub Lieutenant Jack Anderson, RCNVR, recalls the first months of the war at HMCS York, the RCNVR Division in Toronto: We had absolutely nothing, we started completely from scratch. We had no uniforms in stores, or any sort of equipment whatsoever, except for a few old Lee-Enfield rifles and the twelve-pounder gun. …… We asked about uniforms for the men and Ottawa said, “There won’t be any available until the spring of 1940.” I knew the contracts had been let to Tip Top Tailors in Toronto. So I went down and saw the general manager, whom I had known previously when I was at Eaton’s, and he made a special effort and said that when these 100 men were assembled in Toronto, send them down and he would personally kit them up with jumpers and trousers. I got a hundred pair of new black boots from Eaton’s. I got a hundred caps from Muir Cap Company, who also had received a contract to produce sailors’ caps. …… We found ourselves at the Division, completely trapped without any transportation. So, in discussion with the Captain and some of the other officers, we decided to hold a naval ball to raise funds. -
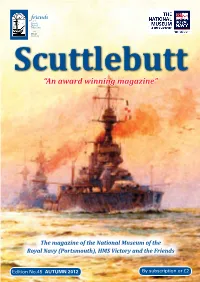
Scuttlebutt 45-Autm12.Pdf
friends of the Royal Naval Museum and HMS Victory Scuttlebutt “An award winning magazine” The magazine of the National Museum of the Royal Navy (Portsmouth), HMS Victory and the Friends Edition No.45 AUTUMN 2012 By subscription or £2 Scuttlebutt The magazine of the National Museum of the Royal Navy (Portsmouth), HMS Victory and the Friends The Friends of the Royal Naval Museum is a Registered Charity No. 269387 CONTENTS The National Museum of the Royal Navy and Council of the Friends..................................................................................................................4 HMS Victory, Portsmouth Chairman’s Report (Peter Wykeham-Martin)................................................................................5 is a Registered Charity No.1126283-1 Lord Judd (Roger Trise).................................................................................................................6 New President (Vice Admiral Sir Michael Moore KBE LVO).........................................................7 Treasurer’s Report (Roger Trise)...................................................................................................7 News from the National Museum of the Royal Navy (Graham Dobbin).................................10 The First Sea Lord hoists his flag in HMS Victory (Rod Strathern)..........................................13 Make a difference in the future: First Sea Lord Overview (Admiral Sir Mark Stanhope GCB OBE ADC).....................................14 remember the Museum in your will now AGM 2013 -

Sea Salts and Celluloid
S E A S A L T S ============= and C E L L U L O I D ============== by ALFRED J. WEST ============== CONTENTS 1 CONTENTS 2 CONTENTS CONTENTS ......................................................................................................................................................................... 3 PREFACE ............................................................................................................................................................................ 5 CHAPTER I. FIRST SNAPSHOTS. .............................................................................................................................. 6 CHAPTER II. A FLOATING EXHIBITION............................................................................................................... 11 CHAPTER III. THE FIRST FILMS........................................................................................................................... 14 CHAPTER IV. THE TRAINING OF THE BOY. ..................................................................................................... 19 CHAPTER V. THE OLD ORDER CHANGETH........................................................................................................ 22 CHAPTER VI. LIFE ON THE OCEAN WAVE. ...................................................................................................... 24 CHAPTER VII. THE CRUISE OF THE “OPHIR”. .................................................................................................. 30 CHAPTER VIII. TRAFALGAR CENTENARY. ........................................................................................................ -
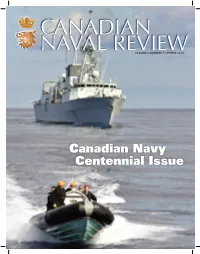
CNR) Is a “Not-For-Profit” the Content Diversity and High Quality “Feel” Presently Publication Depending Upon Its Subscription Base, the Found in the Review
VOLUME 6, NUMBER 1 (SPRING 2010) Canadian Navy Centennial Issue Our Sponsors and Supporters The Canadian Naval Review (CNR) is a “not-for-profit” the content diversity and high quality “feel” presently publication depending upon its subscription base, the found in the Review. Corporate and institutional support generosity of a small number of corporate sponsors, and a also makes it possible to put copies of CNR in the hands small sustaining grant from Dalhousie University’s Centre of Canadian political decision-makers. Without the help for Foreign Policy Studies for funding. In addition, CNR of all our supporters CNR would not be able to continue is helped in meeting its objectives through the support of the extensive outreach program established to further several professional and charitable organizations. Without public awareness of naval and maritime security issues in that corporate support CNR would not be able to maintain Canada. (www.hmcssackville-cnmt.ns.ca) (www.navyleague.ca) (www.gdcanada.com) The Canadian Nautical (www.thalesgroup.com) Research Society (www.cnrs-scrn.org) The Naval Officers’ (www.washingtonmarinegroup.com) Association of Canada (www.noac-national.ca) To receive more information about the corporate sponsorship plan or to find out more about supporting CNR in other ways, such as through subscription donations and bulk institutional subscriptions, please contact us at [email protected]. i CANADIAN NAVAL REVIEW VOLUME 6, NUMBER 1 (SPRING 2010) Our Sponsors and Supporters VOLUME 6, NUMBER 1 (SPRING 2010) Editorial Board Dr. David Black, Aldo Chircop, Lucia Fanning, Gary Garnett, Ken Hansen, Dr. Danford W. Middlemiss, Rear-Admiral (Ret’d) David Morse, Colonel (Ret’d) John Orr, Dr. -

Download (6Mb)
University of Warwick institutional repository: http://go.warwick.ac.uk/wrap A Thesis Submitted for the Degree of PhD at the University of Warwick http://go.warwick.ac.uk/wrap/63697 This thesis is made available online and is protected by original copyright. Please scroll down to view the document itself. Please refer to the repository record for this item for information to help you to cite it. Our policy information is available from the repository home page. Black Diamonds: Coal, the Royal Navy, and British Imperial Coaling Stations, circa 1870−1914. Steven Gray A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in History University of Warwick, Department of History March 2014 Table of Contents List of Figures 4 Acknowledgements 7 Declaration 8 Abstract 9 Abbreviations 10 Chapter 1: Introduction 11 Structure 18 Notes on sources 25 Chapter 2: Historiography 30 Historiography of the Royal Navy, c.1870−1914 31 Empire and the Sea 41 Global history 56 Conclusions 64 Chapter 3: The Rise of Coal Consciousness: 66 Imperial Philosophies, Knowledge, and Bureaucracy Development of Pro-Imperial Politics and Coal Consciousness 72 The Colonial Defence Committee 79 The Establishment of the Carnarvon Commission 83 The Recommendations of the Commission 87 The Last Hurrah of Gladstonian Liberalism 109 The Resurgence of the Coal and Imperial Defence Question 116 Legacy of a Coaling Consensus 136 1 Chapter 4: The Development of a Coaling Infrastructure 141 Sourcing Coal for the Navy at Home 144 Sourcing Coal for -

Canadian Ships by Call Sign for Radiotelegraph
Canadian Ships by Call Sign for Radiotelegraph There are errors in this list simply because it is impossible to make a list like this error free. If you note an error please contact me so that I can correct the error. I have no idea why one cannot make a list like this error free. This is a list of the two, three and four letter call signs Canada assigned to ships during the years radiotelegraph was in use. This is simply the list of those I have found and those I had to work with over the years. I have XJAG listed after radiotelegraph just to show that Canada is now assigning ship calls from those blocks of call signs. I have also listed the Orca, Kingston and CPF naval ships simply because I have them. They were created after radiotelegraph. Some of the Canadian naval ships were called Canadian but were actually commissioned as Royal Navy ships. I have included ships that were not registered in Canada but had Canadian crews. There are a few Canadian ships that I have been unable to identify. In other words this is a list of the ships I have found that were assigned these call signs over the years. This list is in alphabetical order. The two and three letter call signs were the first in use from 1904 until 1923. The International Telecommunication Union had assigned sufficient blocks of these call signs to Canada over the years so that Canada could have assigned a four character call sign to every vessel of every size registered in Canada.